Cri du cœur - Plage, je te hais
EL PAÍS (MADRID)
Soleil qui brûle, sable qui colle, crème solaire qui fuit, méduses qui piquent : pour ce journaliste du quotidien espagnol El País, la plage est le lieu le plus inhospitalier qui soit. Pourquoi s’y ruer tous les ans ? demande-t-il dans un billet à l’humour grinçant.
L’été dernier, j’étais sur une plage de rêve dans les Caraïbes. Sable blanc et fin, ciel d’un bleu éclatant, mer cristalline. Cette eau à la température parfaite léchait le rivage, et là-bas nous étions quasiment seuls.
“Je vais enfin aimer la plage”, voilà ce que je me suis dit. Et sur ces pensées, je me suis précipité pour plonger dans les vagues cubaines, prêt à profiter du paradis. Alors que je prenais du bon temps, j’ai senti comme un coup de fouet sur ma cheville gauche. Merde. Une méduse m’avait piqué. Un affreux choc électromagnétique. Ça ne va pas être possible.
Marins, pirates et cadavres de naufragés
Chaque été, tout le monde migre à la plage (un peu moins en 2020, à cause de la pandémie). Comme si la plage était le milieu naturel de l’être humain, comme si l’Éden n’avait pas tant été un jardin qu’un banc de sable dont Dieu nous aurait expulsés pour qu’on gagne notre vie à la sueur de notre front, loin de la mer. Et nous, nous cherchons constamment à y retourner, comme dans l’utérus maternel, le front toujours ruisselant mais cette fois en s’exposant au soleil.
La plage n’a pas toujours été une destination de rêve ; au contraire, elle était vue pour ce qu’elle est vraiment : un lieu sauvage et dangereux, uniquement fréquenté par les marins, les pêcheurs, les pirates et les cadavres bouffis que la mer recrache après les naufrages. Là-bas, il n’y avait rien à voir, comme le raconte l’historien Alain Corbin dans son livre Le Territoire du vide. L’Occident ou le désir du rivage [éd. Flammarion, 1990]. Ce n’est que plus tard que la bourgeoisie et l’aristocratie ont investi les plages – à Biarritz ou sur les littoraux britanniques – afin de se conformer aux principes du mouvement hygiéniste : bains d’eau, vent, nature. La clé d’une bonne santé.
Les artistes ont commencé à s’intéresser à cette délimitation entre deux mondes, à ce balcon romantique donnant sur l’infini, à cette frontière existentielle (moi, je suis angoissé par la plage, qui m’évoque l’éternité avec le va-et-vient incessant des vagues sur le rivage, des millions d’années après ma mort).
De Coco Chanel à la Barbie Malibu
Et la plage est ainsi devenue en vogue. Jusqu’à nos jours et aux clichés de celebrities qui posent ou sont épiées par les paparazzis sur les plages les plus exclusives, comme en témoignent les tabloïds en période estivale. Au fait : c’est Coco Chanel qui a popularisé le bronzage sur la Côte d’Azur française et en a fait un signe extérieur de glamour et de prestige. Ça a fait fureur à Paris.
Des années plus tard, Barbie Malibu était bronzée et avait des accessoires de plage. La “tanorexie”, ou bronzomanie, est désormais incarnée par des figures historiques hégéliennes comme le chanteur Julio Iglesias.
Autrefois, cette carnation était associée aux ouvriers, aux étrangers et à tous ceux qui travaillaient sous le cagnard, de préférence pauvres. Mais quand la plage est devenue populaire, elle a d’abord été l’apanage des riches, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le bronzage est bien vu et n’est pas stigmatisé. L’avènement du tourisme au milieu du XXe siècle a vu l’arrivée sur les plages des classes moyennes et défavorisées, tartinées de crème et vêtues de maillots (personne n’est beau à la plage, pas même les celebrities), jusqu’à cette année où les plages sont quadrillées pour freiner la pandémie. Mais c’est clair : la plage et l’être humain sont incompatibles, sans même parler de toute créature surgie des mers.
Nous voilà donc dans une société qui place la plage au centre de tout, qui en fait le summum du confort, du succès et du bien-être. Cependant, il n’aura échappé à personne que la plage est un lieu inconfortable où l’on est enduit de sable (qui s’allie très mal à la crème solaire) et où l’on endure des températures extrêmes.
Les dangers de la mer
C’est aussi un lieu inhospitalier : les dermatologues s’accordent à dire que prendre le soleil est un sport à risque, qui aboutit à des mélanomes, à des brûlures et à des insolations. N’oublions pas les files d’attente à la buvette et les salmonelloses.
Et je ne parle même pas des dangers de la mer : l’angoisse de la noyade, l’algue sortie tout droit d’un film qui s’enroule autour des jambes et nous entraîne vers le fond, le requin de Spielberg, le calamar géant, le kraken. Ou la méduse qui m’a piqué en 2019. Quand on m’emmène au large en bateau et que je plonge pour nager, je ressens une terreur digne de Lovecraft en imaginant les horreurs mystérieuses qui rôdent sous mes pieds blancs et innocents.
Ceux qui comme moi n’aiment pas la plage sont relégués au ban de la société. Souvent, et c’est d’ailleurs mon cas, ils vont à la plage uniquement pour ne pas être marginalisés et pour passer du temps avec leurs proches. Car s’il faut dire oui ou non à la plage, la réponse est toujours oui, puisque c’est un lieu jugé agréable, vertueux et convenable. Nous sommes les exceptions et nous souffrons en silence, comme pour des hémorroïdes.
En 2020, je passe mes vacances dans le nord de l’Espagne, dans ma région natale, les Asturies – idéale, au temps du coronavirus, pour celui qui n’aime pas la plage. Les jours ensoleillés y sont rares et certains affirment même que l’été y est le “jour” le plus beau de l’année.
Là-bas, sur la plage sauvage et accidentée de Llanes, je me suis rendu compte qu’il existe des plages plus accueillantes que d’autres pour les humains. Les plages urbaines, par exemple, sont un habitat humain : ce n’est pas pour rien qu’elles sont en ville. Ces plages sont très curieuses, car on peut montrer ses seins et se balader à demi-nus tout près des rues où s’enchaînent Zara, Bershka et Oysho, autant d’enseignes où il serait scandaleux d’en faire autant.
Laissons la plage aux monstres marins
Viennent ensuite les plages les plus typiques – celles de la Costa del Sol, dans le sud du pays. Elles sont complètement domestiquées, la mer est remplie d’urine, de sorte que les foules ringardes ne contrastent pas trop à côté des barres d’hôtels low cost du front de mer.
Mais les plages du nord sont différentes : la mer Cantabrique est violente et sombre, et elle affronte dans une singulière bataille les rochers escarpés. Les forêts débordent sur la plage et la plage déborde sur les forêts – tout y est elfique et mythologique.
En ces lieux où la nature est si puissante et sauvage, la présence humaine est comme un délit cosmique, avec nos vêtements fluo et nos engins en plastique, sans compter nos bourrelets et nos sandwichs à la viande panée emballés dans de l’alu. Et ce pot de yaourt vide dont on se sert comme cendrier – dans le meilleur des cas.
Que nous sommes laids et que nous sommes ringards par rapport au sublime kantien de la nature du Nord, dont l’évolution a suivi son propre chemin. Assez. Laissons la plage aux monstres marins et aux vents froids du nord-ouest.
Sergio C. Fanjul
Cet article a été publié dans sa version originale le 11/08/2020.
Source
El País
MADRID http://elpais.com
Covid-19 - Le reconfinement strict à Melbourne est-il un avant-goût de ce qui attend le reste du monde ?
THE NEW YORK TIMES (NEW YORK)
Confrontée à un rebond des contaminations, la deuxième ville d’Australie a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’imposer un confinement extrêmement strict accompagné d’un couvre-feu. Est-ce là ce qui attend l’ensemble de la planète ?
Melbourne, deuxième plus grande ville d’Australie, est confrontée à une flambée de l’épidémie de Covid-19 contre laquelle viennent d’être imposées des mesures de confinement parmi les plus drastiques du monde – un aperçu, peut-être, de ce que bien d’autres citadins pourraient avoir à vivre dans les semaines et les mois à venir.
Ce reconfinement vient doucher un premier succès : en juin, l’Australie pensait avoir vaincu le virus. Mais il y a eu une faille dans le programme de quarantaine pour les hôtels : des voyageurs de retour en Australie ont contaminé à Melbourne des agents de sécurité de leur hôtel, qui à leur tour ont transmis la maladie autour d’eux.
Et l’épidémie a continué sa progression même après que le port du masque a été rendu obligatoire dans la capitale de l’État de Victoria [le 22 juillet]. Aujourd’hui, alors que les autorités tentent d’enrayer la chaîne des contaminations, Melbourne se métamorphose sous l’effet d’une stricte application de mesures aux dispositions extrêmement détaillées. Un dédale réglementaire mêlant lourdes amendes pour les contrevenants et dérogations sibyllines – pour les couples ou les chantiers du bâtiment – a plongé les rues dans le silence et les habitants dans une infinie perplexité.
Comme un bombardement dont on ne voit pas la fin
Les propriétaires de restaurant s’interrogent sur les livraisons après 20 heures, heure à laquelle débute le couvre-feu instauré [le 2 août]. Les adolescents demandent si leur petit(e) ami(e) peut être considéré comme un partenaire essentiel. Les bénévoles des refuges pour animaux peuvent-ils sortir les chiens le soir ? Le personnel de ménage est-il essentiel chez les personnes atteintes de troubles mentaux ? Des individus ayant été testés peuvent-ils faire du sport à l’extérieur ?
Un confinement sanitaire n’est jamais facile, mais il devient plus perturbant et plus polémique encore quand les mesures évoluent pour faire face à une deuxième ou troisième flambée épidémique, avec des autorités et des populations épuisées. Alors qu’aucune victoire ne paraît pouvoir être proclamée contre ce virus, certains vivent les nouvelles vagues de restrictions comme un bombardement dont on ne voit pas la fin.
Dans certains endroits, l’évaluation des risques évolue d’un jour sur l’autre. À Hong Kong le mois dernier, les pouvoirs publics ont interdit la fréquentation des restaurants en journée avant de revenir sur leur décision dès le lendemain, face au tollé. Dans certaines villes, les écoles jouent les girouettes et alternent réouvertures et fermetures.
Là où l’épidémie a reculé avant de rebondir, l’avenir prend des airs de long chemin de croix. Du côté des politiques, on cherche la métaphore adéquate pour s’adresser aux populations. En Californie, le gouverneur Gavin Newsom compare ses décisions d’ouverture et de fermeture des lieux de travail à un “variateur d’intensité”. Dan Andrews, le Premier ministre de l’État de Victoria, aime à parler de “mise en veille” pour les secteurs économiques obligés de réduire temporairement leur main-d’œuvre, comme le bâtiment ou les abattoirs.
Insouciance persistante d’une partie de la population
Mais quelle que soit la métaphore employée, une chose est sûre : l’avenir est sombre. À Melbourne, ville de 5 millions d’habitants et capitale gastronomique et culturelle réputée, la pandémie a repris de plus belle, y compris après la mise en œuvre de mesures de “stade 3” début juillet qui instaurait des restrictions jusque-là inédites.
Les représentants des pouvoirs publics sont sidérés par l’insouciance persistante d’une partie de la population, ce qui suffit au virus pour prospérer et continuer de se propager. Les statistiques routières montrent ainsi que les habitants ont été plus nombreux à prendre la route en juillet qu’ils ne l’étaient en mars et en avril, lors du premier passage au stade 3 du confinement. Pire, près de 90 % des personnes atteintes du Covid-19 n’ont été ni testées ni isolées quand elles sont tombées malades, relevait le Premier ministre fin juillet. Et 53 % d’entre elles n’ont pas respecté de quarantaine dans l’attente des résultats de leur dépistage. “Cela signifie que des gens qui se sentent mal continuent de mener une vie normale”, constatait Daniel Andrews, qui a sonné l’alarme et rendu les masques obligatoires dès le lendemain, le 22 juillet.
Pour autant, les contaminations n’ont pas cessé d’augmenter, avec un pic à 753 nouveaux cas le 30 juillet. Depuis, une moyenne de 500 nouvelles infections est enregistrée chaque jour, et le bilan du Covid-19 dans l’État de Victoria atteignait 147 morts [le 3 août], après 11 décès supplémentaires dans la journée. S’ils restent bien moins préoccupants qu’aux États-Unis, ces chiffres ont motivé le passage au stade 4 du confinement (une stratégie de “choc et d’effroi” contre le virus, disent les autorités), et ce pour au moins six semaines. Il s’agit de frapper fort, et avec précision. Selon les artisans de la stratégie de lutte contre la pandémie en Australie, le virus ne peut disparaître que si plus de 70 % de la population respecte strictement les mesures de distanciation et les recommandations sanitaires.
C’est dans l’espoir d’atteindre ce seuil indispensable que sont mises en place ces nouvelles restrictions, qui selon le Premier ministre viennent chambouler le quotidien de 250 000 personnes de plus dans l’État de Victoria. Les commerces de détail ont ainsi fermé, les écoles repassent à l’enseignement à distance, les restaurants ne sont autorisés qu’à proposer la vente à emporter et la livraison, et les crèches sont réservées aux enfants des travailleurs essentiels.
Administration intrusive
Des restrictions déjà bien intégrées et comprises par la population. D’autres mesures en revanche, celles liées au couvre-feu et aux limitations d’effectifs dans certains secteurs, nécessitent davantage d’explications. Dan Andrews, un travailliste décrit par certains comme un homme peu commode et paternaliste, est devenu le père dont tous attendent des réponses. Avec ces mesures de confinement, le Premier ministre du Victoria se retrouve à la tête de l’administration la plus intrusive qu’ait connue l’Australie depuis l’époque où elle était une colonie pénitentiaire.
Lors d’une conférence de presse à Melbourne [le 4 août], les journalistes l’ont interrogé sur les heures où il est permis de sortir son chien (c’est apparemment possible après le couvre-feu mais à proximité de chez soi) et sur d’autres points qui sont source de perplexité. Adressant ses remerciements à ceux qui respectent ces nouvelles règles, et réprimandant les autres, le Premier ministre a annoncé que les personnes devant s’isoler n’étaient pas autorisées à avoir une pratique sportive à l’extérieur. Une campagne de contrôle en porte à porte au domicile de 3 000 malades du Covid-19 a recensé 800 absents : tous ont fait l’objet d’un signalement à la police du Victoria pour enquête. Les contrevenants seront dorénavant passibles d’une amende de 4 957 dollars australiens [un peu plus de 3 000 euros], a précisé Dan Andrews.
Mais la police a déjà affaire à des réfractaires. À quatre reprises au moins au cours de la semaine passée, des agents ont déclaré avoir dû fracturer la vitre de voitures pour en extraire les conducteurs qui refusaient de fournir leurs nom et adresse à un poste de contrôle. Des spécialistes du droit pénal s’interrogent sur la pertinence et l’efficacité de cette répression sévère. Mais dans leur majorité, les Melbourniens font le dos rond.
Peter Barnes, 56 ans, a coutume d’aller à pied faire ses courses et dit se féliciter du durcissement des règles, tout en reconnaissant qu’avec l’omniprésence de la puissance publique, visible à tous les coins de rue, il a de plus en plus l’impression d’évoluer dans 1984 de George Orwell. Ceux qui ne s’intéressent qu’à l’économie feraient bien de ne pas oublier qu’“on n’embauche pas un cadavre, lâche-t-il. C’est sûr, les perspectives de travail sont très mauvaises quand on est mort…
Damien Cave
Cet article a été publié dans sa version originale le 04/08/2020.
Source
The New York Times
NEW YORK http://www.nytimes.com/









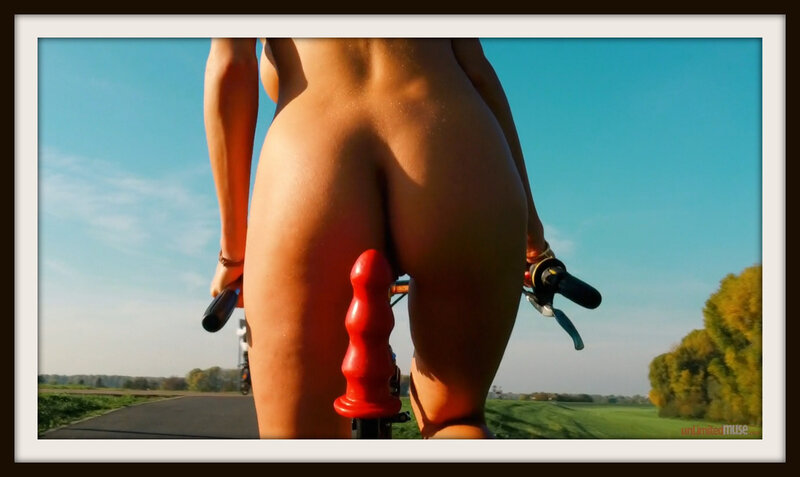







/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)