Par Claude Guibal, Le Caire, de notre correspondante — Libération

Hosni Mubarak à Orly le 28 janvier 1986. Photo Georges Bendrihem. AFP
Successeur de Sadate en 1981, le raïs aura réussi à maintenir l’Egypte au premier rang des nations arabes. Mais son obsession de la stabilité et de la sécurité l’a empêché de moderniser le pays.
Hosni Moubarak, le dictateur immobile
[L'ANCIEN PRÉSIDENT ÉGYPTIEN, HOSNI MOUBARAK EST MORT À 91 ANS. IL AVAIT RÉGNÉ SUR SON PAYS PRESQUE TRENTE ANS AVANT SA CHUTE, EN 2011, LORS DES «PRINTEMPS ARABES». NOUS REPUBLIONS UN PORTRAIT ÉCRIT À CETTE OCCASION.]
Dans les livres d’histoire sur l’antiquité égyptienne, il y a des noms que tout le monde connaît et qui servent de point de repères : Ramsès II, Akhénaton, Aménophis IV. Ils sont les François Ier, Louis XIV ou Napoléon d’une immense épopée. Et puis il y a de longues plages indéterminées dont aucun nom ni fait majeur ne se détache. Ce sont les «périodes intermédiaires».
Hosni Moubarak, qui a largement battu le record de longévité au pouvoir depuis l’instauration de la République, en 1954, aura été une longue période intermédiaire à lui tout seul. Malgré la durée de son règne quasi trentenaire, c’est un pharaon de transition qui s’est inscrit dans le sillage de ce qu’avait lancé son prédécesseur, Anouar el-Sadate, qu’il s’agisse de la paix avec Israël et de l’alliance américaine, ou de ses rapports avec les islamistes. Il réprima durement toute velléité politique des Frères musulmans tout en leur laissant la bride sur le cou sur le terrain social afin de donner une meilleure assise au régime.
Hosni Moubarak, paraît-il, ne manquait pas d’humour. Et d’aucuns assurent qu’il avait ri en entendant cette nokta, trait d’humour si typiquement égyptien : au premier jour de sa présidence, son chauffeur, hérité de ses prédécesseurs, lui demande quel chemin emprunter pour se rendre au palais présidentiel. «Que faisait Nasser ?» s’enquiert alors Moubarak. «Nasser prenait toujours à gauche», répond le chauffeur. «Que faisait Sadate ?» «Il prenait toujours à droite.» Hosni Moubarak réfléchit alors un moment, et dit : «Mets le clignotant un coup à gauche, un coup à droite. Et gare-toi.» L’immobilisme, de fait, est le meilleur moyen d’éviter les accidents.
Ni le charisme de Nasser, ni le bagout de Sadate
En vingt-neuf ans de règne - le plus long qu’ait connu l’Egypte depuis le sultan Mohamed Ali -, Hosni Moubarak a toujours fait de la prudence le moteur de ses décisions. Lucide, il sait qu’il n’a ni le charisme naturel de Nasser, ni le bagout d’un Sadate. Ce besogneux, méticuleux, réfléchi, lent, réticent aux grands chambardements, aime jouer les forces tranquilles. Certains, à commencer par les chefs d’Etat occidentaux, y voyaient la preuve d’une rassurante sagesse. Beaucoup, en Egypte, percevaient surtout dans cet immobilisme le moyen de verrouiller le pouvoir, en évitant que le pays ne s’engage dans la voie des réformes. Un modus operandi très souvent qualifié de «dictature molle». C’est enterrer un peu vite la prouesse principale d’Hosni Moubarak. Héritant à la mort de Sadate du plus grand Etat du monde arabe, le raïs aura réussi, plus d’un quart de siècle durant, à lui éviter guerres et désastres dans un Proche-Orient en ébullition permanente. Armé d’un double credo, obsession sécuritaire et stabilité à tout prix, il aura réussi le tour de force de ne jamais laisser son pays basculer dans le précipice. Mais il ne lui aura jamais donné, non plus, les moyens d’aborder, tête haute et bien armé, les défis du XXIe siècle et de la modernité.
Né le 4 mai 1928 dans le gouvernorat de Menoufeya, dans le delta du Nil, Mohamed Hosni Moubarak est un homme issu de la petite bourgeoisie rurale, ancrée dans le limon du fleuve. A 24 ans, alors que le Mouvement des officiers libres, menés par Gamal Abdel Nasser, renverse la monarchie, le jeune homme sort de l’académie militaire.
C’est dans cette Egypte bouleversée où les gradés remplacent avec fracas aristocrates et haute bourgeoisie que le futur raïs va grimper les échelons. Ses pairs décrivent alors un homme discret, presque falot, goûtant peu les intrigues, profondément dévoué à ses chefs, et parfaitement discipliné. Sonné, comme tous les Egyptiens, par la défaite de 1967, il est à la tête de l’armée de l’air lorsqu’éclate la guerre de 1973. Un sursaut permet à l’aviation égyptienne de redorer ses galons. Et à Hosni Moubarak de s’auréoler d’une gloire militaire qui sera un des piliers sur lesquels il appuiera sa légitimité, aussi bien parmi l’armée que dans la population.
L’exportation du «problème terroriste»
Quand le «héros de guerre» est appelé par Anouar el-Sadate à la vice-présidence, en 1975, il est pourtant inconnu de beaucoup. «Son aisance et son charisme ne se sont révélés qu’une fois au pouvoir. A l’époque, il se tenait plutôt en retrait, silencieux, presque insipide», confie un journaliste libanais qui le croisait alors dans l’ombre de Sadate. Le président égyptien s’appuie pourtant de plus en plus sur ce second qu’il envoie en mission à l’étranger. Dans les coulisses des accords de Camp David, en 1978, ou sous les ors des palais présidentiels du monde entier, Hosni Moubarak fait ses classes en diplomatie internationale. Il y excelle, se révélant capable d’entretenir les meilleures relations avec Washington comme avec Moscou.
Lorsque Sadate s’écroule, le 6 octobre 1981, sous les balles de soldats qui ont rejoint les rangs du jihad, c’est sans discussion que son vice-président le remplace à la tête d’une Egypte abasourdie. Un héritage empoisonné qu’il utilisera à sa manière, sans jamais opérer de choix radicaux et sans jamais se départir de son obsession sécuritaire.
Quand il la prend en main, l’Egypte est au banc du monde arabe pour avoir été le premier Etat arabe à signer la paix avec Israël. Le nouveau raïs doit gérer un pays rongé par la terreur. Il envoie les assassins de Sadate à la corde, et leurs zélotes en prison. Nombre d’entre eux y sont encore, jamais libérés bien qu’ils aient depuis longtemps purgé leur peine. Soucieux de se débarrasser des autres militants islamistes, l’Etat égyptien les encourage alors à suivre la voie du jihad ailleurs, en facilitant leur départ pour l’Afghanistan, où les moudjahidin combattent l’armée soviétique. C’est ainsi que l’Egypte de Hosni Moubarak, plutôt que de traiter à la source son «problème terroriste», va l’exporter, envoyant au loin tous ceux qui, comme Ayman el-Zawahiri, formeront vingt ans plus tard la tête pensante d’Al-Qaeda.
Pour ceux qui restent au pays, Moubarak choisit la méthode forte. La répression est brutale. Des milliers d’islamistes sont arrêtés. Dans le Saïd, au centre de l’Egypte, base arrière des islamistes armés, la police fait raser les champs de canne à sucre pour mettre à découvert les caches terroristes, arrête des familles entières, pratique l’intimidation et la torture. Une approche sanglante que lui reproche la communauté internationale et les associations des droits de l’homme. Des accusations qui blessent le raïs. Il en concevra de l’amertume. Des années plus tard, il notera, acerbe, que les Etats-Unis, autrefois si critiques envers lui, useront des mêmes méthodes dans leur lutte antiterroriste.
Un jeu ambigu avec les Frères musulmans
Afin d’isoler les terroristes, Hosni Moubarak décide d’afficher une certaine tolérance à l’égard de la confrérie des Frères musulmans - théoriquement interdite -, dans la mesure où elle affiche publiquement son refus de la violence. Les islamistes, sans pouvoir bénéficier d’une existence politique officielle, participent ainsi aux scrutins. Commence alors un jeu ambigu et dangereux entre le pouvoir et les Frères. Bien que très discret et mesuré sur sa propre pratique religieuse, Hosni Moubarak va laisser s’instaurer un islamisme de plus en plus présent au sein de la société égyptienne, multipliant les gages «islamiquement corrects», au point de laisser se transformer radicalement la société.
Aux jupes courtes des années 80, ont ainsi succédé les hijabs colorés, peu à peu supplantés par les voiles intégraux, les sombres niqabs. Mais face au terrorisme, le raïs ne transigera jamais. A chaque attentat, il fait front. Il croit être parvenu au comble de l’horreur en 1997, à Louxor, où plus de 60 vacanciers sont abattus par un commando des Gamaa al-Islamiya. Les touristes fuient le pays, l’Egypte est sous le choc. Moubarak ne vacille pas et traque sans merci les terroristes. La paix revient, durablement, pense-t-on alors. Jusqu’à 2003. Des attentats-suicides successifs frappent les lieux touristiques du Sinaï, Taba, Charm el-Cheikh. Des attaques auxquelles les services de sécurité vont répondre par une répression aveugle et mal ciblée, qui va faire de la péninsule désertique une zone quasi insurgée.
Obsédé par la sécurité, Hosni Moubarak a toujours refusé de lever l’état d’urgence instauré à la mort de Sadate, s’attirant là la haine de la société civile égyptienne. Justifiée aux pires moments de la lutte contre les islamistes, la loi martiale est aussi devenue par la suite un moyen d’étouffer toute contestation politique ou sociale. Une arme au service du pouvoir, permettant pêle-mêle l’interdiction des manifestations, la restriction des activités politiques ou la multiplication des arrestations sans charges.
Cet aveuglement à prendre en compte les aspirations de son peuple à la liberté lui aura coûté toute popularité ces dernières années. Car l’avènement des télévisions satellitaires et l’explosion d’Internet ont changé la donne. Longtemps terrorisés à l’idée de critiquer le régime, les Egyptiens se sont enhardis. Désespérés par la violente crise économique, le chômage, la corruption, le manque de libertés civiques, ils ont trouvé un écho à leurs revendications dans les cris du mouvement Kifaya («Ça suffit !») qui, en 2005, a fait tomber le tabou ultime en critiquant le Président et sa famille lors de manifestations dans les rues du Caire. Mais en vain : tout en concédant quelques réformes cosmétiques à l’aube de sa dernière réélection, en 2005, Hosni Moubarak n’a pas su prendre le tournant démocratique. Bien au contraire. Embastillant Ayman Nour, son principal concurrent à la présidentielle, dépêchant des milliers de policiers dans les rues pour contrer la moindre manifestation, multipliant les rafles et les arrestations sans charges, le raïs s’est aliéné, en quelques années, la quasi-totalité de la population. A l’exception des caciques du Parti national démocrate et des milieux d’affaires, qui ont accompagné l’ascension vers le pouvoir de son fils cadet, Gamal, un banquier ultralibéral présenté depuis plusieurs années comme son successeur.
Suzanne, épouse omniprésente au cœur des intrigues
Victime de plusieurs tentatives d’assassinats, dont une, à Addis-Abeba en 1995, à laquelle il ne réchappera que miraculeusement, Hosni Moubarak s’est en effet longtemps refusé à nommer un vice-président. Il ne s’y résoudra que ces derniers jours, sous la pression du soulèvement populaire, dans une tentative désespérée de ramener le calme.
Ces incertitudes sur sa succession, ajoutées à ses soucis de santé et aux multiples rumeurs de disparition, ont alimenté les spéculations toutes ces dernières années. Et entretenu autour lui un climat d’intrigue et de compétition dans lequel son épouse, Suzanne, joue un rôle influent. Femme de caractère, omniprésente sur les questions sociales, on lui prête, plus qu’à son mari, d’être à l’origine de la mise sur orbite politique de leur fils Gamal. En une poignée d’années, ce dernier s’est en effet hissé à la tête du parti au pouvoir, se plaçant en candidat naturel à la succession.
Cet héritage du pouvoir programmé n’est guère du goût des Egyptiens, qui n’ont jamais accordé le moindre crédit aux dénégations répétées d’Hosni Moubarak et de son fils, jurant qu’il n’y avait pas de pouvoir héréditaire en Egypte. Transparent en matière politique, Gamal Moubarak l’est beaucoup moins en économie. Son influence grandissante se signale alors par une forte inflexion libérale du régime, trop longtemps handicapé par les lourdeurs de l’économie soviétisée héritée de l’ère nassérienne. Mais ce changement ne s’est soldé que par un écart accru entre la bourgeoisie des affaires, engagée dans une course folle à l’argent, et le reste de la population, au bord de la misère.
Les relations particulières avec Israël
Hosni Moubarak, à qui on ne prête pourtant guère de goût pour le luxe ou l’ostentatoire, a vu son image d’homme intègre irrémédiablement salie par l’ambiance d’affairisme qui régnait autour de son dernier gouvernement d’avant la révolution, composé massivement de businessmen. Grèves ouvrières, hausse des prix délirante, scandales financiers, les dernières années du règne du raïs ont été plombées par une colère sociale sourde sur laquelle les Frères musulmans ont pu capitaliser. Une colère que rien ne vient adoucir, dans ce Proche-Orient en proie au chaos et aux chocs répétés entre islam et Occident.
C’est pourtant de ce domaine géopolitique que Moubarak tire ses plus grands mérites. Les accords de paix avec Israël, qui ont coûté la vie à son prédécesseur, ont beau être rejetés par la population, il saura s’y tenir, pragmatique et résolu. C’est ainsi qu’il parvient, en 1982, à récupérer le Sinaï et à devenir un acteur de premier plan de la donne israélo-palestinienne. Signataire de la paix, il a su s’imposer comme médiateur naturel dans la région et justifier longtemps auprès du Congrès américain le maintien de l’aide annuelle de 2,1 milliards que les Etats-Unis octroient à l’Egypte.
Car Moubarak a bien conscience que ce statut d’allié privilégié est la meilleure façon pour l’Egypte de rester parmi les grands. Concurrencée par l’Arabie Saoudite et par l’Iran, elle n’est plus la grande puissance incontournable qu’elle a été sous Nasser. Pour se maintenir dans la course, le raïs n’aura donc eu de cesse d’apparaître comme le seul leader arabe capable de soutenir fermement les Palestiniens tout en dialoguant avec Israël. Un travail d’équilibriste, jouant les bons élèves pour Washington au risque de mécontenter son propre peuple, qui préfère s’enflammer pour des Yasser Arafat ou des Saddam Hussein, plus emblématiques de la fierté arabe.
Avec Israël, ce voisin avec qui l’Egypte a signé la paix tout en refusant de normaliser les relations, Moubarak aura joué un ballet étonnant, fait d’entrechats et d’éloignements, sans jamais jouer la rupture. Il ne s’y rendra qu’une fois, en 1995, sommé par la Maison-Blanche d’assister aux funérailles de Yitzhak Rabin. Mais il multipliera les invitations et les sommets internationaux, qu’il aimait tenir dans sa ville fétiche de Charm el-Cheikh, symbole d’une Egypte qu’il a su propulser à la tête des destinations touristiques les plus prisées de la planète.
Ces rencontres ont été pour lui l’occasion de tisser des relations souvent chaleureuses avec ses homologues internationaux. Avec François Mitterrand ou Jacques Chirac, diplomates français et égyptiens parlent même de forte amitié, nourrie par son habileté à faire rire ses interlocuteurs par des imitations tordantes de ses pairs arabes. Parmi les principales sources de son ironie, le colonel Kadhafi ou Hafez el-Assad.

La une de Libération le 31 janvier 2011.
Auprès des leaders palestiniens, il tentera de jouer les parrains sévères, ne cachant pas son agacement envers Yasser Arafat, qu’il trouve ingérable. La prise de pouvoir du Hamas à Gaza, en 2007, va le mettre dans une position des plus inconfortables. Obligé de composer avec le gouvernement islamiste, il ne lui pardonnera jamais d’avoir fait exploser la frontière avec l’Egypte début 2007, permettant à des dizaines de milliers de Gazaouis de se ruer dans le Sinaï. Il n’oubliera jamais l’humiliation de ce fait accompli, devant lequel il aura pourtant su réagir avec une certaine habileté. Il n’en concevra que plus de colère encore envers les Frères musulmans, qu’il soupçonne de collusion avec le Hamas pour le déstabiliser et provoquer sa chute.
La corde sensible du patriotisme
En trente ans de pouvoir, l’homme Moubarak aura vécu dans une extrême discrétion. A la manière des dictateurs, il a fait afficher son image à tous les carrefours des grandes villes du pays. Et à chacun de ses anniversaires, les pages des journaux officiels étaient couvertes d’encarts louangeurs. Mais sa vie privée est demeurée un tabou qu’aucun journaliste égyptien n’a jamais osé briser.
Dans ses interventions télévisées des 1er février et de jeudi, alors que des centaines de milliers d’Egyptiens étaient dans la rue, le vieux raïs aux cheveux noirs a par deux fois tenté de jouer sur la corde sensible du patriotisme et du paternalisme. Il a rappelé son passé de héros de la guerre de 1973, durant laquelle il commandait les forces aériennes. Et, surtout, il a glissé au détour d’une phrase qu’il voulait mourir et être enterré dans son pays. Un appel pathétique que le peuple égyptien n’a pas voulu entendre.












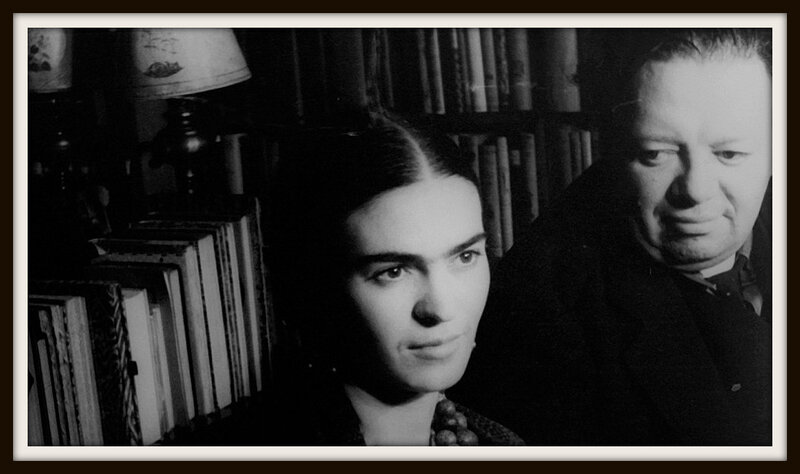

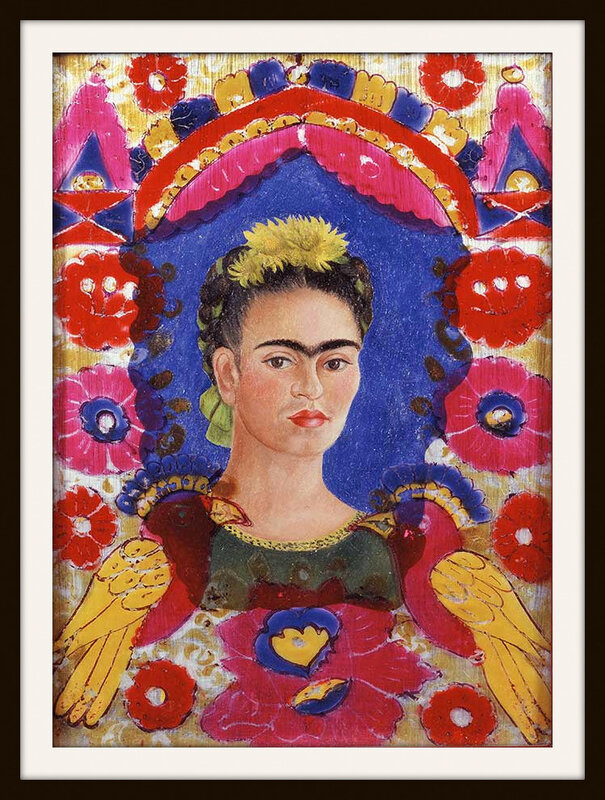
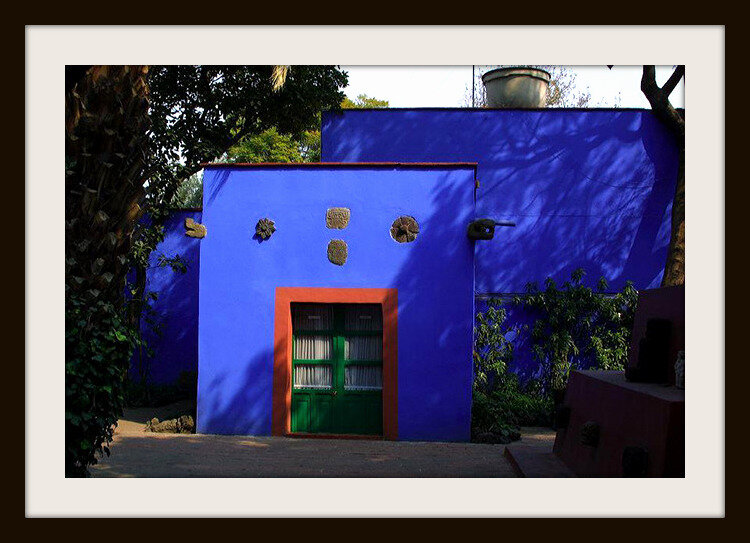






/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)