Par Denis Cosnard - Le Monde
Chaque dimanche, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, le photographe revient sur l’année de ses 16 ans, lorsque la découverte du secret de sa naissance a tout bouleversé, et l’a fait abandonner la carrière musicale à laquelle il se destinait.
A 80 ans, le photographe emblématique des années yéyé et de Salut les copains, publie, le 28 octobre, Déjà hier (Calmann-Lévy, 288 pages, 19 euros). Il y commente des images de son père adoptif François Périer (1919-2002), de sa famille, et surtout des nombreux artistes devenus ses amis, à commencer par Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, ou encore Patrick Modiano.
Je ne serais pas arrivé là si…
… si ma vie ne s’était pas arrêtée net en 1956. J’avais 16 ans. Ma mère avait quitté la maison depuis 1947, et j’allais parfois la voir au club Saint-Germain, à Paris, où elle dansait tous les soirs, ou chez elle, avenue de Wagram. J’y croisais des hommes. Toujours dans la même robe de chambre, mais avec une tête souvent différente. Ce soir-là, c’était un type que je connaissais déjà. Il me dit : « Ta mère ne va pas tarder, tu n’as qu’à l’attendre. » Je rentre donc dans l’appartement, et on s’assoit dans le salon. Lui en robe de chambre, moi habillé. Situation gênante. Il ne sait pas quoi me dire. A un moment donné, il prend sous la table une pochette de disque, et me la montre en lâchant : « Ton père n’est pas ton père. Ton père, c’est lui. » Sur la pochette, je vois un musicien noir, entouré de guitares… Imaginez le choc !
Ce musicien, c’est Henri Salvador. Vous ne vous doutiez de rien ?
Non. J’ignorais même son existence. Quand on partait en vacances, avec mon frère ou ma sœur, je bronzais en trois heures, et eux en trois semaines. Donc je voyais bien que j’étais différent. J’étais aussi le seul musicien de la maisonnée. Je n’avais pas le moindre soupçon pour autant. A l’époque, on gardait le secret sur ces affaires de famille.
Le choc est donc total ?
Je suis sonné. Un autre père… Je sors dans la rue, je marche, je marche, et je tombe sur une affiche de mon géniteur, annonçant un spectacle à l’Alhambra deux jours plus tard. J’y vais, en payant ma place. Pendant deux heures, je me prends le spectacle dans la tête. Un jazzman génial, trente musiciens derrière lui. Tout ce dont j’avais rêvé était là… Depuis l’âge de 5 ans, j’apprenais la musique, je composais, j’adorais le jazz, j’étais sûr que ce serait ma vie. Je me voyais déjà engager Frank Sinatra pour chanter mes morceaux. Michel Legrand n’avait qu’à bien se tenir… Et soudain, voici que c’est déjà fait, fini, il n’y a plus rien à ajouter. Fou de curiosité, je me glisse tout de même jusqu’aux coulisses, et j’aperçois la vedette, de profil, dans son costume blanc. Là, un fort des Halles m’attrape et dit : « Toi, maintenant, tu te casses. » C’est cette nuit-là que j’ai pris la décision la plus importante de ma vie, pas forcément la plus intelligente : j’ai définitivement fermé le piano, abandonné la musique, écarté tout ce qui ressemblait à l’homme que je venais de voir, et décidé d’adopter mon père…
C’est-à-dire François Périer, le comédien qui vous a élevé ?
Puisqu’il m’avait adopté, je l’ai choisi à mon tour. J’ai voulu être lui. Marcher les pieds à 10 heures 10 comme lui, me mettre en colère comme lui… C’était un homme prodigieux. Il ne m’a pas vraiment éduqué, car il était sans cesse au théâtre ou en tournage, mais il m’a donné un exemple et des souvenirs extraordinaires. Après les spectacles, tout ce qui comptait dans le théâtre et le cinéma de l’époque venait souper à la maison, à Neuilly. Orson Welles, Louis Jouvet et bien d’autres. Au bout du jardin, j’allais jouer sur la péniche de Jean Marais et Jean Cocteau. Oui, mon père était tout pour moi.
Comment a-t-il réagi ?
Après l’Alhambra, je suis rentré à la maison, et à deux heures du matin, je lui ai déclaré : « Pour mon père, je sais. » Il s’est assis, s’est mis à pleurer… et nous n’en avons plus parlé jusqu’en 1983 ! Moi, j’étais dévasté. Je ne fichais plus rien en classe. Mon père m’a alors retiré de l’école et embarqué sur un tournage de Fellini, à Rome. Il se demandait que faire de moi. Un photographe lui a répondu : « Quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match », et s’est tourné vers moi : « Est-ce que tu veux être photographe ? » Il aurait pu me proposer de devenir plombier ou maçon, j’aurais dit oui de la même façon. Peu m’importait, puisque ma vie s’était arrêtée deux mois plus tôt. Depuis, j’improvise. Tous les dix ans, j’ai changé de vie, de métier, de pays, de femme… Comme mon grand-père maternel, Jacques Porel, le fils de la comédienne Réjane, je suis un dilettante, désespéré, mais assez apte au bonheur.
Quel souvenir gardez-vous de votre mère, l’actrice Jacqueline Porel ?
Le choc de 1956 a balayé tout le reste, si bien que je me demande parfois si je l’ai vraiment connue. C’était une femme très libre, avec sa propre morale. Elle est tout de même partie en 1947 en laissant trois enfants, dont une fille de 3 ans ! Sa mère l’a d’ailleurs déshéritée, parce qu’elle avait divorcé. Je me souviens qu’elle a un temps travaillé au Carroll’s, chez Frede, la célèbre lesbienne patronne de cette boîte de nuit. J’allais la retrouver là-bas. Elle me serrait dans ses bras en me présentant à tout le monde. Mais les enfants, elle n’y comprenait pas grand-chose.
A 16 ans, vous voici donc photographe…
La vie a un humour incroyable. Au moment même où je décide d’arrêter la musique, je deviens l’assistant d’un fan de jazz qui me met un Leica entre les mains, et m’envoie photographier pour Jazz Magazine les plus grands musiciens du monde, à commencer par Ella Fitzgerald et Miles Davis. Et quelques années plus tard, à mon retour de l’armée, il lance un petit journal pour les jeunes, Salut les copains, et me colle à nouveau à dix centimètres de gens qui font de la musique et marchent dans le monde entier : les Beatles, les Stones, etc.
Cet homme, c’est Daniel Filipacchi. Un autre père ?
Quelle chance j’ai eue de rencontrer ce type intelligent, plein d’humour, qui était allé en Amérique avant tout le monde, cet homme de presse et de radio, ce photographe qui organisait des concerts… Il m’a adopté en cinq minutes et m’a fait une confiance incroyable. Il avait 26 ans, moi 16. Tous les soirs, il me ramenait en voiture à la maison, et me parlait pendant une heure. Je suis tombé fou de lui. Il a évacué mon histoire familiale et m’a fait entrer dans un autre univers.
Celui de la photo ?
La photo, je m’en fiche. Je faisais ça pour lui plaire, comme j’aurais fait n’importe quoi. Je ne me suis jamais pris pour un artiste. Il s’agissait juste de créer des posters pour faire rêver les gamins de Montélimar. Ce que j’aimais, c’était rencontrer des mômes de 17 à 20 ans partis de rien, comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, les Beatles, et les mettre en valeur. Regardez Françoise. Je la découvre à 18 ans, alors qu’elle a passé toute sa vie dans un 45 mètres carrés avec sa mère et sa sœur, qu’elle se croit laide, qu’elle ne sait rien d’elle. Ces mômes, la musique était toute leur vie, leur façon de s’en sortir. Alors que moi, je suis passé de Neuilly au 6e arrondissement via Los Angeles, c’est tout !
Les années 1960 ont aussi leur face sombre : la guerre d’Algérie.
J’ai connu Oran en 1961, pendant mon service militaire. La ville se délitait à grande vitesse. Je me souviens de manifestations effrayantes. J’ai vu des dames, entraînées par la folie de la foule, assassiner des ouvriers algériens à coup de pavés et de barres de fer. J’ai vu des pieds-noirs brûlés vifs. L’OAS [Organisation de l’armée secrète, pour le maintien de la France en Algérie] a voulu me tuer, alors que je n’avais rien fait. Puis j’ai été exfiltré en Allemagne, dans un camp disciplinaire pour des militaires de carrière pro-OAS. Ils me détestaient. J’ai eu encore plus peur qu’en Algérie ! Avec le recul, je suis content d’avoir connu tout ça. Sinon, j’aurais été un enfant gâté à la vie trop facile.
Après avoir été le grand photographe de « Salut les copains », vous passez brutalement au cinéma. Pourquoi ?
A cause de Jacques Dutronc ! J’étais amoureux de lui.
Amoureux ?
Oui. J’ai aimé cinq femmes, dont Françoise. Mais à vrai dire, je ne pensais qu’aux photos que je voulais faire avec elle, et je suis passé un peu à côté de l’histoire d’amour que j’aurais pu vivre avec elle. Quand, après notre séparation, elle m’a dit qu’elle avait rencontré quelqu’un, j’ai voulu voir cet homme. C’était Jacques. Il m’a plu énormément, avec son costard-cravate et les insolences qu’il proférait. Un vrai amour, assez peu raisonnable, mais sans le sexe. J’ai pensé qu’il devait faire du cinéma. Le jour où j’ai trouvé l’argent, j’ai quitté le groupe Filipacchi, où j’avais la plus belle situation au monde, et je n’ai plus touché un appareil photo pendant vingt ans. J’ai fait deux films avec lui et je ne le regrette pas.
Puis vous êtes parti pour les Etats-Unis. Pourquoi ?
A Paris, ma femme de l’époque m’avait quitté pour un autre. Alors, je suis parti du jour au lendemain, un peu comme ma mère. Une productrice américaine avait vu quelques films publicitaires que j’avais réalisés et m’avait dit : « Vous devriez venir aux Etats-Unis, ça peut marcher pour vous. » Sur cette seule base, je me suis envolé pour Los Angeles. J’y ai passé dix ans et tourné des centaines de publicités. Un travail alimentaire mais intéressant, car il faut faire court, raconter la vie d’une personne en quarante-cinq secondes. Les premières années étaient merveilleuses. Ensuite… l’Amérique n’est pas un pays, c’est un business, comme on dit. J’y ai gagné des fortunes, mais je me suis jamais senti aussi seul.
C’est aux Etats-Unis que vous avez fini par rencontrer votre géniteur…
En 1983, alors que je suis à Los Angeles, Eddy Barclay m’appelle, m’invite à dîner avec Henri, et nous laisse en tête-à-tête. On ne sait pas quoi se dire. Il me propose finalement d’aller voir Deep Throat, le fameux film porno. Hallucinant ! On s’est retrouvé comme deux militaires dans un cinéma vide. Cette initiative a néanmoins brisé la glace et après, il m’a parlé. Il m’a expliqué qu’il avait connu ma mère, puis qu’il était parti au service militaire. Ma mère a alors rencontré François Périer, sans savoir qu’elle était enceinte. Henri lui-même n’a appris mon existence qu’en 1947, par une indiscrétion. Il a alors appelé mon père et lui a demandé : « Qu’est-ce qu’on fait avec mon fils ? » Oui, « mon fils », lui qui ne m’avait jamais vu ! C’était surréaliste. Mon père lui a répondu : « Si tu t’approches de lui, je te tue. »
Après notre rencontre américaine, je l’ai revu pendant dix ans, en cachette de mon père. Mais il s’est très mal comporté avec mes enfants, les rejetant. Cela m’a ravagé. Et c’est avec un psy que j’ai écrit Enfant gâté (XO, 2001), le livre racontant cette histoire.
Après les Etats-Unis, vous êtes revenu en France, travailler… avec votre sœur !
Puisque je m’ennuyais, et qu’elle dirigeait Elle, elle m’a incité à reprendre la photographie, pour son magazine. Avec des mises en scène comme celles que j’imaginais pour Salut les copains, mais autour de la mode, cette fois-ci. Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier ont pris la place des Rolling Stones. C’était un bonheur de travailler avec ma sœur, le premier amour de ma vie. A une mère près, j’aurais pu l’épouser !
Le dernier virage vous mène en Aveyron…
J’en avais assez qu’on m’ait collé une étiquette, celle du photographe des yéyé. Assez de l’intelligentsia parisienne, qui a toujours méprisé ce qu’on a fait dans les années 1960, mes photos, mes films, simplement parce que c’était populaire. Alors j’ai choisi d’aller loin de Paris, dans un village inaccessible en TGV. C’est la France d’avant, celle qui se lève tôt et ne râle pas. Cela fait vingt-cinq ans que j’y vis seul, avec une chienne et deux ânesses. En faisant gaffe, il me reste quinze printemps opérationnels. J’ai trois romans à y écrire, dont l’un est bien avancé.
Vous jouez aussi sur scène. Comme François Périer, donc ?
Oui, un spectacle où je raconte ma vie en présentant des photos. Depuis cinq ans, je le donne un peu partout, cela m’oblige à prendre la voiture, à traverser la France avec ma chienne, et m’évite de me scléroser. J’ai un contrat de trois ans pour continuer. Me voici donc sur les planches, moi qui ai tant détesté le théâtre. Enfant, j’avais l’impression qu’il me prenait mon père. Ce qui est cocasse, c’est que la première a eu lieu à La Michodière, à Paris, le théâtre qu’il a longtemps dirigé. Dommage qu’il ne soit plus là, la coïncidence l’aurait fait rire…
Vous prenez encore des photos ?
Très peu. A cause du fameux poster de 1966 pour lequel j’avais réuni plus de quarante artistes dont Johnny, Françoise, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Michel Berger et Serge Gainsbourg, on me demande souvent des photos de groupe. Je sens que je vais finir photographe de mariage, allant de village en village, avec ma petite échelle !
« Déjà hier », de Jean-Marie Périer (Calmann-Levy, 288 pages, 19 euros), sortie en librairie le 28 octobre.




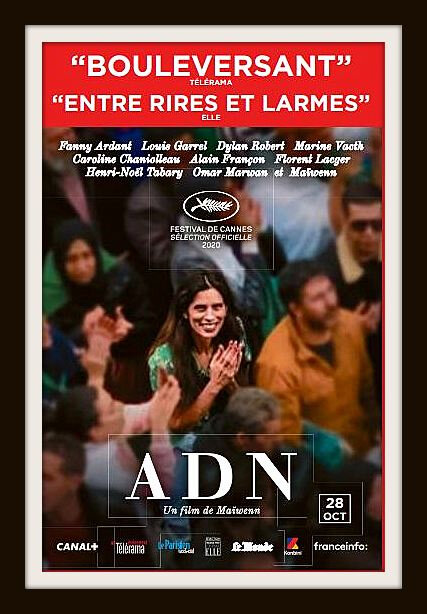












/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)