Douglas Kennedy : « Tous les scénarios hypothétiques ne font qu’alimenter l’incertitude du moment »
Tribune
Par Douglas Kennedy, Ecrivain
Comment écrire sur quelque chose dont on ignore encore les répercussions à long terme ? s’interroge le romancier américain. Dans ce grand inconnu, le sentiment de perte prédomine, estime-t-il dans une tribune au « Monde ».
C’est le début de la dixième semaine de confinement… et j’écris ces lignes à précisément 4 h 46 du matin. Mes insomnies s’aggravent. En période pré-Covid, j’avais en général une ou deux mauvaises nuits par semaine. Désormais, après soixante-trois jours de ce marathon confiné, je me réveille presque toutes les nuits au bout de trois ou quatre heures d’un sommeil agité, incapable de sombrer à nouveau dans ses profondeurs inconscientes. Alors, je me lève, je me fais une tisane, et je monte dans mon bureau pour écrire quelques heures. Ce matin, une idée m’a frappé : je suis en train de devenir un témoin expert de ce moment où la nuit s’ébroue et où une nouvelle aube s’étend sur ce coin de la Nouvelle-Angleterre que je considère comme chez moi.
Les écrivains sont bien sûr de notoires insomniaques. Charles Dickens arpentait la suie ténébreuse des nuits du Londres victorien avec une régularité quotidienne. Franz Kafka passait fréquemment plusieurs jours d’affilée sans dormir. Francis Scott Fitzgerald a écrit un essai (publié après sa mort) dans lequel il décrit la souffrance que lui procurait chaque jour la crainte que son esprit ne succombe pas au sommeil. Parmi mes camarades romanciers, le « syndrome de la nuit blanche » est presque un titre de fierté. Comme l’a dit ce barde de la mélancolie moderne, Leonard Cohen, « le dernier refuge de l’insomniaque est son sentiment de supériorité sur le monde endormi ».
Mais en ce moment, à peu près tous les gens que je connais ont des problèmes de sommeil. Des amis avocats. Des amis médecins. Des amis professeurs d’université. Des amis anciens golden boys à Wall Street. La femme qui m’a coupé les cheveux l’autre jour, ici, dans le Maine (où les coiffeurs ont été déclarés « services essentiels » et ont pu rouvrir… avec masques obligatoires pour tout le monde). Tous m’ont parlé de leurs insomnies. Même Rob, le fumeur de joints du dispensaire d’Etat local où j’achète légalement de la marijuana (et qui possède vraiment tous les outils à base de plantes pour assommer sa clientèle la nuit), m’a confié : « Mec, rien de ce que je fume n’arrive à mettre mon cerveau en veille très longtemps ces jours-ci. C’est comme si, avec ce virus, on était tous surcaféinés. »
Peur et dépression
J’ai approuvé la métaphore, et l’ai même répétée à une amie australienne à l’autre bout du monde tard ce soir-là durant notre coup de fil hebdomadaire. Comme nous sommes tous largement isolés les uns des autres en ce moment (et empêchés de nous déplacer à part sur de courtes distances), le téléphone ou les appels sur Skype sont devenus les canaux indispensables du lien humain. Je passe une bonne partie de l’année en voyage. Ou, du moins, c’est ainsi que je vivais jusque-là. A présent, les frontières étant fermées, je suis au téléphone une heure par jour avec un ami dans un endroit de la planète qui n’était autrefois qu’à un saut de puce en avion, mais qui est devenu une contrée reculée.
Ma copine australienne – une cinéaste avec qui je suis ami depuis plus de trente ans – est parmi les gens les plus robustes psychologiquement que je connaisse. Pourtant, même elle confie devoir lutter contre des moments d’abattement croissants. Quant aux gens autour de moi qui sont dans des relations de couple bancales ou dans des familles à problèmes, le confinement s’apparente pour eux à cette vision de l’intimité quotidienne digne d’August Strindberg [le dramaturge suédois, 1849-1912] : un supplice en forme d’impasse sans issue possible… car il n’y a en effet nulle part d’autre où trouver refuge.
Dans cette intelligente revue culturelle et politique en ligne qu’est The Daily Beast, j’ai lu un article sur les raisons pour lesquelles les gens souffrant d’anxiété ou d’attaques de panique s’en sortaient souvent mieux sur le plan psychologique pendant cette pandémie. Un psychologue interviewé pour l’occasion expliquait : « Une grande partie de l’anxiété tient à l’appréhension de l’inconnu, l’inquiétude qu’une chose grave se produira inévitablement. » Mais depuis le Covid-19, « beaucoup de gens disent : “Cette chose terrible est arrivée”, donc, à bien des égards, vous n’êtes plus dans un état d’appréhension. »
La « chose terrible » est en fait en train de se produire en ce moment. Pas étonnant (comme le faisait remarquer un autre psychologue cité dans le même article) que ceux qui ont passé une bonne partie de leur vie à négocier ce sombre labyrinthe qu’on appelle la dépression se disent : maintenant, tous les gens du monde non déprimé ont un aperçu de ce à quoi ressemble mon monde intérieur.
L’anxiété est, bien sûr, un des attributs de la condition humaine. De même que la peur ; la crainte que nous avons tous d’un effondrement individuel et collectif, telle que l’exprima magnifiquement le poète irlandais William Butler Yeats [1865-1939] dans un de ces plus célèbres poèmes, The Second Coming [Traduction d’Yves Bonnefoy] :
Tout se disloque. Le centre ne peut tenir.
L’anarchie se déchaîne sur le monde
Comme une mer noircie de sang : partout
On noie les saints élans de l’innocence.
Un moment révélateur
Une crise est toujours, d’une manière ou d’une autre, un moment révélateur. Tout drame, depuis la Grèce antique, est d’une certaine façon ancré dans la notion aristotélicienne de « catharsis ». Comme l’écrivait le philosophe : « La fonction de la tragédie est de provoquer une clarification (ou illumination) par une catharsis de la pitié et de la peur. » La catharsis est aussi devenue une composante essentielle de la psychanalyse freudienne : l’idée d’une révélation émergeant de toutes les choses refoulées ou escamotées dans nos psychés individuelles. Mais cette pandémie est un événement mondial, qui soulève donc une question romanesque intéressante : que devient la catharsis que nous associons d’ordinaire avec le récit de fiction quand nous traversons une période d’incertitude aussi absolue ?
L’ambiguïté est le terrain de jeu favori des écrivains. Quand, par exemple, je construis un personnage et/ou un dilemme moral dans un de mes romans, j’essaie toujours d’éviter les certitudes. Car en littérature (comme dans la vraie vie) on ne peut pas adopter la mentalité d’un western de série B : les méchants en chapeaux noirs, les gentils en chapeaux blancs. Aussi tous les écrivains naviguent-ils dans cette zone grise opaque entre ces extrémités manichéennes, et ils perçoivent donc les nuances subtiles et les ressorts psychologiques complexes derrière chaque interaction humaine.
Et si, au bout du compte, le plus grand mystère de la vie est soi-même, alors toute la dynamique de la catharsis dans n’importe quel récit de fiction est liée à l’idée d’une sorte de prise de conscience issue d’un dénouement aux effets purificateurs ou révélateurs. Othello se trouve confronté à sa monstrueuse jalousie meurtrière – et à sa manipulation par Iago – avant de mourir. La dépression finale d’Emma Bovary s’exprime dans une folle frénésie d’achats, et cette accumulation de dettes, ajoutée à une nouvelle déception amoureuse, l’informe en sous-texte qu’elle ne pourra que continuer à vivre sa petite vie étriquée dans son petit village étriqué, aux côtés de son barbant médecin de mari. C’est cette catharsis qui la pousse à se procurer de l’arsenic…
Etrange nouvelle réalité
Or, malgré quelques timides signes de déconfinement, la vérité est que nous sommes tous encore aux prises avec le grand inconnu. L’économie mondiale a été totalement déstabilisée. Cette dépression laissera dans son sillage d’immenses dégâts personnels, notamment dans les pays (comme les Etats-Unis) où il n’existe pas de vrai filet de sécurité social. La montagne de dettes pour les particuliers sera colossale.
Ce qui pose des questions à nombre d’entre nous : vais-je perdre ma maison ? A cause du carnage économique et commercial, vais-je perdre ma source de revenus ? Pourrons-nous jamais revoyager tranquillement ? Retrouverons-nous un jour le mode de vie que nous prenions tous autrefois pour notre normalité quotidienne ? Comme l’écrivait le romancier anglais L. P. Hartley [1895-1972] au début de son chef-d’œuvre Le Messager (adapté à l’écran par Joseph Losey) : « Le passé est un pays étranger : on y fait les choses autrement qu’ici. » Le monde dans lequel nous existions jusqu’à la semaine du 9 mars 2020 – quand la planète a commencé à se mettre à l’arrêt – est-il désormais ce pays étranger ?
Je ne suis ni grand clerc, ni savant, ni futurologue. Et l’un des grands truismes de cette épidémie est que nous entendons tous les jours des voix disparates nous brosser différents portraits de la vie après le Covid-19… ou du moins de la vie avec le Covid-19, si, par hasard, il ne s’évaporait pas de lui-même dans la nature. Tous ces scénarios hypothétiques ne font qu’alimenter l’incertitude du moment.
De même que les nombreuses consignes divergentes sur les choses à faire ou ne pas faire quand, par exemple, on se ravitaille au supermarché. J’ai des amis qui laissent une nuit entière dans leur garage toutes les denrées qu’ils ont achetées avant de leur faire franchir le seuil de la cuisine afin d’éliminer toute toxicité potentielle. Un de mes amis, photographe de jazz à New York, n’est pas sorti de son petit appartement depuis le 12 mars car il est germophobe. On m’a dit que le port du masque était une précaution indispensable. On m’a aussi dit que les masques n’étaient pas d’une grande utilité contre le virus. Et la dernière fois que j’ai serré la main de quelqu’un… ?
« EN ATTENDANT, NOUS SOMMES PLONGÉS DANS UN CURIEUX ÉTAT DE CHUTE LIBRE »
La vérité est que nous n’avons pas la moindre idée de la façon dont va évoluer cette étrange nouvelle réalité que nous partageons tous. En attendant, nous sommes plongés dans un curieux état de chute libre. Plusieurs lecteurs m’ont demandé si je songeais à écrire un roman sur ce moment de confinement. Ma réponse : comment quiconque pourrait écrire sur quelque chose dont il ignore encore les répercussions à long terme ?
Kierkegaard avait raison en disant : « La vie doit être vécue en regardant vers l’avenir, mais elle ne peut être comprise qu’en se retournant vers le passé. » Sauf que cette compréhension ne peut advenir qu’avec un certain recul par rapport aux événements eux-mêmes. Par conséquent, nous ne saurons pas avant un bon bout de temps de quelle manière tout ça nous aura changés.
Peurs intimes
Et pendant ce temps, c’est un sentiment de perte qui prédomine. Nous ruminons tous sur les choses qui, jusqu’à très récemment, nous procuraient un centre d’intérêt, du plaisir et un sentiment d’appartenance. Je suis un fana de jazz et de musique classique. J’ai entendu des rumeurs disant que nombre de mes clubs de jazz new-yorkais préférés ne survivraient pas financièrement à l’épidémie. Manhattan sans le Village Vanguard (peut-être le meilleur club de jazz au monde) ? Impensable. Pourtant, ça pourrait arriver. J’espère que les salles de jazz que je fréquente quand je suis à Paris – le Sunset-Sunside, le Duc des Lombards, le Baiser salé, le New Morning – rouvriront bientôt leurs portes. On verra bien…
Je me demande aussi quand je pourrai de nouveau écouter un concert au Théâtre des Champs-Elysées ou à la Philharmonie [à Paris]. Ou un récital de musique de chambre Salle Gaveau. Mes chers cinémas d’art et d’essai de la rue Champollion vont-ils tous s’en sortir ? Et même si beaucoup de mes lieux culturels favoris rouvrent, le paysage social de la vie quotidienne aura-t-il changé au point de dissuader les gens de passer une soirée au cinéma ? Ou de s’asseoir avec 1 500 autres spectateurs dans une salle de concert ou de théâtre ?
Encore une fois, je n’ai pas de réponse à ces inquiétudes. Je sais aussi qu’elles sont très personnelles, enracinées dans les passions intimes qui m’aident à contrebalancer les aspects plus durs de la vie. J’ai un ami qui est un fervent supporteur du Liverpool Football Club et qui avait des trémolos dans la voix en se demandant tout haut s’il reverrait jamais un match dans un stade bondé… ou si son club remporterait la Premier League, qu’il était clairement sur le point de rafler pour la première fois depuis trois décennies quand le championnat a été suspendu. N’avons-nous pas tous peur de perdre ces plaisirs qui contribuaient à donner du sens à nos vies particulières ?
« SI UNE PETITE PART DE NOTRE CONDITION HUMAINE APPRÉCIE LE FRISSON DE L’INSTABILITÉ, LA GRANDE MAJORITÉ D’ENTRE NOUS A BESOIN D’UNE CERTAINE ASSURANCE POUR AVANCER JOUR APRÈS JOUR »
Pendant ce temps, on sent bien que la catharsis post-Covid n’est pas pour demain ; que nous traversons tous une terra incognita dans laquelle le dénouement demeure incertain. Lors de brefs moments d’optimisme, je me dis que, dans le monde de l’après-pandémie, les villes redeviendront plus abordables, qu’il y aura une fantastique explosion de créativité et que l’intense capitalisme monoculturel qui a tant asséché la vie ces dernières décennies vacillera. Mais, dans des moments de pessimisme avant l’aube, je me demande aussi si nous ne fonçons pas tout droit vers le totalitarisme.
Le romancier en moi pourrait imaginer bien des troisièmes actes possibles en conclusion du drame que nous partageons tous. Mais ce serait un exercice de pure spéculation. Et même si une petite part de notre condition humaine apprécie le frisson de l’instabilité, la grande majorité d’entre nous a besoin d’une certaine assurance pour avancer jour après jour. Or, pour l’instant, c’est l’incertitude qui définit l’horizon immédiat. Pas étonnant que l’insomnie – la mienne, la vôtre – gagne du terrain.
(Traduction de Julie Sibony.)
Douglas Kennedy est écrivain. Son nouveau roman, Isabelle, l’après-midi (312 pages, 22,90 euros), paraîtra aux éditions Belfond le 4 juin.







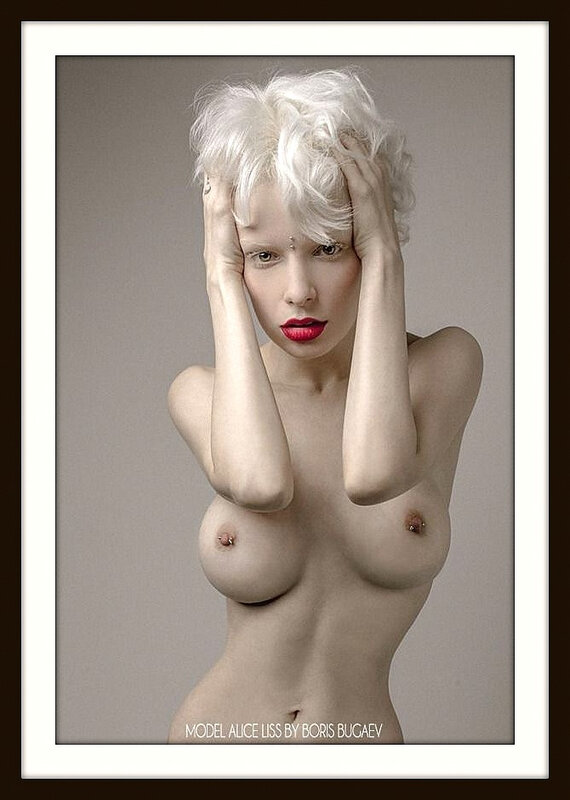


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)