Enquête : « Je suis comme un lion en cage » : confiné seul dans des petites surfaces, l’épreuve du feu
Par Jessica Gourdon
Chambre de bonnes, studettes, résidences étudiantes… Si beaucoup de jeunes sont rentrés chez leurs parents, ceux qui sont restés dans leur logement expérimentent une forme de solitude inédite.
Quand Valentin a appris qu’il allait devoir se confiner dans sa chambre de 15 m2, il en était presque amusé. « J’étais content de sortir du confinement, et voilà que je replonge dedans… » Ironie du calendrier, cet étudiant à Supaéro [Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace] était revenu la veille dans sa résidence toulousaine, après avoir été enfermé… pendant deux semaines dans une fausse base martienne, plantée au milieu d’un désert de l’Utah.
Cette expérimentation est proposée par la Mars Society à des groupes d’étudiants du monde entier, dans le cadre de recherches sur la vie sur la planète rouge. A sept dans 40 m2, avec une seule sortie par jour (« en combinaison »), un accès à Internet limité et des fenêtres fermées : pour la vie confinée, Valentin était rodé.
« Du coup, là, je le vis plutôt bien », commente le jeune homme de 21 ans, qui rêve d’être astronaute. Et ne pensait pas devoir appliquer si vite dans son quotidien les leçons de son expérience dans l’Utah : se fixer un planning, transcrire par écrit ses émotions, garder une activité physique quotidienne et des moments de détente, faire de la relaxation…
Alors que beaucoup d’étudiants sont revenus chez leurs parents pour le confinement, certains, pour des raisons variées – peur de les contaminer, relations difficiles, contraintes liées à un job ou à l’exiguïté du logement familial – sont amenés à vivre cette période dans de très petites surfaces, en solitaire. Dans les résidences d’étudiants par exemple, 40 % des jeunes sont restés, selon le Centre national des œuvres universitaires. Et contrairement à Valentin, beaucoup de ces jeunes adultes ne sont pas préparés à une telle épreuve.
Des logements conçus pour vivre à l’extérieur
Tout d’abord car les logements de petite taille sont avant tout conçus pour vivre à l’extérieur. Dans les résidences, les espaces collectifs (cuisines, cantines, salles de sport, foyers…) ont fermé ou sont en accès restreint, obligeant les locataires à se confiner dans des espaces non prévus pour y passer tout son temps.
« Dans les usages, les petits logements sont faits pour dormir, pour s’y réfugier après avoir passé la journée dehors. Ils sont un peu comme des cocons, des cabanes. Le salon, c’est le reste de la ville, ce sont les salles de cours, les cafés, les parcs », raconte Anja Hess, auteure du livre-enquête Les Habitants des chambres de bonnes à Paris (L’Harmattan, 2016).
Maximilien, qui vit dans un 18 m2 « pas lumineux » à Châtillon (Hauts-de-Seine), à côté de Paris, raconte qu’il avait l’habitude, après ses cours à l’école du Louvre, de voir des amis ou de travailler à la bibliothèque de Beaubourg jusqu’à 22 heures. Il passait rarement des soirées dans son studio, et le week-end, il était toujours dehors. « C’est franchement compliqué à vivre. Il y a des jours où je me sens comme un lion en cage. »
« A PART PASSER DE MA CHAISE AU LIT, JE NE PEUX PAS TELLEMENT FAIRE PLUS », RACONTE NADIA, LOCATAIRE D’UN 14 M2 À PARIS
Tous ceux que nous avons interrogés le disent : le plus difficile, dans ces petits espaces, est de séparer le travail des moments de détente. Quand Nadia, qui loue un 14 m2 à Paris, termine sa journée de stage derrière son ordinateur, elle reste au même endroit. « A part passer de ma chaise au lit, je ne peux pas tellement faire plus », raconte cette étudiante au Celsa.
« Le plus dur, c’est de rester concentré sur son travail quand on est en permanence dans le même espace », remarque Auxence, 22 ans, en master de cinéma à l’université de Lille, qui vit dans une chambre du Crous de 9 m2 à Villeneuve-d’Ascq. Il avait l’habitude de réviser en groupe à la bibliothèque. « Et là, franchement, j’ai du mal à travailler. Au quotidien, c’est assez horrible », commente l’étudiant, qui essaie tant bien que mal de boucler son mémoire sur les idoles yé-yé.
Cette restriction de l’espace peut avoir un effet anxiogène. « Elle atteint l’élan vital. Quand on vit dans un espace confiné, quand le corps est contraint, c’est comme si le champ des possibles de l’existence était refermé », estime Jeanine Chamond, professeure émérite en psychologie, qui a notamment travaillé sur le corps des prisonniers.
« ÇA ME FAIT PENSER À UNE CELLULE DE PRISON. J’AI L’IMPRESSION DE DEVENIR UN PEU FOU. C’EST UNE ÉPREUVE », CONFIE JULIEN, ÉTUDIANT À PARIS
Un sentiment partagé par Julien, 24 ans, étudiant en master de lettres. A Paris, il loue une chambre de bonne de 9 m2 sur le boulevard Saint-Germain – 600 euros de loyer par mois, avec toilettes sur le palier. Au sixième étage de son immeuble haussmannien, il est le seul locataire à ne pas avoir plié bagage. Il ne quitte son perchoir que le dimanche, pour remplir les rayons du Monoprix Saint-Michel, où il travaille une demi-journée par semaine.
« Ce qui est difficile, c’est d’être contraint à l’immobilité. Je me sens enfermé, empêché de bouger, j’ai du mal à me concentrer… Ça me fait penser à une cellule de prison. J’ai l’impression de devenir un peu fou. C’est une épreuve, je me dis que j’attends la libération. » Une consolation pour ce Toulousain d’origine, il a découvert A La Recherche du temps perdu : sur son lit simple, Proust le transporte du côté de chez Swann, un œil sur le ciel de Paris.
« Ça n’allait pas, j’écoutais du Barbara »
Au-delà de l’espace restreint, le plus grand défi, pour ces jeunes, est d’affronter la solitude. Dans l’immeuble parisien où réside Nadia, il y a dix studios. Avec ses voisins, ce n’étaient parfois que de simples « bonjour », mais c’était une présence. Depuis le confinement, l’étudiante de 22 ans ne croise plus personne. « J’ai l’impression d’être la seule qui n’a pas réussi à fuir. »
Son appartement, un rez-de-chaussée dans le 15e arrondissement de Paris, donne sur une cour et sur l’entrée d’un parking. « Je vois un peu le ciel, mais je dois me pencher. » Au loin, les cloches d’une église ou le bruit des oiseaux l’apaisent, et donnent à son quotidien un air de normalité. « D’habitude je suis une personne enjouée. Mais là, je vois qu’au fil des jours je deviens irritable. Evidemment, cette situation joue sur le moral », dit-elle.
« C’est dur de se sentir seule et enfermée », reconnaît aussi Léa, 22 ans, depuis son studio de 18 m2 à Maurepas (Yvelines), qui donne sur une route nationale presque déserte. Cette étudiante en master de ressources humaines admet que son moral « fait des montagnes russes », mais tient bon. Tout comme Maximilien, qui a eu fin mars un « gros coup de blues » de deux jours : « Ça n’allait pas, j’écoutais du Barbara. » Les contacts par visio avec ses amis l’aident à retrouver le moral. « Mais plus les jours passent, plus on se rend compte que ça ne remplace pas les contacts humains », note-t-il.
Plus ou moins difficile selon chacun
Tous ne vivent pas mal cette situation. Certains s’en accommodent, comme Sophie, 20 ans, étudiante en webdesign. Dans sa résidence Campuséa de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), elle a réorganisé sa vie avec efficacité. Après sa journée de stage en télétravail, elle fait de la broderie, suit des cours d’orthographe, joue à des jeux de société virtuels avec ses voisins qui n’ont pas déserté – une vingtaine parmi la centaine d’étudiants. « Je fais plus de sport que d’habitude, j’ai plus de temps pour moi, je fais des masques, j’ai la peau toute lisse. » Elle voit aussi son copain, locataire au septième étage. « Du coup, je le vis plutôt bien. »
En réalité, pour ces étudiants, la façon de vivre ce confinement dépend de leur ancrage dans leur vie et dans leur habitat, estime le sociologue Christophe Moreau, spécialiste des jeunes adultes. Il distingue plusieurs profils : ceux qui sont rentrés pour le confinement chez leurs parents, souvent les plus jeunes ; ceux qui ont investi leur nouvelle vie indépendante et leur logement, qui réussissent à entretenir des relations à distance et à s’organiser ; et enfin, ceux qui sont restés dans leur appartement mais manquent de ressources pour gérer leur emploi du temps, se préparer des repas équilibrés, ou pour qui la solitude est très déstabilisante.
C’est pour ces derniers que cette épreuve est la plus dure, selon Christophe Moreau :
« A cet âge, le groupe de pairs, c’est une bouée de sauvetage, c’est une façon de dépasser les traumatismes de l’adolescence, c’est plus qu’une source d’amusement. Le collectif joue un rôle de pacificateur d’émotions et de sécurisation identitaire. Quand il n’est pas là, cela peut être dramatique pour certains. »
Sans aller jusqu’à cette situation, ce confinement reste, dans tous les cas, une « épreuve de soi », résume Christine Bouvier-Müh, enseignante-chercheuse en philosophie à l’université catholique de Lyon. Une expérience inédite pour tout le monde, qui se vit mieux dans un espace plus grand mais laisse chacun affronter sa « solitude de sujet ». « L’essentiel est de garder le contact avec l’extérieur, de continuer à bouger, et de ne pas se laisser submerger par les nouvelles alarmantes ou par le travail », conseille-t-elle.
Après une demi-heure au téléphone où il nous a parlé de sa vie confinée, Maximilien est formel : dès que tout cela sera terminé, il ira passer une nuit ailleurs, pour voir « un autre ciel ». Et puis, il va résilier le bail de son 18 m2. Il cherchera un appartement plus grand, en colocation, pour la rentrée.









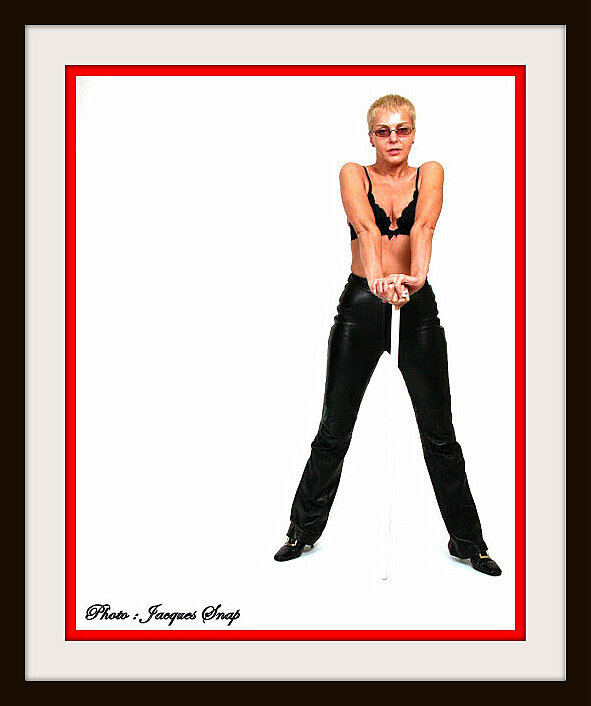



/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)