Par Michel Guerrin - Le Monde
A 73 ans, c’est un des derniers grands photographes de mode vivant de sa génération. Modernes et intemporelles, ses images sont moins soucieuses du vêtement que des modèles, dont il cherche à révéler la beauté. Deux expositions mettent en avant son travail cet automne.
A l’automne 1991, par un froid glacial, Barcelone accueille un festival de photo de mode bouillonnant. Trente-deux photographes, du beau monde, deux courants qui s’affrontent. Certains perpétuent les fastes et le glamour d’antan. D’autres, tels les Anglais Corinne Day ou David Sims, multiplient les poses trash hors du studio et négligent les vêtements pour se rapprocher de la vie. Au milieu, en terrain neutre, un ovni. Des petits Polaroid. Une lumière fantomatique habite des vues de mode, portraits ou natures mortes. Des objets si fragiles qu’on craint qu’ils ne tombent du mur ou que l’image ne s’efface.
L’auteur est Italien, il habite Paris, il s’appelle Paolo Roversi. Nous demandons à le rencontrer devant ses photos. Il nous fait savoir qu’un dîner est plus approprié. Dans un restaurant de Barcelone, il apparaît tout en noir. Le vêtement est confortable, le regard bleu métallique, le geste lent, la voix chaude, la courtoisie extrême. Français précis, accent italien, élégance britannique. Il impose les plats entre deux silences. « Reprenez de ces pâtes. »
Le repas dure quatre heures. Paolo Roversi évoque Les Fiancés, de l’écrivain romantique italien Alessandro Manzoni, digresse sur Kerouac, parle des photos de Robert Frank, Walker Evans, André Kertész ou Guy Bourdin. Mais il ne dit pas un mot des siennes. Ce dîner, on s’en souvient car il se répétera tant de fois. Roversi prend des nouvelles de la famille, évoque ses lectures, se montre autant admiratif d’un poète japonais méconnu, d’un livre pour enfants que d’un passement de jambes du footballeur Roberto Baggio. Il déplore la perte de culture et de raffinement de l’Italie. Mais parlez-lui de ses images, il devient évanescent. Il n’y a pas plus d’indices dans les livres qu’il a publiés.
Deux rétrospectives de choix
Pour Roversi, la photographie doit rester un secret. Le CV et les images parlent pour lui. Il est, à 73 ans, un des derniers géants de son art – beaucoup de ceux qu’il a côtoyés, dont Robert Frank, Helmut Newton ou Peter Lindbergh, sont morts. Il photographie toujours avec une joie intacte, refuse beaucoup de propositions – « J’ai un âge où je peux. » Il a pour clients privilégiés des magazines (Vogue Italie, Vogue UK, AnOther Mag, Self Service, Luncheon) et des marques (Comme des Garçons et Dior). Il enseigne à l’ECAL, prestigieuse école d’art de Lausanne. Il est représenté par une galerie à Paris (Camera Obscura) et par une autre à New York (Pace Gallery). Il ajoute qu’il voit mieux qu’avant. Voir quoi ? Sur les images prises par d’autres, il lit les visages, les mains, les poses, les regards. « Je suis un voyant. »
Son actualité est riche. Une rétrospective à partir du 10 octobre à Ravenne, en Emilie-Romagne, où il est né. Une exposition au Festival international de mode et de photographie, à Hyères, à compter du 15 octobre – il y présidera aussi un jury. Il remettra, le 13 octobre, un prix qui porte le nom de son fils Filippo, décédé en 2017 à l’âge de 43 ans, et qui récompense de jeunes photographes de mode. Ce sera au Palais Galliera, à Paris, un lieu qui prévoit également une rétrospective de son œuvre en octobre 2021.
Paolo Roversi a travaillé avec tant de stylistes et de magazines prestigieux, il a tiré le portrait de célébrités, de modèles parmi les plus demandés, d’autres beaucoup moins, d’anonymes aussi. Il a produit des nus, natures mortes et paysages, des photos en Inde ou au Yémen. Il a photographié la Coupe du monde de football, en 1998, pour le journal Libération. Soit un matériau riche et divers, qui s’étire sur cinquante ans.
Pourtant, la cohérence saute aux yeux, qu’il résume d’une formule. « J’ai enregistré des visages familiers. » Familiers à lui, à nous aussi, comme s’ils nous invitaient à l’introspection. « Prendre une photo consiste à révéler quelque chose en toi et à l’amener dans l’image. On ne prend pas une photo, on la donne. » Ses images baignent aussi dans l’oxymore : elles sont d’une contemporanéité intemporelle. Elles auraient pu être prises hier ou après-demain.
Un rêveur à part
D’un côté, Roversi ne colle pas à l’actualité, soustrait les signes de l’époque, ne descend pas dans la rue. De l’autre, il a travaillé avec des personnalités parmi les plus radicales de leur temps. Ce qui fait de lui un classique et un moderne. Si la mode change sans arrêt et si Roversi est toujours là, c’est qu’il n’a pas cherché à suivre le rythme. Il impose le sien. Il impose un climat romanesque, poétique, théâtral, onirique, qui est le produit de sa culture, son enfance, ses rêves, ses rencontres.
« La mode est un grand fleuve qui coule, que je regarde depuis la rive. Je ne me jette pas dans la vague. Je n’ai jamais cherché à être dans le coup. J’ai vu passer beaucoup de courants, plus ou moins intéressants, beaucoup de jeunes photographes qui voulaient être à la page. Rester au bord permet de durer. »
Tout cela, on pourra le vérifier dans l’exposition de Ravenne, au Musée d’art de la ville, logé dans un imposant monastère du XVIe siècle. Il va occuper les trois étages. Vingt et une salles, 270 photos. Il peut parler des heures de ce musée, du gisant d’un guerrier, dont la rigidité de l’armure tranche avec le visage d’ange. « On dit que les femmes qui l’embrassent se marient dans l’année. »
Le visiteur découvrira son œuvre sous le titre de « Studio », dont il a une définition toute personnelle : « Le studio n’est pas seulement une pièce où l’on photographie ou une technique de prise de vue. Le studio est un état d’esprit, il épouse ma biographie, il me suit en voyage, il est dans ma tête. C’est moi. »
Studio de lumière
Adolescent à Ravenne, il installe un studio à la cave. Quand il débarque à Paris, en 1973, il déplace le lit pour ses prises de vue. Depuis plus de trente-cinq ans, son studio est un immeuble des années 1930, dans le 14e arrondissement de Paris, qui abrite sur cinq niveaux deux espaces pour les prises de vue, son secrétariat, sa bibliothèque, ses archives, un laboratoire, une grande cuisine, des chambres, une salle de réunion, un bureau où il noircit des carnets de ses dessins et idées. Le lieu s’appelle Studio Luce, un nom trouvé par le notaire après avoir demandé comment on dit lumière en italien.
C’est sa deuxième maison, qu’il rejoint tous les jours depuis son domicile à côté des Invalides. Lui comme ses modèles doivent du reste se sentir comme à la maison pour coller à son esthétique. Pas d’horloge. Nous sommes hors du temps. Le principal espace de prise de vue est fermé par une grande baie vitrée. Mais, comme il est orienté au nord, le soleil n’entre jamais, frappant l’immeuble en face, ce qui donne « la plus belle lumière qui soit ». Au 3e étage, il a bricolé « le plus petit studio du monde », 4 mètres sur 2 mètres, une boîte magique et blanche dans laquelle il fait des photos ou s’abandonne pour méditer.
Le studio est à Paris, mais il pourrait être à Ravenne, là où il a conservé une maison, à côté de la mer. Il faut évoquer l’apport du père, un médecin qui se lève à 4 h 30 pour soigner tout le monde, les riches, les pauvres, qui se fait payer en moutons, poulets ou panettones à Noël – une centaine une année – et qui, le dimanche, projette sur le mur de la salle à manger ses films au format 8 mm. Evoquer la mère, qui chante dans la maison, récite avec Paolo des poèmes de Manzoni, prend des photos avec un Kodak Retina. Evoquer un oncle, passionné de photographie.
L’enfance est heureuse mais sans luxe, il hérite des vêtements de ses quatre frères et sœurs. Il regarde les bœufs gagner la piazza del Popolo le jour de marché, dessine à la craie les buts de football sur la pierre de l’église, passe l’été à Ravenna di Mare. Et reçoit à 8 ans, un appareil. Au même âge que Lartigue, et comme lui, il photographie ce qui l’entoure.
Il attendra d’avoir 16 ans et un voyage en Espagne, pour avoir la révélation : la photo ne sert pas juste à alimenter les albums de famille. Elle peut être poétique. A son retour, il montre quatre images au facteur, un photographe amateur. A la sortie de l’école, il rend visite à un photographe de quartier, Nevio Natali, qui lui apprend les rudiments du métier. Il participe aussi à des concours, punaise dans sa chambre son tirage d’une vieille Napolitaine au visage aussi ridé que le mur derrière elle et en rêve toute la nuit.
La passion des mots et des images
Le jeune Roversi est fou de littérature et d’art, il fait du théâtre, se rêve en chef d’orchestre, mais sa mère le voit en avocat. « Tu parles bien, Paolo… » Un premier cours de droit romain tourne au désastre. Il apprend alors qu’à l’université de Bologne, une des plus prestigieuses d’Europe, à une heure de voiture de Ravenne, des enseignants iconoclastes bousculent les humanités. Nous sommes à la fin des années 1960. Umberto Eco donne un cours de sémiologie, analyse les signes de la culture populaire, parle de textes médiévaux, de Léonard de Vinci, de BD, de cinéma, de photo. Il officie non pas en amphithéâtre mais sur la pelouse. Pour Roversi, c’est le choc.
En 1970, il ouvre à Ravenne un studio spécialisé dans le portrait. Ses premiers modèles sont sa famille, puis il élargit le cercle aux amis, aux jolies femmes de la ville, aux personnalités locales. Pour l’agence Associated Press, il « couvre » les funérailles du poète américain Ezra Pound à Venise. Et puis il rend visite, à Brisighella, au peintre Mattia Moreni, le père de la styliste de mode Popy Moreni. Il y rencontre le photographe et directeur artistique Peter Knapp, qui lui conseille d’aller à Paris.
« LA MODE, C’EST COMME PHOTOGRAPHIER UNE VOITURE OU UNE BOÎTE DE CHOCOLATS, LES IMAGES DOIVENT EXPRIMER AUTRE CHOSE. » PAOLO ROVERSI
Pourquoi, à 25 ans, alors qu’il est marié et qu’il a deux enfants, que Ravenne est un cocon rassurant, qu’il y tient un studio, que ses frères et sœurs ne quitteront pas la ville, choisit-il de partir ? En guise de réponse, il cite le titre d’un livre d’Eugenio Montale, un poète qu’il chérit, Prix Nobel de littérature en 1975 : Fuori di casa. En dehors de la maison. Quitter sa maison, c’est la reconstruire ailleurs et la conserver. Ce n’est pas tirer un trait mais le prolonger.
Pourquoi la mode ? Le film Blow Up, d’Antonioni, le marque après sa sortie, en 1966. « Ce héros de photographe qui joue avec les filles, en enjambe une pour la photographier, qui découvre aussi un personnage caché dans une image, c’est le mariage du cinéma, de l’art, du mystère et de la photographie. »
Premiers pas dans la mode
C’est un résumé de son esthétique. Il dit encore qu’il est fécondé par des images d’Avedon, Penn, Bourdin, Newton, Sieff, Blumenfeld, dont il ne retrouve pas ailleurs la créativité et la fantaisie. Il voit de la mode chez les portraitistes qu’il vénère, comme Nadar ou August Sander. Il en voit même chez Walker Evans. Un photographe de mode qui ne va pas au-delà de la mode ne l’intéresse pas. « La mode, c’est comme photographier une voiture ou une boîte de chocolats, les images doivent exprimer autre chose. »
Quand il débarque à Paris, il tape à la porte de Newton pour être son assistant. Refus. Il tape à la porte de Guy Bourdin qui lui demande son signe du zodiaque et lui rétorque « J’aime pas les Balance » – plus tard, ils fredonneront ensemble des airs d’opéra et échangeront des poèmes. Il est finalement pris par Laurence Sackman, excellent mais méconnu photographe anglais dont il retiendra une règle : bien fixer la caméra au sol mais laisser la tête très libre.
« LORS DE LA PRISE DE VUE, IL TE REGARDE COMME UNE PERSONNE, PAS UN MANNEQUIN. IL TE SIGNIFIE QUE TU ES UNIQUE. TU N’ES PAS UN PORTEMANTEAU MAIS UNE FEMME. »
LAETITIA FIRMIN-DIDOT
La tête libre, solide aussi, il la faut pour imposer une photographie que beaucoup pourraient trouver pas assez tapageuse, sexy, spectaculaire, sociale. Plusieurs noms, dans des genres divers, ont animé la mode au fil des décennies – Helmut Newton, Bruce Weber, Steven Meisel, Nick Knight, Mario Testino ou Mario Sorrenti, David LaChapelle, Terry Richardson, Juergen Teller… Seul Roversi colle au journal intime. C’est peu et c’est énorme. Cela vient de loin.
Sa première photo de mode, il la prend à 9 ans, quand il dit à sa sœur aînée, 18 ans, qui s’est mise en beauté pour aller danser : « Viens, je te fais une photo. » Les mots sont banals. Ils sont devenus un rituel. Il les répète depuis cinquante ans pour signifier au modèle qu’il est bien plus important que les vêtements ou le statut social qu’il porte. Pour cela il se montre toujours bienveillant.
La quête de la beauté
Laetitia Firmin-Didot a travaillé avec Roversi entre 1985 et 1992 avant de l’épouser. Ses souvenirs de prise de vue, notamment pour Cerruti, rejoignent ceux de tant de modèles : « Paolo instaure d’abord un climat joyeux et familial, multiplie les blagues, joue au ping-pong ou aux fléchettes avec les modèles, met de la musique napolitaine, n’expédie pas le déjeuner. Il prend son temps alors que tant de photographes font clic-clac et au revoir. Ensuite, lors de la prise de vue, il te regarde comme une personne, pas un mannequin. Il te signifie que tu es unique. Tu n’es pas un portemanteau mais une femme. La séance est intense, dans le silence souvent, d’autant que rien n’est préétabli. Vous n’imaginez pas comme il cherche, expérimente, veut l’imprévu. Ce sont des journées très longues et magnifiques, impensables aujourd’hui où tout semble codifié et minuté. »
Nicole Wisniak, la directrice de la revue Egoïste, dont Roversi est le photographe privilégié, résume d’une formule : « Pour des photographes, la séance est un ring. Pour Paolo, c’est une piste de danse. » Elle le définit comme un séducteur distant à la Marcello Mastroianni. Et puis cette évidence : « Les modèles sont en confiance car elles savent qu’elles seront belles. »
Pour faire surgir la beauté, le photographe réduit le décor à un fond neutre. « Le sujet, je l’isole, le nettoie, pour qu’il devienne le centre du monde. » Richard Avedon, maître de la confrontation, dans un genre ô combien tendu, afin de faire jaillir une personnalité, disait « There is nobody home » quand le sujet avait le regard inhabité. Même chose pour Roversi, mais dont le résultat est intériorisé.
Le mouvement #metoo a gagné la mode, et aussi la photo de mode dans le rapport aux mannequins, avec quelques procès à la clé contre certains photographes. De cela, Roversi ne veut pas parler, estimant sans doute que lorsqu’il est au travail, sa méthode et son approche vont à l’encontre de toute violence et plaident pour lui, qu’il n’y a rien à ajouter ou à commenter.
Le goût de la mise à nu
Un jour, discutant avec Irving Penn devant ses portraits d’enfants de Cuzco, au Pérou, il lui demande en quelle langue il leur parle. Réponse de Penn : « Pas besoin de parler, tu le sais bien. » Roversi prolonge : « Vous n’imaginez pas le nombre de fois où j’ai photographié sans dire un mot. » Il a réalisé quarante-sept séances entre 1987 et 2001 avec Kirsten Owen, mannequin atypique des années 1990, ou plutôt anti-mannequin tant elle est dépouillée des tics du modèle, avec un visage changeant, affichant parfois des traits durs – « elle est de toutes les saisons », résume avec élégance Roversi. Et pourtant il ne lui parlait quasiment pas, tout passait par le regard, réalisant même d’elle un portrait en train de pleurer, publié en couverture du magazine i-D : « Je lui ai fait porter une robe que portait ma mère à 20 ans. » Roversi est un metteur en scène du souvenir, mais le temps s’étire dans sa photographie jusqu’au présent.
Ce sentiment, il l’accentue parfois par le procédé de la double exposition : associer deux images dans le même cadre, prises à deux instants distincts, souvent proches. La facture des tirages n’est pas floue – le flou désincarne les gens – mais fuyante, vaporeuse, parfois mouillée. Le Polaroid joue longtemps son rôle dans ce rendu, même si depuis une dizaine d’années il opère surtout en numérique, mais sans perdre la fragilité de la matière grâce à un travail sophistiqué en laboratoire.
En 1999, il publie Nudi (éd. Stromboli & Steidl), soit quarante-six Polaroid de femmes nues et mises à nu, en pied, certaines célèbres – Kate Moss, Inès de la Fressange, Stella Tennant, Sasha, Milla Jovovich, Kirsten Owen. Les corps laiteux sur fond blanc, les poses empruntées, la matière cristalline du Polaroid, tout cela donne un sommet d’émotion et de fragilité. « Mes photos ne sont pas très nettes, pas très claires. Ce sont des choses qui viennent de loin. »
Le tournant des années 1980
Du vocabulaire de la photo, comme révélateur, fixateur, surface sensible, qu’il adore et qui résonne avec son art. Cela vient de l’inventeur Nicéphore Niépce, dont la première photo de l’histoire, en 1827, un point de vue depuis la fenêtre de sa maison, à Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire), l’a marqué par sa révélation hésitante, au point d’obtenir l’autorisation de passer une nuit entière sous la fenêtre en question. « C’est comme si j’avais dormi dans les bras de Niépce. »
La vision fragile vient de Ravenne, aussi, où le brouillard est parfois dense l’hiver. « Je marchais à tâtons jusqu’à l’autre côté de la place. » Ravenne abrite aussi les plus belles mosaïques du monde, qu’il a regardées jusqu’à s’en user les yeux, et dont il a transposé dans ses images les contours mal définis, les visages statiques, avec des bleus et des rouges d’une profondeur vibrante. Nombre de modèles enfin sont des filles qui sont un peu garçons et des garçons qui sont un peu filles, une ambiguïté qu’il assimile à « une frontière fragile entre le bien et le mal ». C’est avec cette photographie que Roversi gravit les échelons, marche après marche. « J’en ai dégringolé pas mal aussi. »
1980 est un tournant. Peu connu, il remporte de haute lutte une campagne publicitaire de cosmétiques pour Dior. On lui demande combien d’argent il veut, et, comme il ne rêve que de sujets de mode ambitieux ou de portraits, il répond : « Pour un rouge à lèvres ? Rien… » Sourire du commanditaire. « Il m’a coûté cher ce sourire. » Mais la porte est ouverte, il travaillera beaucoup pour Dior, notamment durant la période John Galliano.
La même année 1980, il a un coup de foudre pour le Polaroid grand format 20 × 25 qui vient d’être commercialisé. Les photographes de mode utilisent à l’époque ce procédé instantané, où l’image se révèle au bout d’une minute, pour faire des tests avant la « vraie » prise de vue. Roversi, lui, qui aime rappeler qu’il est né l’année de création du Polaroid, en 1947, adopte le négatif-positif de grand format, qu’il loge dans une imposante et antique chambre photographique. Il est au début bien seul, au point que la première fois qu’il montre ses Polaroid à un magazine on lui rétorque : « Mais on ne peut pas imprimer ça ! »
Rencontres déterminantes
Quand on demande à Roversi de cerner ses images importantes, il préfère raconter des rencontres qui l’ont construit. Fraîchement arrivé à Paris, il cherche des mannequins, voit une fille magnifique à Saint-Germain-des-Prés, la suit dans la rue jusque dans l’immeuble où elle entre. A chaque marche, il se dit qu’il doit l’aborder. Elle frappe à une porte, un homme ouvre, la fille entre. C’est le mannequin Jerry Hall, future épouse de Mick Jagger. Il ne la photographiera jamais. Mais l’homme, avec qui elle partage cet appartement, prêté par Karl Lagerfeld, lui demande sur le palier : « Qui es-tu ? Tu veux quoi ? » C’est Antonio Lopez, génial dessinateur de mode.
Roversi cite aussi le styliste japonais Yohji Yamamoto, pour qui, en 1985, à la grande époque des catalogues publicitaires, il réalise des images où les modèles sont sculptés par des couleurs rouges ou vertes, hallucinées et dissonantes. « C’est bizarre », lui dit Yohji. Ça l’est. Il évoque encore le couturier italien Romeo Gigli, dont il accompagne la carrière naissante, en 1983, ce qui lui permet d’inventer de toutes pièces l’image d’une femme. Et puis la styliste japonaise Rei Kawakubo de Comme des garçons, « importantissime pour moi », pour sa déconstruction des canons de la féminité. Nino Cerruti, aussi, dont il dit qu’il lui a un peu appris à vivre. Ou Franca Sozzani, qui a dirigé le Vogue Italie à partir de 1988 et dont il dira à sa mort, en 2016, qu’elle a fait du magazine son journal intime.
Sa dernière grande rencontre est Nicole Wisniak, qui lui a demandé de remplacer au magazine Egoïste Richard Avedon, après sa mort, en 2004. Ils ont tant à partager – le goût du romanesque, le refus de se plier aux modes et au temps. Il a photographié l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani nue et belle comme un Botticelli, le cinéaste Xavier Dolan aux prises avec ses démons…
Mais, à côté des portraits, il doit relever un autre défi qui a fait la réputation d’Egoïste : suggérer une narration en images sur plusieurs doubles pages. « Ce n’est pas simple, car pour moi la photo n’a pas d’arrière-pensées, pas d’explication à donner, mais j’aime m’y affronter avec Nicole. » Il faudra patienter jusqu’à 2021 pour découvrir la nouvelle livraison d’Egoïste et le fruit de leur collaboration.
Roversi cultive tant l’art de la rencontre qu’il est un des rares grands photographes à avoir cherché l’amitié de confrères qu’il admire. Il fut l’intime jusqu’à sa mort, en 2019, du mythique Robert Frank, qui, avec son livre Les Américains (1958), a inventé une photographie existentielle. Leur rencontre, en 1994, tient du roman. Il apprend que Frank va animer un stage dans un village du Gard. Les inscriptions sont closes, 15 personnes. Il donne son nom, ils seront 16. Mais, sortant d’une prise de vue en Allemagne, il arrive sur place avec quelques heures de retard. Ce qui donne ce dialogue : Robert Frank : « Tu es qui ? » « Je m’appelle Paolo. Désolé pour le retard. » « Pas grave, montre-nous ton portfolio. » « Je n’en ai pas. » « Tu es en retard et tu n’as pas de portfolio… » « Juste une petite photo du Yémen… » « Alors vide tes poches. Tes poches me parlent plus de toi qu’un portfolio. »
« Paolo Roversi-Studio Luce », du 10 octobre au 10 janvier 2021, au Musée d’art de Ravenne.
« Silenzio », du 19 octobre au 29 novembre, à la Villa Noailles, Hyères.












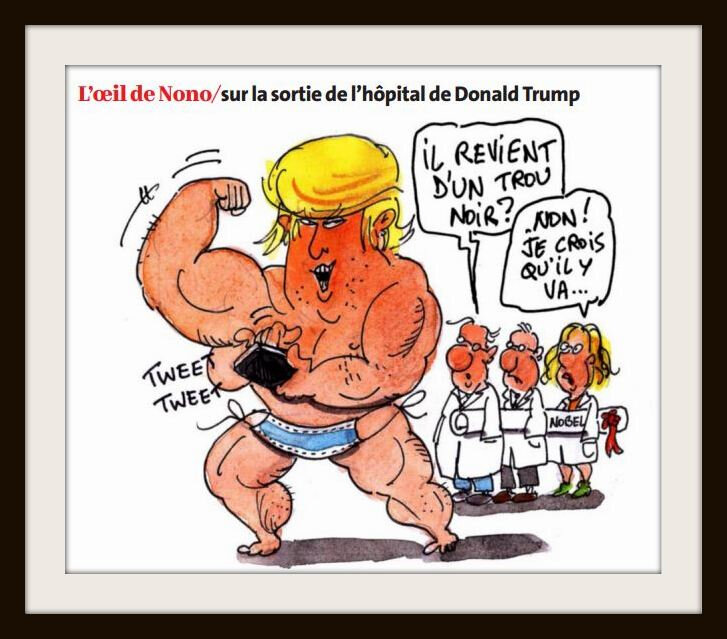
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)