Cabinets d’architectes pour les JO au Japon
Par Isabelle Regnier
A Tokyo, les plus grands noms du pays comme Shigeru Ban ou Tadao Ando ont planché pour inventer des lieux d’aisance high-tech.
Avec leurs sièges chauffants et leurs petits jets d’eau orientés vers les différentes parties intimes, les toilettes Toto ont supplanté les traditionnels washiki, ces cuvettes oblongues en émail creusées à même le sol qu’on trouve encore dans de nombreux endroits au Japon, mais qui évoquent désormais une certaine rusticité.
Depuis le lancement de ces trônes futuristes en 1980, l’entreprise Toto n’a cessé de peaufiner son image de luxe high-tech, provocatrice et progressiste, en finançant un prototype comme la « Toto caca » (en 2012), moto à trois roues carburant aux fèces humaines dont le siège a la forme d’une cuvette d’aisance, ou en créant (en 2015) un musée des toilettes à Tokyo. Son succès aidant, les toilettes sont devenues au Japon un sujet de fierté nationale.
Tant et si bien qu’en prévision des Jeux olympiques (JO) de 2020, la ville de Tokyo a confié aux meilleurs architectes du pays un programme de dix-sept toilettes publiques pour le bouillonnant quartier de Shibuya. Tel qu’il s’affiche sur le site de l’opération, le projet visait à dissiper les a priori négatifs attachés à ces équipements (mauvaise hygiène, odeurs, insécurité…). La qualité du design, le prestige des architectes (sur les seize sélectionnés, ils ne sont pas moins de quatre à avoir remporté un Pritzker), un système de nettoyage en continu et des sièges fabriqués par Toto devraient y contribuer.
Autre objectif affiché : la promotion d’une société inclusive, qui se traduit dans chaque projet par l’existence, aux côtés des toilettes hommes et des toilettes femmes, d’une troisième pièce, destinée à la fois aux personnes souffrant de handicap, à celles qui ont un bébé à langer et à celles et ceux qui refusent de se voir assigner un genre sexuel – reste à voir comment sera appréciée une telle conception de l’inclusion…
Teintes acidulées
Un virus ayant reporté les JO à une date incertaine, le programme a pris un peu de retard, mais la livraison se fait à un rythme régulier. Lundi 7 septembre au matin, dans le parc Jingu-Dori, une trentaine de personnes attendait ainsi l’ouverture des toilettes de Tadao Ando, petit cône anthracite serti de fines lames de béton et sectionné par deux disques en haut et en bas, qui rappelle le goût du maître pour l’épure géométrique.
Plus spectaculaires et ouvertement prototypiques, celles de Shigeru Ban ont été inaugurées vendredi 31 juillet. L’architecte à qui l’on doit, en France, le Centre Pompidou-Metz et La Seine musicale, a installé ses toilettes dans des caissons de verre aux teintes acidulées. Lavande, rose et orangé dans le parc Yoyogi Fukamachi Mini ; turquoise, vert, lapis-lazuli dans le parc Haru-no-Ogawa Play (ou Community). Les façades sont transparentes, ce qui rend possible de vérifier l’état des lieux depuis le dehors. Ce qui interroge aussi sur leur fonction réelle. Mais la provocation est une blague. Une fois la porte passée et refermée derrière soi, les vitres s’opacifient. Chacun, chacune se retrouve dès lors libre de faire ce qu’il ou elle a à faire en toute sérénité.
Littérature érotique : les 27 livres et BD incontournables
PAR Anne-Claire Norot, Bruno Juffin, Elisabeth Philippe, Emily Barnett, Jean-Baptiste Dupin, Jean-Baptiste Morain, Léo Soesanto, Louis-Julien Nicolaou, Nelly Kaprièlian, Philippe Azoury
De Catherine Millet à Oscar Wilde en passant par Guido Crepax ou J.G. Ballard, un panorama des plus grands textes érotiques pour tourner la page du confinement.
Les Chemins de désir de Claire Richard (2019)
Dans un texte d’abord pensé comme un podcast et adapté en livre, l'autrice explore les itinéraires du désir à travers la pornographie.
Une femme raconte et analyse son imaginaire érotique, le décompose, l’interroge, remonte jusqu’à ses origines : de quoi est-il fait, comment se structure-t-il ? Et si, à la base, il y avait une image – ou des images – qui a laissé une empreinte indélébile sur sa psyché pour le restant de sa vie, et va influencer toute sa vie sexuelle ? Cette image est pornographique.
Claire Richard se souvient de la découverte qu’elle a faite, enfant, d’un magazine pour adultes découvert chez ses grands-parents ; puis d’une planche de BD pornographique inspirée d’Histoire d’O de Pauline Réage… Plus tard, elle plongera dans la multiplication des images porno à l’accès si facile sur internet et la plateforme YouPorn. Enfin une femme parle de son rapport au porno. Claire Richard, qui est autrice de fictions radiophoniques, avait d’abord conçu ses Chemins de désir comme une série de podcasts pour la radio. NK
Sex Shop de Claude Berri (1972)
L'Amour, accessoires de Fleur Breteau (2017)
Quatre ans durant, l'autrice a travaillé dans une chaîne de loveshops. Elle en a tiré ce livre entre recueil de confessions et coulisses du métier.
“Les mecs, ça marche comme les interrupteurs, ils sont on ou off. Les nanas, c’est de l’art contemporain : j’y comprends rien.” Des aveux d’échecs, des confessions et des perles de drôlerie, Fleur Breteau en a recueilli des pleins cahiers. Entre 2007 et 2013, elle a œuvré, comme directrice artistique et comme associée, dans une petite chaîne de loveshops acidulés, Passage du Désir. Ambiance cosy coquine et friponnerie chic. De son expérience, elle a tiré ce recueil savoureux d’instants vus et vécus en magasin et nous fait pénétrer dans les coulisses du métier. D’un voyage au “supermarché du cul”, genre de hangar banlieusard où s’achètent en gros jouets pour adultes et accessoires fantaisies, on saute au Salon Vénus “de la fesse” à Berlin, grand raout des représentant·es du commerce X.
Mais les mots ici, ce sont surtout ceux des client·es qui passent le seuil de la boutique. Des mots chuchotés ou lancés avec quelque chose de frondeur ou, plus rarement, étranglés entre deux sanglots : “Parfois, nous étions tous les deux, vous et moi, les premiers à entendre les mots qui vous sortaient tout crus sans prévenir, que vos oreilles n’en revenaient pas et vos yeux s’agrandissaient jusqu’à en faire péter les arcades des sourcils (…). Et je faisais celle qui remarquait pas que ça chauffait au-dedans de vous.”
Oui, ça chauffait pour l’homme venu acheter un sextoy pour rallumer la flamme conjugale. Fleur Breteau lui conseilla un week-end en amoureux plutôt qu’un jouet violet aux airs d’épilateur électrique. Ça chauffait aussi, pour cette quadra distinguée qui cherchait un plug “pour s’élargir”, face à la lubie anale de son compagnon barbare. Et puis, ça s’enflammait complètement du côté de Jéjé, paysan esseulé, qui commanda sur internet un œuf masturbateur japonais pour remplacer “ses p’tites poules”.
Cette parole, tour à tour décomplexée ou drolatique, touchante ou déroutante, Fleur Breteau l’a façonnée, classée, taillée pour mieux la sublimer. Ainsi, elle dit la solitude et l’ignorance, les fantasmes et les pudeurs. Mais L’Amour, accessoires n’est pas une étude, l’autrice l’écrit : “Tout ce qui est raconté ici se déroule hors des statistiques.” Le texte, dès lors, se lit moins comme une enquête que comme un instantané sensible du paysage sexuel français. LS
La Belle Echappée de Nicholson Baker (2011)
Bienvenue au pays des Baisonours : l’Américain imagine une utopie où le sexe serait roi. Un beau conte de fesses.
C’est un pays des merveilles classé XXX, auquel on n’accède pas en passant par un terrier de lapin mais en se laissant aspirer par une variété d’orifices – trou de parcours de golf, sèche-linge, méat urinaire ou capuchon de stylo. Au-delà se trouve une terre de cocagne érotique, qui est aux amateur·trices de bombance charnelle ce que la chocolaterie de Roald Dahl est aux plus goulu·es dévoreur·ses de cacao : un lieu dévolu à l’exultation des sens, au décuplement des désirs et au foisonnement des fantasmes. Avec ce roman paru en 2011 aux Etats-Unis, Nicholson Baker dévoie en effet le conte de fées au contact du Kâmasûtra.
Narrées, pour l’essentiel, sur le ton de la fantaisie naïve, les aventures de Shandee, Dave, Rhumpa et les autres doivent une grande partie de leur charme au décalage entre l’égalité d’humeur de la prose (“C’est là que nous trouvons les essences dures dont sont tirés nos saladiers et notre ligne Dendros de godemichés…”) et l’extravagance des objets, situations et métamorphoses qu’elle décrit.
Dotés d’une plasticité proprement cartoonesque, les corps échangent sans frontière de genre leurs organes génitaux, les arbres se muent en hardeurs patentés et des hommes sans tête font de dociles sex-toys ; à l’entrée de ce parc d’attractions, d’émoustillantes têtes de chapitres promettent aux badauds monts (de Vénus) et merveilles (de la science) – “Henriette opte pour la pompafesses”, “Polly visite la Salle aux Pénis”, “Luna s’accouple avec un arbre à chibres”, “Rhumpa rend visite au pornomonstre” ou “Dave récupère sa bite d’origine”. Implicitement féministe (ce sont les filles qui mènent la danse), volontiers humoristique (le monde parallèle de la “maison des trous” est régi par des règles d’une absurdité carabinée) et gaillardement parodique, le livre de Baker se cantonne délibérément à une sexualité saine, solaire, consensuelle et désinhibée. BJ
Comtesse d’Aude Picault (2010)
L’éducation sensuelle d’une jeune aristocrate du XVIIIe siècle racontée avec une extrême finesse.
Dans les années 1970, l’âge d’or de la gaudriole, les kiosques de gare n’avaient rien à envier aux sex-shops. A l’heure où la BD érotique connaît une spectaculaire remontée de sève, il n’est pas très étonnant que l’on redécouvre ce sous-genre qui a marqué une jeune génération.
Aude Picault ouvre le bal avec Comtesse, une historiette coquine en costumes et sans paroles. Ignorante des choses du sexe, la comtesse connaît une nuit de noces décevante mais, en l’absence de son mari (qui préfère les hommes), elle va peu à peu s’éveiller à la chair. Comtesse est donc le récit d’une initiation sensuelle, thème classique de la littérature libertine du XVIIIe siècle, où l’éducation sexuelle sert souvent à illustrer un propos moral plus large. Rien de cela dans Comtesse, qui se concentre sur l’essentiel : les sensations, l’imaginaire et le plaisir. Avec une grande économie et beaucoup de finesse, Aude Picault montre le cheminement intellectuel et sensuel de la comtesse. D’abord intriguée par ses lectures, puis troublée par des fleurs, une carte à jouer ou un pot de confiture, elle finit par se donner à son viril et discret majordome, même si la frontière entre la réalité et le fantasme n’est jamais très claire. JBD
Bolero de John Derek (1984)
La Jument d’Esparbec (2009)
Une Emma Bovary en herbe devient l’héroïne d’un roman pornographique baroque, raffiné et haletant.
Auteur déjà d’une demi-douzaine d’ouvrages érotiques (La Foire aux cochons, Monsieur est servi, Le Goût du péché, etc.), Esparbec emmène loin et longtemps avec sa Jument. Mariée à un avocat de province fort mal outillé, Mélanie de Challonges ne rêve que de pouvoir fuir cette ennuyeuse existence bourgeoise pour explorer les replis de sa sexualité. Une scène clé (déclenchée par une palpation mammaire chez son gynécologue) révèle la forte libido de cette héroïne, qui décide de prendre des cours d’équitation chez Hugo von Pratt, un curieux éleveur de chevaux ayant pour élèves la totalité des femmes mariées de la ville.
Entre les scènes d’écurie où Mélanie se fait prendre moult fois entre bottes de foin et crottins fumants, et celles, atteignant des pics de raffinement pervers, où elle devient la dame de compagnie d’une baronne sadique qui l’exhibe nue dans ses cocktails, il y aurait de quoi piquer du nez. Que nenni. Bien qu’innombrables, ces cochonneries résultent chaque fois d’une infusion lente, d’une dramaturgie précise et diversifiée, soucieuse de ménager ses effets. L’auteur introduit régulièrement un nouveau motif, déplaçant le centre de gravité de l’action : un nouvel accessoire, une position particulièrement difficile à réaliser, l’entrée en scène d’un voyeur. Le porno réclame d’être décoré. Et c’est en raccrochant son livre à cet art du superflu qu’Esparbec livre un roman pornographique très divertissant. EB
Les Rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez
Eloge des fétichistes de Pierre Bourgeade (2009)
Disparu en 2009, Pierre Bourgeade reste l’auteur d’une œuvre monumentale sous le sceau du fétichisme.
Pierre Bourgeade avouait conserver plus facilement les enveloppes des lettres qu’on lui envoyait que les lettres elles-mêmes. L’expéditeur, pour y apposer les timbres, avait obligatoirement léché l’enveloppe, et c’est cela et rien d’autre qui intéressait Bourgeade. Il avait été jusqu’à faire l’acquisition de deux lettres que Céline avait envoyées depuis son exil au Danemark. Deux lettres qui, par chance, étaient dans leurs enveloppes d’origine, cette surface que Céline avait naturellement mouillée de sa propre excrétion. Achetant ces lettres, Bourgeade devenait à la minute même le propriétaire de la salive célinienne et, ce faisant, pouvait s’imaginer en posséder le secret. C’est toujours la même histoire : on aime la totalité d’une œuvre littéraire dans la ferveur suscitée par le seul fétiche.
Cette histoire de bave et d’éternité, Bourgeade l’a racontée dans L’Objet humain (Gallimard/L’Infini, 2003) beau livre d’entretiens menés par Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot, ses éditeurs chez Tristram. Et c’est, comme de juste, chez Tristram que sort en 2009 de manière posthume Eloge des fétichistes. Un éloge qui prolonge L’Objet humain, s’empare souvent des mêmes souvenirs mais les emmène assez loin, vers une globalisation totale du fétiche : le monde, chez Bourgeade, est fragmentaire, parcellaire, et chaque morceau choisi, retranché, adoré ne se soustrait pas au monde, ne s’arrache pas à lui, ne se sépare pas du tout, mais au contraire le démultiplie.
A la fin du livre, quand chaque fétichisme aura été raconté, dessiné le monde dans son entier ne sera plus lui-même qu’un immense fétiche, divisible à l’infini, chaque partie ayant ses adorateurs voyant dans le morcellement de leur adoration le début d’un cosmos. Fétichisme des orteils, des seins, des fesses, de la bouche, de la voix, du tigre, des talons hauts, des formes rondes, de la couleur rouge, de l’immobilisation, de l’androgynie, de la boue. Fétichisme de la mort, aussi. PA
Journal de l’amour – Journal inédit et non expurgé des années 1932-1939 d’Anaïs Nin (2003)
Anaïs Nin dévoile sa sexualité hors norme à travers le récit d’une vie amoureuse multiple et de sa liaison avec son père. Un monument du genre.
La part la plus sulfureuse de l’œuvre de Nin sommeillait en fait dans son Journal : publié pour la première fois en 1969, mais dans une version délestée de ses passages les plus licencieux, Inceste reparaît en 1992 sous une forme cette fois non expurgée. Tirée du Journal de l’amour, qui s’étend de 1932 à 1939, cette section concerne presque exclusivement la vie sentimentale et sexuelle de Nin. Au plus proche, par définition, de son ressenti, l’écriture y explore un désir cru et un appétit charnel hors norme, à travers un défilé de figures masculines sacralisées.
Concentré sur les années 1932-1934, Inceste nous fait entrer dans l’intimité de sa relation avec Henry Miller et son épouse June – dont elle a déjà conté l’éclosion dans Henry et June. Bien que Miller soit à plusieurs reprises dépeint comme un ogre sexuel, doué d’une libido hors du commun, la sensualité affleure surtout dans la complicité charnelle que nouent les deux femmes.
La démesure sexuelle chez Nin suit le chemin d’une transgression, et va atteindre son paroxysme à travers la liaison incestueuse qu’entame Nin avec son père en 1933. Père et fille se réunissent pour quelques jours dans un hôtel de Valescure, en France. La jeune femme goûte ce temps passé avec ce père, pianiste célèbre et don juan, qui a quitté sa mère tôt et manqué à son enfance. Chez ce père vieillissant, mais toujours beau et charismatique, elle reconnaît “l’homme que j’avais cherché dans le monde entier. (…) Le lion, le roi de la jungle, l’homme le plus viril que j’aie jamais connu”. Hantée par cette liaison, Nin ne l’incorpore pas moins à la somme des autres qui cohabitent dans sa vie. Anaïs s’estime en effet coupable de “quadruplicité en amour”. Au début des années 1930, ses amants “fixes”, en comptant son père, s’élèvent à cinq – sans parler des unions fugaces. EB
La Vie sexuelle de Catherine M. de Catherine Millet (2001)
Confession sexuelle du XXIe siècle, résolument contempraine et sans pathos ni psychologie, La Vie sexuelle de Catherine M. a fait pénétrer la littérature française dans le XXIe siècle.
En 2001, la directrice d’Art Press, intellectuelle avant-gardiste, lançait une petite bombe littéraire qui allait bouleverser les codes de l’écriture du sexe, et exploser tous les clichés de la représentation de la vie sexuelle des femmes par elles-mêmes. Dans La Vie sexuelle de Catherine M., elle racontait non seulement sa vie sexuelle dans tous ses détails, non seulement celle-ci était hors normes, mais aussi elle le faisait sans pathos, sentimentalisme, psychologie, sans non plus culpabilité, et encore moins d’idéologie. Irrécupérable, donc. Inexcusable, aussi, pour certains. En un mot : libre. Et c’est peut-être ce qui choqua le plus, mais qui fit son immense succès.
Millet narrait avec force détails cliniques, comme on décrit une œuvre d’art, ses expériences sexuelles : le nombre de ses amants, connus d’elle comme anonymes, ses goûts que d’aucuns auraient cachés – aimer s’abandonner à une multitude d’hommes, être prise par plusieurs lors de partouzes, ou dans une camionnette au bord d’une autoroute… Comment, une femme puissante pouvait adorer être soumise dans le sexe ? Comment, une femme-sujet pouvait revendiquer son désir d’être objet érotique ? Une femme pouvait donc décider de cela sans s’en sentir dégradée, humiliée, rabaissée ? On a beaucoup comparé la littérature de Millet à celle des libertins du XVIIIe siècle. Elle était, en revanche, ultra-contemporaine, ultra-novatrice, dans l’aspect extrêmement précis, sans enjolivure, de son style pour aborder la sexualité. En faire un sujet d’écriture comme un autre. Débarrasser l’érotisme de ses clichés, de ses voiles, de ses faux mystères, et la pornographie de sa ringardise ou sa vulgarité. La Vie sexuelle de Catherine M. est construite comme une exposition, en quatre “installations” (chapitres) : “Le Nombre”, “L’Espace”, “L’Espace replié” et “Détails”. Sidérant, le texte a été traduit en 44 langues et est devenu un véritable phénomène littéraire. NK
Filles perdues d’Alan Moore et Melinda Gebbie (1991)
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sexuelle des héroïnes de votre enfance.
Quand Alan Moore (From Hell, V for Vendetta) revisite les histoires pour enfants, le résultat n’est pas à mettre entre toutes les mains. Fruit d’un travail de seize années avec Melinda Gebbie, dessinatrice devenue sa femme, Filles perdues est une relecture pornographique d’Alice au pays des merveilles, du Magicien d’Oz et de Peter Pan à travers le prisme de la vie sexuelle de leurs héroïnes, Alice, Dorothy et Wendy. Le célèbre scénariste de BD fait se rencontrer ces trois personnages, devenus adultes, dans un hôtel autrichien, à la veille de la Première Guerre mondiale. Alice, lesbienne initiatrice vieillissante, Dorothy, jeune Américaine délurée, et Wendy, Anglaise coincée, font connaissance, intellectuellement et physiquement, et reviennent sur leurs expériences sexuelles adolescentes, traumatiques ou épanouies.
Dans cette somme complexe et franchement salée, Alan Moore fait sa propre psychanalyse des contes de fées. Partant d’histoires qui n’ont cessé de soulever questions et interprétations depuis leur publication, il choisit d’aller au plus brut, mais aussi au plus tabou. Il mêle intimement fantasmes et éléments clés des romans originaux, détourne les codes, met chaque personnage et événement au service de son exégèse salace. Chez Dorothy, l’ouragan devient son premier orgasme, le bûcheron en fer-blanc et le lion, ses conquêtes ; pour Wendy, Peter Pan est un jeune hédoniste ambigu, la fée Clochette, une nymphette à peine pubère, et le capitaine Crochet, un vieil arthritique pédophile ; quant à Alice, la potion est une drogue, la chenille, un dealer, et la Reine de Cœur, une mère maquerelle…
Le trait de Gebbie, soigné, puisé dans les dessins et peintures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, évoque tantôt Mucha, Beardsley, Steinlen, Schiele, tantôt certains classiques de la BD pour adultes comme Sweet Gwendoline de John Willie ou Liz et Beth de Georges Lévis. Moore et Gebbie façonnent ainsi une atmosphère de grande partouze psychédélique et joyeuse, qui butera sur la Première Guerre mondiale. ACN
Les 110 Pilules de Magnus (1986)
Elégante adaptation d’un roman érotique chinois très cru par l’auteur italien, maître du fumetti.
L’auteur italien Magnus, pseudonyme de Roberto Raviola, décédé en 1996, fut, dans les années 1960, l’un des artisans des fumetti neri (BD noires italiennes). Librement adapté d’un épisode du Jin Ping Mei, roman-fleuve érotique chinois de la fin du XVIe siècle, le livre décrit les aventures sexuelles d’un riche marchand libertin, Hsi-Men cheng. Pour accroître sa virilité et satisfaire ses maîtresses, il se procure auprès d’un moine médecin cent dix pilules aux puissants effets aphrodisiaques. Commence alors un ballet effréné de parties de jambes en l’air avec épouses et nouvelles conquêtes, jusqu’à l’extase puis la déchéance finale. Allègre et leste, le livre évite toute vulgarité par la finesse et l’élégance des dessins, la douceur des traits, les influences Art Nouveau. Mais Les 110 Pilules n’est pas qu’une suite de scènes de cul béates. Des regards inquiétants, une scène d’humiliation et d’outrage laissent aussi filtrer une perversité magnétique et troublante. ACN
De Catherine Millet à Oscar Wilde en passant par Guido Crepax ou J.G. Ballard, un panorama des plus grands textes érotiques pour tourner la page du confinement.
Cérémonies de femmes de Jeanne de Berg (1985)
Maîtresse SM et épouse d’Alain Robbe-Grillet, Catherine Robbe-Grillet se dissimulait derrière le pseudo de Jeanne de Berg pour signer le récit de ses cérémonies, et nous ouvrir les portes d’un univers secret.
En 1956, un certain Jean de Berg publie L’Image aux Editions de Minuit, un roman érotique qui sera aussitôt frappé par la censure. Vingt-neuf ans plus tard, sur le plateau d’Apostrophes au milieu d’invités médusés, apparaît une certaine Jeanne de Berg, petite et gracile, le visage masqué par une voilette. Elle est l’invitée de Bernard Pivot pour présenter Cérémonies de femmes, le livre étonnant où elle consigne les cérémonies BDSM qu’elle organise entre femmes. Tous la regardent sans savoir s’il s’agit d’une farce ou d’un véritable phénomène. Pivot suggère alors qu’elle est l’épouse d’un écrivain célèbre, dont le nom ressemble à “jupe brûlée”.
Jean ou Jeanne de Berg, c’est en fait Catherine Robbe-Grillet, née en 1930, qui a épousé le pape du Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet, en 1957 ; d’abord initiée par son mari au rôle de soumise, elle réalisera vite qu’elle est plutôt dominatrice, qu’elle aime les mises en scène théâtrales, une forme de déplacement du sexe dans un rituel sadomasochiste encore prolongé ou accentué par l’écriture d’une scénographie, l’imagination d’un décor, l’ajout d’artifices… Bref, dans la recréation tridimensionnelle d’un univers totalement fantasmatique, onirique, dont la plus grande beauté réside aussi dans son caractère éphémère. Un moment troublant, inédit, qui ne se partage qu’entre participant·es.
Catherine Robbe-Grillet a toujours refusé que ses cérémonies soient filmées, et “vues” par des non-initié·es autrement que par l’écriture de ses livres. Cérémonies de femmes nous ouvre donc les portes d’un monde parallèle au nôtre (nous, les non pratiquant·es), d’un culte esthétique, cérébral, ritualisé, littéraire, d’autant plus érotique – et non pornographique – qu’il comporte ses propres codes, secrets. NK
Le Journal de Valentina de Guido Crepax (1985)
L’auteur italien a su redonner ses lettres de noblesse à la fesse dessinée : la preuve avec Valentina, icône ultime à forte valeur érotique.
De l’œuvre de Guido Crepax, Roland Barthes disait simplement “le dessin qui bande”. Barthes y aura vu la chair faite langage, préoccupation de cet ex-illustrateur de pochettes de disques de jazz, architecte de formation et surtout père de Valentina (née en 1965), héroïne qui transcenda le fumetti, la BD coquine à l’italienne. Une icône de la “bande dessinée pour adultes” sans doute plus légitime qu’une Barbarella, parfaite incarnation des chapelles sixties en -isme : érotisme, esthétisme et même trotskisme.
D’abord personnage secondaire (copine d’un super-héros mineur, Neutron), Valentina la jet-setteuse, pas dupe et boudeuse, occupera le devant de la scène dans des intrigues de science-fiction, d’espionnage, virant progressivement à l’hallu saphique ou onaniste. Elle est selon l'auteur “la rêveuse masochiste, la photographe toute-puissante, la plus belle des androgynes avec le plus beau derrière du monde”. Crepax modèle son héroïne sur l’actrice du muet Louise Brooks. Sa frange, son regard lointain et, surtout, sa sensualité indécente de par son innocence même. Crepax et Brooks finiront même par se lier et correspondre, l’actrice lui avouant qu’il était le seul artiste, avec le cinéaste G.W. Pabst (Loulou), à avoir saisi son essence iconique : celle d’une “créature stupide, et qui n’existe pas”.
Jamais vulgaire, le trait épuré, le corps se fragmente de case en case, tel du split-screen ou les photogrammes d’un film expérimental. Crepax stratifie l’éros comme il se doit : réel, encore plus gratifiant lorsque irréel, chargé de psychanalyse et de politique, charnel et cérébral. LS
Les Infortunes de la Belle au bois dormant d’Anne Rice (1983)
Une récréation : pour son autrice et pour le·la lecteur·trice, embarqué·e dans un conte de fées habilement revu et corrigé en version SM.
Au rayon érotisme + fantastique, Anne Rice est bien sûr connue pour ses Chroniques des vampires, avec ses suceurs de sang hypersexués. C’est seulement dans les années 1990, au faîte de cette gloire vampirique, que l’autrice avoua avoir pris une petite récré SM, sous le pseudo-francisant d’A. N. Roquelaure, avec sa trilogie dite des Infortunes de la Belle au bois dormant.
On savait que, loin de Charles Perrault, le conte originel était déjà très connoté puisque le Prince réveillait la pauvre Belle non d’un baiser mais en la violant. Image forte, très nécrophile, que n’ont pas oubliée les films Kill Bill – Volume 1 (Uma Thurman en sex-toy, plongée dans le coma) ou le Sleeping Beauty de Julia Leigh (de façon littérale). Rice brode longuement, après cette scène originelle, selon un curieux feuilleton à rebondissements. Après avoir été “sauvée” par le Prince, Belle devient son esclave sexuelle, prétexte à mettre en scène un monde médiéval encore plus libidineux que dans Le Trône de fer, où des princes et princesses sont chair à harem, forcé·es à copuler, à ramper comme des animaux, à être fessé·es et humilié·es en public. Ce traitement est censé leur enseigner la sagesse.
Même si Rice déniaise la légende, le·la lecteur·trice est toujours un peu à distance, amusé·e. Ce petit monde ritualisé croise Histoire d’O (pour l’initiation) et Disneyland (avec ses esclaves transformé·es, exhibé·es en poneys à partir du second volume), où le licencieux est encadré, monté sur rails. Le style neutre, presque factuel, où les dialogues sont au bord de l’harlequinade très épicée, renforce ce climat de parc d’attractions pour adultes. Dans sa préface, Rice écrit ainsi : “Le lecteur est invité à s’identifier avec les esclaves, à jouir lui-même de leur condition. Il ne s’agit pas ici de réelle cruauté, il s’agit de s’abandonner, de s’amuser à imaginer que vous n’avez d’autre choix que de prendre plaisir au sexe.” LS
Omaha danseuse féline de Reed Waller et Kate Worley (1978)
Un comic book qui défraya la chronique avec son propos leste et libre.
Après la grande gueule Fritz the Cat de Crumb qui ronronnait au début des années 1970, la chatte Omaha apparut sous le crayon de Reed Waller à la fin de cette même décennie. Danseuse nue, Omaha se trouve mêlée à une lutte pour le contrôle des clubs de strip-tease de la ville. Se succèdent ainsi courses-poursuites et scènes du quotidien, et parmi celles-ci quelques parties de jambes en l’air naturelles et spontanées. L’anthropomorphisme contribuant à esquiver les foudres de la censure, Omaha est une des premières héroïnes américaines à se montrer libre de son corps et de ses désirs.
Si Waller (accompagné de son amie Kate Worley) revendique quelque chose, ce n’est alors ni la libération de la femme comme Crepax, ni la subversion comme Pichard, mais simplement le bonheur ordinaire, la simplicité de ne pas avoir à se cacher, de vivre sa sexualité avec joie et innocence. ACN
Crash ! de J.G. Ballard (1973)
J.G. Ballard imagine la fusion du sexe et de la technologie, et choisit la voiture comme métaphore du désir contemporain.
“Elle, l’utérus transpercé par le bec héraldique de l’emblème du constructeur ; lui, déchargeant sa semence sur les compteurs lumineux qui marqueraient à jamais l’ultime température et l’ultime niveau d’essence de la machine.” Ouvert au hasard, Crash ! n’émoustille pas littéralement, pas vraiment en fait. On le lit, on l’imagine comme un voyeur qui dénuderait des idées – comme chez Sade, la meilleure pornographie qui soit, celle qui tient de l’abstraction, qui énonce que tout est possible, même avoir Elizabeth Taylor en guest-star. Ici, c’est la fusion du sexe et de la technologie imaginée par J.G. Ballard en 1973, une vision anxieuse mais moderne. De quoi inquiéter une éditrice anglaise de l’époque, qui décréta après lecture que Ballard était “au-delà de toute aide psychiatrique”.
Car Crash ! n’a pas envie de rassurer. Après un accident de voiture, son narrateur James Ballard prend son pied avec les collisions, les ébats en bagnole et sa rencontre avec Vaughan, un performeur obsédé par les morts automobiles de célébrités. Ballard (l’écrivain) déroule sur voie rapide la vie sexuelle de personnages semi-zombies et vrais névrosés, maris, femmes et amant·es, maintenu·es en vie par le fantasme de passer à l’acte (Crash ! déploie autant d’énergie à imaginer le sexe qu’à le figurer). Le livre devient vite une litanie de pénétrations hommes/femmes, humain/voiture et voiture/voiture. C’est froid, objectif comme un contrôle technique et fascinant.
Ballard fait de la voiture une métaphore du désir contemporain, instantané mais jamais assouvi, autodestructeur. En bon dérapage sur la SF, Crash ! décrit comment la technologie nous change. Sa formulation est très simple mais saisissante : les corps ne sont beaux qu’une fois encastrés ou frottés au volant, les parkings à étages sont des lupanars. Aujourd’hui, il suffit de remplacer “voiture” par “smartphone” pour que Ballard conserve son acuité. Plastique contre métal, ergonomie contre pesanteur, mais la même dictature de la vitesse et de l’ubiquité (mais sans avoir à se déplacer), le même objet de désir tactile. La technologie chez Ballard touche à l’intime, par des raccourcis des plus troublants, façon sex-toy chromé. LS
Le Nécrophile de Gabrielle Wittkop (1972)
En 1972, Gabrielle Wittkop publiait son premier livre : au-delà d’un homme qui baise les morts, un roman d’amour universel.
Gabrielle Wittkop (1920-2002) osait dire qu’elle aimait le sexe mais pas les enfants, l’érotisme mais pas les entraves. Elle se revendiquait sadienne et fille des Lumières. Elle avait l’angoisse lumineuse et le rire d’un noir d’encre. On ne saurait trop conseiller de se plonger, ou de se replonger, dans la lecture du Nécrophile, texte appartenant depuis sa première parution, en 1972, au petit cercle fermé des romans vénéneux. Livre qui n’en finit pas de reparaître, destiné à l’éternelle résurrection.
Lucien N., antiquaire à Paris, a atteint “un état nécrophilique presque idéal”, baise des cadavres depuis longtemps lorsqu’il commence son journal. Les dates sont aussi étranges et anachroniques que le temps lorsqu’il est mental : elles se mélangent et ne forment qu’un temps amoureux, rythmé par le recommencement rituel de la découverte du corps – enfants, adultes, vieillards, femmes, hommes, tous aimables parce que “purifiés” par la mort, cette “grande mathématicienne qui rend leur valeur exacte aux données du problème” – qu’il déterre au cimetière Montparnasse, séquestre plusieurs jours pour un huis clos d’un érotisme lancinant, jusqu’à l’inévitable séparation.
Chairs verdies, bleuies, jets provenant d’une bouche brusquement ouverte, odeurs de bombyx puis relents de charogne, corps parfois habités parce qu’il les garde trop longtemps, dans l’espoir vain de repousser les limites du possible et la souffrance de la séparation : les amours nécrophiliques portent en elles leur propre inachèvement, l’impossibilité d’une suite, l’échec, d’avance, d’une réciprocité, l’obligation d’une séparation éternelle.
Suzanne, sa passion, qu’il tente de conserver à force de sacs de glace et de courants d’air, pour qui il abandonne travail et société, avec qui il s’enferme jour et nuit pour des plaisirs condamnés non pas tant par la morale que par la fuite du temps et le délabrement des chairs. Si les mots de Lucien, les phrases de Wittkop, accomplissent le miracle troublant de rendre, en les décrivant avec sensualité, la vie aux chairs mortes, jamais ils n’animent le désir de ce corps en cours de décomposition. Le nécrophile n’est pas seulement celui qui aime un mort, c’est celui qui aime un autre qui ne le désire pas. Amours limitées, humaines et pathétiques : si le texte et son narrateur nous bouleversent autant, c’est qu’au-delà des apparences il s’agit bien d’un des romans d’amour les plus mélancoliques qu’on ait lus ; qui dit l’immense tristesse d’un être dont la vie elle-même serait éternellement différée, condamné à ne pas être aimé, à la solitude et à lui-même. NK
Barbarella de Jean-Claude Forest (1964)
Héroïne fantastique et fantasmatique, Barbarella bouscula les codes et les années 1960.
Sur grand écran et dans une version (par Roger Vadim) kitsch et pas si féministe que ça, Barbarella fut incarnée par la très progressiste Jane Fonda. Son modèle de papier l’était un peu moins, puisque Jean-Claude Forest la modela – semble-t-il – sur Brigitte Bardot (tout de même encore une ex de Vadim). Deux actrices qui parachèvent le statut d’artefact pop sixties de cette série (d’abord parue en feuilleton à partir de 1962). Avec ses aventures spatiales sexy, Barbarella faisait le pont entre le passé (les comics innocemment héroïques à la Flash Gordon) et la libération sexuelle d’alors, consacrant l’idée de BD pour adultes. En France, il s’agit de la première héroïne de BD. Mais de ces strips il ne faudrait pas tant en retenir l’érotisme – certes un peu daté aujourd’hui – qu’un univers psychédélique réussi, saupoudré de Lewis Carroll et d’humour. LS
Emmanuelle d’Emmanuelle Arsan (1959)
Dans la chaleur de Bangkok, l’éducation sexuelle d’une jeune bourgeoise très ouverte. Un classique devenu culte.
Dans l’imaginaire collectif, Emmanuelle, c’est le fauteuil en rotin et les petits seins diaphanes et parfaits de Sylvia Kristel. On se souvient plus du film de Just Jaeckin à l’esthétique seventies que de la série de livres qui l’a inspiré, œuvre en partie autobiographique d’Emmanuelle Arsan, romancière et épouse de diplomate. Salué à sa sortie par André Breton et La Nouvelle Revue française, le premier volume de cette saga érotique paraît en 1959 dans une édition clandestine, cinq ans après Histoire d’O, son antimodèle. Loin des souffrances mystiques de l’héroïne de Pauline Réage, Emmanuelle Arsan se veut l’apôtre d’un érotisme irréligieux et joyeux.
Emmanuelle, jeune mariée de 19 ans, part rejoindre son époux installé à Bangkok et va découvrir mille et une voluptés dans les bras d’hommes et de femmes, toujours dans une ambiance très “dîner de Monsieur l’ambassadeur”, les Ferrero en moins, les threesomes en plus.
Rien que dans l’avion qui l’emmène en Thaïlande, Emmanuelle fait l’amour avec son voisin de cabine, puis avec un inconnu qui l’entraîne dans les toilettes : “Elle faillit laisser échapper un cri lorsqu’elle vit le reptile herculéen qui se dressait devant elle hors de sa broussaille dorée.” Emmanuelle Arsan aime beaucoup les métaphores animales pour évoquer l’anatomie intime, mais elle peut aussi se montrer plus directe et les scènes gagnent alors en efficacité.
Dans la première moitié du livre, la plus haletante, Emmanuelle se masturbe – beaucoup – ou baise quasiment à chaque page, avec Marie-Anne l’adolescente dévergondée, avec la comtesse Ariane après une partie de squash ou sous la douche avec Bee, une belle et mystérieuse Américaine. Quelques citations de Mallarmé ou de Goethe se faufilent de temps en temps entre les sexes trempés et les fantasmes moites. Malheureusement, il arrive que les protagonistes cessent de baiser pour parler. EP
Histoire d’O de Pauline Réage (1954)
Chef-d’œuvre de la littérature érotique et mise en scène d’un SM mystique et extrême, Histoire d’O trouble toujours autant.
Histoire d’O est une ode à la soumission comme abandon absolu à l’autre. Pour Jean Paulhan, auteur de la préface intitulée “Le Bonheur dans l’esclavage”, ce roman est “la plus farouche lettre d’amour qu’un homme ait jamais reçue”. Et c’est à lui qu’elle était destinée, adressée par sa maîtresse Dominique Aury sous le pseudonyme de Pauline Réage. Paulhan avait mis la jeune femme au défi d’écrire un tel livre. A sa sortie, le roman fit scandale. François Mauriac décréta même qu’il s’agissait d’un livre “à vomir”. Aujourd’hui, Histoire d’O n’a rien perdu de sa charge transgressive ni de sa puissance érotique. Le sadomasochisme extrême qu’il met en scène demeure toujours aussi fascinant et subversif.
O consent librement à être enchaînée, lacérée, prostituée, marquée au fer rouge. Par amour. “Sous les regards, sous les mains, sous les sexes qui l’outrageaient, sous les fouets qui la déchiraient, elle se perdait dans une délirante absence d’elle-même qui la rendait à l’amour, et l’approchait peut-être de la mort.” C’est d’abord pour son amant, René, qu’elle accepte ces sévices. C’est lui qui la fait entrer au château de Roissy, où O est initiée aux règles de la vie d’esclave sexuelle. Un lieu clos aux allures de couvent plus que de bordel. Les femmes dorment dans des cellules, doivent rester silencieuses et portent l’habit, non pas la robe et le voile, mais un corsage qui laisse voir les seins aux aréoles fardées de rouge et une jupe qu’il faut porter remontée dans une ceinture serrée. Elles peuvent être prises à tout instant et par n’importe qui, les maîtres comme les valets, souvent repoussants.
Les allusions à la vie monastique sont nombreuses dans Histoire d’O et viennent souligner la dimension mystique de cette extase dans la souffrance. En obéissant corps et âme aux désirs de ses maîtres, René d’abord puis Sir Stephen auquel elle est livrée, O entre pour ainsi dire dans les ordres – sexuels et non religieux. Dans l’ascèse, elle fait vœu de jouissance. Peu à peu exclue du monde, elle porte les stigmates de son bannissement : l’anneau au doigt ; celui, double avec “un triskel niellé d’or sur une face”, qui perce son sexe ; et sa chair marquée au fer rouge. Mais O n’est jamais victime. “C’est une destruction dans la joie”, commentera laconiquement Dominique Aury. Jusqu’au bout, O choisit son sort et assume son désir. EP
Querelle de Brest de Jean Genet (1947)
Un roman comme une lame de fond, qui porte le désir à son point d’incandescence, jusqu’à l’horreur.
Jean Genet publie Querelle de Brest en 1947, à Lyon. Le volume, infamant, pédéraste comme aucun autre dans la littérature française, restera six ans sans nom d’éditeur sur sa couverture, avant que Gallimard ne le ressorte en 1953, dans une édition quelque peu lavée. On se demande bien – maintenant que cette édition expurgée a été définitivement écartée du commerce (l’édition courante en Imaginaire Gallimard reprend le texte de 1947) – comment on a pu croire, même l’espace d’une seconde, pouvoir ôter à Querelle quoi que ce soit de sa charge érotique : c’est simple, elle est partout, dans tout. Pas un mot, pas une image qui en réchappe, qui ne fasse pas la démonstration, la déplie, de toute sa puissance évocatrice. Alors, Querelle de Brest coule. Il coule du désir qui l’inonde jusque dans les interstices de la phrase.
La page, Genet l’envisage comme une lame de fond qui va, vient, déferle, se brise, se retire pour composer dans l’écume une série de fantasmes, une association de fantasmes : un fantasme de marin s’épanouissant dans un fantasme de meurtre sordide, se faisant tailler des pipes par des fantasmes de matelots jusqu’à ce qu’un fantasme de lame s’enfonce dans un fantasme de carotide, et Genet, repu, de pouvoir enfin, à ce terme, parler du “tendre des roses, du rouge des fraises” de la gorge quand on la tranche, quand la lame coupe le marin de sa vie.
Son érotisme ne travaille qu’à ça : pousser les paradoxes du désir à leur summum de vérité, plonger jusque dans l’honnêteté d’un désir toujours mêlé d’horreur, écrire des images jusqu’à faire éclore de beaux oxymores, ces beaux oxymores armés de lames que sont ces anges incapables d’autre chose que de perfection esthétique et ne trouvant nulle part ailleurs que dans le crime l’extrême pointe de leur présence au monde, là, parmi la brume de Brest, le pantalon blanc taché du sperme crème d’un autre. PA
De Catherine Millet à Oscar Wilde en passant par Guido Crepax ou J.G. Ballard, un panorama des plus grands textes érotiques pour tourner la page du confinement.
L’Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence (1928)
Lorsqu’une jeune femme bien née et mariée goûte aux joies de la sexualité avec son garde-chasse, c’est toute la société qui se sent menacée. Une ode bucolique à la liberté du corps et de l’esprit.
“Aimeriez-vous que votre femme ou vos domestiques lisent ce livre ?” En 1960, trente-deux ans après sa parution en Italie, L’Amant de Lady Chatterley de l’auteur anglais D.H. Lawrence sortait enfin en version non expurgée en Grande-Bretagne, et sa publication donna lieu à un retentissant procès pour obscénité contre l’éditeur Penguin. La célèbre question posée par le procureur Mervyn Griffith-Jones n’eut pas raison de l’ouverture d’esprit du jury, qui jugea Penguin non coupable. Les foules britanniques purent enfin goûter à ce roman à la réputation sulfureuse – trois millions d’exemplaires furent vendus en Grande-Bretagne dans les trois mois suivants. Elles découvrirent alors enfin l’histoire de l’impudique Constance, jeune femme issue de la bourgeoisie intellectuelle mariée à un baronnet qui revient de la Grande Guerre paralysé et impotent. Délaissée sexuellement, constatant amèrement le déclin de son corps jamais touché, Constance se détache peu à peu de son mari et trouve du réconfort dans les bras du garde-chasse du domaine, Oliver Mellors. Alors que Constance s’éveille aux beautés du sexe, lui, malheureux en ménage, retrouve tendresse et plaisir d’être avec une femme.
Lu aujourd’hui, L’Amant de lady Chatterley n’a rien de graveleux ni même de torride. Les scènes de sexe sont brèves et moins nombreuses que celles, bucoliques et sensuelles, célébrant avec poésie les beautés de la nature. L’acte sexuel y est résumé dans des termes gentiment soft (“L’homme fit glisser doucement et soigneusement jusqu’aux pieds de Connie le mince fourreau de soie, puis avec un exquis frisson de plaisir, il éprouva la chaleur de son corps et déposa un baiser sur son nombril. Il dut la pénétrer immédiatement, accéder à la paix terrestre que lui offrait ce corps tranquille et doux.”).
Cette mixité sociale née de la sexualité, la revendication de leur droit au bonheur malgré leur différence de statut, le fait qu’ils osent aller contre les conventions avaient finalement plus de quoi choquer la bourgeoisie et l’aristocratie que leurs tendres ébats. ACN
L'Apollonide : Souvenirs de la maison close, de Bertrand Bonello (2011)
Le Con d’Irène de Louis Aragon (1928)
Une œuvre sauvée in extremis de la destruction mais reniée par son auteur, qui laisse ici libre cours à un flot de libido littéraire.
Nous sommes en 1926 et Louis Aragon, 29 ans, a laissé définitivement tomber ses études de médecine pour se consacrer aux activités du groupe surréaliste, où il tient le rôle de second d’André Breton. Seulement, la poésie ne nourrit personne. Aragon signe un drôle de contrat avec le couturier et collectionneur Jacques Doucet : chaque mois, contre la somme de 1000 francs, il lui livrera ses écrits. Aragon, dans une sorte de rage graphomane motivée par la faim, écrit une grande œuvre intitulée La Défense de l’infini. Le Con d’Irène est le seul fragment qui en demeure aujourd’hui. Louis Aragon est à l’époque l’amant de Nancy Cunard, héritière richissime de la compagnie maritime Cunard. Leur liaison est houleuse. En novembre 1927, dans un accès de rage (auto) destructrice, Aragon détruit la plus grande partie (1500 feuillets, dit-il) de La Défense de l’infini dans un hôtel de la Puerta del Sol, à Madrid – avant, quelque temps plus tard, de tenter de mettre fin à ses jours lors d’un séjour vénitien avec Nancy.
En douze chapitres, le poète écrit une œuvre éclatée où se reflètent toutes ses contradictions. Aragon, comme ses amis surréalistes, croit à l’amour fou : contre la pornographie perverse du bourgeois (dans Le Con d’Irène, Aragon va au bordel, décrit les ébats auxquels il assiste mais avec une sorte de dégoût), l’orgasme ne trouve son point culminant que dans l’union absolue, même temporaire, entre un homme et une femme.
L’érotisme est d’abord dans cette libido littéraire qui innerve le livre, une sorte de jet continu de poésie entrecoupé de stases plus romanesques. Ensuite dans ces descriptions cauchemardesques ou fascinées de la liberté sexuelle des autres, des émissions séminales du sexe d’Irène aux ébats plus ou moins incestueux et lesbiens de sa mère. Mais si Le Con d’Irène est un livre qui comporte des scènes pornographiques, rarement son auteur semble y trouver un quelconque plaisir, loin des fanfaronnades machistes de la plupart des pornographes. JBM
Les Onze Mille Verges de Guillaume Apollinaire (1907)
Sous les initiales G. A., Apollinaire publie en 1907 une épopée tumultueuse qui conte les tribulations d’un noble roumain à travers le monde des perversions sexuelles.
Effrontément licencieux, Les Onze Mille Verges rivalise d’imagination délinquante avec les forfaits de Fantômas. Ou, du moins, avec ce qu’auraient pu être ces forfaits si Souvestre et Allain avaient cherché l’inspiration dans le Psychopathia Sexualis de Richard von Krafft-Ebing.
Aussi exhaustif que le savant ouvrage publié en 1886 par le psychiatre austro-hongrois, le roman recense en une centaine de pages quelques millénaires de perversions sexuelles. Et le fait à un train d’enfer, en suivant le parcours d’un nobliau roumain (quoique francophile) ouvert à toutes les positions, combinaisons et exactions érotiques. De Paris jusqu’en Extrême-Orient, le prince Vibescu et ses comparses – le cambrioleur queutard Cornabeux et les courtisanes Culculine d’Ancône et Alexine Mangetout – en pincent pour l’hétérosexualité gaillarde, l’homosexualité vigoureuse et le saphisme gourmand, ne rechignent jamais devant des écarts nécrophiles et/ou coprophiles, croisent d’éloquents apologistes de la pédophilie ou de la zoophilie et s’épanouissent dans le sadomasochisme.
Bien que l’équipée priapique du prince laisse dans son sillage une montagne de cadavres émasculés, éviscérés ou empalés, nulle dimension transgressive ne vient introduire dans ce foutoir la moindre parcelle de philosophie – on est loin du souci d’inversion des valeurs qui caractérise l’œuvre de Sade, Les Onze Mille Verges opte pour une paillardise rabelaisienne, excelle dans les pastiches de poèmes symbolistes comme dans l’humour de corps de garde, et exhibe les incontournables ingrédients de l’érotisme Belle Epoque que sont l’adiposité des formes et la luxuriance tropicale des pilosités. Ici, tout est gros – les mots, les membres virils, les fessiers, les poitrines et les rebondissements grand-guignolesques, la cavalcade par un trépas en forme d’apothéose : condamné à être flagellé par onze mille verges, le prince Vibescu rend l’âme sans broncher, tandis que les trilles des oiseaux de Mandchourie rendent “plus gaie la matinée pimpante”. BJ
Teleny d’Oscar Wilde (1893)
En marge de ses écrits, qui abondent déjà en références à une philosophie hédoniste et en jeux de mots à double sens, Oscar Wilde rédigea un étonnant roman érotique à tendance pornographique.
On a longtemps douté de la paternité de Teleny, petit roman paru en 1893, sous le manteau et à tirage très limité. Sans doute était-il embarrassant de trouver soudain tant de pornographie chez l’incomparable artiste qu’était Oscar Wilde. Et puis, les conditions mêmes de sa composition (il s’agirait du résultat d’un pari d’écrire à plusieurs mains) le rendaient décidément louche. Il était plus réconfortant d’imaginer que Wilde n’avait pas beaucoup touché à cette succession de scènes obligées (l’éducation sentimentale interrompue avec la découverte de la chère amie faisant pipi ; la visite au bordel qui tourne à l’orgie la plus ignoble ; les scènes d’amour hétérosexuel qui suivent le cahier des charges : missionnaire, levrette, masturbation, fellation, etc.) aboutissant à de longues descriptions de tendres ébats homosexuels. En réalité, il semble bien que, d’une idée ébauchée avec quelques amis, il ait été le seul à accoucher sur papier.
C’est un récit de possession d’un homme par un autre homme, René Teleny, qui apparaît comme un idéal synthétisant toutes les aspirations artistiques et sexuelles de Wilde. Tout ce qui ne sacrifie pas aux obligations pornos est ici d’une rare sincérité, et la fatale attraction du narrateur pour Teleny s’avère finalement bien plus érotique que le détail de leurs copulations. La noirceur des pages consacrées aux galipettes hétérosexuelles (qui s’achèvent toujours dans la mort et l’effroi) ne vise d’ailleurs qu’à rendre plus solaire l’union passionnelle, fragile, menacée, nécessairement clandestine, et dont dès le début il semble qu’elle finira mal, des deux jeunes hommes.
Le Roman de Violette de la marquise Mannoury d’Ectot (1883)
Un roman d’initiation aux choses de l’amour qui met en scène, au XIXe siècle, trois visages du saphisme.
Longtemps une énigme, Le Roman de Violette, publié par “une célébrité masquée” à Bruxelles en 1883 mais daté “Lisbonne, 1870”, est désormais attribué à la marquise Mannoury d’Ectot. Si la qualité du texte a pu donner quelque crédit aux pistes menant à Alexandre Dumas ou Théophile Gautier, l’apologie de la liberté amoureuse et la sensibilité aux émotions féminines trahit celle qui signa aussi “la vicomtesse de Cœur-Brûlant”. Née Mademoiselle Le Blanc, la marquise se retrouva veuve assez jeune et usa de sa fortune à la manière d’une Madame Verdurin normande, accueillant généreusement poètes, artistes et musiciens, parmi lesquels Verlaine ou Maupassant. Ruinée après 1870, elle se réfugia en Belgique, où elle continua à fréquenter les milieux littéraires. Prenant à son tour la plume, elle devint la première autrice avérée de clandestins érotiques.
On lui accorde aujourd’hui trois romans licencieux, dans lesquels elle paraît raconter dans son salon ce qu’elle faisait dans son boudoir. Dans Le Roman de Violette, Christian, un peintre, recueille Violette, une jeune lingère qui vient d’échapper aux désirs brutaux de son employeur. Il installe l’innocente adolescente dans sa garçonnière et entreprend de l’initier avec attention aux choses de l’amour. Anatomique et sensuelle, cette éducation est aussi philosophique, Christian défendant ardemment le droit naturel des femmes à disposer d’elles-mêmes. Ralliée à ces vues progressistes, Violette se trouve toute disposée à goûter aux plaisirs que lui offre la comtesse Odette de Mainfroy, une riche veuve dégoûtée des hommes par son mari. Pour préserver le trio, désormais lié par un pacte sensuel, la comtesse va être amenée à séduire une jeune actrice, Florence, connue pour ses penchants lesbiens. A travers Violette, Odette et Florence, d’Ectot dessine trois images du saphisme : curiosité, passion et dédain. Sans aller toutefois jusqu’à envisager que l’homme puisse complètement sortir du tableau. JBD
La Vénus à la fourrure de Leopold von Sacher-Masoch (1870)
Ce chef-d’œuvre à la longue descendance met en scène la jouissance sadomasochiste dans un écrin fascinant.
Etrange destin que celui de Leopold von Sacher-Masoch. Auteur au romantisme exacerbé, il composa une œuvre variée qui fut si largement appréciée en son temps qu’elle lui valut le surnom de “Tourgueniev de la Petite-Russie” et que, parmi d’autres, Hugo, Zola et Ibsen en firent les louanges.
Mais, dès son vivant, il tombe dans l’oubli, et aujourd’hui encore, s’il se rappelle à nous, ce n’est qu’à travers une forme de sexualité à laquelle il a involontairement donné son nom – le masochisme –, terme inventé par le psychiatre Krafft-Ebing pour désigner une perversion vieille comme le monde : la flagellation était pratiquée dès l’Antiquité, notamment lors de rites magico-sexuels et, bien avant que Sacher-Masoch ne commence à écrire, la soumission absolue à une maîtresse insensible avait déjà conduit plus d’une âme romanesque à se délecter de son propre naufrage.
Néanmoins, cette cristallisation du nom de Sacher-Masoch sur le rituel érotico-flagellatoire est justifiée par le magnifique écrin littéraire offert par le premier au second, La Vénus à la fourrure. Presque pas d’ébats ici. On fouette, on foule aux pieds, on emprisonne et on soumet, oui, mais les corps se dénudent peu et l’amour physique est toujours pudiquement voilé. Et pour cause : l’exultation ne doit naître que de la douleur, de la honte, de l’anéantissement de soi-même.
Séverin a fait la rencontre d’une jeune et belle veuve, Wanda von Dunajew. L’un cherche une idole à laquelle soumettre sa volonté, l’autre entend épuiser sa vitalité à la manière antique, en exerçant sa cruauté sur un esclave, le temps de chercher un maître capable de la dompter. Un pacte est passé. La nouvelle Vénus sera autorisée à punir toujours plus durement son adorateur. Elle sera toujours vêtue d’une fourrure, fétichisation symbolique de la toison pubienne, parure fauve et hypnotique qui caressera ses formes lisses et froides de déesse immaculée mais la salira assez de désir pour la rendre “plus que nue”, selon le mot de Baudelaire.
Dans l’étouffante torpeur de leur huis clos pervers, et à mesure que les limites imposées par le contrat menacent d’être franchies, la dérive des deux amants rend leurs comportements et leurs sentiments de plus en plus énigmatiques, de plus en plus fascinants. LJN
Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir de John Cleland (1748)
Une jeune fille du XVIIIe siècle raconte sa vie de travailleuse du sexe en gardant la distance vertueuse de l’amoureuse. Le premier roman pornographique britannique longtemps censuré.
“Ce jeune et soyeux duvet éclos depuis quelques mois et qui promettait d’ombrager un jour le doux siège des plus délicieuses sensations, mais qui jusqu’alors avait été le séjour de la plus insensible innocence.” L’un des grands charmes de Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir réside dans ses circonlocutions foisonnantes pour désigner la bagatelle. Suffisant pour que les censeurs en 1748, année de parution, accusent le livre et son auteur John Cleland de “corrompre les sujets de Sa Majesté”. Et pour que le premier roman pornographique anglais soit longtemps lu et publié sous le manteau dans sa version uncut. Le livre fut encore jugé en 1964 lorsqu’un éditeur londonien tenta de le republier. Perversion, décréta la justice britannique, sur la foi d’une scène de flagellation. Elle eut gain de cause : mais, rassurons-nous, les Britanniques peuvent de nos jours lire Fanny Hill sans faire de vague.
Le livre se présente sous la forme de deux longues lettres, auto-apologétiques, écrites par l’héroïne à une mystérieuse destinataire. Fanny, ex-travailleuse du sexe, justifie son parcours : comment, orpheline, elle finit bonne dans un bordel où la patronne veut la prostituer. Comment sa virginité devient un enjeu. Comment Fanny découvre le plaisir avec les femmes, le voyeurisme puis l’amour de sa vie, un jeune noble du nom de Charles. Comment le destin sépare Charles et Fanny. Comment Fanny gagne sa vie en monnayant son corps. Un tunnel de péripéties, d’ébats à deux, à plusieurs, homo/hétérosexuels, tout en rondeur et volupté.
Mais la grande affaire de Fanny dans sa confession est d’affecter sa distance dans le récit du stupre, d’être une verbeuse vertueuse. Loin de virer hypocrite après moult pages d’“engins” passant sur le gazon, Mémoires de Fanny Hill penche vers le manifeste individualiste où l’on dispose de son corps. Apollinaire, qui signa la préface d’une édition française, estimait qu’elle était “la sœur anglaise de Manon Lescaut, mais moins malheureuse”. LS
La mort de Camille Réto en 1911 à Belle-Ile, symbole de l’horreur des bagnes pour enfants
Incendies : “Ça finira par se refroidir” - en Californie, Trump sort de nouveau la carte du déni climatique
COURRIER INTERNATIONAL (PARIS)
Le président américain a balayé lundi d’une phrase les inquiétudes sur le réchauffement lors d’une visite en Californie, en proie comme toute la côte ouest des États-Unis à des incendies d’une ampleur historique. Ces feux ont injecté la question du changement climatique dans une campagne dominée jusqu’ici par la pandémie, l’économie et la justice raciale, note la presse américaine.
Sa petite phrase choc a été reprise en boucle lundi par tous les médias américains. “Ça va se refroidir”, a lancé Donald Trump à un journaliste qui l’interrogeait sur le rôle joué par le changement climatique dans les incendies.
Le président américain a “profité de sa visite” dans la région de Sacramento, en raison des immenses feux de forêt qui ravagent la Californie, pour “remettre en question le consensus scientifique selon lequel le réchauffement de la planète est une cause majeure de ces incendies destructeurs”, note le Washington Post.
Le candidat démocrate Joe Biden s’est au même moment déchaîné contre son rival en le qualifiant de “pyromane du climat”, lors d’un discours en plein air à Wilmington, dans l’État du Delaware où il habite. “Ces visions contraires de la question climatique se sont retrouvées en pleine lumière médiatique lundi, alors que l’avion du président américain atterrissait à Sacramento”, raconte le Mercury News.
Le réchauffement, grand oublié de la campagne
Pour le Washington Post, les feux “ont directement injecté la question du changement climatique dans une campagne présidentielle dominée jusqu’à présent par la pandémie, l’économie chancelante, les manifestations pour la justice raciale et la question des capacités de leadership des deux candidats”. Mais “le réchauffement de la planète et son impact sur la vie quotidienne sont désormais difficiles à ignorer”, conclut le quotidien américain.
“Trump qui a, par le passé, qualifié le réchauffement climatique de canular, s’est très peu exprimé au sujet des dizaines d’incendies qui ont déjà brûlé 1,2 million d’hectares en Californie, tué au moins 20 personnes et recouvert l’État de fumée”, rappelle le San Francisco Chronicle. La semaine dernière, il a brisé son silence lors d’un meeting de campagne dans le Nevada en jugeant que les feux étaient entièrement la conséquence d’une “mauvaise gestion forestière”.
57 % des forêts en Californie appartiennent à l’État fédéral, 3 % seulement au Golden State
“Certes, la Californie et d’autres États de la côte ouest pourraient faire beaucoup plus pour rendre les forêts plus résilientes face au feux. Mais comme l’a rappelé lundi le gouverneur Gavin Newsom, le gouvernement fédéral possède 57 % des forêts en Californie, contre 3 % seulement pour le Golden State, et le reste est privatisé”, note le comité de rédaction du Los Angeles Times, dans un éditorial.
“Malgré ce déséquilibre”, le gouverneur démocrate a aussi précisé que la Californie dépensait “cinq à six fois plus” que le gouvernement fédéral dans la lutte contre les incendies et la foresterie. “C’est donc au gouvernement fédéral d’en faire beaucoup plus”, “en partenariat avec les États et les propriétaires fonciers”, souligne les journalistes du Los Angeles Times.
“Mais au-delà de ça, l’approche myopique de Trump consistant à se concentrer sur la gestion des forêts passe à côté du plus gros problème”, conclut le quotidien californien. “Le réchauffement climatique est indéniablement la cause de l’aggravation des feux”.
Noémie Taylor-Rosner
Covid-19 : l’Europe doit se préparer à une hausse de la mortalité cet automne, prévient l’OMS.
Le directeur de la branche européenne de l’organisation sanitaire Hans Kluge a mis en garde le continent sur le fait que les mois d’octobre et de novembre devraient être “plus durs” que la période actuelle, pendant laquelle le nombre de morts quotidiens est resté au niveau observé depuis début juin, autour de 400 à 500 par mois. Le responsable onusien a estimé que la situation devrait désormais appeler une réponse ciblée et non plus des confinements généralisés. En France, les préfets de Gironde, du Nord et des Bouches-du-Rhône ont renforcé lundi les mesures pour juguler le Covid-19 en augmentation. Ils ont notamment décidé de restreindre les visites dans les Ehpad et ont appelé à limiter les rassemblements dans la sphère privée. Malgré le fait que la France cherche à relancer son économie, l’hexagone “craint fortement qu’un confinement ne soit de nouveau nécessaire”, note le Business Insider Deutschland. Dimanche, le gouvernement israélien a été contraint d’adopter cette solution, “malgré la grande résistance des entreprises”, rappelle le site.


















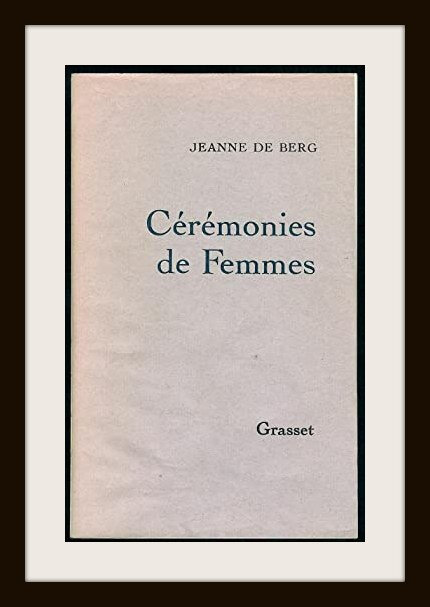




















/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)