Reportage - Vieillissement, précarité et Covid-19 : à Copacabana, chronique d’une catastrophe annoncée
Par Bruno Meyerfeld, Rio de Janeiro, correspondant
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire du célèbre quartier de Rio de Janeiro un terrain favorable à la pandémie due au coronavirus. L’impéritie du gouvernement de Jair Bolsonaro a encore accéléré la donne. Et les rues autrefois glamour se sont transformées en épicentre de la crise sanitaire. Comme une parabole de la situation du Brésil.
En septembre 2019, je me suis installé à Copacabana pour y vivre. Je ne m’attendais pas, en quelques mois seulement, à voir ce quartier mourir. Vivre dans ce lieu légendaire de Rio de Janeiro, pour moi, franco-brésilien, c’était d’abord le fruit du hasard. La quête ardue d’un appartement à travers la ville merveilleuse m’avait mené vers ce petit deux-pièces de la rue Santa-Clara. On s’y sentait bien, à deux pas du posto 3 de la plage et tout près du bucolique jardin Bairro Peixoto, où il fait si bon rêvasser à l’ombre des amandiers et des flamboyants.
Mais Copacabana, cet « arc de l’amour », cher à Vinicius de Moraes, doux père de la bossa-nova, ça restait aussi et encore pour moi un rêve, un objet de désir. Pourtant, en ce mois de juin, alors que la pandémie due au coronavirus déferle sur le Brésil, le poète reconnaîtrait-il sa plage chérie ? Avec près de 200 victimes et 1 700 cas officiellement recensés, Copacabana est aujourd’hui le quartier de Rio le plus touché par l’épidémie, avec les taux de décès et de contamination de loin les plus élevés de la ville.
La plage, méconnaissable
Après Sao Paulo, son éternelle rivale, Rio est devenue le deuxième épicentre du Covid-19 au Brésil. Près de 5 000 décès et de 40 000 cas positifs y ont été recensés (pour 40 000 morts et 800 000 malades au Brésil, devenu l’un des principaux foyers de la pandémie dans le monde). Face au drame en cours, les autorités locales ont réagi tardivement et surtout partiellement, fermant lieux culturels, églises, jardins et commerces non essentiels… mais se refusant à rendre le confinement de la population obligatoire.
Ci-gît donc Copacabana. Bienvenue à « Copacorona ». Commençons par l’évidence : la plage. Lors de notre dernier passage, fin mai, elle était méconnaissable. La mairie a interdit des semaines durant l’accès à l’eau et au sable, fermé kiosques et commerces, prohibé le stationnement des voitures, chassé les vendeurs ambulants. Sous le beau soleil, la « princesse de la mer » ressemble à un désert. « Un cimetière même ! », déprime Alonso Igual, 62 ans, vieux loup de mer qui tient depuis plus d’une décennie un château sculpté dans le sable pour touristes sur le front de mer.
Casquette délavée, barbe moutarde, peau tannée par le soleil, Alonso crapote sa Marlboro en silence, les yeux perdus sur le trottoir mosaïque pavé de noir et blanc, en forme de vague. Autrefois (il y a trois mois seulement), le Tout-Rio s’y pavanait à pas lent, impérial en minislip de bain rouge. Désormais, des Cariocas au regard inquiet y tracent rapidement leur route, bouches et narines masquées de près. « C’est triste de voir ça. Personne n’ose s’arrêter pour mon château. Je fais zéro reais par jour ! Tout le monde a peur… », rumine Alonso avant de balancer un crachat sur la promenade.
La pandémie a surpris Rio en plein hiver : le Carioca a froid, ferme portes et fenêtres (il fait 20 degrés). Dans ce blizzard (relatif), le silence prend ses aises, étire ses lourds bras et jambes sur les 78 rues, 5 avenues, 6 travessas et 3 ladeiras de Copacabana. Fini les bruyantes conversations entre voisins. Fini les rires. Fini la musique échappée des bars. Les grands axes se sont vidés. On ne sort que pour les courses au supermarché. L’asphalte appartient aux clochards solitaires, vêtus de couvertures et de sacs plastique. Le jour, il est hanté par les gangs de pigeons et la nuit par la mafia des ratazanas, ces terrifiants rats cariocas, de la taille de petits félins.
Le Copacabana Palace, fermé
Le Copacabanais (ou Copacabanense), je l’ai étudié pendant des mois : c’est un mammifère ultrasocial à sang chaud qui vit dénudé les trois quarts de l’année. Le voilà contraint de se revêtir d’un masque protecteur et de se tenir à distance de son prochain. « Les gens ont changé, ce n’est plus le même quartier », raconte Sandro Aurélio, pharmacien de 29 ans, qui effectue des livraisons un peu partout le long de la plage. « Avant, on papotait beaucoup avec les clients. Certains me prenaient même dans les bras ! Aujourd’hui, c’est à peine s’ils ouvrent la porte ou osent taper leur code de carte bancaire… et ils ne parlent plus que du coronavirus. »
À « Copacorona », la rue est métallique : on marche entre des rideaux de fer. Nombreux sont les lieux, ouverts nuit et jour depuis des décennies, à l’avoir baissé. C’est le cas du Pavão Azul, célèbre « pé-sujo » (« pied sale » : troquet miteux) ouvert en 1957, où on pouvait il y a peu s’envoyer entre amis sous les néons graisseux des bières glacées, coupées au mauvais maïs. Le même sort a frappé le libanais Baalbeck, et ses esfihas aux épinards, le portugais Adega Perola et ses sardines grillées, La Trattoria et son risotto truffé, le Galeto Sat’s et ses cœurs de poulet à picorer ou encore le Cervantes et son inégalable sandwich ananas-dinde-fromage.
Mais le plus célèbre des claquemurés, c’est évidemment le Copacabana Palace, symbole de la plage et phare de « Copa ». En ce mois de juin, le somptueux hôtel couleur crème me fait l’impression d’une grosse pannacotta congelée. Ouvert en 1923, il est portes et piscines closes pour la première fois en un siècle. Les 550 employés ont été renvoyés chez eux et les 225 chambres sont vides (à l’exception d’une seule, occupée par le chanteur Jorge Ben Jor, qui y réside à l’année). À l’entrée, une dizaine de drapeaux de pays du monde entier claquent au vent. Juste pour la forme. Tout est allé si vite, personne n’a eu le temps de se préparer.
Empruntons la petite rue arborée Domingos Ferreira, parallèle à la plage : sur la façade noire ornée de vaguelettes jaunes du théâtre Sesc Pompeia sont toujours collées les affiches des spectacles du mois de mars. Eglises, temples et synagogues ont quant à eux renoncé à leur show hebdomadaire : le culte se fait désormais en ligne sur YouTube. À l’extrême sud de la plage, le fort militaire de Copacabana, reconverti en musée, a retrouvé sa vocation de bunker, ses vieux canons pointés en vain vers le Pain de Sucre, inutiles dans la bataille qui se joue sur la terre ferme.
Une génération qui disparaît
Les portiers d’immeuble (invariablement originaires de la région du Nordeste) font office de soldats. « On est en première ligne, me confie Carley, débarqué il y a deux décennies depuis Hidrolândia, loin, très loin dans le Ceará. Dans mon immeuble, tout le monde se confine, il y a des gens que je n’ai pas vus depuis des mois. On a deux dames, âgées de 94 et 99 ans… Pour elles, je fais tout : les courses, les retraits d’argent, j’organise des rendez-vous médicaux. Elles se sentent très seules, on discute souvent au téléphone ou à la fenêtre, pour passer le temps. Je me sens très responsable. C’est comme si j’étais de leur famille. » Carley veut nous rassurer : « Pour l’instant, on n’a eu aucun mort. »
Dans le quartier, c’est pourtant une génération qui disparaît, emportée par le Covid-19. Il y a João Lourenço dos Santos, dit « Maguila », professeur bien-aimé de futevolei sur la plage, décédé à 70 ans, mais aussi Luiz Alfredo Garcia-Roza, célèbre auteur policier, inventeur du « Copacabana noir », parti à 83 ans. Dans les hôpitaux du coin sont aussi décédés plusieurs gloires cariocas, tel le père de l’art cinétique, Abraham Palatnik, 92 ans, ou Lourdes Catão, 93 ans, surnommée « la Locomotive », ancienne gloire de beauté glamour des années 1950 et 1960, à la grande époque de Rio et de Copabana.
Cet âge d’or, je connais quelqu’un qui l’a vécu : ma tante Antonieta, que, dans la famille, on appelle tous affectueusement « Tatà ». C’était une vraie Copacabanaise pur jus, indépendante, chic et fière de l’être. Tatà fumait des cigarettes américaines, servait le déjeuner dans de la porcelaine française et faisait de la gym sur la plage, coachée par une entraîneuse allemande. Elle fréquentait le cinéma Roxy, orné d’une belle colonnade rouge, sur l’avenue Nossa Senhora, faisait ses courses dans la luxueuse galerie Art déco Menescal et dînait de crustacés sur le front de mer, au restaurant Fiorentina. Dans son immeuble, l’Edifício Bagdá, au 28, rue Edmundo-Lins, l’entrée était décorée avec faste de grands tapis rouges, reproduisant le luxe fantasmé des palais orientaux.
Synonyme de luxe, glamour et modernité
À son époque, Copacabana était synonyme de luxe, de glamour, de modernité et donnait le ton au pays entier. Quelques décennies plus tôt, ce n’était pourtant qu’une simple plage. Un sertão lointain et exotique, séparé de Rio de Janeiro par de noirs sommets granitiques et recouverts de forêt sauvage. Le lieu est habité par une poignée de pêcheurs et de marins : des peruleiros, de retour du Pérou et de Bolivie, qui ont construit là une minuscule chapelle où trône l’image d’une vierge, célébrée sur les bords du lac Titicaca, de l’autre côté du continent : Notre-Dame de Copacabana. Elle donne son nom à cette baie incognita.
DÈS LE DÉPART, LA FUTURE « COPACORONA » EST PENSÉE COMME UN SUMMUM DE L’HYGIÈNE, MAIS AUSSI DE LA MODERNITÉ ET DU CHIC. (…) DÈS LES ANNÉES 1930, COPACABANA EST LA « PETITE PRINCESSE DE LA MER », UNE MARQUE QU’ON S’ARRACHE ET QUI ATTIRE LES PLUS GRANDS.
Celle-ci ne le restera pas longtemps. À la fin du XIXe siècle, le Brésil saute à pieds joints dans la modernité. L’esclavage est aboli, la République proclamée. La capitale, Rio de Janeiro, se sent à l’étroit dans sa baie de Guanabara. Elle réclame une nouvelle frontière. Son regard se porte vers le sud, direction l’océan et les plages de l’Atlantique. Dès 1892, la voie est ouverte, avec l’inauguration d’un premier tunnel (aujourd’hui surnommé « túnel velho » : le « vieux tunnel »), percé sous le morne de la Saudade. Un Novo Rio commence.
Il se remplit vite : dès 1920, le quartier compte 17 000 âmes. Au tournant du siècle, les bains de mer sont à la mode, censés exterminer les virus en tout genre. Brassées par de puissants courants marins, les fraîches eaux de Copacabana sont réputées pour leur propreté et attirent toute une petite faune de jeunes médecins, journalistes, avocats, industriels, qui a soif d’eau salée et surtout de lumière. Cette nouvelle aristocratie, « elite praina » (élite de la plage), se construit des chalets, cottages et bungalows, puis de petits palais excentriques sur le modèle de ceux de Biarritz ou de Long Island, et enfin de splendides immeubles Art déco, avec parking inclus pour garer la Porsche et la Cadillac.
Dès le départ, la future « Copacorona » est pensée comme un summum de l’hygiène, mais aussi de la modernité et du chic. On s’y rend en tramway, en voiture, voire en aéronefs, qui, au début du siècle, atterrissent sur le sable fin. Les rues sont asphaltées et éclairées par la fée électricité. On y ouvre le premier cinéma du Brésil dès 1909, puis le premier fast-food, le premier centre commercial, les premiers gratte-ciel. Le Brésilien y goûte ses premières glaces et y avale ses premiers hot dogs. Dès les années 1930, Copacabana est la « petite princesse de la mer », une marque qu’on s’arrache et qui attire les plus grands.
Le culte du corps musclé, bronzé et dénudé
Au Copacabana Palace, le marbre est de Carrare, le cristal de Bohême et les meubles sont français, bien entendu. Toutes les stars y défilent, comme dans un film : Edith Piaf, Ray Charles, Nat King Cole et Marlene Dietrich chantent dans la Golden Room, où Orson Welles s’enivre jusqu’à plus soif et Ginger Rogers donne des cours de danse. Dans les chambres, Joséphine Baker et Le Corbusier vivent une brève liaison, Sartre et Beauvoir goûtent à un luxe bien bourgeois. Au bord de la piscine, Mick Jagger et Janis Joplin font de discrètes longueurs (cette dernière se fera virer manu militari du palace pour avoir osé nager dans le plus simple appareil).
Le quartier s’endort la journée à la plage et se réveille la nuit tombée. Ici play-boys, jetsetteurs et autres socialites vivent le « grand monde » (en français dans le texte). On trouve cinémas, théâtres, clubs de musiques et surtout « boates » hétéros et gay, où la jeunesse s’enivre, danse et chante à tue-tête sous les volutes du lança perfume, ce spray désodorisant à base d’éther et chloroforme que l’on inhale à plein nez pour ses effets euphorisants. « Copa » c’est la « capitale interdite de l’amour », selon un tube des années 1950, un lieu de transgression, où tout est exposé et réinventé, à commencer par le corps : celui-ci doit impérativement être musclé, bronzé et surtout dénudé.
Fini les armures de coton : place au maillot de bain synthétique, qui colle à la peau, et dévoile peu à peu bras, jambes, épaules, puis les seins et enfin les fesses. À Copacabana, allongé sur cette petite baie de lumière, le Brésilien est un Narcisse heureux. Il se contemple et s’aime. Il devient un héros de film d’action, un super-Brésilien, « superhomme », « supersympa », « supervivant », « superchaud », comme le chantera en 1968 Caetano Veloso dans son Superbacana. À Copacabana, le Brésil est parfait, à l’aise dans ses contradictions : tout à la fois naturel et moderne, aristo et bohème, frénétique et paresseux, nu et élégant, achevé et infini. Pour la première fois, il est universel. Evidemment, ça ne durera pas.
Une densité de plus de 20 000 personnes au m2
Limité par les montagnes au nord et l’océan au sud, le petit quartier ne peut s’étendre au-delà d’un petit kilomètre de large sur quatre de long. Résultat : Copacabana est rapidement saturé. Entre 1920 et 1970, la population y augmente de 1 500 % (elle dépasse aujourd’hui les 160 000 âmes) ! À Copacabana, on compte plus de 20 000 êtres humains au kilomètre carré : quatre fois la densité moyenne de Rio et près de cinquante fois celle de Brasilia, qui ravit, en 1960, le titre de capitale à la « ville merveilleuse ».
On compense le manque de place par la hauteur et le manque de temps par la laideur. Dès les années 1950, une frénésie de construction s’empare de Copacabana, qui abandonne tout style architectural. Les derniers chalets sont rasés ou abandonnés. Place aux blocs de ciment tristes et aux cages à lapins. Un immeuble symbolise la transformation du quartier, le duzentão, au 200, rue Barata-Ribeiro : une baleine de béton couleur saumon pourri, surpeuplée et délabrée, comptant 507 appartements (45 par étage).
À 73 ans, Jane di Castro est l’une des grandes figures du quartier. « J’ai connu l’époque où les rues étaient pleines jour et nuit : personne ne voulait rentrer chez soi ! », se souvient cette transsexuelle à la chevelure blonde, chanteuse de profession (et coiffeuse à ses heures). Mais le Drink, « boate » où elle chanta tant de fois, a fermé, comme tant d’autres clubs fameux, comme les boutiques de luxe, comme presque tous les cinémas et les théâtres, remplacés par des églises évangéliques (désormais aussi nombreuses que les catholiques).
L’eau de mer, autrefois si pure, est souillée par les égouts. Les avenues aux allures d’autoroutes sont polluées par le passage quotidien de dizaines de milliers de voitures. « Le glamour s’en est allé », soupire Jane di Castro, qui incrimine les nouveaux venus. « À partir des années 1980-1990, avec l’arrivée du métro, les gens des quartiers populaires, moins éduqués, ont commencé à débarquer en masse et à s’installer ici. Les gens élégants et chics sont partis, maintenant, au bord de la plage, il n’y a plus que des gros ventres très laids en slips de bain ! », dit-elle, mépris de classe assumé.
La bohème et les plus fortunés ont fui
L’aristocratie de plage a abandonné le navire par la première chaloupe. Le dernier carré des socialites et play-boys vit reclus dans l’édifice Chopin de l’Avenida Atlântica, collé au Copacabana Palace, et reconverti en véritable forteresse du luxe. Là, après de longues et chaotiques tractations par WhatsApp, on a finalement réussi à obtenir un rendez-vous avec la très excentrique Narcisa Tamborindeguy. À 53 ans, cette grande mondaine, héritière d’une richissime famille basco-portugaise, reçoit le visiteur dans son salon, donnant sur l’océan, rempli de miroirs et de peintures à son effigie, qu’elle parcourt nerveusement en talons hauts et robe vermillon, digne d’une d’impératrice de péplum.
« COPACABANA N’EST PLUS LE CENTRE DU MONDE. C’EST DEVENU UNE SORTE DE BANLIEUE DANS UNE VILLE DE PROVINCE. » ANA DE HOLLANDA, EX-MINISTRE DE LA CULTURE
En guise d’interview, on se voit remettre quatre feuilles blanches format A4, les réponses à nos questions préécrites en rose fluo. On en extrait une phrase, vaguement mélancolique : « Ce quartier, pour moi, reste la “princesse de la mer”, il fait partie de ma vie, je suis née ici, j’y suis attachée, je n’en sors que pour sortir du Brésil. »
Narcisa doit se sentir bien seule. La bohème a fui vers le nord, à Laranjeiras et à Santa Teresa, les plus fortunés ont migré vers l’ouest, direction Ipanema, Leblon et Barra da Tijuca. Hormis quelques nostalgiques, ils sont bien peu dans le quartier à se revendiquer encore haut et fort Copacabanais. Ana de Hollanda, ex-ministre de la culture, sœur du chanteur Chico Buarque, est l’une des rares exceptions. « Copacabana n’est plus le centre du monde. C’est devenu une sorte de banlieue dans une ville de province. Ici, au moins, les gens ne sont pas chichiteux, l’inélégance est assumée. Alors, oui, il y a des nids-de-poule, un lampadaire sur deux fonctionne… mais j’aime bien cette décadence ! », me raconte-t-elle, depuis son petit salon, où trône, accroché au mur couleur sable, un poème dédicacé écrit de la main du poète Vinicius de Moraes, l’amoureux de « Copa ».
Une mauvaise réputation
Mais c’est un fait : le quartier traîne aujourd’hui une sale réputation. La décadente de Rio accueille désormais les plus marginaux de la société, garotas de programa (« prostitués ») et sans-abri par centaines. À Copacabana, les règlements de comptes et les attaques à main armée sont réguliers. Ils ont parfois lieu en plein soleil et à même la plage. La nuit, dans les rues vides et humides du « Rio noir », ça ne sent plus le lança perfume, mais plutôt les effluves de Javel du crack. Lors de la première nuit dans mon studio de Santa Clara, des coups de feu éclatèrent au bout de la rue : je me souviens encore du bruit des détonations, se réverbérant en écho le long des façades ; de l’image des voisins d’en face fuyant dans leur arrière-cuisine ; puis de ce silence angoissé qui avait nappé l’asphalte… le décor était planté.
Surtout, la « petite princesse » est devenue une vieille reine ridée. Le quartier est aujourd’hui le plus âgé de Rio et du Brésil : un habitant sur trois a plus de 60 ans. Sur l’Avenida Atlântica, à part les touristes, passent en nombre des Copacabanais aux cheveux blancs, à canne ou en déambulateur, voire en chaise roulante. Pour eux, tout est prévu : des salles de sport, des files de supermarché et des postes de police sont réservés aux seniors. « Je n’ai aucun ami de mon âge par ici. Quand on sort le soir, c’est quasiment jamais à Copacabana », confie Yannick, 30 ans, jeune résident du quartier.
« COPACABANA EST LE QUARTIER LE PLUS ÂGÉ, LE PLUS DENSE, LE PLUS SALE ET LE PLUS PRÉCARISÉ DE RIO. AJOUTEZ À CELA QU’IL DEMEURE LE PLUS TOURISTIQUE, ET VOUS AVEZ LE COCKTAIL PARFAIT POUR CRÉER UN GRAND CLUSTER. » HUGO CRASSO OLIVEIRA DE NASCIMENTO, MÉDECIN
Les anciens gratte-ciel de la jeunesse dorée sont devenus des Ehpad verticaux, remplis de vieux monsieurs et de dames âgées nostalgiques. Ainsi, la rigolote Dona Augusta, 94 ans, confinée chez elle, toute contente d’avoir de la visite, et qui reçoit debout, avec le sourire (mais sans masque) dans son petit appartement à la moquette poivre et sel. « J’ai vécu le Copacabana du temps de Bardot ! », dit-elle, le regard pétillant, avant de pester sec : « Tout est terminé maintenant, Copacabana, c’est un quartier vulgaire, pauvre et violent. J’ai peur quand je sors, je n’ai même plus envie de descendre dans la rue. D’ailleurs, je ne me souviens même plus de quand je suis allée à la plage pour la dernière fois. »
Le « super-Brésilien » de Copacabana a explosé en plein vol, et la pandémie s’est contentée d’achever un quartier mourant. « Il est tout à fait logique et naturel que ce quartier soit devenu l’un des épicentres du coronavirus au Brésil », nous explique Hugo Crasso Oliveira de Nascimento, 31 ans, médecin de famille, grosses moustaches noires dissimulées sous son masque chirurgical. « Copacabana est le quartier le plus âgé, le plus dense, le plus sale et le plus précarisé de Rio, donc forcément le plus vulnérable, résume-t-il. Ajoutez à cela qu’il demeure le plus touristique, donc le plus exposé, et vous avez le cocktail parfait pour créer un grand cluster. »
Des crises économiques à répétition
Copacabana compte six favelas, où habitent au moins 10 % de sa population. « Le coronavirus n’a pas résorbé la fracture sociale, au contraire ! », déplore Vânia Ribeiro, dynamique vice-président de l’association des habitants de la favela de Tabajaras qui donne rendez-vous pour papoter au calme sur le toit d’un centre commercial, dont les commerces sont quasiment tous fermés. Dans sa communauté, « beaucoup travaillent dans le secteur informel, comme vendeurs ambulants sur la plage, par exemple. Aujourd’hui, elle est fermée et ils n’ont plus de salaire, plus rien pour s’acheter à manger et aucune aide de la mairie », explique-t-elle.
Vânia a déjà dénombré 9 morts du Covid-19 et des centaines de cas suspects dans la favela, bâtie sur les pentes du morne de São João, juste en surplomb de l’un des meilleurs hôpitaux du pays, le Copa Star. Peut-elle y envoyer les malades du Covid-19 ? « Bien sûr que non ! C’est un hôpital privé, qui n’accueille que l’élite, totalement inaccessible pour nous, répond Vânia. Il refuse de nous recevoir, même pour une consultation de routine. Malgré la pandémie et le fait que les hôpitaux publics soient débordés, impossible de le faire changer d’avis. »
La déchéance de Copacabana, c’est finalement celle de Rio. « Mais, pour nous, les Copacabanais, la chute a été plus rude, car on partait de très, très haut », me fait remarquer Katia Vieira Amorim, 65 ans, dont la boutique hors du temps, Perucas Lady, sur la Barrata Ribeiro, propose depuis cinq décennies des perruques faites main dans un décor de théâtre. Elle aussi a connu sa déchéance. « Autrefois, on avait 11 boutiques dans tout Rio, qu’on a dû fermer une à une… On avait aussi une belle façade tout en bronze. Il a fallu démonter. (…) Des voleurs venaient la nuit pour la découper et la revendre », poursuit Katia.
Les crises économiques à répétition, dont celle qui dure depuis 2014, ont eu raison de la plupart des boutiques historiques du quartier. Ni la croissance de la lumineuse décennie Lula, ni les Jeux olympiques d’été organisés en 2016 n’ont permis de renverser la tendance et de redynamiser ce quartier à bout de souffle, abandonné à son sort et aux touristes.
Un score plébiscitaire pour Jair Bolsonaro
Katia, elle, peste contre les gouverneurs successifs de Rio de Janeiro, pratiquement tous passés par la case prison pour des affaires de détournement de fonds publics. « Ces politiciens corrompus et incompétents ont laissé ce merveilleux quartier plein de vie se dégrader d’année en année ! », attaque-t-elle.
Est-ce ce sentiment de déclassement, cette fierté blessée, qui a poussé les Copacabanais à se jeter dans les bras de Jair Bolsonaro ? Lors de l’élection présidentielle de 2018, ce dernier a remporté ici la majorité des voix dès le premier tour et un score plébiscitaire de 61 % au second. L’Avenida Atlântica, autrefois prisée par les intellectuels de gauche, est devenue le point de rassemblement des manifestants d’extrême droite, exigeant la levée des mesures de confinement et un retour de la dictature militaire. « On n’est plus très bien vu dans le coin », reconnaît Mathias Bidart, chaleureux Argentin et guitariste au bar Bip-Bip, dernier bastion de gauche de la plage, décoré de drapeaux du Mouvement des sans-terre et du Parti des travailleurs. « En novembre 2019, quand on a célébré la libération de prison de Lula, les voisins nous ont jeté des œufs », se rappelle-t-il.
Appauvrissement, explosion des inégalités et de la violence, évangélisation, déculturation, vieillissement et maintenant extrême droite et coronavirus… Copacabana a accompagné, voire anticipé, tous les changements profonds du Brésil. Pourra-t-elle réinventer son avenir ou a-t-elle joué sa dernière chanson ? Quelques semaines seulement avant l’arrivée du Covid-19, j’ai quitté Copacabana. Ni dégoûté ni lassé. Peut-être un peu déçu. Avant de laisser le quartier, histoire de « tuer la saudade », comme on dit au Brésil, je suis repassé une dernière fois au 28, rue Edmundo-Lins. « Tatà » est partie depuis longtemps, décédée en 2008, à l’âge canonique de 96 ans. À l’entrée de l’Edifício Bagdá, les grands tapis rouges ont été retirés et une vilaine grille en métal installée. Le grand spectacle de Copacabana paraissait bel et bien terminé.
Presse : très précaires pigistes
De nombreux free-lance se sont retrouvés brutalement sans revenus
Je préfère que vous ne donniez pas mon nom. » « Faites attention, je suis la seule fille du service pour lequel je travaille, on va savoir que c’est moi. »« Ne citez pas mes deux employeurs principaux, mes collègues vont me reconnaître tout de suite. » Difficile, quand on est journaliste précaire, payé à la pige ou en CDD, de faire valoir ses droits sans craindre les représailles. « Si j’ai du boulot depuis autant d’années, c’est parce que je la ferme, se persuade Juliette, célibataire et mère de deux enfants. On sait qu’avec moi il n’y a pas de problème. »
A la mi-mai, la jeune femme tirait pourtant désespérément le diable par la queue. Parce qu’elle n’avait pas encore été rémunérée pour des enquêtes menées au cours des douze derniers mois, ou parce qu’elle ne disposait pas de deux fiches de paie dans les quatre derniers mois − les deux principaux critères figurant dans le décret du 16 avril sur le chômage partiel −, elle n’avait accès au dispositif chez aucun de ses employeurs. « Heureusement que je suis logée et que mon ex m’aide financièrement », murmure-t-elle, croisant les doigts pour recevoir, un jour, les 10 000 à 12 000 euros qui lui reviennent.
Cagnottes spontanées
Quand le confinement a été instauré, de très nombreux journalistes ont vu leur activité disparaître. Plus de rencontres à suivre pour les journalistes sportifs, plus de films, de livres, d’albums ou de concerts inédits pour les critiques, plus de voyages pour les spécialistes du tourisme, plus de hors-séries ou de suppléments (supprimés) à remplir. Quand elle a mis en place un fonds d’aide d’urgence, la mutuelle Audiens, spécialisée dans la couverture des professionnels de la culture et des médias, a reçu en quinze jours autant de demandes d’aide qu’en une année et demie.
Dans certaines rédactions, comme à L’Equipe ou à France Télévisions, des salariés ont spontanément abondé des cagnottes. Des délégués syndicaux se sont battus pour intégrer les pigistes au décret sur le chômage partiel ou, quand cela a été nécessaire, rappeler les employeurs à leurs devoirs − certains ont essayé d’imposer des conditions supplémentaires, comme la détention de la carte de presse, alors que le texte ne le stipulait pas.
En mars et avril, Dan Perez, délégué SNJ-CGT à L’Equipe, recevait « 10 à 15 appels par jour » émanant des quelque 200 précaires embauchés à la pige par le groupe. Privés de matchs, les « livers », ces journalistes spécialisés dans le commentaire ultraprécis livré en direct, « ont vu leur activité passer de 100 % à zéro », justifie-t-il. « Comme on a tendance à penser que le foot ne s’arrête jamais, donc le boulot, on s’est retrouvés complètement démunis », reconnaît Thomas Fédérici, « liver » depuis neuf ans. Alors qu’il compte sur un revenu mensuel de 900 à 1 000 euros en moyenne annuelle, ce trentenaire a touché 600 euros de chômage partiel. Il ne s’estime pas à plaindre et fait avec, en attendant le retour des jours de match. Critique littéraire privée d’ouvrages par le confinement et de chômage partiel car de nationalité belge, Kerenn Elkaïm a résolument essayé de sublimer le moment : chaque jour ou presque, elle a mené des interviews d’écrivains du monde entier en direct sur Facebook. Pour la beauté du geste.
Début de carrière
Groupes WhatsApp pour comparer les situations et se défouler, velléités de monter des collectifs ou de se syndiquer, réflexions sur le métier… « Le seul avantage de cette histoire, c’est qu’entre indépendants, isolés comme jamais, on s’est enfin rapprochés », constatent nombre de jeunes gens avec lesquels Le Monde a échangé. Qui est payé ? Est-il vrai que si les piges s’arrêtent, cela équivaut à un licenciement ? Comment faire quand elles diminuent ? « Honnêtement, ça faisait du bien d’échanger, note Inès. Quand on est seul dans son coin, on n’a aucun poids. » Spécialisée dans la culture, elle a continué à recevoir des commandes, « mais, comme la pagination des magazines a baissé, j’en ai eu beaucoup moins qu’avant. Et ça continuera tant que la pub ne reviendra pas ». Son été sera placé sous le signe de la diète : comme mars, avril et mai lui seront payés en juin, juillet et août, « j’aurai un salaire riquiqui et plus de chômage partiel pour compenser ».
Quand on est payé à la tâche, mieux vaut « ne pas être un panier percé », confirme cette éditrice dans le sport, passée d’une vingtaine de jours de travail par mois à quatre. Elle a compris que la parenthèse Covid allait marquer durablement son début de carrière : « Avec l’Euro et les JO qui étaient prévus cet été, les jeunes professionnels comme moi aurions pu montrer ce qu’on avait dans le ventre, nous faire remarquer, décrit-elle. Au lieu de ça, non seulement on n’aura pas de boulot cet été, mais on en aura moins après : puisqu’on nous annonce un plan social, même les titulaires vont trinquer ! »
Au collectif Profession pigiste, Véronique Hunsinger juge qu’« il est encore très difficile de mesurer toutes les conséquences » de la crise sur le journalisme free-lance. « C’est pour les jeunes diplômés, que je m’inquiète », glisse-t-elle. Sans expérience, sans carnet d’adresses, et avec un éventail des possibles restreint comme jamais, leurs premiers pas dans le métier risquent d’être très compliqués.

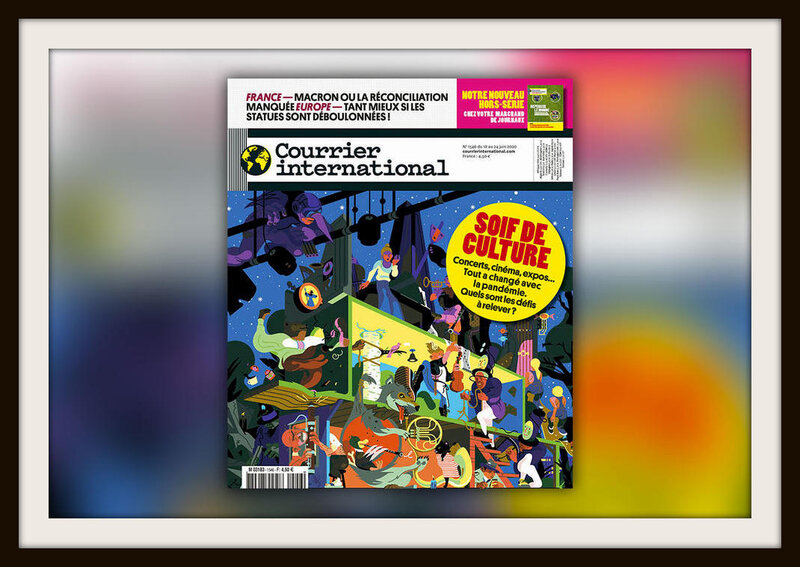













/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)