Par Michel Lefebvre
A la veille de l’anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, l’historien Julian Jackson présente une biographie qui renouvelle la vision autour du général, le dégageant de certains mythes.
L’année 2020 est celle de Charles de Gaulle avec trois anniversaires : les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de l’appel du 18 juin et les 50 ans de sa disparition.
L’historien britannique Julian Jackson, professeur à Queen Mary, University of London, dressera son portrait le 4 novembre 2020 au Mémorial de la France combattante-Mont-Valérien, lors d’une cérémonie organisée par l’ordre de la Libération.
Un hommage inspiré de l’imposante biographie qu’il lui a consacrée, parue en 2019 (Seuil) et intitulée De Gaulle. Une certaine idée de la France. Ce nouveau livre, couronné du Duff Cooper Prize, a été reçu plutôt favorablement dans l’Hexagone comme renouvelant la vision autour du général, le dégageant des mythes pour en donner une vision historique plus distanciée que celles de certains de ses biographes.
Pour comprendre le parcours du Général, il est nécessaire de revenir à sa période de formation et en particulier à ses écrits d’avant-guerre. Dans votre livre, vous traitez du de Gaulle théoricien militaire à travers ses livres « Le Fil de l’épée » (1932) ou « Vers l’armée de métier » (1934). Trouvez-vous que ce travail a été sous-estimé ou surestimé ?
Dans mon livre, je parle beaucoup des quatre livres que Charles de Gaulle a écrits dans l’entre-deux-guerres. Il m’intéresse moins comme théoricien de la guerre que comme analyste de ce qu’on appelle en anglais le leadership, l’idée du chef, les relations entre la politique et le militaire, et cela me semble très important de comprendre la réflexion qu’il développe dès les années 1920 et 1930. Il est un intellectuel. Sa réflexion est beaucoup plus profonde et plus intéressante que celle d’un théoricien militaire.
Ce qui est fascinant, par exemple dans son premier livre intitulé La Discorde chez l’ennemi (1924), écrit juste après la première guerre mondiale, c’est son analyse des raisons de la défaite de l’Allemagne : c’est un livre de réflexion sur la relation entre le politique et le militaire. Selon lui, une des raisons de la défaite, c’est le déséquilibre entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire et le fait que, en Allemagne, les militaires avaient essayé sans succès de tout contrôler. Il réfléchit également sur l’importance des circonstances – de la contingence (il est très bergsonien) dans la vie politique et sur la nécessité de savoir s’adapter.
Que peut-on dire sur le positionnement de Charles de Gaulle dans l’échiquier politique des années 1930 ?
C’est une question importante. Je voulais éviter ce que l’on pourrait appeler une vision téléologique, c’est-à-dire de voir déjà le de Gaulle de 1940, le de Gaulle de 1945 ou le de Gaulle de la Ve République, dans celui des années 1930. Pour moi, sa trajectoire n’était pas écrite d’avance.
Dans les années 1930, on ne peut pas décrire Charles de Gaulle comme un homme de gauche, c’est un homme de droite, un conservateur, c’est pour cela que je reproche à la très grande biographie de Jean Lacouture de surestimer le côté « républicain » de De Gaulle dans les années 1930. Par exemple, quand Jean Lacouture écrit que déjà, dans les années 1930, il défendait la liberté contre le totalitarisme.
Je pense que, idéologiquement, il aurait pu basculer dans un sens ou dans un autre. Il y a un côté très autoritaire dans ses écrits des années 1920 et 1930, l’obsession du rôle du chef, une espèce de défiance, partagée par beaucoup de Français, à l’égard de la vie parlementaire et d’une République qui ne fonctionne pas.
Il ne va pas vers la gauche, mais il s’écarte de la droite, sa famille normale, parce qu’elle a adopté une position d’apaisement à l’égard de l’Allemagne par obsession de l’anticommunisme et, pour Charles de Gaulle, le danger de l’Allemagne était plus grand que le danger du communisme. En fait, il pensait toujours en termes de nation et jamais en termes d’idéologie.
« IL NE VA PAS VERS LA GAUCHE MAIS IL S’ÉCARTE DE LA DROITE, SA FAMILLE NORMALE, PARCE QU’ELLE A ADOPTÉ UNE POSITION D’APAISEMENT À L’ÉGARD DE L’ALLEMAGNE »
Alors que beaucoup d’hommes de droite basculaient dans l’idée « plutôt Hitler que Blum », cela aurait été impossible pour De Gaulle parce que, pour lui, la nécessité d’une alliance avec l’Union soviétique – la Russie, comme il disait toujours – était nécessaire contre l’Allemagne. Pour lui, le combat est contre le germanisme éternel, y compris dans sa variante nazie.
Quand il écrit son dernier livre avant la guerre, La France et son armée (1938), il juge les régimes politiques depuis les débuts de la France jusqu’au présent. Il ne les juge pas selon la couleur politique, que ce soit l’Empire, l’Ancien Régime, la monarchie ou la République : pour lui, ce qui compte, c’est l’efficacité du régime pour défendre les intérêts nationaux.
Il admire Léon Gambetta, Sadi Carnot, mais il admire aussi Turenne, Louis XIV, etc. Il est toujours pour la défense de l’Etat, la défense des intérêts de la France, et il est plutôt indifférent à l’aspect politique : si la République défend les intérêts de la France, on défend la République, si la monarchie défend les intérêts de la France, on défend la monarchie.
Donc ce n’est absolument pas un maurrassien ?
Parmi ses grands biographes, Eric Roussel aurait tendance à le tirer un peu plus vers le côté maurrassien, Jean Lacouture dans l’autre sens. Pour moi, Charles de Gaulle est, comme tout homme intelligent de cette époque, influencé par Charles Maurras, mais ce qu’il en a retenu, c’est l’importance de l’Etat : qu’il faut un Etat fort pour défendre les intérêts de la France. Une autre chose qu’il a prise de Maurras, je crois, c’est l’idée que la vie des nations est un combat, il y a toujours des ennemis, il faut toujours se battre.
« IL FAUT INSISTER SUR LE FAIT QUE DE GAULLE N’A MONTRÉ PRESQUE AUCUNE TRACE D’ANTISÉMITISME, CE QUI EST ASSEZ REMARQUABLE POUR QUELQU’UN DE SA GÉNÉRATION ET DE SON MILIEU »
On peut dire que Maurras a cessé d’être maurrassien quand il a viré vers la collaboration avec l’Allemagne – lui qui avait toujours été germanophobe devient obsédé par l’ennemi intérieur.
Et il faut insister sur le fait que De Gaulle n’a montré presque aucune trace d’antisémitisme, ce qui est assez remarquable pour quelqu’un de sa génération et de son milieu. Il est indifférent aux origines ethniques, religieuses, politiques des gens, s’ils servent la France. Et c’est une grande différence avec Maurras qui était obsédé par les ennemis intérieurs, les juifs, les protestants, les francs-maçons…
Charles de Gaulle a un mentor en la personne de Philippe Pétain, il travaille pour lui et, en même temps, il défend son autonomie politique, intellectuelle, littéraire, par rapport à son chef. Est-ce une relation père-fils ?
Avant la première guerre mondiale, Philippe Pétain a été son premier colonel et Charles de Gaulle a eu beaucoup d’admiration pour le grand soldat de la Grande Guerre. On peut même dire que le portrait qu’il trace du chef est en grande partie celui de Pétain. Dans un sens, dans les années 1920, Pétain est son patron. De Gaulle répète souvent cette phrase un peu étonnante : « Pétain est mort en 1925. »
C’est un peu paradoxal, car c’est en 1925 que De Gaulle a commencé à travailler dans son cabinet. Dans la seconde partie des années 1920, je crois qu’il a senti que Philippe Pétain était un peu figé intellectuellement, qu’il était devenu prisonnier de son propre mythe ; et donc De Gaulle s’éloigne intellectuellement vers la fin des années 1920, parce que, en vivant dans une proximité relative avec Pétain, il a commencé à voir les faiblesses du personnage.
« QUAND GEORGES POMPIDOU, UN DE SES PROCHES DE L’ÉPOQUE, LUI ANNONCE LA MORT DE PHILIPPE PÉTAIN EN 1951 EN LUI DISANT “PÉTAIN EST MORT”, DE GAULLE CORRIGE : “LE MARÉCHAL EST MORT” »
Et il y a toute l’histoire de la querelle autour du livre La France et son armée, ouvrage pour lequel Charles de Gaulle a tout d’abord travaillé pour le maréchal, et finalement s’est posé la question de le publier sous son propre nom.
A partir de 1934, il s’émancipe intellectuellement de Pétain et trouve un nouveau patron dans la personne de Paul Reynaud, qui a contribué à l’ancrer dans la République, parce que De Gaulle voyait que c’était possible de faire passer ses idées à travers un homme politique de grande intelligence à l’intérieur du système.
Donc pour revenir à Philippe Pétain, quand on prend toutes les personnes qui témoignent à son procès en 1945 – Léon Blum, Edouard Daladier, Paul Reynaud, Albert Lebrun, etc. –, toutes croyaient au mythe, croyaient que Pétain était un bon républicain. Charles de Gaulle, lui, s’était déjà libéré de cette idée avant la défaite.
Je pense tout de même qu’il a toujours gardé une certaine admiration pour le Pétain de la première guerre mondiale, et il y a à ce sujet une anecdote assez significative. Quand Georges Pompidou, un de ses proches de l’époque, lui annonce la mort de Philippe Pétain en 1951 en lui disant « Pétain est mort », de Gaulle corrige : « Le maréchal est mort. »
On en arrive aux jours sombres de juin 1940, ces journées incroyables où Charles de Gaulle va partir à Londres pour chercher un destin. Comment fait-il ce choix de partir ?
Ce sont des jours d’une densité incroyable. Sous-secrétaire d’Etat à la défense nationale dans le gouvernement de Paul Reynaud, il est opposé à l’armistice et partisan du repli du gouvernement en Afrique du Nord. Au moment où Paul Reynaud démissionne de la présidence du Conseil, il est remplacé par Philippe Pétain, le 16 juin, et il est clair que le nouveau gouvernement va signer l’armistice. Pour Charles de Gaulle, cette option n’est pas envisageable, et il prend la décision d’aller à Londres, de rompre, de devenir un rebelle.
Pour revenir à ses écrits d’avant-guerre, il y a un propos assez fascinant, quand il décrit les qualités d’un grand chef, il évoque l’amiral britannique John Jellicoe pendant la première guerre mondiale en expliquant qu’il avait toutes les qualités d’un Nelson sauf une : il ne savait pas désobéir. Pour De Gaulle, il faut savoir rompre et désobéir pour protéger les intérêts supérieurs de l’Etat.
Donc, il arrive à Londres le 17 juin. Les premiers jours sont très compliqués. Il espère que les grands chefs coloniaux, par exemple le général Noguès en Afrique du Nord, qui était hostile à l’armistice au début, allaient se rallier à lui. Il envoie des messages : « Je suis prêt à vous servir si vous êtes prêts à vous opposer à l’armistice. »
Mais en fin de compte, tous ces gens vont se rallier à Philippe Pétain. Si Charles Noguès ou le général Maxime Weygand par exemple avaient décidé de rompre avec le maréchal, De Gaulle aurait-il accepté de servir sous leurs ordres ? En théorie oui. Mais finalement, il se retrouve seul, et il se dit, puisque Reynaud n’est pas venu à Londres, c’est moi qui dois assumer la France. Il voit vraiment depuis le début ce qu’il veut être.
« CHURCHILL EST COMME UN FRANKENSTEIN QUI A CRÉÉ UN MONSTRE QUI LUI ÉCHAPPE. CE MONSTRE, C’EST DE GAULLE, ET FRANKENSTEIN VA LUI DONNER L’ARME DE LA BBC »
Il y a un dialogue très connu avec le juriste et diplomate René Cassin. Celui-ci, qui rédige le texte des accords entre De Gaulle et le gouvernement britannique, lui demande : « Qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes la légion étrangère ? » Et De Gaulle répond : « Nous sommes la France. » Cela semble un peu fou. Mais, pour lui, un Etat qui signe un armistice et qui accepte l’occupation de son territoire n’est pas un Etat indépendant, il n’y a plus de France en France, et donc « Je suis la France », ce n’est pas un signe de mégalomanie, c’est une décision rationnelle. Sa position au début est très compliquée, hybride ; il n’est pas reconnu comme un chef de gouvernement, il est seulement le dirigeant des Français libres.
Toute la complexité de ses relations avec le premier ministre britannique, Winston Churchill, vient de cette méprise, parce que Churchill n’a jamais accepté ou compris l’intention de De Gaulle. Il ne voulait pas simplement être le chef des Français libres, il se voyait comme un chef politique représentant les intérêts supérieurs de la nation et défenseur de ses intérêts autant contre ses alliés que contre ses ennemis !
L’attitude de Winston Churchill face à Charles de Gaulle est aussi assez fascinante, il l’aide, mais il ne veut pas non plus en faire un chef d’Etat comme vous le dites. Pourtant, le 28 juin, il va le reconnaître, ce qui est un geste politique assez étonnant…
Ce geste n’est pas approuvé par l’establishment britannique, le Foreign Office (« bureau des affaires étrangères ») est très sceptique. Il ne faut pas oublier que Vichy était un gouvernement reconnu par énormément d’Etats, il avait une flotte, il contrôlait l’Afrique du Nord… Des membres du Foreign Office pensaient pouvoir trouver un modus vivendi avec Vichy.
Donc, le geste de Winston Churchill est assez remarquable, mais je crois qu’il n’en a pas compris les conséquences. Churchill est comme un Frankenstein qui a créé un monstre qui lui échappe. Ce monstre, c’est De Gaulle, et Frankenstein va lui donner l’arme de la BBC. De Gaulle est un des premiers hommes politiques dans l’histoire du monde à avoir été fabriqué par la radio. Et, avec cette arme, il va s’émanciper.
Il y a un chassé-croisé entre l’attitude du Foreign Office et celle de Churchill. A partir de la mi-1942, début 1943, le Foreign Office commence à admettre que De Gaulle est incontournable. Et au moment où il bascule, par pragmatisme, Churchill vire dans l’autre sens, parce qu’il commence à trouver son poulain insupportable. Mais c’est trop tard, le monstre est sorti de sa cage. Churchill était un romantique, il y avait beaucoup de générosité dans sa personnalité, alors que De Gaulle n’en avait pas beaucoup, il était nettement plus froid.
Churchill avait du mal à comprendre pourquoi De Gaulle ne remerciait jamais. Pourtant, ce dernier se montrait très explicite : « Moi, je n’ai rien, vous, vous avez un empire, vous avez une armée, vous avez un peuple. Moi, je n’ai qu’une chose, c’est mon intransigeance. » Pour prouver que la France avait des dents, De Gaulle mordait la main qui le nourrissait, celle de Churchill.
C’était encore plus compliqué avec Franklin D. Roosevelt, le président américain, qui considérait Charles de Gaulle comme une espèce de fasciste sans aucune légitimité…
Au début, pour Franklin Roosevelt, le régime de Vichy existe. Si on peut le faire basculer dans le camp des Alliés, cela pourrait économiser des vies de soldats américains. C’est une politique assez logique et cohérente jusqu’en novembre 1942, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord et sont initialement combattus par les forces de Vichy.
A partir de cette époque, c’est absurde de miser sur Vichy, et donc l’attitude de Roosevelt par rapport à Charles de Gaulle devient à mon sens plutôt irrationnelle. Je l’expliquerais peut-être par l’influence de quelques exilés français aux Etats-Unis, comme l’écrivain et diplomate Alexis Saint-Leger, alias Saint-John Perse, ou le banquier et économiste Jean Monnet, de bons républicains, très méfiants envers De Gaulle.
« DE GAULLE NE SAVAIT PAS CE QU’IL VOULAIT COMME RÉGIME EN 1940. A LA MI-1942, QUAND L’IDÉOLOGIE DE LA RÉSISTANCE DEVIENT RÉPUBLICAINE, IL S’Y ADAPTE »
Quand Roosevelt rencontre Charles de Gaulle pour la première fois en janvier 1943, il le trouve très étrange, mystique. Et il pense aussi qu’il est la marionnette des Britanniques ; cela semble pour nous un peu paradoxal, mais beaucoup d’Américains le pensaient. Il y a donc beaucoup de choses qui influencent l’attitude de Roosevelt en 1943.
Même en 1944, même juste avant le Débarquement, il dit que Charles de Gaulle est un fasciste ou un communiste, au choix, et il cherche n’importe quelle raison pour s’opposer à lui. Cela devient frustrant finalement pour ses propres conseillers, et pour le général Eisenhower, chef des forces alliées en Europe, qui, à la veille du jour J, aurait aimé trouver un accord avec le général de Gaulle malgré Roosevelt.
Parmi ceux qui s’opposent à l’occupation allemande en France ou à Londres, il y a une grande diversité idéologique et pas mal de défiance à l’égard du caractère républicain de De Gaulle…
Charles de Gaulle ne savait pas ce qu’il voulait comme régime en 1940, ça n’était pas la question pour lui, il n’était ni républicain ni antirépublicain, il était plutôt a-républicain pendant cette période.
En novembre 1941, dans un discours à l’Albert Hall, à Londres, il prononce pour la première fois la phrase « Liberté, égalité, fraternité » et commence à parler de la République. Avant cette période, les émissions de la France libre étaient introduites par « Honneur et patrie ».
J’insiste encore sur le fait que De Gaulle est toujours quelqu’un qui n’a pas d’idées figées sur les régimes, donc il n’est jamais un républicain comme les républicains de la IIIe République. Beaucoup de résistants, beaucoup de Français libres, étaient des hommes de droite, il y avait des antisémites également, mais la Résistance a fini par trouver une idéologie républicaine, progressiste et de gauche en réaction à Vichy. Et, à partir de la mi-1942 à peu près, quand l’idéologie de la Résistance devient républicaine, De Gaulle s’y adapte.
Jean Moulin, quand il arrive à Londres, se pose lui-même la question « De Gaulle est-il républicain ? »…
La réponse de Jean Moulin est : « Il faut travailler pour lui et après on verra. » Il voit en lui la personne qui défend les intérêts de l’Etat. Il ne faut pas oublier que Jean Moulin est un préfet, un homme d’Etat et un grand républicain. Donc, il voit que l’important à ce moment-là c’est l’intérêt de l’Etat, de la France dans le monde.
Un autre geste politique important de De Gaulle est l’unification des mouvements de résistance sous la direction de Jean Moulin. Là encore, un mélange de pragmatisme et d’habileté…
Je crois que c’est un choix pragmatique. Dans mon livre, j’insiste sur la souplesse, le pragmatisme de De Gaulle. Pour lui tout est en mouvement, il ne faut jamais être figé sur une position. La seule chose importante, c’est la France. Pour tout le reste, on s’adapte.
Les relations entre la France libre et la Résistance étaient incroyablement compliquées. En témoigne par exemple le grand livre Alias Caracalla, au cœur de la Résistance (Gallimard, 2009), de Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, qui est pour moi un livre féroce sur la Résistance écrit par un Français libre. La stratégie d’unification de la Résistance est d’une habileté remarquable, elle a été suggérée par Jean Moulin, et Daniel Cordier décrit le cheminement de cette idée avec beaucoup de finesse.
Mais en fait l’objectif était très simple : le général de Gaulle voulait montrer aux Alliés qu’il était incontournable parce qu’il était soutenu par les Français, or, pour beaucoup, pour Roosevelt notamment, les anciens chefs politiques, les Blum, les Reynaud, les Jeanneney, comptaient beaucoup plus que charles de Gaulle ou des chefs résistants sortis de nulle part. De la part de De Gaulle, c’était d’une grande habileté politique. Il avait une capacité, une finesse pour sentir les situations, qui est un peu à contre-courant des idées classiques sur un De Gaulle très raide. Il n’est pas raide, il est très souple.
Pour revenir à Philippe Pétain et à cette théorie du régime de Vichy fonctionnant comme un bouclier face à l’occupation allemande, est-elle toujours présente ?
Récemment, il y a eu cette petite polémique quand Emmanuel Macron a essayé de séparer le Pétain de Verdun et le Pétain de la seconde guerre mondiale. Cela n’a pas marché, et l’actuel président, qui est très pragmatique, a rapidement changé son fusil d’épaule.
Mais cela a ressuscité parmi certains journalistes cette idée de Vichy comme bouclier face à l’occupation allemande. Une idée qui avait été autrefois très présente quand des partisans de Pétain fustigeaient ces méchants Anglo-Saxons menés par le diable d’historien américain Robert Paxton, qui essayait alors de discréditer la France.
Mais je pense que, depuis le discours du président Jacques Chirac en 1995, la grande majorité des Français voit dans le gouvernement de Vichy un régime coupable qui a livré des juifs aux Allemands. Et c’est d’autant plus intéressant que Jacques Chirac a dans un sens implicitement attaqué l’idée gaulliste que la vraie France était à Londres. Donc je ne suis pas convaincu que la thèse du bouclier a beaucoup de prégnance actuellement.
L’appel du 18 juin fonctionne comme un mythe, quelle est l’importance de ce discours pour vous ?
Le dernier grand discours du général de Gaulle, le 2 février 1969 à Quimper. | AFP
Ce n’est pas un mythe. Il y a un discours, un discours qu’il a prononcé à la BBC. C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui l’ont écouté, mais ça n’a aucune importance. L’important c’est qu’il l’a fait et qu’il l’a fait le 18 juin.
Le texte du discours prononcé et celui publié sont un peu différents, il y a eu quelques petites modifications pour satisfaire les Britanniques, mais ça n’a aucune importance, parce que finalement le texte du discours est plus ou moins celui que l’on peut lire. Dans les Discours et messages, de Charles de Gaulle, le deuxième discours qu’il prononce est celui du 19 juin. En fait, il n’existe pas le 19 juin 1940. Celui publié a dû être rédigé par la suite, puisqu’il parle d’événements qui sont postérieurs au 19 juin. Ce discours-là est un mythe.
« LE DISCOURS DU 18 JUIN RESTERA COMME UN MÉLANGE D’INTELLIGENCE ANALYTIQUE ET DE PROPHÉTISME VISIONNAIRE. DE GAULLE EST CLASSIQUE ET ROMANTIQUE »
Celui du 18 juin restera comme un mélange fascinant d’intelligence analytique et de prophétisme visionnaire. De Gaulle est à la fois classique et romantique, il est habité par la « raison » et par le « sentiment ». Il est à la fois Giuseppe Mazzini et Camillo Cavour ! – deux des pères de la République italienne.
Le sentiment, c’est le geste moral, le courage, la volonté, l’appel à la résistance. La raison, ce sont les arguments qu’il donne : c’est une guerre mondiale, il y a l’Empire britannique, il y a les colonies… C’est un discours réfléchi, pensé.
Donc, pour moi, le 18 juin, c’est d’un côté, courage, morale, volonté, sentiment, romantisme si vous voulez, et de l’autre, des arguments précis et raisonnés. Le génie du général de Gaulle en tant qu’acteur politique se résume dans ces deux aspects de sa personnalité.
Cet entretien est paru dans Le Monde Hors-Série « 1940. De Gaulle, la résistance. Pétain, la collaboration » (juin-août 2020).



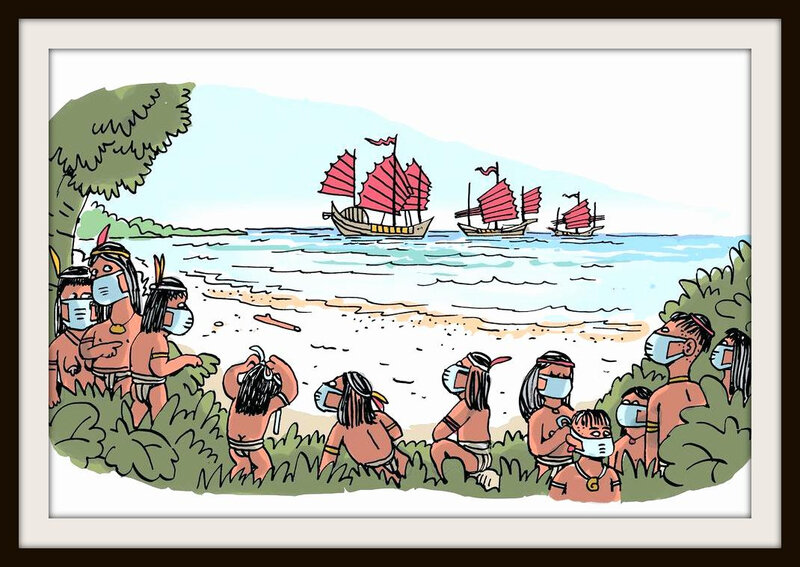

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)