Covid-19 : "Nous ne sommes pas accoutumés au recueillement", selon le philosophe Nicolas Grimaldi
Par Florence Sturm
Entretien |Face à l'évolution de la pandémie de coronavirus, la France a fait le choix du confinement : selon le philosophe Nicolas Grimaldi, le retranchement imposé par cette situation révèle que l'on ne vit pas pour soi-même, mais pour notre lien avec les autres.
Le professeur de philosophie Nicolas Grimaldi, pris en photo en 2007.• Crédits : Dominique Carton - Maxppp
Alors que les Français vivent confinés chez eux depuis ce mardi 17 mars, comment tenir psychologiquement, philosophiquement ? Et que révèle cette situation de notre rapport aux autres et à nous-mêmes ? Pour répondre à ces interrogations, Florence Sturm est allée chercher l'éclairage du philosophe Nicolas Grimaldi.
Cet ancien professeur à la Sorbonne a consacré la plupart de ses ouvrages à élucider nos expériences de la subjectivité. Il interroge notre rapport à la crise sanitaire actuelle et au confinement, avec le regard très particulier de celui qui vit lui-même "comme un trappiste cloîtré", dans l’ancien sémaphore de Socoa sur la Côte Basque. Il y réside depuis 1968, plus d’un demi-siècle donc : un salon au milieu de l’océan Atlantique et la mer "qui, très régulièrement, toutes les six heures, accompagne le plein champ… une sorte de chorale qui enfle lentement". Nicolas Grimaldi rend aussi un hommage vibrant aux équipes soignantes mobilisées contre le coronavirus.
Parmi ses très nombreux ouvrages parus pour la plupart aux PUF et chez Grasset : Socrate, le sorcier, Traité des solitudes, et Sortilèges de l’imaginaire. A paraître en juin : Les Songes de la raison.
Que vous inspire cette situation ?
Cette situation a un côté anachronique. Nous avions oublié qu’il puisse y avoir des épidémies aussi violentes, aussi contagieuses, que la vie puisse être aussi fragile. Et surtout, nous ne mettions plus en question l’état de société : que nous puissions tout recevoir des autres, cela nous paraissait l’ordre quasiment naturel de l’échange.
Or, voici que d’un coup, en un instant, une pandémie semble suspendre l’état de société, c’est-à-dire l’état d’échange naturel. A une exception près toutefois : jamais nous n’avons autant éprouvé combien nous dépendions les uns des autres, et combien leur dévouement, leurs compétences, leurs sacrifices, leur abnégation sont nécessaires à notre vie. Il s’agit tout simplement de la compétence et du dévouement du corps médical.
Dans son discours annonçant le confinement, sans lui-même prononcer le mot, Emmanuel Macron a parlé de "guerre" à plusieurs reprises...
Nous pourrions dire que nous sommes en guerre, comme l’a répété trois ou quatre fois le président de la République, avec cette différence que la guerre défend des valeurs, une puissance politique, tandis qu’en l’occurrence, nous n’avons rien à défendre d’autre que notre propre santé. Ce que chacun défend, c’est lui-même et à l’occasion les autres.
A la guerre, on nourrit les combattants, on leur apporte les munitions. Ici, au contraire, il s’agit de s’abriter, de se retrancher, de se recueillir, de se mettre aux abris. Par conséquent, c’est en cela que nous sommes invités à sortir de l’état de société par une sorte de retranchement et, à l’occasion de ce retranchement, d’un recueillement.
Naguère, au XVIe, au XVIIe siècle, rien n’était plus banal. Pour se préparer à la mort, on se préparait au salut et pour se préparer au salut, on se recueillait dans la solitude, une solitude qui nous mettait face à face avec Dieu, dans la prière. Or, ce Dieu s’est un peu éloigné, son image s’est effilochée, de sorte qu’il n’y a plus grand monde pour penser à son salut.
Et cependant, ce qui rend si pénible, si difficile, presque si odieux ce temps de vacances absolues, c’est précisément que nous sommes réduits à nous-mêmes, un peu comme ce que disait Pascal : "Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos". Précisément parce que la vie, c’est le mouvement, et comme le dit également Pascal, "le repos entier, c’est la mort"… De sorte que lorsque nous n’avons plus rapport aux autres, tout se passe comme si nous n’avions plus rapport à nous-mêmes. Evidemment, demeurent encore la radio, la télévision, qui sont des divertissements mais nous n’avons rapport qu’à des images que nous recevons et il n’y a rien que nous ne puissions donner.
Comment alors gérer l’angoisse, la peur qui nous étreint en lien avec la mort ?
Ce qui rend le divertissement indispensable, comme le disait encore Pascal, c’est précisément qu’il nous détourne d’avoir à penser à notre propre vie pour ne pas avoir à penser à notre propre mort. En effet, nous avons cessé de scander notre temps par celui des enterrements. Nous ne pensons plus à notre propre mort, et par ce fait même, la vie se recroqueville, se résume sur le bord d’un instant.
Nous vivons d’instants en instants, de stimulations en stimulations, comme une manière de mettre entre parenthèses le propre de la vie, car le propre de la vie, c’est le dynamisme d’une continuité, un effort, une même entreprise, un même souci, etc.
Quand soudain surgit la maladie, un peu comme dans Le Hussard sur le toit de Jean Giono avec une épidémie de choléra, chacun sent la précarité, la fragilité de la vie et sent du même coup ce qui nous manque.
Ce qui nous manque, par rapport au XVIIe siècle, c’est le sens de la communion des saints, le sacrifice des uns qui contribue à sauver les autres. Les vies servent de vases communicants. Ce que l’un en donne, l’autre en profite. Dans ce retranchement auquel nous sommes assujettis, personne ne profite de cette vie qui vient de se suspendre. Mais la grande découverte que manifeste cette situation, c’est que je ne vis pas pour moi-même. Sans les autres, je découvre que ma vie n’est presque rien.
Vous diriez que ce confinement engendre un retour sur soi ou plutôt un repli sur soi ?
Il est un repli dans la mesure où l’on pense : "J’aimerais uniquement passer au travers" ; il me fait découvrir combien l’individu que je suis est précaire, fragile, menacé. A l’inverse, dans la mesure où ce retranchement me fait découvrir ma solidarité avec tous les autres, dans la mesure où je n’existe que pour transfuser ma vie dans la leur, alors, c’est un monde de lucidité, de confiance, de réalisme, qui nous révèle que l’on n’est pas soi à soi tout seul. On ne vit pas pour soi. La vie d’un individu consiste à donner la vie.
A ce moment-là, comment qualifier certains comportements, comme la ruée sur les produits alimentaires ou les départs en nombre de Paris ?
C’est, me semble-t-il, ce que Pascal avait décrit du divertissement, le vertige de l’instant. Essayer d’oublier la peur de l’avenir et profiter d’un dernier instant de liberté, dernier instant de plaisir, dernier instant d’irresponsabilité.
C’est croire que la vie est faite d’instants. Or ce n’est pas vrai. Ce qui fait le sens de la vie, c’est la continuité d’un seul et même dynamisme, la continuité d’un seul et même effort, l’accomplissement d’un seul et même vœu, d’une seule et même attente.
Dans cette crise, il y a aussi des différences fondamentales dans le statut des personnes qui la traversent : les malades, les soignants, ceux qui sont confinés, ceux qui continuent à travailler, avec également les angoisses futures d’un point de vue économique.
Tout à fait. Rien ne paraît plus remarquable à cet égard que l’attitude du corps médical et du corps infirmier. Ceux qui, en dépit d’un danger possible, n’en continuent pas moins d’exercer leur profession, précisément parce que l’ensemble des autres a besoin de leurs compétences, de leur savoir-faire. Ceux-là sentent que leur vie a pour fonction de faire vivre les autres.
En tant que philosophe, quelle école avez-vous envie de convoquer face à cette crise ? Les Stoïciens ?
Il me semble, christianisme mis à part, si j’ose dire, que ce moment de crise, de repliement, de recueillement, de retranchement, nous fait vivre la vérité de ce que Pascal avait décrit de la condition humaine.
Mais il y a une grande différence entre l’époque de Pascal et la nôtre, c’est que l’on se sentait sans cesse sous le regard de Dieu et le moment de la mort était anticipé comme un rendez-vous qu’elle nous aurait donné avec Dieu. Tandis qu’aujourd’hui la mort nous paraît l’irrémédiable et en même temps l’absurde. C’est plutôt Pascal que Marc Aurèle à cause de "si l’on nous enlève le divertissement, j’aurais d’abord l’impression que c’est la vie elle-même qui nous est enlevée".
C’est une manière frivole de vivre ce qui est si grave, à savoir la vie, précisément parce que la moindre chose, le moindre virus, peut nous la faire perdre. On nous a donné ce prodige et nous n’en faisons que ça !
Nous ne sommes pas accoutumés au recueillement, à sentir ce que notre vie a, en elle-même, de prodigieux, de fragile, de précaire. Le propre de la vie est être le dynamisme d’une communication. La vie est comme la lumière, c’est un rayonnement.
Une question plus pragmatique : comment dans nos quotidiens et les jours à venir, faire face le mieux possible à ce confinement et à cette situation ?
Je ne peux pas communiquer mon expérience de très vieil homme à des jeunes gens ! Je ne pense pas qu’ils puissent se satisfaire de lire à loisir ou de consacrer à la lecture le loisir que le coronavirus leur impose… Néanmoins, il me semble que l’occasion créée par cette pandémie nous fait vivre un peu anachroniquement, de la même façon que vivaient naguère nos arrières grands-parents ou nos arrière, arrière-grands-parents qui, dans leur vallée, dans l’isolement de leur village, avaient la solitude pour destin. La soirée se passait autour du feu… personne ne nous empêche de faire du feu… on se parlait à deux ou trois et maintenant, nous voici, en quelque sorte, résumés à notre famille la plus étroite, une manière également de resserrer notre intimité, et par conséquent, d’être plus attentifs à l’attente d’autrui, notre femme, notre enfant, nos proches.
Pensez-vous qu’il y aura un avant et un après dans cette crise ? Cela peut-il creuser davantage des inégalités déjà très marquées dans la société française ?
Un avant et un après, il y en aura probablement un pour les épidémiologistes, les virologues, les médecins, peut-être un dans l’organisation administrative de la société, ce qui sera le choix des politiques, pour autant qu’ils soient lucides.
La mort est justement ce qui rend tous les hommes égaux. Le destin de Péguy n’est pas privilégié par rapport à celui d’un paysan breton. Tous meurent de la même façon. Mais à cet égard, le danger ou l’imminence du danger fait sentir à tous les hommes ce qu’ils ont de profondément semblable. Tous sont assujettis à la mort.
C’est aussi l’occasion de revivre ce que la vie avait, naguère, de solitaire. Evidemment, personne ne peut mourir à ma place. Je peux acheter cent mille choses dans les grandes surfaces ou les magasins les plus luxueux mais je n’achèterai pas l’immortalité. Raison de plus pour nous rappeler que la vie est faite pour être donnée.
En même temps que cet épisode nous fait sentir la solitude lorsque vient à être suspendu l’état de société, en même temps il manifeste combien nous dépendons des autres. Non seulement d’un point de vue médical, mais par le fait même que le danger mobilise tous les autres à notre profit. Il y a aussi une mondialisation de la recherche scientifique. Très certainement sont en ce moment à l’œuvre des équipes de biologistes qui cherchent à répondre à l’agressivité du virus et peut-être sont-ils en train de mettre au point de possibles vaccins.
Avez-vous des conseils de lecture à livrer ?
Je conseillerais surtout de lire ce qui vous plaît. Il faut que lire soit un plaisir. Souvent, ce plaisir est la découverte de ce qu’on aurait écrit si on y avait pensé, de ce que la pensée des autres anticipe la nôtre. Pour ma part, je lis un très beau livre, La Force de l’invisible d'Anne-Claire Désesquelles (éditions Pocket), professeure de khâgne à Lyon. L’idée est celle-ci que je trouve extraordinaire, car elle est en quelque sorte en aval de toutes les analyses philosophiques : la cause de tout mouvement, c’est une force. Or, alors que le mouvement est toujours visible, matériel, la force est invisible et immatérielle. L’auteure développe cela avec une maîtrise, une simplicité et une profondeur que je trouve tout à fait admirables. Et je m’émerveille du talent des autres.
Tous nous nous émerveillons du talent, de l’abnégation de tous les médecins et de tous les infirmiers. Je pense surtout à ce qui se passe en ce moment en Alsace et je suis à la fois terrifié et admiratif. Terrible est l’agression et en même temps la réponse et la mobilisation sont admirables.



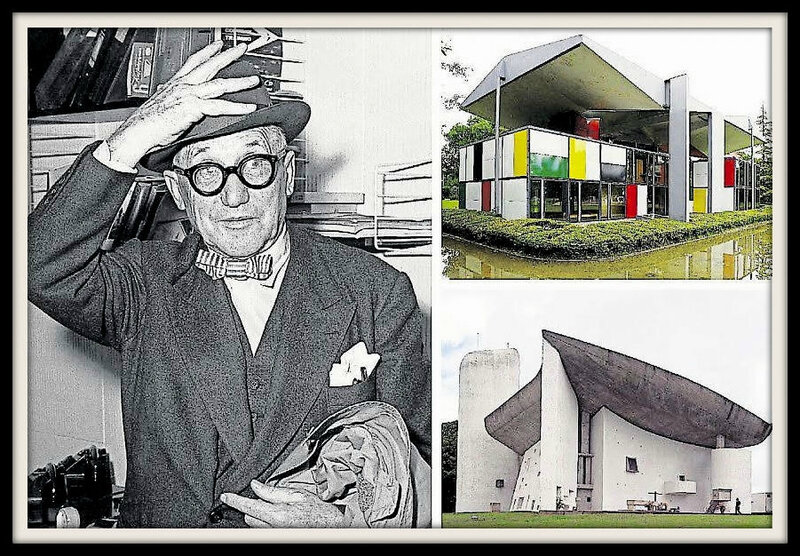



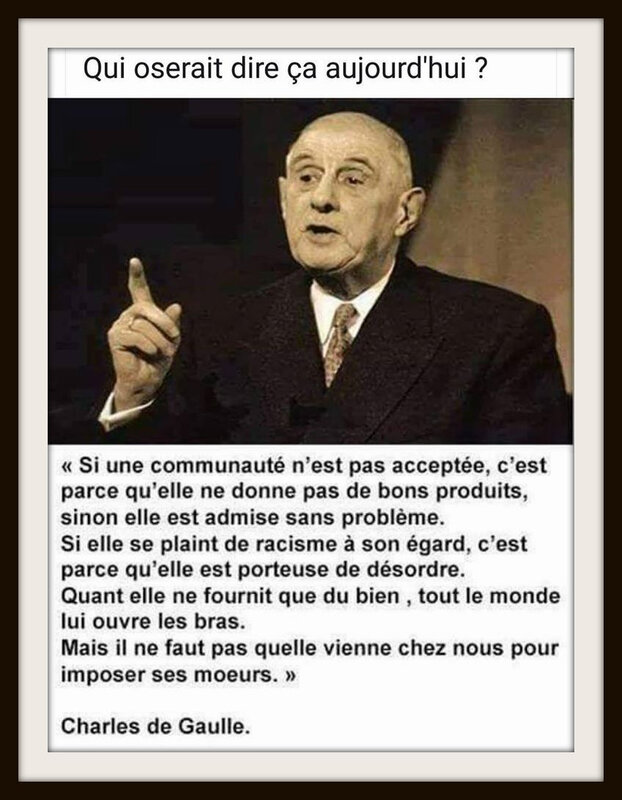

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)