
Par Zineb Dryef
Après avoir longtemps ignoré les mannequins transgenres, les grandes marques de parfums et de cosmétiques, désireuses de prouver leur progressisme, font appel à elles. A condition que leur physique réponde à certaines normes et que leur discours ne soit pas clivant.
Le visage nu et les cheveux tirés, Teddy Quinlivan applique au gros pinceau de la poudre dorée sur ses joues et son front, avant de maquiller ses cils de noir et ses lèvres de rouge grenadine. La vidéo, un tutoriel beauté comme on en voit souvent sur YouTube, a été postée le 22 août sur l’Instagram de Chanel Beauty, un compte aux plus de 3 millions d’abonnés consacré aux cosmétiques de la maison parisienne.
Le petit film de vingt-cinq secondes a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse, et pas uniquement en raison du poids de la marque dans le secteur de la beauté : Teddy Quinlivan n’est pas un modèle comme les autres. La jeune femme de 25 ans est une mannequin trans, née dans un corps d’homme, ce qu’elle avait révélé en 2017, après des débuts prometteurs sur les podiums.
Une évolution durable
Le 26 août, dans la foulée de Chanel Beauty, elle postait sur son compte personnel un texte décrivant son parcours, d’enfant martyrisé à l’école jusqu’au métier de mannequin : « J’ai défilé deux fois pour Chanel avant mon coming out. Je savais qu’en révélant ma transidentité j’allais devoir arrêter de travailler pour certaines marques, je pensais ne jamais pouvoir collaborer à nouveau avec une maison iconique comme Chanel. Mais me voilà dans cette campagne de publicité Chanel Beauty. Je suis la première personne transgenre qui travaille pour la maison Chanel et c’est un grand honneur et une grande fierté pour moi de représenter ma communauté. » Même si, selon le vocabulaire du milieu, elle n’est pas « égérie » ni « amie de la maison ».
La jeune Américaine, révélée en 2015 par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femme de Louis Vuitton, n’est pas la seule de sa profession à avoir révélé publiquement sa transidentité. Comme elle, la Brésilienne Valentina Sampaio, l’Américaine Hari Nef et, avant, l’Australo-Bosnienne Andreja Pejic et la Brésilienne Lea T ont posé pour des magazines et défilé pour des marques de luxe.
« On a compté trente-deux mannequins transgenres pendant la Fashion Week de septembre, souligne Géraldine Bouchot, directrice éditoriale tendances et prospective chez Carlin. Il y a un vrai phénomène de visibilité. » Une cadre dirigeante d’une grande maison de luxe abonde : « Ça n’est pas un phénomène ponctuel, mais une évolution durable. L’indicateur, c’est que le secteur de la beauté, beaucoup plus conservateur que celui de la mode, s’en empare. »
« Corps devenus incontournables »
Car voilà : si, en apparence, prêt-à-porter de luxe et beauté sont indissociables, leurs dynamiques sont très différentes. La mode est plus audacieuse et, de par sa gamme de prix, s’adresse à une clientèle plutôt restreinte. La beauté, qui s’inscrit dans une logique plus industrielle, se destine au grand public et ne peut pas s’autoriser de faux pas en communication. C’est au sein de cette industrie très normée que surgissent aujourd’hui des visages transgenres.
Récemment, l’ex-athlète olympique devenue vedette de la télé-réalité Caitlyn Jenner a imaginé un bâton de rouge à lèvres pour M.A.C ; Hari Nef, actrice vue dans Transparent, représente le parfum Bloom de Gucci et les fonds de teint True Match de L’Oréal ; on a vu les Françaises Raya Martigny (mannequin et figure de la nuit parisienne) et Inès Rau (comédienne, au casting de Vernon Subutex, et première playmate trans) dans un spot de Kérastase pour l’une et dans une campagne Balmain Hair pour l’autre ; la brune Lea T, très amie du créateur italien Riccardo Tisci, est apparue dans une campagne Redken ; Andreja Pejic (un temps égérie de Jean Paul Gaultier) pose pour des fards de la gamme Be Bold (« soyez audacieux ») de Make Up Forever…
Une histoire singulière illustre ce revirement : celle de l’Américaine Tracey Norman, mannequin en vogue dans les années 1970. Son visage s’est longtemps affiché sur les boîtes de teinture n° 512 de Clairol, une marque grand public de soins capillaires aux Etats-Unis dont le slogan clamait « Born beautiful ».
Mais, dans les années 1980, sa carrière s’arrête brutalement après la révélation de sa transidentité par une vieille connaissance. En 2015, New York Magazine lui a consacré un long portrait, revenant sur son histoire oubliée, comme pour rappeler, au moment où Caitlyn Jenner posait pour une mémorable couverture de Vanity Fair, qu’il ne fallait pas perdre de vue « à quel point il était dangereux il y a quarante ans – et encore aujourd’hui – pour des femmes comme Norman de simplement marcher dans la rue ». Dans les jours qui suivent la parution de l’article, Clairol a rappelé Tracey Norman pour lui proposer d’être l’égérie de sa nouvelle campagne. La sexagénaire a accepté.
« TOUT LE MONDE Y GAGNE : LES MARQUES, EN TERMES D’IMAGE, ET LES PERSONNES TRANS, ENFIN MONTRÉES DE FAÇON POSITIVE. » KARINE ESPINEIRA, SOCIOLOGUE
Comment expliquer cette bascule ? « Ces corps sont devenus incontournables dans la mode, le sport, les concours de beauté, les séries télévisées, la téléréalité, le spectacle, le cinéma », observe Karine Espineira, sociologue des médias (Paris-VIII) qui a beaucoup travaillé sur la représentation transidentitaire. L’universitaire observe que l’industrie de la beauté arrive à la traîne d’un mouvement amorcé dans les séries télévisées dès le milieu des années 2000.
« Cette reglamourisation n’est pas anodine. Tout le monde y gagne : les marques, en termes d’image, et les personnes trans, qui sont enfin montrées de façon positive. On est loin de la représentation médiatique des années 1980 et 1990, qu’elles vivaient comme une forme de maltraitance. » Soit des rôles de prostituées assassinées ou de drag-queen comico-pathétiques dans des fictions télévisées où elles n’étaient souvent que figurantes.
Pour les marques, un enjeu d’image
Depuis le milieu des années 2010, des productions grand public en ont fait des personnages crédibles et identifiables : Orange is the New Black, Transparent, Glee, Sense8 et, en France, Plus belle la vie ou Mytho… La starisation de l’actrice Laverne Cox, qui est apparue en couverture de Time, ou de Caitlyn Jenner est également venue secouer ces anciennes représentations médiatiques. Une fois le corps trans légitime pour le grand public, les industries de la mode et de la beauté s’en sont emparé.
Avec une certaine ambiguïté, néanmoins. Interpellée sur les réseaux sociaux par un fan qui lui reprochait de ne pas avoir choisi de personne transgenre pour le lancement de sa marque, Fenty Beauty, la chanteuse Rihanna avait répliqué qu’elle ne faisait pas de casting spécifiquement trans et qu’elle n’avait pas l’intention de copier ces annonceurs qui recrutent des femmes noires comme simples cautions de diversité.
Ne pas être exploitée : c’est l’une des raisons qui ont poussé Teddy Quinlivan à faire son coming out. Une grande marque qui la « suspectait » d’être transgenre lui aurait proposé un énorme contrat pour qu’elle le révèle sous forme de publicité pour l’un de ses produits. Elle aurait refusé, et a choisi la chaîne CNN pour l’annoncer elle-même.
Pour les marques, la mise en avant des mannequins transgenres est devenue un enjeu d’image, comme ça avait été le cas avec les modèles noirs, métissés, ou dont les mensurations ne correspondent pas au fameux 85-60-85. Dans la plupart de ces campagnes dites « inclusives », seule compte la représentation d’une beauté diversifiée.
LES MAGASINS SEPHORA AMÉRICAINS PROPOSENT DES COURS DE MAQUILLAGE AUX FEMMES TRANSGENRES, NOTAMMENT PENDANT LEUR PÉRIODE DE TRANSITION.
« Depuis #metoo, depuis cette prise de parole politique collective sur les réseaux sociaux, on assiste à une volonté des marques d’afficher plus de tolérance et d’inclusivité, analyse Géraldine Bouchot. On sort de l’affirmation d’une beauté WASP (Blanc anglo-saxon protestant) pour aller vers la visibilité de toutes les beautés. »
« Aujourd’hui, le luxe n’est pas de mettre du doré partout. Etre luxe, c’est défendre des valeurs », explique Amélie Challéat, directrice de la communication et de l’image de Kérastase International. Après avoir longtemps proposé de « belles endormies » (les vieilles publicités pour des soins Kérastase montrent des femmes blanches alanguies), les campagnes de la marque optent aujourd’hui pour une « vision féministe » de la beauté, avec des photos « peu, voire pas retouchées ».
Les mannequins, des ambassadrices porteuses de messages
En juin, aux côtés d’Emily Ratajkowski et d’autres influenceuses, Raya Martigny a participé au tournage de « Cruise The Musical », une petite vidéo promotionnelle où toutes ces femmes dansent sur un bateau-mouche, à Paris. Amélie Challéat explique que cette vidéo était destinée aux réseaux sociaux, donc à une génération qui, selon elle, exige de la visibilité, de l’égalité et du respect pour tous. « C’est une façon de donner le pouvoir au public qui achète nos produits », assure la communicante.
« Il ne s’agit plus d’acheter un produit pour se faire du bien mais pour faire du bien à tout le monde, indique Géraldine Bouchot. On prend en compte les conséquences de son acte de consommation. C’est pourquoi les marques doivent prendre position et choisir les combats qu’elles veulent mener. »
Aux Etats-Unis notamment, où les positions virulentes de Donald Trump contre les communautés queer ont contraint de nombreuses marques à politiser leurs stratégies de communication. Depuis 2018, les magasins Sephora américains proposent ainsi des cours de maquillage aux femmes transgenres, entre autres pendant leur période de transition (le processus de changement de genre, dont la finalité n’est pas forcément l’opération).
Pour lancer cette initiative, la marque a mis en ligne un spot remarqué : il s’ouvre sur une liste de pronoms « They, She, Ze, He, Xe, We » – une question majeure pour les communautés queer – puis sur le visage d’Aaron Philip, une mannequin noire, transgenre et handicapée.
De fait, les mannequins ne sont plus présentées seulement comme de jolis visages mais comme des ambassadrices porteuses de messages. Pour son parfum Mutiny (« mutinerie »), Maison Margiela, sous la direction artistique de John Galliano, a choisi des femmes qui affirment « oser défier les codes identitaires et de féminité, une norme souvent limitante, pour affirmer leur propre identité », s’enthousiasme Guillaume de Lesquen, président monde de Designer Brands Fragrances L’Oréal Luxe.
Parmi ces « mutinists », Hanne Gaby Odiele, mannequin qui a révélé qu’elle était intersexe il y a deux ans, et Teddy Quinlivan. Sur les réseaux sociaux, la campagne s’est poursuivie avec, entre autres représentantes, Raya Martigny et Inès Rau. De quoi exprimer des valeurs progressistes.
Pas question que le message soit trop politique
Produit différent mais message similaire avec Gillette. L’hiver dernier, pour sa gamme féminine Venus, le fabricant de rasoirs a embauché Jazz Jennings, activiste LGBTQ de 19 ans. La jeune femme est notamment connue aux Etats-Unis pour une interview sur son identité trans qu’elle avait donnée enfant à l’animatrice Barbara Walters sur ABC News.
Dans le spot publicitaire de Gillette, la jeune fille raconte que le geste de se raser les jambes lui a permis à l’adolescence de « vraiment se sentir femme pour la première fois ». Elle confie aussi que, devenue plus sûre d’elle, elle s’est sentie libre de ne plus s’épiler si elle n’en avait pas envie.
L’ORÉAL A MIS FIN AU CONTRAT DU MANNEQUIN TRANSGENRE MUNROE BERGDORF APRÈS SES PRISES DE POSITION SUR LA TUERIE DE CHARLOTTESVILLE.
Les égéries sont certes invitées à exprimer leur identité, mais pas question que le message soit trop clivant ou trop politique : il doit rester dans le giron de celui porté par la marque. Ainsi, en septembre 2017, L’Oréal a mis fin au contrat du mannequin transgenre Munroe Bergdorf après ses prises de position sur les incidents de Charlottesville (Virginie), survenus un mois plus tôt.
Elle avait posté ce message sur son compte Instagram : « Je n’ai plus l’énergie de parler de la violence raciale des Blancs. Oui, de tous les Blancs. Parce que la plupart d’entre vous ne réalisent même pas ou refusent d’admettre que leur existence, leurs privilèges et leur succès en tant que race sont bâtis sur le dos, le sang et la mort de personnes de couleur. » Malgré une tentative d’explication sur les réseaux sociaux, la Britannique a aussitôt été évincée de la campagne à laquelle elle participait, L’Oréal considérant que son message contrevenait aux « valeurs de la marque » qui « soutient la diversité et la tolérance envers les gens, indépendamment de leur race, de leur milieu, de leur genre et de leur religion ».
Corps minces et jeunes
Munroe Bergdorf a ensuite partagé sa déception sur son compte : « On te demande de sourire dans des campagnes de beauté qui font l’éloge de la diversité. Mais tu ne dois surtout pas parler du fait que le manque de diversité est dû au racisme, ou des origines du racisme, ou cela te coûtera ton travail. »
Sam Bourcier, sociologue, militant politique et auteur d’Homo Inc.orporated : le triangle et la licorne qui pète (Cambourakis poche, 2019), estime que Bergdorf avait été « choisie parce qu’elle était trans, mais on l’a empêchée de s’affirmer comme personne racisée » : « On segmente les personnes, on valorise telle ou telle partie d’elles-mêmes comme on valorise des actifs, on réalise des plus-values. » Le penseur dit ne pas croire que la visibilité est synonyme de progrès : « Tout dépend des formes que prend cette visibilité, de qui porte cette visibilité. La mode récupère des mouvements sociaux pour les vider de leur substance politique. »
L’INCLUSIVITÉ DANS LA BEAUTÉ IMPLIQUE SOUVENT POUR LES FEMMES, TRANSGENRES OU NON, DES NORMES IDÉALES ET INACCESSIBLES.
« Je trouve extraordinaire qu’une top-modèle, après son coming out trans, puisse poursuivre son chemin et sa carrière, estime la sociologue Karine Espineira. Mais, d’un autre côté, on reproduit des normes corporelles qui peuvent être oppressives. »
Car l’inclusivité dans l’industrie de la beauté implique souvent, pour les femmes, qu’elles soient transgenres ou non, des normes idéales et inaccessibles : corps minces et jeunes ; visages lisses et rosés ; chevelures fournies, brillantes et soyeuses. Karine Espineira relève que « ces corps pourraient ne pas passer pour transgenres ».
Les seules morphologies trans acceptées par le monde de la beauté seraient donc celles qui « passent », les cultures LGBTQ ayant défini le terme de « passing », soit l’aptitude à ne pas avoir de pomme d’Adam proéminente ou de voix trop grave – donc de ne pas être confondue avec un homme.
Une problématique à laquelle n’a pas voulu répondre Sue Nabi. Personnage emblématique du monde de la beauté, cette femme d’affaires a passé vingt ans chez L’Oréal Paris, dont trois à la direction générale, puis quatre à la présidence de Lancôme. Une figure atypique, qui a joué un rôle majeur dans le secteur. Dans un portrait que lui consacrait Le Monde en 2013, elle assumait notamment son changement de genre passé.
Aujourd’hui, celle qui croit que la démarche la plus inclusive est de proposer des campagnes « sans visages » a lancé sa propre ligne de soins pour la peau, Orveda, une gamme « genderless » qui ne compte ni égéries ni ambassadeurs.
Sur son site, on ne voit que des produits. « Le soin de peau n’est lié ni au genre, ni au sexe de naissance, mais à l’efficacité. La recherche du glow, de l’éclat, n’est ni masculine ni féminine. C’est une attente de tous les consommateurs : des produits efficaces et une formulation clean, confie-t-elle. L’identité de genre, la carnation ou le poids n’ont rien à voir avec les cosmétiques. L’inclusivité, c’est justement de sortir des cases qu’on nous impose. »
Et les hommes trans dans tout ça ?
Il est des identités qui échappent à cette industrie de la beauté, qui, même si elle fait appel à des mannequins femmes trans, n’en reste pas moins normée. Aussi, si certains (rares) hommes trans sont apparus sur les podiums de mode, comme le jeune Américain Nathan Westling, ils sont absents de l’univers des cosmétiques ou de la beauté masculine.
Et il est encore loin le temps où des individus FTM (female-to-male) apparaîtront dans des réclames vendant des désodorisants musqués ou des rasoirs pour barbes de quatre jours. « Le caractère performatif et constructif de la féminité relève de l’évidence : on entend toujours dire que pour être une femme, il faut se maquiller, s’habiller, etc., estime Sam Bourcier. Pour la masculinité, au contraire, il y a l’idée qu’elle est naturelle, qu’elle s’impose. »








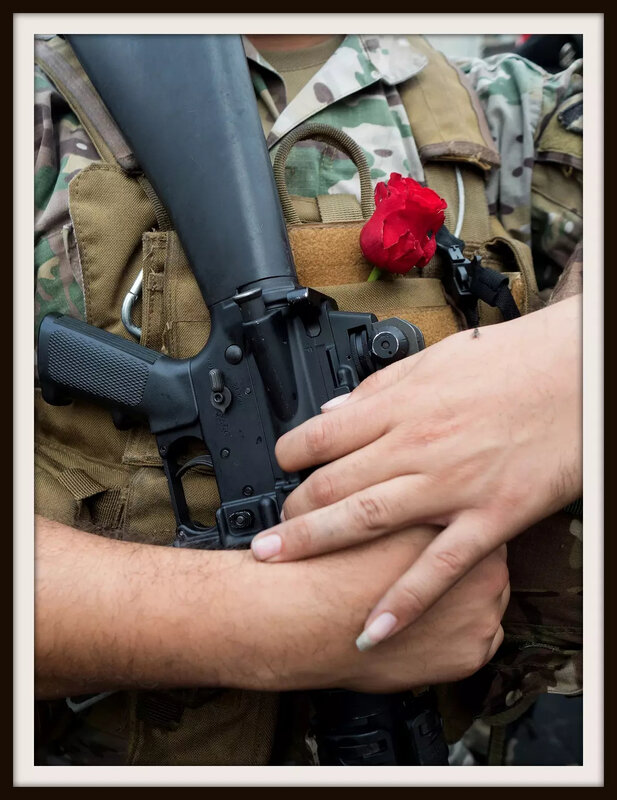










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)