Par Damien Leloup - Le Monde
De nombreux cas de chevaux mutilés ont été recensés en France ces dernières semaines, suscitant une grande émotion et diverses opérations pour retrouver les coupables. Dans les deux pays, des affaires similaires avaient suscité le même phénomène, avant d’être finalement attribuées à des causes naturelles.
Plus d’une trentaine de cas dans une douzaine de départements recensés par les services de l’Etat ; plus de cent sur une carte participative mise à jour par des internautes. Depuis le début de l’année, et plus encore depuis l’été, des chevaux sont retrouvés portant les traces de profondes coupures, atrocement mutilés ou morts. Une oreille, le plus souvent la droite, parfois la gauche, manque sur le cadavre ; un œil a été arraché ; parfois, les parties génitales ont été enlevées, et le museau est atrocement abîmé. Jeudi 3 septembre, une nouvelle enquête pour « acte de cruauté envers animaux » a été ouverte par le parquet de Limoges après la découverte dans la matinée du cadavre d’une jument mutilée.
C’est l’œuvre de dangereux « barbares », préviennent les autorités, dont le ministre de l’agriculture, Julien Denormandie. Les mutilateurs, particulièrement bien préparés et organisés, ne laissent pas de traces ; dans certains cas, des caméras de vidéosurveillance situées à proximité du méfait n’ont rien enregistré de notable ; dans d’autres, des chiens de garde n’ont pas empêché l’attaque. Les attaques se succèdent à un rythme effréné sur l’ensemble du territoire, et visent des animaux de grande taille, capables de se défendre à coups de sabots.
LE PORTRAIT-ROBOT DE L’AGRESSEUR PRÉSUMÉ A ÉTÉ PARTAGÉ PLUS DE 500 000 FOIS SUR FACEBOOK
Sur les forums et les groupes Facebook de passionnés de chevaux, l’émotion est gigantesque. Des milliers de messages ont été publiés ces derniers jours pour organiser des rondes, choisir un modèle de caméra de surveillance, ou partager des photographies de véhicules suspects aperçus près d’un pré. Le portrait-robot d’un agresseur présumé, gérant de centre pour animaux, dans l’Yonne, a été partagé plus de 500 000 fois sur Facebook.
Mais qui donc s’attaque ainsi aux chevaux ? Les enquêteurs, qui n’ont trouvé aucun point commun entre les différentes attaques hors du mode opératoire supposé, envisagent la piste d’une « secte sataniste » ou « d’un jeu macabre coordonné via Internet ».
Chaque année, des chevaux sont tués ou blessés par des humains. Mais dans la totalité des cas identifiés ces dernières années, les mobiles sont bien plus prosaïques ; on recense notamment des accidents de chasse ou de la circulation, des vengeances personnelles ou des cambriolages, ou, plus rarement, des actes zoophiles. L’existence d’une cabale nationale visant à démembrer des chevaux serait une première. Mais une autre hypothèse, peu envisagée jusqu’à présent, est pourtant très crédible : celle que les « mutilateurs de chevaux » n’existent tout simplement pas. Ou en tout cas, pas sous la forme imaginée.
Une affaire étrangement similaire en Suisse
A l’été 2005, une étrange série de mutilations d’animaux agite la Suisse. Des chevaux, des vaches, et surtout un âne baptisé Coca, doux comme un agneau et qui promenait les enfants à Couvet, dans le canton de Neuchâtel, sont retrouvés morts et atrocement mutilés. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs mobilisent de très importants moyens pour retrouver le « sadique des champs », et l’affaire fait les gros titres de toute la presse. Jusqu’au mois de septembre.
« J’AI LE COUPABLE. ON A RETROUVÉ DES POILS, ET CE SONT DES POILS DE CANIDÉ », AFFIRME OLIVIER GUÉNIAT
Olivier Ribaux, à l’époque analyste pour la police, se souvient très bien de cette discussion téléphonique avec Olivier Guéniat, qui dirigeait en 2005 la police judiciaire du canton. « Il m’a dit : “J’ai le coupable” », raconte-t-il au Monde. « J’étais un peu étonné, je lui ai dit, “ah bon, comment tu as fait ?”. Il m’a dit : “Avec l’ADN ! On a retrouvé des poils, et ce sont des poils de canidé”. »
Quelques semaines plus tôt, de retour de vacances, Olivier Guéniat avait décidé de tout reprendre à zéro : autopsies, témoignages, prélèvements… Il se rend dans un abattoir pour tester méthodiquement sur des carcasses différents types de couteaux, pour voir si les blessures coïncident avec celles relevées sur les cadavres. Les conclusions sont sans appel : ni l’âne Coca ni aucun des autres animaux examinés n’ont été tués par l’homme. Les bêtes sont mortes de cause naturelle, avant d’être mutilées par des charognards – renards, corbeaux et rongeurs.
Chasse aux satanistes au Royaume-Uni
Le même scénario s’est déroulé, avec quelques variations, dans de multiples pays ces dernières années. Au Royaume-Uni, d’abord : entre 1983 et 1993, une mystérieuse série de plus d’une centaine de mutilations de chevaux est signalée dans le Hampshire ; aucun suspect ne sera jamais arrêté. A l’époque, déjà, la presse tabloïd alerte sur les « tueurs satanistes », sans qu’aucun lien ne soit réellement établi.
Alan Jones et Alison Griffiths, respectivement historien et policière, ont longuement étudié le sujet ; s’ils se disent toujours convaincus qu’une ou plusieurs personnes ont attaqué des chevaux dans la région à l’époque, leur analyse statistique des attaques montre que, contrairement à ce qui était avancé dans la presse, les dates des « attaques » n’avaient aucun rapport avec les supposés « jours de sacrifice » d’un calendrier sataniste. « Dans quelques cas, des symboles avaient été dessinés sur place. Mais ils n’avaient aucun sens, et avaient possiblement été laissés pour faire peur », expliquent-ils au Monde.
UNE PRIME DE 20 000 LIVRES STERLING EST OFFERTE PAR LE « DAILY MAIL » ET DES ASSOCIATIONS
A l’époque, la police déploie des moyens impressionnants pour tenter d’attraper lesdits « satanistes » : des dizaines d’enquêteurs sont mobilisées, vingt-six suspects sont interrogés puis relâchés ; une prime de 20 000 livres sterling (qui correspondraient à environ 40 000 euros aujourd’hui) est offerte par le Daily Mail et des associations de défense des chevaux pour toute information permettant d’arrêter les coupables, sans succès.
L’enquête officielle est plus ou moins abandonnée à la fin des années 1990. Mais un homme la poursuit : Ted Barnes, ancien enquêteur de la Metropolitan Police Equine Crime Unit, qui travaille alors pour la Ligue internationale pour la protection des chevaux. Mais après quinze ans d’enquête, M. Barnes conclut que les coupables n’existent pas.
A l’exception d’une poignée de cas où une intervention humaine est possible, la plupart s’expliquaient par des mutilations causées par des charognards, ou des blessures accidentelles du cheval, expliquait-il en 2001 au Guardian. Même les blessures les plus suspectes, touchant les parties génitales et souvent attribuées à un pervers sexuel sadique, ont d’autres explications : « Une jument en chaleur peut avoir un comportement aberrant, se frotter contre un poteau ou un objet coupant, et ensuite tenter de soulager la douleur en continuant de se frotter, ce qui occasionne des blessures atroces. Un cheval ne s’arrête pas parce qu’il voit du sang. »
En 2013 à Dartmoor, dans le Devon, la mort d’un poney retouvé sans son sexe, sa langue et avec une oreille manquante, avait été attribuée à des satanistes. Jusqu’à ce que l’autopsie confirme que l’animal était mort de causes naturelles, puis partiellement dévoré par des charognards. | CAPTURE D’ÉCRAN
Autres animaux, mêmes conclusions : entre 2015 et 2018, le pays se passionne pour l’affaire du « tueur de chats de Croydon », dans la banlieue sud de Londres. Plusieurs centaines de corps de félins mutilés sont signalés, des moyens colossaux sont investis dans la traque d’un sadique, avant que l’enquête ne conclue que les animaux avaient été renversés par des voitures et mutilés, là encore, par des corbeaux et des renards.
Le FBI et la piste extraterrestre
Des séries semblables sont signalées entre 1993 et 2003 en Allemagne – aucun « pferderipper » (éventreur de chevaux) ne sera jamais identifié. Mais aussi aux Etats-Unis, où les mutilations d’animaux – des chevaux mais aussi et surtout des vaches – alimentent, depuis les années 1970, différentes thèses, dont celle, très populaire, d’une intervention extraterrestre. En 1979, le FBI s’empare du dossier, et confie une enquête à Kenneth Rommel, vétéran de l’agence fédérale qui a travaillé durant vingt ans sur les braqueurs de banques. L’enquêteur rouvre les dossiers de 96 cas, six chevaux et 90 vaches, tous au Nouveau-Mexique – où se situe la célèbre zone 51, censée avoir recueilli l’épave d’un OVNI qui se serait écrasé près de la ville de Roswell.
Son rapport, aujourd’hui public, est sans appel : « Je n’ai rien trouvé dans les rapports qui indique que ces animaux ont été mutilés par autre chose que des prédateurs ou des charognards. Toutes les preuves suggèrent fortement que ces animaux sont morts de mort naturelle ou de blessures courantes, et ont ensuite été partiellement dévorés par des charognards. »
Seuls deux cas semblaient compatibles avec des blessures à l’arme blanche. Dans des interviews postérieures, l’agent se montrera plus direct, et aussi peu amène pour les forces de l’ordre et pour la presse : « Vous avez le shérif machin-chose, qui n’est même pas capable de retrouver sa propre voiture de police, qui vous dit “Ça ressemble à une coupure faite par un laser chirurgical”, et comme les journalistes adorent ce genre de trucs, ils le répètent. Moi, si j’étais journaliste, je commencerais par lui demander, “Shérif, comment se fait-il que vous vous y connaissiez autant en lasers chirurgicaux ?” »
Blessures trompeuses
C’est un point commun dans de nombreux cas de mutilations signalées en France : des blessures qui semblent avoir été faites à l’aide d’un couteau ou d’un scalpel, suggérant qu’une intervention humaine est évidente, voire le fait d’un professionnel, vétérinaire, boucher ou médecin. Or, ce n’est pas si simple : comme le note une abondante littérature scientifique, les blessures causées par des charognards peuvent à s’y méprendre ressembler à des coups portés par une arme blanche. Les morsures de renard, par exemple, peuvent avoir une forme « surprenamment droite, semblable à celle d’un coup de couteau », notait en 1989 le Canadian Veterinary Journal. Les coupures et blessures similaires, parfois impressionnantes, sont courantes chez les chevaux.
« LES VÉTÉRINAIRES SOIGNENT, CE NE SONT PAS DES MÉDECINS LÉGISTES ! », EXPLIQUE OLIVIER RIBAUX
En 2005, en Suisse, même des policiers et vétérinaires aguerris se sont trompés, se souvient Olivier Ribaux, aujourd’hui professeur à l’Ecole des sciences criminelles de l’université de Lausanne et vice-doyen de la faculté de droit : « Quand on est policier, et qu’on intervient sur un homicide, on sait comment faire, on a l’habitude ; un animal, moins. Et les vétérinaires soignent, ce ne sont pas des médecins légistes ! » Seule une autopsie en bonne et due forme permet de confirmer ou d’infirmer l’origine d’une blessure. Les analyses menées par le réputé Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont ainsi permis d’écarter toute intervention humaine dans la mort d’un cheval, retrouvé avec un œil et une oreille en moins, le 17 août, près de Roanne (Loire).
Climat de panique
Plus complexe encore, certains détails qui semblent suggérer une intervention humaine, comme un rituel satanique, s’avèrent trompeurs. Le fait que seule une oreille ait été prélevée, ou encore la disparition de l’appareil génital ou d’un œil, trouvent une explication très logique dans le comportement des charognards, qui s’attaquent en priorité aux parties aisément accessibles et moins protégées par de la peau épaisse. Ces animaux n’ont pas la force nécessaire pour soulever la tête d’un cheval, et s’attaquent donc à l’oreille et à l’œil exposés…
« DES TOURISTES PASSENT UNE NUIT EN GARDE À VUE PARCE QU’ILS OBSERVENT LES VACHES AVEC DES JUMELLES », SE RAPPELLE OLIVIER RIBAUX
En Suisse, enquêteurs et journalistes ont fait leur autocritique, et tiré des leçons de l’étrange épisode du « zoophile des champs », comme ils l’avaient surnommé en 2005. Survenue en plein été, l’affaire avait « bénéficié » d’une actualité par ailleurs morne, qui avait contribué à sa mise en avant permanente. Mais le climat de panique avait nui à l’enquête, juge M. Ribaux. « Imaginez la situation. Il y a une pression sur les enquêteurs, le politique s’en mêle, il y a des patrouilles de paysans armés… Des touristes se font arrêter et passent une nuit en garde à vue parce qu’ils observent les vaches avec des jumelles… C’est difficile de réfléchir à d’autres hypothèses. Un contexte s’est construit, dès qu’on voit une bête morte dans un champ, tout de suite on pense que c’est lié à l’affaire. »
Quelques articles de presse publiés en août. Plusieurs centaines d'articles ont été publiés sur le sujet, y compris dans de très nombreux journaux étrangers.
En France, de nombreux propriétaires d’animaux revisitent aussi, à la faveur de l’actualité, la mort plus ancienne de leur animal. En 2019, « j’ai retrouvé la doyenne des juments du troupeau morte dans le pré avec une oreille en moins. A l’époque nous avions pensé à un animal. (…) Aujourd’hui, je suis sûr que c’était déjà ces malades mentaux », écrit ainsi une internaute, parmi de nombreux témoignages similaires, sur un groupe Facebook de propriétaires de chevaux. D’autres, à l’inverse, se montrent très prudents, pour ne pas « alimenter une psychose », comme cette propriétaire d’une jument retrouvée avec une « entaille nette » qui envisage aussi la piste d’une blessure accidentelle.
L’idée du « tueur en série d’animaux » a la vie dure – faute d’autopsies systématiques sur les animaux, de nombreux cas de mutilations sont restés, ces dernières années, sans explication certaine. En Suisse, des années après la série de l’été 2005, de nombreuses personnes restent convaincues qu’un tueur sadique a bien sévi dans les cantons du pays ; et des internautes continuent de mener leur propre enquête sur le « tueur de chats de Croydon ». Aux Etats-Unis, la théorie d’expériences à grande échelle pratiquées par des extraterrestres sur le bétail reste un sujet phare des sites d’ufologie.
Face aux images horribles des corps mutilés, « on a besoin d’explications, note M. Ribaux. Si l’on n’en trouve pas, on va en chercher : rites sataniques, extraterrestres, challenges sur Internet… Paradoxalement, l’hypothèse alternative qui consiste à dire que peut-être il s’agit simplement de morts naturelles apparaît moins claire que les autres ! »



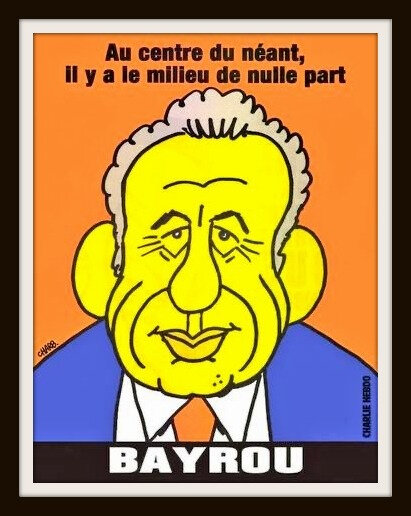

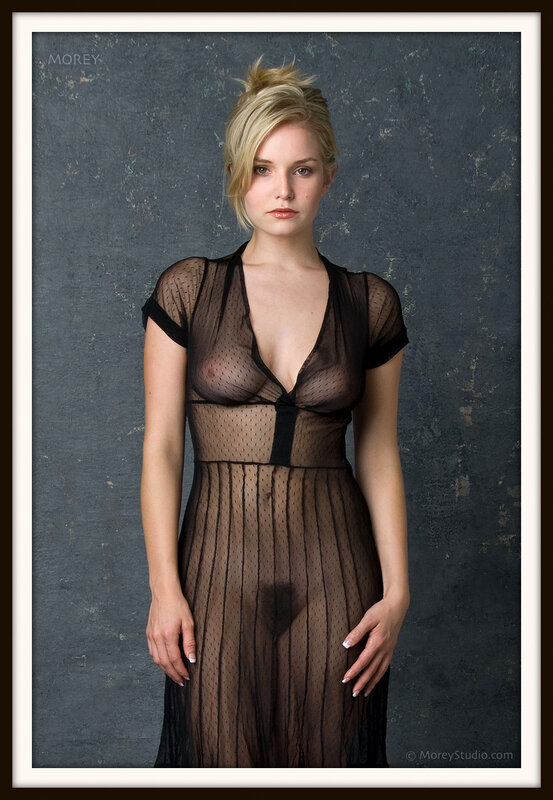
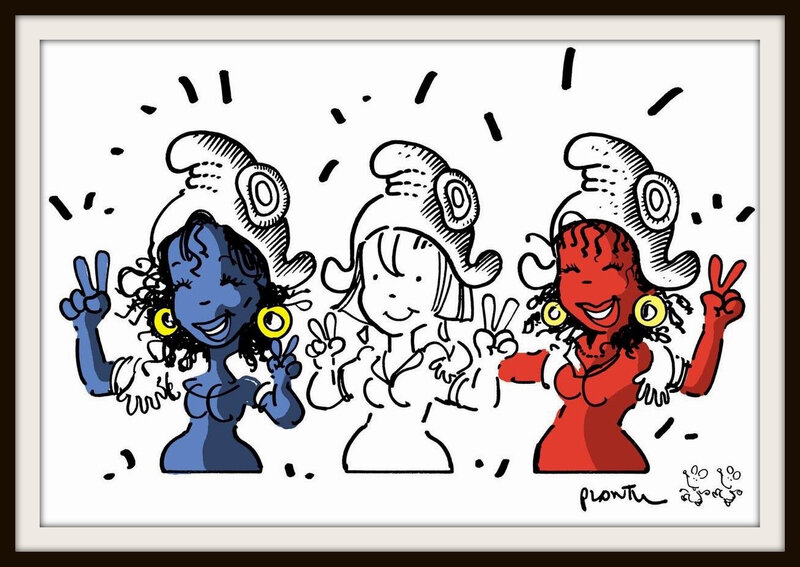


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)