
Par Aureliano Tonet
Au-delà de sa célèbre collaboration avec le réalisateur Sergio Leone, le chef d’orchestre et compositeur italien, mort le 6 juillet, à 91 ans, laisse une œuvre immense.
Joueur chevronné, Ennio Morricone avait composé l’hymne des Jeux olympiques d’échecs, qui s’étaient déroulés en 2006, à Turin. « Le jeu d’échecs est bien plus qu’un simple passe-temps, affirmait-il, en 1991, au magazine spécialisé Torre & Cavallo. C’est une chose importante ; une philosophie, un moyen de mieux se connaître, un miroir de la lutte de la vie. » Anecdotiques, sans doute, au regard d’une œuvre musicale parmi les plus prodigieuses du XXe siècle, ces phrases peuvent être transposées au rapport passionnel qu’il entretenait avec la chose artistique : une affaire « importante », où l’intimité le dispute au lyrisme, et la conflictualité à l’apaisement.
Pour le partenaire emblématique du cinéaste Sergio Leone, qu’il a accompagné de Pour quelques dollars de plus (1964) à Il était une fois en Amérique (1984), cette lutte s’est achevée, lundi 6 juillet : le chef d’orchestre et compositeur italien est mort, à 91 ans, dans une clinique de sa ville de Rome, où il avait été admis à la suite d’une chute.
Il était une fois, donc, Ennio Morricone. Né le 28 novembre 1928, à Rome, il grandit à Trastevere, alors l’un des quartiers les plus populaires de la capitale italienne. Sa mère, qui travaille dans le textile, l’élève au côté de ses trois sœurs, Adriana, Maria et Franca. La peintre yougoslave Eva Fischer, de retour de déportation, est sa voisine. Plus tard, Morricone conviendra que cette enfance sous haute protection féminine a pu nourrir son attrait pour les voix de femmes − l’un des leitmotivs de sa proliférante discographie. « L’instrument par excellence, celui qui ménage les plus impressionnantes variations, du cri au murmure, c’est la voix humaine − en particulier féminine », confessera-t-il, en 2014, au Monde.
Tout aussi décisive sera l’influence paternelle : originaire d’Arpino, dans le Latium, Mario Morricone est trompettiste dans divers orchestres. C’est cet instrument que le jeune Ennio décide d’étudier au conservatoire de Santa Cecilia, en même temps que l’orchestration et la composition. Une encre dont se servira le maestro pour établir sa « signature » : altières et mélodieuses, ses parties de trompette figurent en tête des sonorités auxquelles l’adjectif « morriconnien » est le plus souvent associé, avec le tressautement de la guimbarde ou le chuintement des chœurs.
Si ces « gimmicks » l’ont rendu célèbre bien au-delà du cercle des amateurs de musique de films, le Romain prenait ombrage de ce que l’on réduise son écriture à une succession d’effets, aussi accrocheurs fussent-ils : « La trompette produit des sons tellement intenses qu’il faut l’utiliser avec parcimonie », disait celui qui a gravé quatre morceaux avec le jazzman Chet Baker, en 1962.

Premiers pas dans la musique légère
Car c’est dans la « musique légère », comme disent les Transalpins, qu’Ennio Morricone a fait ses gammes. D’abord sur les plateaux de la télévision nationale, la Rai, où il effectue quelques piges d’arrangeur, entre 1956 et 1958. Puis, plus fondamentalement, au sein de la filiale italienne de Radio Corporation of America (RCA).
Nommé directeur artistique de cette maison de disque, en 1956, Vincenzo Micocci a de grandes ambitions : offrir au « Boom » − le miracle économique italien − une bande-son digne de ce nom. En 1961, Micocci fait édifier de vastes studios d’enregistrement, via Tiburtina, au nord de Rome. Il en confie les clefs à un trio d’arrangeurs qui viennent de s’illustrer sur plusieurs productions siglées RCA : l’Argentin Luis Bacalov, ainsi qu’un duo d’amis fraîchement diplômés du conservatoire, Bruno Nicolai et Ennio Morricone.
Grâce à ce trident exceptionnel, la pop de la Botte rivalise bientôt d’inventivité avec ses rivales anglo-saxonnes. Morricone, en particulier, officie derrière les principales vedettes de l’époque, à un rythme effréné : Mina (Se telefonando), Gianni Morandi (Fatti mandare dalla mamma), Gino Paoli (Sapore di sale), Rita Pavone (T’ho conosciuto), Edoardo Vianello (O mio signore), Jimmy Fontana (Il Mondo), Paul Anka (Stasera resta con me)…
Pour le jeune orchestrateur, cette école est le contrepoint idéal à ses études académiques. A Santa Cecilia, son maître Goffredo Petrassi l’avait initié au répertoire classique − Bach, Beethoven, Stravinsky − comme à l’avant-garde contemporaine, de Luciano Berio à Luigi Nono. Chez RCA, Morricone découvre un instrumentarium que les mandarins du conservatoire vouaient aux gémonies, et qui fera le sel de ses futures partitions : guitare électrique, basse, batterie… Il apprend la vitesse d’exécution, l’efficacité mélodique, l’émulation collective. Surtout, il saisit le potentiel artistique de formes alors jugées mineures, car populaires : la pop-music, dont il goûte la malice et la sensualité, tout en onomatopées ; et, bien sûr, le cinéma.
Faut-il s’en étonner ? Le premier cinéaste à faire appel à lui, Luciano Salce, a frayé avec le music-hall. Artiste prolixe que ce Salce, tour à tour acteur, parolier, metteur en scène de théâtre, de télévision ou de cinéma. Morricone l’a brièvement côtoyé dans les studios de la Rai, en 1958, puis lors des répétitions d’une pièce avec le mime Félicien Marceau, La Pappa Reale (1959), dont il assure l’illustration sonore.
Lyrisme facétieux
Leurs six collaborations filmiques, de Mission ultra-secrète (1961) à El Greco (1966), sont dans le ton des travaux de Morricone chez RCA : entre autres merveilles, la voix ténébreuse du chanteur Luigi Tenco y fait mouche, servie par les paroles de Salce et les cordes lancinantes du maestro.
Au sud de Rome, dans les studios de Cinecittà, les jeunes Turcs du cinéma italien repèrent ce compositeur prometteur. Parmi eux figure une vieille connaissance de Morricone, Sergio Leone, qui a fréquenté la même école primaire que lui.
Enfant de la balle − son père est réalisateur, sa mère actrice −, épris de cinéma américain, Leone cherche à subvertir les stéréotypes du western. En croisant cet imaginaire avec ceux du péplum et du film de samouraï, il compte bien en révéler l’ironie ; pire, la cruauté. Finies les poursuites effrénées de cow-boys et d’Indiens : place à une ronde de mercenaires et de gringos, cupides et laconiques. Le scénario de Leone tient en quelques lignes ? A charge pour Morricone, préposé à la bande-son, d’en déployer toute la richesse. Le maestro pioche dans le lexique qu’il a commencé à élaborer pour Salce et la RCA − arpèges obsédants, chœurs incongrus… −, dont il accentue les facéties opératiques. Le résultat, Pour une poignée de dollars (1964), est un carton international, et propulse Morricone au rang de star, en même temps que la vedette du film, un certain Clint Eastwood.
Dès lors, le compositeur sera de tous les longs-métrages de Leone. Et pour quelques dollars de plus (1965), Le Bon, la Brute et le Truand (1966), Il était une fois dans l’Ouest (1968), Il était une fois la révolution (1971) creusent la veine du western à l’italienne, auquel la presse a cru bon d’accoler le terme « spaghetti », ce qui a le don d’irriter Morricone.
Quant à leur ultime collaboration, Il était une fois en Amérique (1984), elle fera date : le film est une méditation mélancolique sur le temps et l’amitié, et la partition, le plus vertigineux des sabliers. Du reste, il n’est pas interdit de lire, dans le duo formé par Max (James Wood) et Noodles (Robert De Niro), un écho de la relation tempétueuse qu’entretenait le cinéaste avec son alter ego musical.
Est-il couple plus dissemblable que Leone, ogre débonnaire et généreux, et Morricone, ludion sec et nerveux ? « Sergio supportait la Lazio de Rome, et Ennio le club de foot rival, l’A.S. Roma, racontait au Monde l’acteur et cinéaste Carlo Verdone, en 2019. Je me demandais comment ils pouvaient s’entendre aussi bien l’un avec l’autre… Lorsque Leone m’a annoncé qu’il produirait mon premier film, Un Sacco Bello (1980), il a emmené Morricone dans ses bagages. C’était non négociable, j’étais terrorisé ! Dieu soit loué : sa bande-son est un joyau. »

Un caractère trempé
Cela a contribué à sa légende : le caractère du compositeur était plutôt du genre trempé. Dans un premier temps, cet orgueil rageur sera son meilleur atout. A partir de la moitié des années 1960, l’Italie bascule dans la violence politique ; une nouvelle génération de cinéastes, aussi dorée que séditieuse, s’en fait l’écho.
Pour leurs pellicules irrévérentes, les partitions incandescentes de Morricone s’avèrent le combustible idoine : Bernardo Bertolucci l’enrôle sur Prima della rivoluzione (1964), Marco Bellocchio sur Les Poings dans les poches (1965), Pier Paolo Pasolini sur Des oiseaux, petits et gros (1966). Suivront Marco Ferreri, Elio Petri, Mauro Bolognini, Dario Argento, Mario Bava, les frères Taviani… « Il ne se passe pas un mois sans qu’Ennio et moi, nous nous engueulions par téléphone, confiait le réalisateur Paolo Taviani au Monde, en 2018. C’est un génie, et une sacrée tête de mule. »
Il n’empêche, sur les génériques, « Musique d’Ennio Morricone » devient le plus fiable des labels de qualité. D’autant qu’il franchit sans encombres les frontières : en 1969, son nom apparaît aussi bien à l’affiche du Clan des Siciliens, du Français Henri Verneuil, que de La Tente rouge, du Soviétique Mikhaïl Kalatozov ; deux ans plus tard, Here’s To You, extrait de Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo, est un tube international, porté par la voix de Joan Baez.
Mais, très vite, les choses se gâtent : « Ennio demandait qu’on lui apporte le film déjà monté, expliquait Marco Bellocchio au Monde, en 2016. Alors seulement il pouvait se mettre au travail : il regardait les images et composait la musique, point final. Je voulais davantage d’interaction ; à partir de 1972, je me suis tourné vers un compositeur plus jeune et conciliant. » En authentique auteur, Morricone exige, auprès de chacun de ses collaborateurs, le « final cut » : il ne l’obtiendra pas toujours, loin s’en faut. Malgré la fidélité que lui témoigneront Bernardo Bertolucci, Mauro Bolognini ou Guiseppe Tornatore, sa carrière, jalonnée de fâcheries plus ou moins définitives, souffrira en partie de cette irascibilité. Elle lui devra aussi, paradoxalement, ses plus beaux trésors.
Dès 1966, Morricone, qui ne désire rien davantage que de garder le contrôle sur ses créations, claque la porte de RCA : il fonde avec son vieux complice Vincenzo Micocci la maison de disque Parade. Un nom ô combien morriconien, tout d’esquive et d’esbroufe, qui tient autant de la revue militaire que de la rêverie. Quatre ans durant, Morricone y publiera certains de ses meilleurs disques, ainsi que ceux d’arrangeurs (Piero Piccioni, Luis Bacalov, Armando Trovajoli…) et d’interprètes dont il partage la sensibilité. Las, entâché par les malversations d’un avocat possédé par le demon du jeu, le label ferme boutique en 1970. Cet échec ne dissuade guère le compositeur d’ouvrir, la même année, et aux côtés des mêmes musiciens, un studio d’enregistrement dernier cri, le Studio Ortophonic.
Il donne sur la Basilique du Sacré-Cœur Immaculé de Marie, une église massive du très chic quartier des Parioli, dans le nord de Rome : « Quand j’y pense, cela me semble incroyable que Morricone ait enregistré les bandes-son des premiers films de mon père, Dario Argento, dans un environnement aussi coincé », racontait au Monde la fille du maître du cinéma d’épouvante, Asia Argento, en janvier.
Schizophrénie musicale
De fait, au tournant des années 1970, Morricone semble une parfaite incarnation de la notabilité. Avec le groupe d’improvisation Nuova Consonanza, ou sous son propre nom, il cède à son penchant pour la musique sérieuse, ou plutôt « absolue », ainsi qu’il la définit : « La musique de film, à l’inverse de la musique absolue, est appliquée et contrainte, insistait-il, non sans une pointe de condescendance. Elle s’adresse à un public de culture moyenne. »
Toujours impeccable avec ses montures foncées et sa mine concentrée, déjà bardé d’hommages et de récompenses, Morricone file, depuis 1956, un mariage sans histoires avec Maria Travia, qui lui donnera quatre enfants. Sauf que sa discographie prend une allure de plus en plus schizophrène : d’un côté, les partitions « respectables », adoubées par l’establishment du classique et du cinéma international ; et de l’autre, des bandes-son démoniaques, illustrant les sous-bois les plus permissifs du cinéma « bis ».
Composées à une cadence de satyre, publiées en catimini, voire sous des pseudonymes dignes d’acteur porno (Dansavio, Leo Nichols…), ces bandes originales voient Morricone prendre part à une improbable bacchanale. Dans cette Italie à cheval entre les années 1960 et 1970, l’heure est au mélange des genres cinématographiques ‒ le film érotique drague le policier, le péplum pactise avec le western. Pour célébrer ces noces torrides, le maestro trouve des notes insensées : débarrassé des étiquettes esthétiques, confronté à des cinéastes aux ego moins susceptibles, il laisse dériver sa virtuosité vers de voluptueux rivages, qui empruntent autant à la musique baroque qu’au funk et à la bossa-nova. N’a-t-il pas enregistré tout un album, en cette prolifique année 1970, avec le maître de la musique populaire brésilienne, Chico Buarque de Hollanda ?
Comble de la lascivité, il invite ses camarades de jeu à participer à l’orgie : à la même époque, les condisciples les plus proches de Morricone − Bruno Nicolai, Piero Umiliani… − se livrent à des caresses musicales similaires, même si aucune de leurs bandes originales n’égalera ses prouesses. Avec le temps, ces musiques composées pour d’obscures séries B − La Donna Invisibile (1969) de Paolo Spinola, Metti, una sera a cena (1969) de Giuseppe Patroni Griffi, Maddalena (1971) de Jerzy Kawalerowicz… − ont été réévaluées, au point d’apparaître aujourd’hui comme les chapelles sixtines de sa discographie.
Morricone lui-même était conscient de leur valeur. N’a-t-il pas « recyclé » l’un de ces thèmes, Chi Mai ?, pour la fameuse bande-son du Professionnel (1981) de Georges Lautner ? Le compositeur n’oubliait jamais d’inclure ces partitions sensuelles au répertoire des concerts qu’il donnait depuis des décennies, dans les arènes du monde entier. Avec leur protocole réglé comme du papier à musique, ponctué par d’interminables ovations, ces cérémonies insistaient, non sans emphase, sur la carrière internationale de Morricone.
C’est que celle-ci, à partir de L’Exorciste II de John Boorman (1977), connaît une vive accélération. Là encore, la liste des cinéastes qui se sont tournés vers lui donne le tournis : Terrence Malick (Les Moissons du Ciel, 1978), John Carpenter (La Chose, 1982), Brian de Palma (Les Incorruptibles, 1987), Roman Polanski (Frantic, 1988), Pedro Almodovar (Attache-moi, 1990) ou Quentin Tarantino (Les Huit Salopards, 2015, qui lui valut son premier Oscar, en 2016, neuf ans après celui reçu pour l’ensemble de sa carrière)… Rien moins que le gotha du cinéma mondial, même si Morricone s’adonnait, de temps à autre, à des choix plus compromettants : qui se souvient de sa participation à La Cage aux folles 2 (1980), d’Edouard Molinaro, par exemple ?
Avant de se rendre à la pharmacie où il avait ses habitudes, dans le centre de Rome, le compositeur passait systématiquement un coup de fil : « Morricone ! », criait-il dans le combiné. « Lequel ? », répondait la pharmacienne, qui comptait un homonyme parmi sa clientèle. Le compositeur faisait alors fuser les noms d’oiseaux : « Le maestro, bon Dieu ! Celui dont le nom a été donné à un astéroïde ! » Une passe d’armes qui évoque celle qui l’opposa à Quentin Tarantino, en novembre 2018, sur un mode bien plus planétaire et polémique : « Cet homme est un crétin, aurait dit Morricone à un journaliste de la version allemande de Playboy. Il n’a rien des grands d’Hollywood, comme John Huston, Alfred Hitchcock ou Billy Wilder. Tarantino ne fait que du réchauffé. » Après la publication, l’Italien nia ardemment avoir tenu de tels propos, menaçant même le magazine de poursuites judiciaires.
L’« anxiété » de la scène
Du reste, on touche là au cœur du système Morricone : la musique a-t-elle déjà connu un être à ce point écartelé entre la quête d’honorabilité et l’appel de la dépravation ?
Avant chaque interview, le « staff » du musicien glissait aux journalistes une liste d’expressions prohibées et de « conseils » pour que l’entretien se déroule dans de bonnes conditions : mieux valait, vous faisait-on comprendre, prononcer le mot « maestro » que « spaghetti ». Cependant, le même entourage se plaisait à raconter les « vices cachés » de Dottore Ennio et Mister Morricone : parmi eux, une passion quasi pathologique pour les clefs de chambre d’hôtel, dont il avait assemblé, murmurait-on du bout des lèvres, une impressionnante collection. Curieuse manie pour quelqu’un qui a passé sa vie cloîtré dans son studio d’enregistrement, non ?
Pas tant que ça, répondront ceux qui ont déjà assisté à l’un de ses concerts. Sur scène, Morricone semblait user de sa baguette comme un serrurier manœuvre la gâche, le pêne ou la bouterolle. En fin mécanicien, il privilégiait les sonorités métalliques − carillon, glockenspiel, clavecin, arpèges de guitare électrique, cuivres −, qu’huilaient violons et violoncelles. Si certaines parties paraissaient un brin rouillées (basses et batteries notamment, très kitsch), le dispositif, dans l’ensemble, fonctionnait à merveille : chez chaque spectateur, la boîte à images s’ouvrait grand, laissant défiler une cavalcade de cow-boys et de coyotes, de mafieux et de filles fardées. « Avant de monter sur scène, je ressens une grande anxiété, reconnaissait-il en 2014. Comme tout chef d’orchestre, j’ai une responsabilité vis-à-vis des musiciens et du public. Si le concert se passe bien, je redeviens tranquille. »
De toutes ces grands-messes, les plus poignantes furent données à Rome, comme il se doit. Pour ses adieux à la Ville éternelle, Morricone reçut, le 11 janvier, une longue standing-ovation, au Sénat. Six mois plus tôt, du 15 au 23 juin 2019, il s’était produit dans un lieu à l’histoire autrement sulfureuse, les thermes de Caracalla : c’est que, chez cet homme-là, les honneurs se doublaient toujours d’un frisson de volupté.











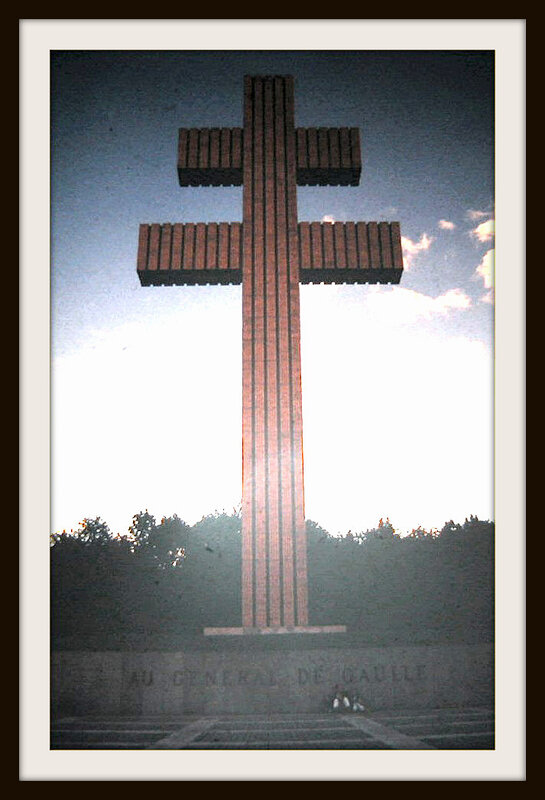










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)