Woodstock, 15-18 août 1969 : rock, « peace and love » et crises de nerfs
Par Sylvain Siclier
C’était il y a cinquante ans. Du 15 au 19 août 1969, 500 000 personnes sont venues assister au festival, bien plus que le nombre de billets vendus. Retour sur les moments de grâce ou des folies musicales, les embouteillages monstres et les briquets levés.
Du 15 au 18 août 1969, près de 500 000 personnes – un nombre estimé – seront venues, à un moment ou un autre assister au Woodstock Music and Art Fair, près de la commune de Bethel dans l’Etat de New York. Au programme du festival musical, une trentaine de groupes de rock, de folk et de blues, dont quelques vedettes – Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplins, Crosby Stills Nash & Young, The Who, Sly and The Family Stone, Jimi Hendrix.
Il y eut des moments de grâce ou de folie musicales (Sly and The Family Stone emporta la nuit vers le funk cosmique et torride), des artistes qui y furent révélés (Richie Havens, Melanie, Santana, Joe Cocker…), d’autres oubliés depuis (Quill, Bert Sommer, Sweetwater…), une jeunesse libre et joyeuse.
Et aussi des embouteillages monstres causés par un afflux de spectateurs, plus du double des billets vendus, des orages qui transformèrent les lieux en décor de fin du monde, beaucoup de désorganisation – initialement prévu à Woodstock, le festival n’a trouvé son site que trois semaines avant son ouverture –, des concerts ratés, des tractations financières en coulisses, un déficit qu’il fallut plusieurs années à rembourser.
A l’occasion de l’anniversaire des 50 ans du festival, retour sur quelques épisodes de ce qui a été mythifié avec le temps en rassemblement de la contre-culture aux Etats-Unis, quand pour ses responsables il s’agissait avant tout de réaliser une bonne opération commerciale.
1. Vendredi 15 août : un air de liberté et des embouteillages
Il est environ 17 h 40, vendredi 15 août 1969, lorsque, sur la scène en bois du Woodstock Music and Art Fair – « foire musicale et artistique de Woodstock », nom officiel –, le guitariste et chanteur Richie Havens (1941-2013) répète le mot freedom, « liberté », sur la mélodie de Motherless Child, un chant apparu au temps de l’esclavage aux Etats-Unis.
Havens, comme cela est rappelé dans le livre Woodstock, de Mike Evans et Paul Kingsbury (traduction française, Editions de La Martinière, 288 pages, 25 euros), avait interprété toutes ses chansons prévues. On lui demande de continuer pour faire patienter avant le prochain groupe retardé. « Pendant la longue intro (…) je gagnais du temps pour savoir ce que j’allais chanter. Je crois que le mot “freedom” m’est sorti de la bouche à cause de cette liberté que j’avais sous les yeux. »
Cette improvisation, immortalisée dans le film consacré au festival, réalisé par Michael Wadleigh et sorti en mars 1970 – avec notamment dans l’équipe la monteuse Thelma Colbert Schoonmaker et Martin Scorsese comme assistant réalisateur –, ce freedom répété à l’envi, devenant la chanson-symbole de cet air de liberté associé à la mythologie de Woodstock. Liberté des idées, des corps et des esprits dans les atours de la période hippie, durant « trois jours de paix et de musique », slogan de la publicité publiée à quelques jours du festival « dans des centaines d’hectares (…) sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge ».
C’est en fait Sweetwater, formation folk-rock psychédélique de Los Angeles, qui devait ouvrir le festival. Le groupe s’est retrouvé bloqué dans des embouteillages commencés dès le matin. Les petites routes pour arriver au village de Bethel (New York), à 170 km au nord-ouest de la ville de New York, près duquel a été installé le festival, sont devenues impraticables. Dans un rayon de vingt kilomètres, des dizaines de milliers de voitures ont été garées sur les bas-côtés. Bus et navettes en provenance de New York et des villes environnantes ne peuvent avancer. On termine le trajet à pied, encombrant un peu plus le passage.
D’abord prévu dans la commune de Woodstock, au nord de New York, puis à Saugerties à quelques kilomètres, le festival a gardé son nom de Woodstock lors de l’annonce, fin mai, qu’il irait à Wallkill… avant de trouver une solution à Bethel, fin juillet.
L’équipe prend ses quartiers au motel El Monaco, à White Lake, un hameau à 4,5 km du terrain loué à Max Yasgur, éleveur de vaches laitières. Il a fallu tout installer rapidement à tel point que le site est à peine terminé au moment de l’ouverture et que les accès en sont mal contrôlés. Surtout, le nombre de spectatrices et spectateurs qui convergent vers le site est bien plus important que prévu.
Si 186 000 billets ont été vendus (pour un, deux ou trois jours), ce sont entre 400 000 et 500 000 personnes, qui seraient venues, à un moment ou l’autre, sur la pente herbeuse et les abords du festival, comme l’indiquera, peu après, l’un des organisateurs, Michael Lang – associé au sein de la société Woodstock Ventures avec John P. Roberts, Joel Rosenman et Artie Kornfeld. Dont 4 062 personnes munies d’un billet qui n’ont pu accéder au site et ont été remboursées après.
Les fins grillages qui délimitent le site peuvent être pliés facilement. Une partie de la foule trouve plus pratique de passer par là plutôt que de continuer à faire la queue. Max Yasgur n’a pas voulu que l’on entoure l’ensemble de ses terres. On arrive donc aussi par des forêts alentours, des petits chemins. En fin d’après-midi, il n’est plus possible de gérer la billetterie. Le festival est déclaré « free », en accès libre, gratuit. Annonce faite par John Morris, coordinateur de production du festival et l’un des présentateurs.
De toute manière, le budget est déjà largement dépassé, notamment avec les dépenses de location d’hélicoptères pour amener certains groupes coincés dans les embouteillages ou du ravitaillement. Alors autant passer pour de chouettes organisateurs sympas. Même si un plan du film les montre prendre la décision… le sourire crispé.
2. Des briquets levés et trois chansons souvenirs
C’est un briquet rectangulaire, en métal blanc, orné de symboles du désarmement nucléaire et de la paix (un cercle renfermant une fusée stylisée). En rouge, le dessin de la guitare et la colombe conçu par Arnold Skolnick pour les affiches du festival de Woodstock, plus la mention « 50 Years 1969-2019 Woodstock ». Dans un communiqué, il est précisé que cette édition spéciale du célèbre briquet Zippo, entend aussi rappeler la tradition « des briquets levés aux concerts ».
Laquelle tradition aurait trouvé son origine lors du passage de la chanteuse folk Melanie Safka, dite Melanie, vendredi 15 août 1969, dans la nuit, presque à la fin de la première journée du festival. Le sitariste indien Ravi Shankar et ses deux musiciens ont quitté la scène sous une averse – il y en aura d’autres de forte ampleur le samedi 16 et le dimanche 17. La scène est trempée, le système électrique non sécurisé. The Incredible String Band refuse de jouer. Melanie, elle, n’a besoin que de sa guitare acoustique et d’un micro pour sa voix.
La jeune femme, qui a fait ses débuts dans les clubs folks de Greenwich Village, a alors un seul album à son actif. Encore une inconnue pour la majorité du public. John Morris, coordinateur de production et l’un des présentateurs, a demandé au public de brûler une allumette, allumer un briquet, pour l’accueillir. Dans le mensuel britannique Uncut de mai 2009, Melanie se souvient : « La colline a été éclairée avec toutes ces bougies, on aurait dit des lucioles. »
De bougies, il y en avait bien quelques-unes, mais surtout des briquets et des lampes électriques à piles. Cette vision inspirera à Melanie la chanson Lay Down (Candles in the Rain), en gardant l’idée des bougies plus poétique. Elle l’enregistre avec le groupe gospel Edwin Hawkins Singers, qui s’est fait connaître avec Oh Happy Day. Sorti en mars 1970, le souvenir de cet instant et plus globalement de cet appel à la fraternité, sera un succès pour Melanie. L’allumage de briquets deviendra par la suite un rite lors des concerts. De nos jours, ils ont été remplacés par les lumières des téléphones portables.
Une autre chanson va évoquer Woodstock. Elle est écrite par la chanteuse Joni Mitchell, qui n’a pas mis les pieds au festival. Celle-ci est alors en couple avec Graham Nash, qui, avec David Crosby, Stephen Stills et Neil Young doit jouer au festival le dimanche 17 août – ce sera en fait avant le petit jour, lundi 18, à 3 h 30 que le groupe montera sur scène.
Joni Mitchell n’est pas à l’affiche mais accompagne son chéri et doit aussi enregistrer une séquence pour l’émission de télévision « The Dick Cavett Show ». Les informations sur les embouteillages autour du site, à Bethel, sur les festivaliers dans la boue après une tempête, la déclaration de zone sinistrée prise par les autorités locales font craindre au producteur et manager David Geffen que le retour pour l’émission soit impossible.
Joni Mitchell reste donc à New York. Elle composera sa chanson Woodstock à partir de ce que lui raconteront Graham Nash et le guitariste et chanteur John B. Sebastian, ce qu’elle a lu dans les journaux, vu à la télévision, écouté à la radio.
Elle fait de l’événement un voyage initiatique sur les terres de Max Yasgur, propriétaire du terrain loué aux organisateurs, jardin peuplé d’un demi-million d’êtres humains qui se transforment en poussières d’étoiles, en papillons. Cette vision idyllique figurera sur son album Ladies of the Canyon, publié en avril 1970. Crosby, Stills, Nash and Young ont enregistré la chanson pour leur disque Déjà Vu, publié un mois avant. Et c’est leur version, électrique, qui accompagne le générique de fin du film Woodstock, de Mike Wadleigh, sorti en salle fin mars.
Autre tradition, celle du chant entonné par les festivaliers, pour faire arrêter la pluie, en scandant en parallèle « no rain, no rain ». Un « wohhh, oh-oh-ohhh, oh » (mi, qui descend à ré puis à si, remonte à ré puis à mi) qui perdurera durant des années, mais cette fois pour faire revenir les groupes au rappel lors des concerts.
3. Révélations et gloires éphémères
Avec le recul, la programmation du festival de Woodstock a des allures de Panthéon du rock (beaucoup) et du folk (un peu). Mais seul un tiers des trente-deux groupes avait alors un statut de vedettes : The Grateful Dead, Jefferson Airplane, le « all-star » Crosby, Stills, Nash & Young, qui venait de se constituer, la chanteuse Janis Joplin, le guitariste Jimi Hendrix, Blood, Sweat & Tears, Sly & The Family Stone – dont le passage nocturne à 4 heures, dimanche 17, fut le point culminant du festival –, Creedence Clearwater Revival et, pour défendre la vieille Europe britannique, The Who. Joan Baez, égérie du folk new-yorkais et The Band, le groupe qui a accompagné Bob Dylan en 1966, palliaient l’absence de ce dernier.
Les autres étaient surtout connus par des spécialistes du folk (dont Incredible String Band, Melanie…) et du blues (Johnny Winter, Paul Butterfield Blues Band, Canned Heat…). Et puis il y avait ceux pour qui le passage à Woodstock, et surtout les séquences de leurs concerts gardées dans le film documentaire réalisé par Michael Wadleigh auront eu un impact indéniable.
Country Joe McDonald, qui fait chanter les initiales « F.U.C.K. » au public. Les Anglais Joe Cocker et Ten Years After, groupe mené par le guitariste Alvin Lee, que les Etats-Unis commencent juste à connaître, et qui seront régulièrement résumés à leurs prestations de With a Little Help From My Friends pour le premier et au solo virtuose sur I’m Going Home pour le second. Tout comme Richie Havens avec son improvisation, Freedom. Le groupe Santana, qui vient d’enregistrer son premier album, qui sortira fin août 1969, est aussi une grande révélation du festival.
A l’opposé, qui se souvient de la venue de Bert Sommer, Tim Hardin, du Keef Hartley Band ou de Quill, tous par ailleurs oubliés sur la plaque commémorative installée en 1984 sur le site du festival ? La palme de la malchance revenant à Quill.
Formé à Boston en 1967, le quintette mené par les frères Cole – Dan au chant et Jon à la basse – est en plein essor. La presse musicale loue leur énergie scénique et leur blues-rock un peu psyché. Ahmet Ertegun, puissant patron d’Atlantic Records, vient de les signer pour l’un de ses labels. Et Michael Lang, co-organisateur du festival, est leur manageur. Quill, qui a joué pour les équipes du festival durant les jours précédents et dans des salles aux environs, est programmé en ouverture du samedi 16, avant plein de vedettes (Joplin, Grateful Dead, Creedence, The Who…). Woodstock doit être sa consécration.
Il n’en sera rien. Quill joue bien en début d’après-midi, une trentaine de minutes, mais sa prestation n’est que partiellement filmée. Les pluies qui se sont abattues pendant la nuit du vendredi ont désorganisé les équipes, plusieurs caméras ne sont pas prêtes, des problèmes techniques ne sont pas résolus. Quelques semaines après le festival, il est manifeste que Quill ne pourra pas être dans le film. Pas plus que sur le triple album (mai 1970) et le double album (juillet 1971) de la bande-son du documentaire, publié, ironie du sort, par Cotillion Records, son label. La maison de disques se désintéresse du groupe et le laisse enregistrer sans l’appui d’un producteur. L’album sort en janvier 1970, sans investissement promotionnel et passe inaperçu. Jon Cole quitte peu après le groupe, laissant les autres tenter de poursuivre avec un deuxième album. Jamais publié. A l’été 1970, le groupe n’existe plus.
Il faudra attendre 1994 et le documentaire Woodstock Diaries, de Chris Hegedus, Erez Laufer et D. A. Pennebaker, pour que Quill apparaisse à l’écran… durant une minute. Et 2009, pour que deux des quatre compositions jouées figurent dans le coffret de 6 CD publié par Rhino. En cette année 2019, le concert complet a finalement trouvé sa place dans un coffret de 38 CD (!), chronologie de l’intégralité du festival, au tirage limité à 1 969 exemplaires. Tous vendus en pré-commandes avant la sortie, le 2 août.
4. « Peace and Love »… et musiciens au bord de la crise de nerfs
Ah, Woodstock ! Sa jeunesse pacifique, qui danse au soleil levant ou couchant. Son ambiance bon enfant, au contact de la nature. Sa chouette musique, rock, folk, soul, blues, et toutes ses bonnes vibrations, qui ont envahi le site… Voilà pour l’image « peace and love » souvent associée au festival.
Si tout cela apparaît dans le film de Michael Wadleigh, d’autres éléments, dont certains abordés dans ce long documentaire, ont été bien plus sombres. Et il est généralement admis qu’il est miraculeux que le festival ne se soit pas transformé en « désastre à grande échelle », comme le formulait le mensuel musical Mojo en août 2013.
En quelques heures, l’eau et la nourriture manquent. Les sanitaires sont en nombre insuffisant – quelques dizaines selon le magazine Cracked dans un article en septembre 2009. Des milliers de festivaliers ont planté leurs tentes sur des terrains agricoles proches, dont les récoltes sont perdues. Les averses du vendredi ont rendu boueux le site prévu pour recevoir au mieux 100 000 personnes et non les 400 000 qui vont y déferler. Le personnel soignant, une centaine de personnes, va intervenir auprès de 6 000 festivaliers, principalement pour des cas de déshydratation, de foulures, de malaises dus à l’épuisement, et de prises de mauvais acides.
Dans leur ouvrage Woodstock - 3 jours de paix et de musique (La Martinière, 288 pages, 25 euros), Mike Evans et Paul Kingsbury comptabilisent aussi « deux naissances, quatre fausses couches », deux morts, l’un « par surdose d’héroïne » et l’autre accidentellement « écrasé par un tracteur » lors du nettoyage du site. Miracle aussi que la tempête du dimanche après-midi, qui empire les choses, n’ait pas fait s’écrouler les échafaudages pour les projecteurs. Et l’isolation électrique défaillante sur la scène aurait pu causer de graves accidents si des musiciens avaient pris des décharges.
Les retards se sont accumulés en raison des embouteillages, de la pluie, du non-fonctionnement de la scène circulaire montée sur roues qui devait permettre d’installer le matériel d’un groupe pendant qu’un autre jouait. Musiciennes et musiciens s’ennuient, se défoncent trop, boivent trop. Ce qui donnera quelques prestations piteuses, en particulier pour les vedettes. « Le pire concert qu’on ait fait », déclarera Mickey Hart du Grateful Dead. « On n’avait pas notre sono, (…) on ne maîtrisait rien, le concert était affreux », estime Rick Danko de The Band. Creedence Clearwater Revival, en pleine nuit, et Jefferson Airplane, au matin, jouent devant des masses endormies.
Avec Pete Townshend, le guitariste de The Who, la charge est féroce : « Tous ces hippies qui glandaient en se disant que le monde allait changer à partir de ce jour-là… » Durant le mauvais concert du groupe – qui circule intégralement sur YouTube – il vire violemment de la scène l’activiste politique Abbie Hoffman, venu protester contre l’emprisonnement récent de John Sinclair, membre des White Panthers. Et ajoute : « Le prochain enfoiré qui se pointe sur la scène, je le descends ! » Pas mieux pour Neil Young, qui considère que le concert avec Crosby, Stills et Nash était « de la merde. On a joué comme des cons », et qui a refusé d’être filmé. « Si l’un de vous vient me faire chier trop près, je lui file un coup de guitare dans la gueule. »
Pendant ce temps, en coulisses, ça discute argent. Les organisateurs, qui ont investi 500 000 dollars pour démarrer le festival au début de l’année 1969, ont déjà des pertes équivalentes lorsque montent les premières notes. Seuls à ne pas planer à mille mètres, les manageurs renégocient les cachets de leurs artistes, les droits à l’image, exigent d’être payés immédiatement en liquide. A l’issue du festival, les dépenses sont de près de 3 millions de dollars, couvertes à moitié par la billetterie. La dette de Woodstock Ventures, la structure organisatrice, s’élève à 1,3 million de dollars et mettra plusieurs années à être remboursée.
5. Avec Sha Na Na et Jimi Hendrix, un final au lever du soleil
Lundi matin 18 août 1969, le festival de Woodstock vit ses dernières heures. Le public a commencé à déserter les lieux dans la nuit, après le passage de Crosby, Stills, Nash & Young, entre 3 h 30 et 5 heures. Au lever du soleil, les plus résistants, probablement 40 000 personnes sur les plus de 400 000 venues, ont suivi à moitié endormies le concert du Paul Butterfield Blues Band.
Et voici, vers 7 h 45, qu’arrive Sha Na Na. Une douzaine de chanteurs, danseurs et instrumentistes en blouson lamé argent ou en cuir, tee-shirt blanc, jean au bas remonté, chaussures stylées, cheveux courts gominés ou coiffés en banane. Toute la panoplie des rockers de la fin des années 1950, en contraste avec les vêtements bariolés, chemises à fleurs, bandeaux dans les cheveux longs, communs aux festivaliers et groupes au programme. Comme le rappelle James Perone dans Woodstock : An Encyclopedia of the Music and Art Fair (Greenwood Press, 2005), « la majorité du public a d’abord cru qu’il s’agissait d’une blague ».
Pas du tout. Sha Na Na, qui vient de se former, est une troupe qui prend très au sérieux musicalement et visuellement son évocation du rock’n’roll. Avec des chorégraphies, des interprétations solides et respectueuses de raretés et succès alors oubliés comme Get a Job, The Book of Love, Chantilly Lace, His Latest Flame, Little Darling, Yakety Yak… ou At the Hop, qui est la seule séquence gardée dans le film de Michael Wadleigh.
Sha Na Na, qui aura par la suite une émission de télévision, a manifestement servi de modèle au groupe The Juicy Fruits, dans le film Phantom of the Paradise (1974) de Brian de Palma, et apparaîtra, sous le nom de Johnny Casino and The Gamblers dans le film Grease (1978), de Randal Kleiser. Le groupe existe toujours avec deux de ses membres fondateurs, le chanteur Donny York et le batteur et chanteur Jocko Marcellino.
Un sacré réveil dans le paysage de la colline herbeuse de la commune de Bethel, devenue un terrain humide et boueux après les orages durant le festival. Partout, des détritus, des sacs de couchage et des tentes abandonnés. Le peu de nourriture qui reste est servi sous forme de soupe en guise de petit déjeuner. Les personnels chargés du nettoyage se sont déjà mis au travail, érigeant ici et là des tas d’ordures en attente des camions de ramassage.
C’est devant au mieux 25 000 personnes maintenant que le guitariste Jimi Hendrix arrive avec un nouveau groupe, qui n’aura qu’un mois d’existence, Gypsy Sun and Rainbows. Billy Cox est à la basse, Mitch Mitchell à la batterie, Larry Lee à la guitare rythmique, Juma Sultan et Jerry Velez aux percussions. Ces trois derniers visibles dans le film mais inaudibles, en raison du système d’amplification mal réglé. Et ce n’est pas mieux dans Live at Woodstock, double CD de l’intégralité du concert – moins les deux morceaux avec Larry Lee en leader – publié en 1999 par Experience Hendrix L.L.C., compagnie familiale qui gère l’image, les droits et la musique d’Hendrix.
« Hey Jimi, est-ce que tu planes ? », demande un spectateur. « Oui je plane, merci,répond Hendrix. On n’a eu que deux répétitions. Alors on aimerait s’en tenir à des trucs de rythme primaire. » Le concert durera deux heures quinze. Avec des moments en roue libre, la concentration s’étant diluée durant la longue attente – le festival aurait dû se terminer le dimanche soir –, le manque de préparation. Hendrix s’en excuse à plusieurs reprises. Et puis il y a des éclairs de créativité intense, de folie musicienne, tels le rattrapage de Spanish Castle Magic, qui a pourtant mal commencé, Red House, Lover Man, Jam Back at the House ou Voodoo Child ou Star Spangled Banner, l’hymne national des Etats-Unis, avec effets de sifflements de bombes et de mitraillettes. Hendrix l’a déjà interprété lors de concerts et a enregistré une version en studio. Dans ce décor de fin du monde, celle de Woodstock prendra, rétrospectivement, un statut historique.
6. L’après-Woodstock : concerts commémoratifs, plaque et musée
« Par les organisateurs et avec des groupes de Woodstock. » En 1976, cette accroche parie sur le souvenir encore frais du mythique rendez-vous hippie d’août 1969 pour attirer le public au festival Riviera. Non pas aux Etats-Unis, mais en France, les 24 et 25 juillet, dans un coin caillouteux, avec quelques arbres, un réservoir d’eau bétonné en guise de lac, sur le site du circuit automobile Paul-Ricard du Castellet, dans le Var.
Aux commandes, l’un des producteurs de Woodstock, Michael Lang. Les artistes de Woodstock ne sont que deux : Joe Cocker, en perdition – nous y étions – et Michael Shrieve, batteur de Santana, qui passe au matin du 26 juillet, après le fantastique concert de Magma. La ligne artistique est plutôt fusion jazz-rock (Larry Coryell, John McLaughlin, The Crusaders, Gil Scott-Heron…) avec un peu de reggae (Jimmy Cliff), de salsa (Eddie Palmieri) et de funk (Betty Davis). Sur les 100 000 personnes espérées, voire le double, au mieux 30 000 sont venues. C’est un échec financier.
Plus modestement, et sans implication des producteurs originaux, le 7 septembre 1979, une Woodstock Celebration a lieu au Madison Square Garden, à New York, avec des participants de 1969, dont Canned Heat, Richie Havens, Stephen Stills, Johnny Winter.
En 1984, une plaque commémorative est installée à l’angle des rues Hurd et West Shore, à Bethel, à la pointe Nord du site du festival. Le terrain loué aux organisateurs par Max Yasgur, mort en 1973, a de nouveaux propriétaires qui ont accepté que ce petit monument marque les lieux visités par plusieurs milliers de personnes chaque année. Et du 15 au 17 août 1989, Bethel fête les 20 ans du festival, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, averties par le bouche-à-oreille, et, hormis Melanie en artiste labellisée Woodstock, des groupes locaux.
Puis le temps des célébrations prend une autre ampleur en 1994 et 1999, avec l’équipe de base, Woodstock Ventures. Du 12 au 14 août 1994, après le refus des autorités de Bethel, direction Winston Farm, à Saugerties, à 170 km au nord de New York, l’un des lieux envisagés en 1969. Country Joe, Santana, Joe Cocker, The Band et Crosby, Stills & Nash font le lien avec le passé, dans une programmation électro, rap et rock. Comme en 1969, il pleut – il y aura des batailles de boue, des concours de glissades –, trop de monde s’y bouscule (probablement 500 000 personnes, alors que 200 000 tickets ont été vendus à l’avance), il y a des embouteillages, les services de sécurité sont débordés.
En 1999, les quatre jours du festival, du 22 au 25 juillet, se terminent dans le chaos. Sur les quelque 120 groupes, pas un artiste de Woodstock n’est présent. L’affiche oscille entre hard rock, metal, punk, électro et rap. Le site est un ancien aéroport militaire, près de la ville de Rome (Géorgie), à 1 400 km au sud-est de New York. Cerné de hautes structures en acier, sans espaces d’ombre alors que la température grimpe à presque 40 °C. Il est interdit d’entrer avec ses provisions, des petites bouteilles d’eau sont vendues 4 dollars, il faut plus de vingt minutes pour aller d’une scène à l’autre… Dans les dernières heures, des stands de boissons et de nourriture sont vandalisés, des distributeurs d’argent pillés, des voitures et des installations techniques incendiées. Des viols seront signalés à la police.
A Bethel, de modestes célébrations, presque annuelles, continuent. Le 4 juillet 2006, est inauguré le Bethel Woods Center for the Arts, avec des espaces de concert, un musée, une programmation à la saison. Pour les 50 ans du festival, des événements spéciaux ont été ajoutés, dont la venue de Santana le 17 août et de John Fogerty, le 18.
En revanche, l’énorme machine voulue par Michael Lang, sous le nom de Woodstock 50, prévue du 16 au 18 août, accumule les déboires. Son principal financier se retire, fin avril, et le premier site envisagé déclare forfait, puis un second. Fin juillet, un nouveau lieu est trouvé, le Merriweather Post Pavilion, à Columbia, dans le Maryland, les ambitions de fréquentation sont revues à la baisse, les trois jours ramenés à un seul. Mais rien n’y fait et le 31 juillet, sur le site Internet du festival, un message annonce « notre festival est annulé » (cancelled).
« Les 50 ans de Woodstock », une série en six épisodes
Un air de liberté et des embouteillages
Des lumières dans la nuit et trois chansons souvenirs
Des révélations et des gloires éphémères
Peace and Love… et musiciens au bord de la crise de nerfs
Un final au lever du soleil avec le groupe Sha Na Na et Hendrix
L’après-Woodstock : des concerts commémoratifs, une plaque et un musée


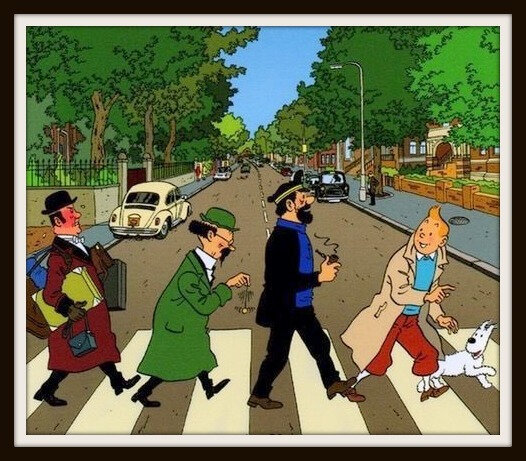
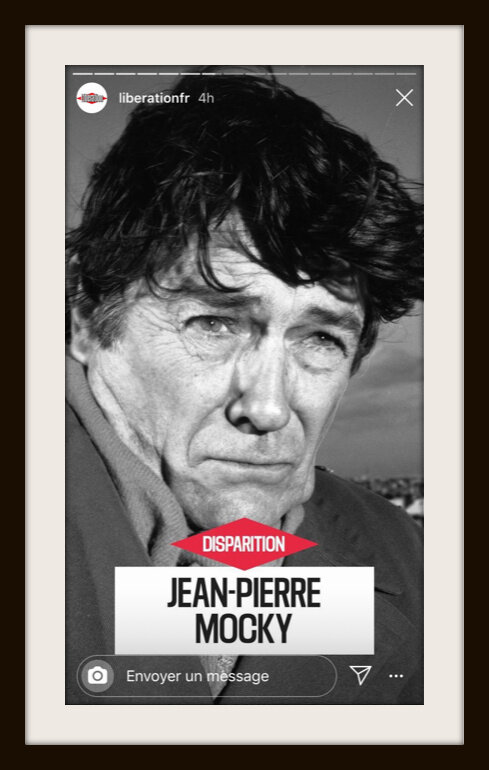
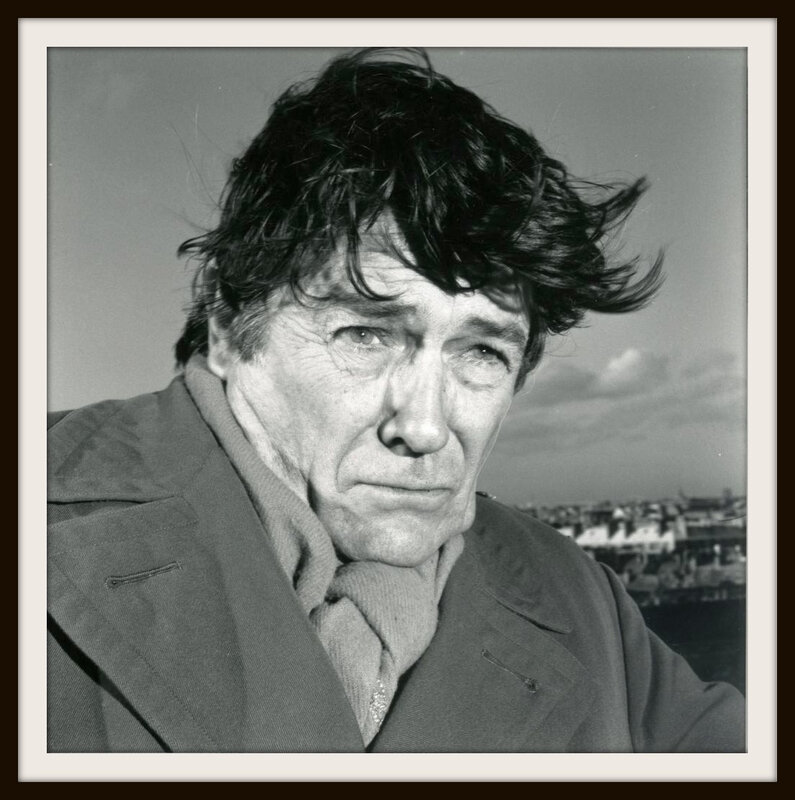
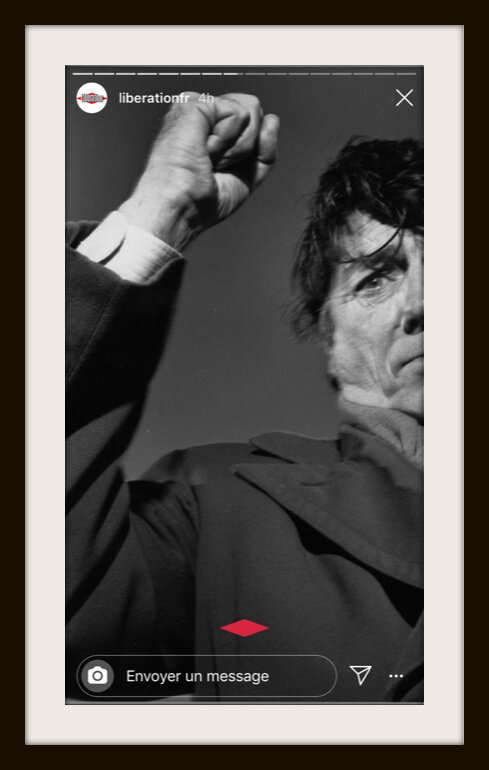


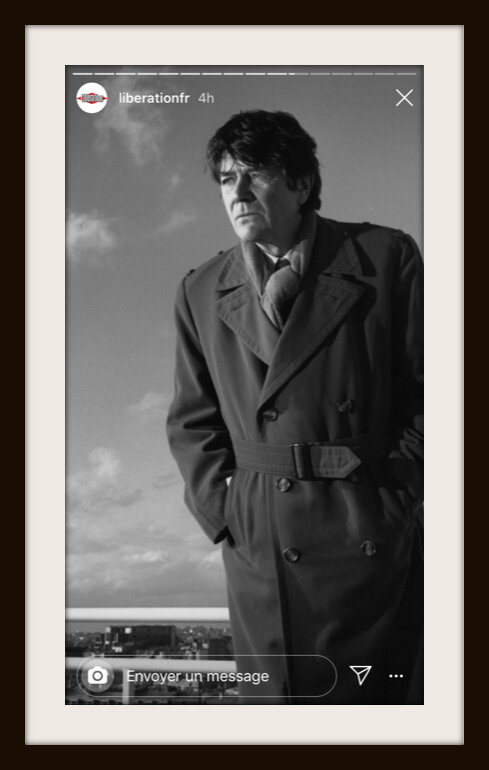

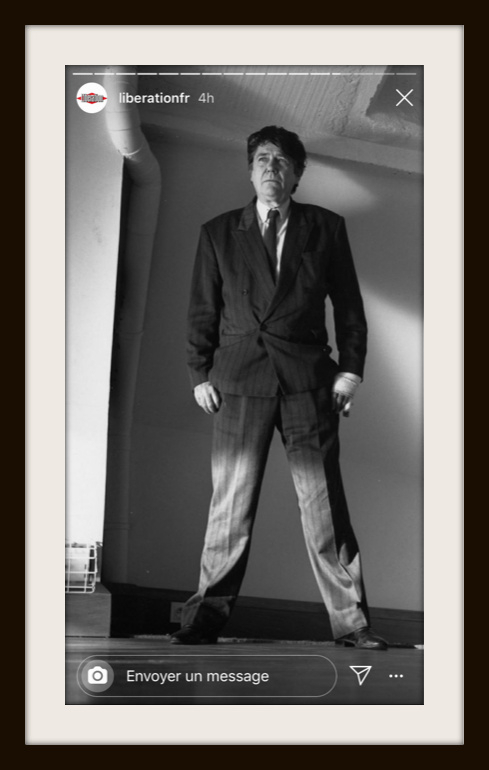

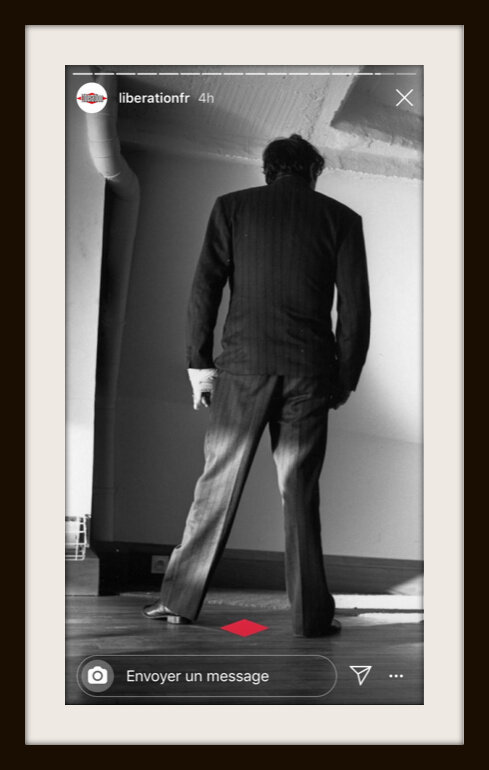

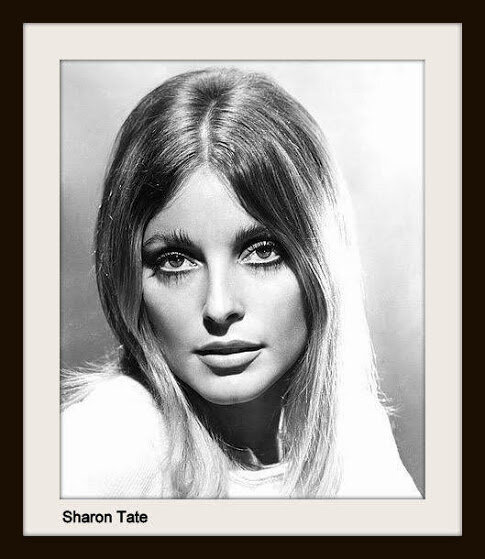










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)