Planches Contacts PARIS MATCH
Expo Photos : Planches-Contacts PARIS MATCH à la galerie ARGENTIC jusqu'au 18 novembre pic.twitter.com/flhO9NxAnA
— Galerie ARGENTIC (@GalerieARGENTIC) 20 octobre 2017
Les MOOC ont-ils tourné court ?
Par Marine Miller - Le Monde
Présentés il y a cinq ans par les universités américaines comme une révolution pédagogique, ces cours en ligne ont-ils tenu leurs promesses ?
« J’ai l’impression qu’il existe deux pilules : une rouge et une bleue. Si vous prenez la bleue, vous pouvez paisiblement retourner dans votre salle de classe et enseigner à vos vingt étudiants. Moi j’ai pris la rouge et j’ai vu Wonderland. » Impossible pour Sebastian Thrun, éminent professeur d’intelligence artificielle, de retourner enseigner à l’université Stanford (Californie) comme si de rien n’était. L’auteur de cette déclaration venait en effet de diffuser, à l’automne 2011, son premier cours en ligne : 160 000 personnes issues de 190 pays s’y étaient inscrites, faisant exploser l’échelle et diversifiant brutalement les profils des étudiants de sa classe. Pis, sur les 200 étudiants qui suivaient le cours sur le campus, seule une trentaine d’entre eux continua à se déplacer après plusieurs semaines de diffusion des vidéos. Quelques mois plus tard, Sebastian Thrun, déjà concepteur de la voiture sans conducteur de Google, annonçait sa décision de se retirer de l’université pour lancer une plate-forme de MOOC (massive open online courses, ou enseignement de masse disponible en ligne), Udacity, et, comme le héros de Matrix auquel il semblait s’identifier en prenant la pilule rouge, faire le pari de « la connaissance et de la vérité ».
L’emballement médiatique autour des MOOC était lancé et l’heure des « gourous » était venue. Au sein de la même célèbre université, Daphne Koller et Andrew Ng lançaient à leur tour leur plate-forme de cours en ligne, Coursera. Au même moment, sur la côte Est, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’université Harvard répliquaient en lançant leur propre plate-forme, conscients du coup à jouer en vertu de la loi du « winner takes all » (le gagnant rafle tout). Dans une de ces conférences qu’affectionnent particulièrement les amateurs d’histoires à succès, Daphne Koller faisait la promesse que, grâce aux cours en ligne, plus aucun étudiant (pauvre et éloigné des Etats-Unis) ne serait exclu des meilleures universités. Pour convaincre, l’enseignante montrait des images d’une file d’attente d’étudiants venus s’inscrire dans une université en Afrique du Sud et pris tout à coup dans un mouvement de foule. Plusieurs blessés et un mort. Effet spectaculaire garanti.
Deux camps
Toute cette agitation et ces déclarations fracassantes eurent un effet retentissant de l’autre côté de l’Atlantique. L’Europe, entre fascination et inquiétude, s’intéressa aussitôt au phénomène. « Tout à coup, tout a bougé très vite. Notre président a décidé de se rendre aux Etats-Unis pour comprendre ce qui se passait dans ces universités d’élite. Et nous nous sommes lancés dans la conception de MOOC à notre tour », se remémore Pierre Dillenbourg, professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’un des premiers établissements à créer des MOOC en Europe.
« Comme à chaque fois qu’une technologie apparaît, deux camps s’affrontent inexorablement. Les évangélistes et les apprentis sorciers qui soutiennent que les MOOC vont répandre le savoir et que l’intelligence humaine va augmenter. Face à eux, la tribu des grognons du numérique qui se méfient de ces outils et agitent le spectre de la fermeture des écoles », rappelle Marcel Lebrun, professeur en technologies de l’éducation à l’Université catholique de Louvain, en Belgique. Rejouant une forme moderne de la bataille d’Hernani, qui opposa au XIXe siècle les romantiques et les classiques autour des codes du théâtre, les universitaires français entrèrent dans le débat.
La première manifestation de cette « bataille » se cristallisa rapidement autour de la pauvreté de cette innovation. Des vidéos en ligne de cours avec des quiz pour vérifier que les apprenants ne décrochent pas : une disruption, vraiment ? Pour Dominique Boullier, professeur de sociologie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, c’était oublier la vague d’enseignement à distance apparue en France dans les années 1990. « Nous observons un effet diligence qui veut que les premières formes d’une innovation reprennent celles déjà connues dans un autre contexte technologique, comme les trains reprirent la diligence, et les automobiles les voitures à cheval. » A y regarder de plus près, les MOOC constituent en effet une version virtuelle mais littérale d’un cours magistral accompagné d’un questionnaire qui ressemble à un simple contrôle de connaissances basé sur la mémoire immédiate.
« LE NUMÉRIQUE EST EXCELLENT POUR STOCKER DE L’INFORMATION MAIS IL EST LOIN D’ÊTRE ÉVIDENT QU’IL APPRENNE À RAISONNER »
PASCAL ENGEL, PHILOSOPHE
Sans devenir un affrontement caricatural entre les contempteurs et les adorateurs des technologies, la question de l’absence « physique » du professeur dans le processus d’apprentissage se posa naturellement. Présentée comme révolutionnaire aux Etats-Unis, cette absence inquiéta une partie des professeurs d’université. « Tout le monde est d’accord sur le fait que les cours magistraux dans des amphithéâtres bondés sont à bannir, mais les professeurs n’en sont pas moins des acteurs de théâtre qui sentent les réactions du public et pas des acteurs de cinéma », estime Pascal Engel, philosophe et directeur d’étude à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). L’enseignement est une activité « vivante » qui suppose des « allers-retours, des changements de vitesse et des adaptations ». « Le numérique est excellent pour stocker de l’information mais il est loin d’être évident qu’il apprenne à raisonner, à questionner ses sources, à réfléchir, ce qui est le but d’un enseignement universitaire », estime le philosophe.
A ces critiques, d’autres enseignants répondirent que les MOOC ne devaient pas « remplacer » le professeur mais l’accompagner, comme une ressource supplémentaire pour construire son cours. Mais au moment où le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur se lançait, fin 2013, dans la création d’une plate-forme de MOOC francophones, étrangement résumée à son acronyme FUN (France université numérique), les premières études vinrent donner raison aux sceptiques.
Aux Etats-Unis, les taux d’abandon étaient vertigineux. Une étude de l’université de Pennsylvanie, publiée en décembre 2013, montrait que la moitié des inscrits consultait une seule séance du cours et seuls 4 % d’entre eux allaient jusqu’au bout. Autre enseignement, une large majorité des inscrits étaient déjà diplômés de l’enseignement supérieur. Les plates-formes américaines Coursera et Udacity avaient déjà changé de modèle économique, l’une se positionnant sur les certificats payants et la revente des données des utilisateurs et l’autre sur le commerce de formation professionnelle pour les entreprises. La même tendance se fit naturellement sentir sur la plate-forme francophone. Les MOOC ne seraient donc pas la révolution majeure qui transformerait l’université du XXIe siècle.
Révolution copernicienne
En revanche, un débat fertile a (re) surgi à la faveur de l’éclatement de la bulle MOOC. Puisque le savoir est « partout sur la Toile, disponible, objectivé, accessible à tous », comme l’écrivait, en 2011, Michel Serres, pourrait-on recentrer le rôle de l’enseignant sur le débat, la pensée critique, et les questions que se posent les étudiants ? Ce qui pourrait prendre la forme d’un dispositif bien connu avant l’arrivée des MOOC : la classe inversée.
« C’est une révolution copernicienne que nous n’avons pas encore accomplie collectivement », reconnaît Jean-François Balaudé, philosophe et président de l’université Paris-Nanterre, pionnier des MOOC français avec son cours intitulé « Philosophie et mode de vie : de Socrate à Pierre Hadot et Michel Foucault », diffusé en 2014 sur la plate-forme française, et qui recueillit l’inscription de 30 000 personnes. L’université Paris-Nanterre, qui prépare sa nouvelle carte de formation licence-master-doctorat, réfléchit à intégrer des MOOC dans plusieurs cursus, « mais cela se fera sans violenter la communauté universitaire », tient à souligner le président, conscient des freins et des méfiances d’une partie de sa communauté.
L’une des explications de la résistance à la classe inversée se trouverait-elle dans notre tradition catholique du cours ex cathedra ? Selon Marcel Lebrun, « cela vient du rapport au livre. Lorsque l’imprimerie se diffuse au milieu du XVe siècle, les catholiques, méfiants, préfèrent valoriser l’interprétation du clergé. Luther, à l’inverse, encourage un accès direct au livre et au savoir, ce qui permettra aussi à la Réforme de prendre de l’ampleur ». Les universités sont restées les héritières de ces pratiques. Le professeur, en son estrade, demeure le dépositaire de la connaissance.
Les MOOC, en 2017, sont entrés dans une période de « traversée de la désillusion », selon des termes empruntés au cabinet américain Gartner. A défaut d’avoir incarné une révolution technologique de grande ampleur, les MOOC ont eu le mérite d’ébranler les convictions pédagogiques et de créer du débat sur les pratiques des enseignants. « La culture numérique n’est vieille que d’une génération, contrairement à l’écriture ou au livre. Laissons le temps à ces innovations de se développer, elles n’ont que cinq ans… », tempère Marcel Lebrun.
Agressions sexuelles
Chaque heure en France : 64 agressions sexuelles. pic.twitter.com/h2SFUB8uoK
— Brut FR (@brutofficiel) 22 octobre 2017
Travail : Prendre ses aises nuit à la productivité
Par Nicolas Santolaria - Le Monde
Les cadres sont invités à sortir de leur « zone de confort » afin de ne pas s’endormir sur leurs lauriers. Au point que certaines sociétés sont allées jusqu’à imaginer une start-up en interne pour s’auto-concurrencer.
Parmi les expressions cocasses qui rythment la vie d’entreprise, je dois avouer une tendresse particulière pour celle qui invite les cadres à « sortir de leur zone de confort ». Cette formule postule en premier lieu qu’existe quelque part, dans le for intérieur de chaque travailleur, un lieu si moelleux, si accueillant qu’on a envie de s’y pelotonner comme dans les draps satinés d’une grasse matinée éternelle.
S’IL AVAIT EU LA CLIM DANS SA CAVERNE, DES TICKETS RESTO ET UNE APPLI DELIVEROO, IL N’EST PAS CERTAIN QUE L’HOMME PRÉHISTORIQUE SE SERAIT LANCÉ DANS LA PÉRILLEUSE CHASSE AU MAMMOUTH
Selon une croyance répandue, le périmètre de cette fameuse « zone de confort » aurait tendance à s’étendre lorsqu’on est un peu trop sûr de son fait, lorsque la perspective de la prise de risque s’évanouit derrière le voile anesthésiant des process. On finit alors par ne plus faire de différence entre une réunion stratégique et un espace lounge, entre une chaise de bureau et un fauteuil club. Cet immobilisme douillet contamine l’ensemble de notre relation au travail, constituant une sorte d’épicentre marécageux qui risque à terme d’engloutir le devenir même de la structure. Quand la moquette est trop épaisse et le chauffage trop bien réglé, l’entreprise devient un colosse aux pieds d’argile que pourrait balayer le simple éternuement d’une start-up tout juste sortie du néant. A quoi bon partir à la conquête de nouveaux marchés et chercher des solutions innovantes, se dit le salarié, si le quotidien est déjà aussi enchanteur qu’un arc-en-ciel de Dragibus ?
Créer de l’insécurité pour booster la productivité
« Il est parfois nécessaire de créer de l’insécurité ou de l’inconfort pour booster la productivité, car trop de confort endort », écrit Béatrice Gérard dans son ouvrage Oseriez-vous sortir du cadre ? S’il avait eu la clim dans sa caverne, des Tickets Resto et une appli Deliveroo, il n’est pas certain que l’homme préhistorique se serait lancé dans la périlleuse chasse au mammouth. C’est en partant de ce constat assez simple que certaines entreprises envisagent désormais de générer une adversité de synthèse, avec l’objectif affiché de sortir le salarié de son prétendu semi-coma. C’est le cas de Scality, société spécialisée dans le stockage intelligent, qui a eu l’idée de créer en interne une start-up lui faisant concurrence sur son propre marché.
Là où Scality vend des licences, l’autre structure propose des produits open source, un peu comme si Apple décidait de distribuer soudain des iPhone gratuits en créant une sous-marque avec une poire à moitié croquée en guise de logo. Ou comme si un salarié transformait son fauteuil à roulettes en planche à clous. Difficile de savoir si cette forme très en vogue d’auto-concurrence épineuse relève du génie disruptif ou de la totale idiotie (les deux n’étant pas incompatibles), mais une chose est sûre : le sommet du confort est de pouvoir organiser soi-même, à l’envi, presque sur le mode du caprice, ses propres zones d’inconfort.














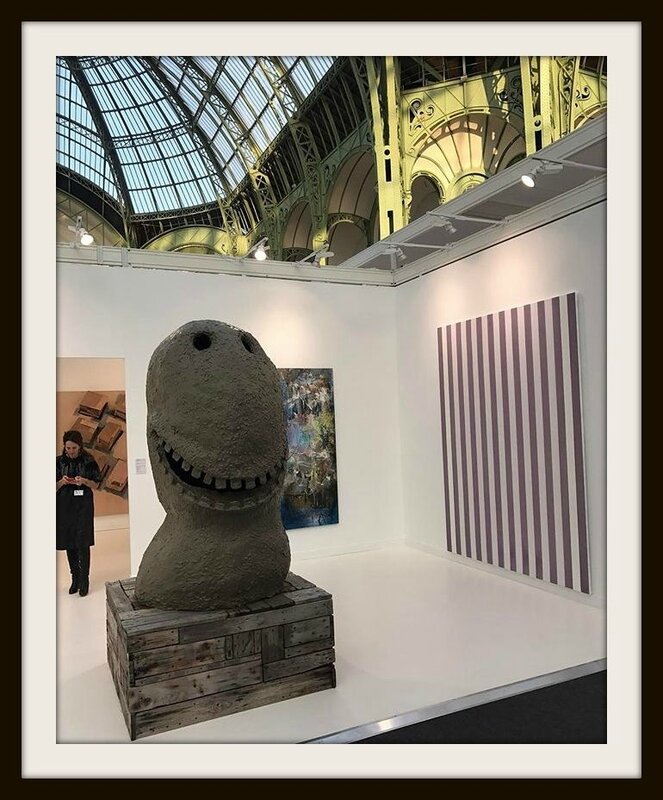

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)