MARCHÉ DE L’ART - L’œuvre tranchée d’Alain Jacquet
Le critique d’art et curateur Pierre Restany (1930-2003) écrivait en 1969 que « quand on s’appelle Jacquet en France, on court toujours le risque d’être pris pour quelqu’un d’autre ». Décédé en 2008 à 69 ans, l’artiste français Alain Jacquet en était conscient. Non sans humour, il avait rajouté à son Déjeuner sur l’herbe, reprise du célèbre pique-nique d’Edouard Manet, un paquet de pain de mie… Jacquet. La maison de ventes Piasa propose, le 23 octobre, cinquante et une œuvres de cet artiste à l’humour mordant. Issues de la collection du marchand genevois Daniel Varenne, décédé en 2018, elles sont estimées entre 600 euros et 80 000 euros.
Voici un vrai pari tant ce créateur a été oublié des institutions et des collectionneurs, malgré un revival tenté dans les années 1990 par la galerie Templon, en 2011, avec une première vente aux enchères chez Joron-Derem, et surtout en 2015 avec une magnifique exposition orchestrée par la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois à Paris. S’il salue le regard de Daniel Varenne, qui a défendu l’œuvre de Jacquet, Georges-Philippe Vallois s’inquiète de l’afflux d’œuvres sur un marché encore peu préparé. « Le risque, c’est qu’il y ait plus d’œuvres que de collectionneurs, car une partie de son travail n’a pas été diffusée, explique-t-il. Les gens pourraient se retrouver face à des choses dont ils ne mesureront pas l’importance. »
Important, Jacquet le fut indéniablement. Seul artiste hexagonal invité en 1969 à l’exposition séminale « Quand les attitudes deviennent forme », à la Kunsthalle de Berne, en Suisse, il fut locataire du pavillon français à la Biennale de Venise en 1976. Avant le black-out. Sa dernière grande exposition française, au Musée d’art moderne et d’art contemporain (Mamac), à Nice, remonte à 2005.
Cet esprit frappeur eut le chic pour se brouiller de son vivant avec tous ses galeristes. Et il ne s’est jamais encombré de plan de carrière. « Jacquet ne s’est jamais contenté d’une seule trouvaille plastique, précise le marchand nancéen Hervé Bize. A contrario, il n’a cessé d’expérimenter, tant intellectuellement que formellement. » Toujours entre deux eaux, pop et conceptuelle, et deux territoires, Paris et New York, il a mêlé avec aisance les genres.
Estimation très raisonnable
Autant dire que le marché n’aime pas les fortes têtes difficiles à catégoriser. « Le fait d’avoir vécu très tôt aux Etats-Unis l’a sans doute aussi mis dans une position relativement inconfortable vis-à-vis de l’Hexagone, et outre-Atlantique on sait fort bien que les Américains ont toujours su davantage privilégier et promouvoir leurs artistes que nous les nôtres », poursuit Hervé Bize. « La dimension sérielle de son travail a aussi pu désarçonner certains clients, alors que c’est sa marque de fabrique », ajoute Florence Latieule, directrice du département art contemporain chez Piasa. Pourtant son œuvre est d’une intelligence visuelle rare. Dans les années 1960, Jacquet se distingue avec Des images d’Epinal aux Camouflages.
Si les pop américains ont biberonné aux comics, Jacquet, lui, a utilisé les images d’Epinal, qu’il décompose en puzzle. Au point de littéralement noyer l’image initiale. Sans l’appui des dessins d’origine, le spectateur peine à déceler les motifs originaux. De cette série, Piasa propose L’Union entre la France et l’Autriche, datée de 1962 et estimée 15 000 euros à 25 000 euros.
Sa série des Camouflages relit l’histoire de l’art sur le mode du recouvrement et du télescopage en multipliant les filtres de lecture. Objets du quotidien ou logos de marque se superposent aux tableaux ou aux sculptures célèbres dans un mélange aussi coloré qu’ironique : une pompe à essence camoufle ainsi La Naissance de Vénus, de Botticelli ; le chien au gramophone de la Voix de son maître vient parasiter un drapeau américain de l’artiste Jasper Johns. Piasa présente, pour 60 000-80 000 euros, un camouflage détournant la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Une estimation raisonnable pour une œuvre qui aurait toute sa place au panthéon du pop art.
Collection Varenne, vente Alain Jacquet, le 23 octobre chez Piasa, Piasa.fr.
Portrait - Vincent Cassel, un éruptif qui se soigne
Par Laurent Carpentier
L’acteur incarne un directeur d’association d’accueil pour jeunes gens handicapés dans « Hors normes », le dernier film d’Olivier Nakache et Eric Toledano.
« J’ai de plus en plus de mal à tuer des gens. Vincent Cassel retourne sa grande carcasse bondissante sur le canapé en Skaï. Dans Jason Bourne, j’étais un peu dégoûté à la fin de tuer à tout-va sans bien comprendre ni qui ni pourquoi – ces scénarios, c’est toujours un peu emberlificoté. » Il se marre.
A 52 ans, on retrouve Vincent Cassel avec barbe et kippa, en directeur d’une association d’accueil de personnes handicapées, dans Hors normes, d’Olivier Nakache et Eric Toledano (Intouchables, Samba, Le Sens de la fête…). Exit la jeune tête brûlée de La Haine (1995), sa marque de fabrique ? Pas si sûr. Derrière ses yeux qui pétillent et son sourire d’ange bout la même force éruptive.
« On a chacun sa manière d’être, constate-t-il. Une énergie qui nous est propre et sur laquelle on surfe. De cette énergie, on fait soit des personnages agressifs comme Vinz dans La Haine, soit des opiniâtres comme Bruno, le héros de Hors normes. » Et d’ajouter, amusé : « Sur le tournage, les réalisateurs me disaient toujours : “gentil, gentil…” »
Vinz un jour, Vinz toujours ? Au départ, d’ailleurs, ce n’est pas Vinz mais Veentz. « C’était l’époque du tag, et les “e”, c’est plus intéressant à dessiner que les “i”. » Gosse des rues, hip-hop, vélo, « parisian attitude », gouaille et provoc : « “J’aime rien, je suis Parisien” : c’était une inscription sur un tee-shirt. J’adore. Une identité. J’ai grandi comme ça, en faisant des allers-retours entre Montmartre et Ménilmontant où j’habite toujours. »
Inadapté par essence
Le drame chez les Cassel (Crochon à l’Etat-civil), c’est l’élégance. Le fils de Jean-Pierre, ce gentleman du cinéma français, va tout faire pour gommer la filiation qui stigmatise, et le côté séducteur qui, chez lui aussi, reprend le dessus pour peu qu’il lui lâche la bride. « Jeune, j’avais la peau lisse, je me sentais adolescent. J’ai lutté contre ça, me vieillissant pour les rôles, me rajoutant des cheveux blancs. L’agressivité que je déployais, c’était pour ça aussi. » Il grimace : « Les gens avec aspérités sont plus intéressants à jouer, et ce sont souvent les méchants. »
« LE SENS DE L’HUMOUR, C’EST PRIMORDIAL. IL N’Y A PAS DE STYLE SANS HUMOUR »
Question bad guys du cinéma, il est devenu spécialiste, du genre à en dresser la typologie sélective : « Le jeu des acteurs ne cesse de changer avec les époques, explique-t-il. On peut commencer avec Paul Muni, dans le Scarface d’Howard Hawks, c’est le temps du muet, très expressionniste. Puis vient le triomphe d’une espèce de naturalisme, avec Marlon Brando qui, à vouloir trop souffrir, en devient presque fatigant. Arrive le minimalisme sur-vécu de Robert de Niro… On s’adapte. Or, aujourd’hui, les tueurs, les vrais, passent eux-mêmes à l’écran, sont interviewés, et parce que les gens vrais ne jouent pas bien, pour les imiter, les acteurs se mettent à jouer maladroitement et sans emphase. »
Vinz lui est cabot, et le revendique. « Le sens de l’humour, c’est primordial. Il n’y a pas de style sans humour. Depardieu, Marielle, Rochefort, Mastroianni… Les grands acteurs frisent le cabotinage parce qu’ils savent jouer l’outrance, être polymorphes, se mouvoir dans l’impro permanente. » Il s’agace : « Reprocher ça à un mec comme Luchini, c’est dire à quelqu’un qui sait voler : “Ne le fais pas en public, on va dire que tu te la pètes.” » Inadapté par essence. Hors normes par nature. « J’ai revu Irréversible, de Gaspard Noé, à Venise : Ouah, quel film ! On aime ou on n’aime pas, mais c’est quelque chose dont tu te souviens – c’est important de marquer les esprits, de réussir à interpeller le spectateur au milieu de tout ce bordel. »
Grande bringue chaleureuse
Pour interpeller, il interpelle. « Sagittaire ascendant lion. Cheval de feu chez les Chinois. » Il s’est étudié sous toutes les coutures : astrologie, psychanalyse, chamanisme. Et puis il a cessé de se mesurer à son père, disparu en 2007. « Je lui ressemble de toute façon de plus en plus. Je me suis revu dans Mesrine. Je ne voyais que lui. »
Il marque une pause, ce qui est rare. « Les enfants, c’est la clé de l’éternité, c’est le seul truc qu’il ne faut pas rater. » Il a trois filles, deux avec Monica Bellucci, avec qui il a vécu dix-huit ans, et une, née en avril, avec Tina Kunakey, une mannequin de trente ans sa cadette. Ils l’ont baptisée Amazonie.
Le Brésil. Son eldorado. Il a 6 ans et, pour la première fois, il va seul au cinéma avec son père. C’est la grande salle du Kinopanorama à Paris. On y joue Orfeu Negro, de Marcel Camus (1959). Un éblouissement. Les couleurs d’abord, et puis la musique. Quinze ans plus tard, le jeune fan de hip-hop s’envole pour Rio, y apprendre la capoeira. Pour un peu, là, racontant ce pays où il s’est installé un temps et continue d’y faire des allers-retours, Vincent Cassel se mettrait à chanter. Mais c’est son corps qui, une fois de plus, se met en mouvement en évoquant le White Album, de Joao Gilberto.
Grande bringue chaleureuse. La main franche. Jamais un mot lâché contre qui que ce soit. Il connaît le métier : un journaliste, ça cause. Son (ex ?) copain Kassovitz défend les théories du complot ? Son frère, Mathias, alias Rockin’ Squat (fondateur autrefois d’Assassin, un groupe pionnier du rap), lui a fait lire Jordan Maxwell, un autre monument du conspirationnisme ? Il élude, bon enfant : « Sans parler d’Illuminati, de complots, ou de trucs barrés, il suffit de regarder le pouvoir des banques pour se dire qu’une élite peut engager la planète entière, faut pas être naïf. » Il préfère mettre l’accent sur le fait que son frère, avec son festival Planeta Ginga, a fait venir dans les favelas Oxmo Pucino ou Booba.
De nouveau, le voilà qui gigote : « Ginga, c’est un mot de capoeira pour désigner tout ce qui se passe entre les corps… une manière de composer avec le quotidien. »
« Les positifs, c’est ce dont on a besoin aujourd’hui »
L’homme est action, geste, physique. Et quand il parle, ce n’est pas un flow, c’est une vague. « Je parle trop vite, les idées sont organisées mais j’ai du mal à énoncer tous les mots… Il faudrait encore travailler l’élocution », constate, vaguement ironique, celui qui s’auto-éduque sur Internet en regardant – en accéléré – interviews et conférences, du coup capable de vous faire au débotté un exposé sur Gunter Pauli et le biomimétisme, le chamanisme ou l’épigénétisme et le junk-DNA…
« J’ai besoin de suivre mon époque. Avec Nakache et Toledano, je suis chez les positifs. C’est ce dont on a besoin aujourd’hui… Est-ce que ce serait moi qui m’adapte ? A force d’avoir travaillé le côté sombre, cynique, je commence à devenir papa cool… » Et puis, comme si on s’inquiétait : « Non, non, ne croyez pas, je continue à prendre un malin plaisir à jouer des rôles subversifs. »
A son Panthéon, l’homme qui « a besoin de faire le grand écart » – il débarque de cinq mois de tournage pour la série américaine d’OSC Westworld – a inscrit Huit et demi, de Fellini, et Raging Bull, de Scorsese. «… Et on ferme sa gueule ! », assène-t-il, jovial. Parce que Vinz, tout de même, c’est Vinz.









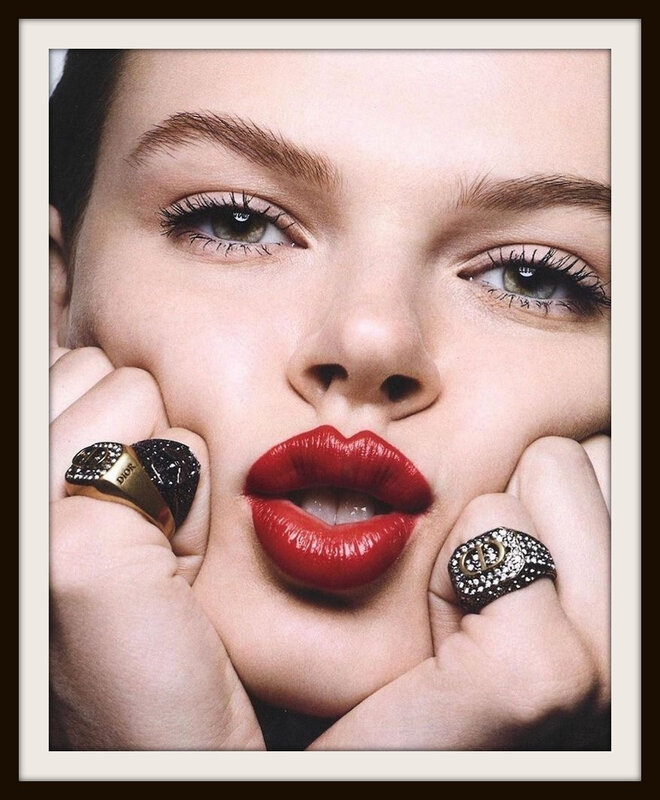




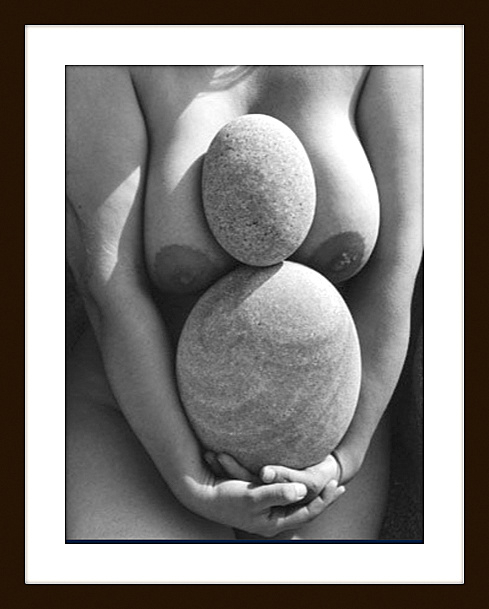

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)