« 120 battements par minute » bouleverse le Festival de Cannes
Par Isabelle Regnier
La tragédie de Robin Campillo chronique magistralement la lutte spectaculaire d’Act Up-Paris, au début des années 1990, pour rendre visibles les ravages du sida.
SÉLECTION OFFICIELLE – EN COMPÉTITION
Une heure déjà qu’on est sorti de la projection, et nos cœurs sont encore contractés du choc qu’ils ont reçu. Des rivières de larmes ont inondé, samedi 20 mai au matin, le Grand Théâtre Lumière à Cannes. De loin en loin, on entendait des sanglots. Attendu comme un des moments forts de ce Festival, 120 battements par minute, de Robin Campillo, cette chronique de l’aventure d’Act Up-Paris au début des années 1990 remporte magistralement son pari périlleux.
En fusionnant chimiquement l’intime et le politique, elle chante la tragédie de cette jeunesse terrassée qui retrouva l’espoir dans la chaleur du groupe et la découverte de sa puissance de feu, et dont la joie nouvelle, intense, se heurtait de plein fouet à la machine de mort de l’épidémie et aux forces réactionnaires complices de la société dans laquelle elle explosait.
Anciens militants d’Act Up, Robin Campillo et son co-scénariste Philippe Mangeot s’inspirent de leur expérience de ces années noires où l’AZT et les autres traitements existants permettaient de freiner le développement du virus sans lever la menace de mort qui pesait sur les séropositifs.
Créée en 1989 sur le modèle de l’association américaine Act Up, née deux ans plus tôt, Act Up-Paris se donnait pour mission de rendre visible, par des actions spectaculaires et des slogans ravageurs, le sida, le combat des malades, l’existence des minorités les plus massivement touchées – gays, lesbiennes, trans, prostitué(e)s, toxicomanes, prisonniers…
« Des molécules pour qu’on s’encule ! »
Siège politique de la guerre, le corps est à la fois la cible de la maladie et l’arme pour la combattre. Et c’est toute la justesse du film que de s’aimanter à ceux de ses acteurs, refusant les séductions que l’esthétique d’Act Up auraient pu lui inspirer. Au long de ses deux heures vingt qui passent à une vitesse folle, ce biopic d’un corps collectif sauvage luttant contre un monstre mortel déploie une trame mélodramatique d’autant plus explosive qu’elle est minimaliste : hésitante et fragmentée comme ne peut qu’être la naissance d’un amour métastasé par le sida, et fondue par ailleurs dans le combat de l’association.
L’histoire de Nathan (Arnaud Valois), nouveau venu aux réunions hebdomadaires, séronégatif, et Sean (Nahuel Perez Biscayart), militant de la première heure confronté aux premiers signes de la maladie, est indissociable, de fait, de celle du mouvement dans laquelle elle éclot, des prises de parole, de la tension et de la joie qui s’y nouent.
Jeter des sacs de faux sang au visage de l’ennemi, qu’ils soient représentants de l’inerte Association française de lutte contre le sida, émanation du pouvoir étatique, ou d’un laboratoire pharmaceutique qui fait primer ses intérêts commerciaux sur la vie des malades, tétaniser au passage les flics qui n’osent pas vous toucher de peur que c’en soit du vrai, se rouler des pelles dans la cour d’un lycée où le proviseur refuse d’installer des distributeurs de préservatifs, brandir des pancartes où est écrit le slogan « Des molécules pour qu’on s’encule ! » : toutes ces actions vont dans le même sens d’une politisation de l’intime, que prolonge fièrement la mise en scène.
Rarement scène de sexe aura tant exprimé d’amour que celle qui se déploie, longuement, sensuellement, tendrement entre Nathan et Sean, dont les corps continuent de se pénétrer tandis que leur conversation sur l’oreiller commence à les recouvrir en « off ».
« La communauté sida »
Dans le petit amphi éclairé au néon où se soude une communauté transcendant les classes sociales, les nationalités, les genres et les statuts sérologiques (« la communauté sida », comme l’appelait Didier Lestrade, figure de proue du mouvement), la parole s’investit d’une puissance politique inédite et joyeuse.
Symptôme d’une vitalité exacerbée par la menace de la mort, cette joie infuse toute la première partie du film qui, l’hymne Smalltown Boy de Bronski Beat en bandoulière, rend justice à l’inventivité de cette association flamboyante dont les actions subversives restent encore dans les mémoires, et au savoir que fabriquaient collectivement en son sein tous ces « ignorants », pour reprendre une terminologie de Jacques Rancière.
Là encore, c’est par les corps que tout passe, corps jeunes, débordant de vie, qui se cabrent dans la rue sous les assauts des policiers, qui pénètrent en trombe dans des institutions pour en saccager l’ordre, qui exultent la nuit sur le dancefloor au son d’une B.O. forgée dans la house du début des années 1990.
Inscrivant l’histoire d’Act Up-Paris dans ses interactions avec les autres grands acteurs de la lutte contre le sida en France, le film n’occulte rien des ratés, des tensions internes, des conflits que la maladie et l’angoisse rendaient d’autant plus cruels. La mort frappe évidemment, et à son approche, la joie finit, rappelant ces jeunes gens hier encore si fougueux à leur solitude scandaleuse face au crime odieux qui avance face à eux.
Mais c’est moins son travail qui arrache toutes ces larmes que le requiem qu’entonnent les vivants autour des défunts, en faisant de leur dépouille, parce qu’ils n’ont pas le choix, l’instrument déchirant d’une nouvelle action politique. L’image d’Adèle Haenel, le poing levé, le visage cramoisi, les yeux remplis de larme, qui n’arrive plus, tant elle suffoque, à scander ses slogans, est la plus bouleversante icône de ce début de Festival.
Film français de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel (2 h 20). Sortie en salles le 23 août. Sur le Web : distribution.memento-films.com/film/infos/80
Festival de Cannes - Cara Delevingne
Les Fantômes d’Ismaël, ou la mythologie de Desplechin en « version française »
Par Isabelle Regnier
Le film du cinéaste devenu figure de l’auteurisme à la française ouvre le festival de Cannes, mercredi, dans une version écourtée par rapport à l’originale.
Pour ouvrir la soixante-dixième édition du festival de Cannes, mercredi 17 mai, Thierry Frémaux a choisi de montrer Les Fantômes d’Ismaël dans une version que son auteur, Arnaud Desplechin, qualifie de « française ».
D’une durée d’une heure cinquante, c’est celle que le distributeur du film, Le Pacte, présente dans la grande majorité des salles de l’Hexagone. Une autre version existe, plus longue de vingt minutes, que Desplechin nomme « version originale », ou « director’s cut ».
Moins rentable a priori puisque sa durée réduit mécaniquement le nombre de séances possibles dans une journée, elle est visible dès aujourd’hui à Paris, au cinéma du Panthéon, et ailleurs en France dans les salles qui en ont fait spécifiquement la demande. C’est celle-là, en outre, qui sortira aux Etats-Unis.
Le cinéaste a beau revendiquer les deux versions comme siennes, les termes qu’il emploie pour les qualifier l’une et l’autre sont éloquents. Comme est éloquent le choix opéré par le directeur du festival. Cette situation inédite, emblématique de l’évolution des rapports de forces entre l’art et le commerce à Cannes et partout ailleurs, confirme Arnaud Desplechin, chef de file du jeune cinéma des années 1990 devenu figure tutélaire de l’auteurisme à la française, dans sa position de perturbateur endocrinien du système.
Deux ans après la fronde qu’il avait initiée en choisissant de montrer Trois Souvenirs de ma jeunesse à la Quinzaine des réalisateurs où l’avaient suivi Miguel Gomes et Philippe Garrel, plutôt qu’en sélection officielle, dans la section Un Certain regard, il continue de jouer les trouble-fête – aux dépens des programmateurs de salles, des critiques et des spectateurs qui se retrouvent, eux, dans une drôle de confusion.
Deux versions, deux films
Car en dépit du fait qu’elles portent le même titre, la « v.o. » et la « v.f. » sont bel et bien deux films différents. A partir d’un même tronc commun long d’une bonne heure, tous deux racontent les tourments d’Ismaël, double de l’auteur que vient hanter, alors qu’il travaille au scénario d’un nouveau film, le spectre de son premier amour.
Mais alors que le premier a la forme aboutie, complexe, sophistiquée d’un autoportrait du cinéaste en miettes, le second, resserré sur le trio de stars formé par Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard, laisse l’impression d’une œuvre déséquilibrée, dont la nécessité ne semble pas aussi évidente.
Quand bien même elle ne sera vue que par une minorité de spectateurs, nous nous appuierons donc, pour évoquer ce onzième long-métrage d’Arnaud Desplechin, sur sa « version originale » dont les ramifications nous paraissent bien plus fertiles.
Les fantômes d’Ismaël commence comme un film d’espionnage. Des diplomates français parlent d’un certain Paul Dedalus, dont personne ne semble savoir ce qu’il est devenu. Jeune homme brillant, surgi de nulle part un beau jour, il a enchaîné les postes diplomatiques dans les régions les plus troubles de la planète, disparaissant et réapparaissant régulièrement, sans crier gare. Serait-il un espion ?
De même qu’Antoine Doinel fusionnait à l’écran les personnalités de Jean-Pierre Léaud et de François Truffaut, Paul Dedalus est ce personnage récurrent de l’œuvre de Desplechin qu’a longtemps incarné son acteur fétiche, Mathieu Amalric.
Dispositif en forme de poupées russes
Dans Trois Souvenirs de ma jeunesse, le jeune Quentin Dolmaire en proposait un nouvel avatar, le souvenir que Dedalus, arrivé au seuil de la cinquantaine et toujours interprété par Amalric, gardait de lui-même adolescent. Il revient ici doté d’un nouveau statut, celui de double fictionnel d’Ismaël, un réalisateur qui a les traits de Mathieu Amalric et dont le nouveau scénario s’inspire de la vie de son frère Ivan, un personnage joué par Louis Garrel.
A partir de ce dispositif en forme de poupées russes, Arnaud Desplechin réactive sa mythologie – ses personnages, son dialogue avec la Bible, Homère, Joyce, Shakespeare, avec l’histoire de l’art, du cinéma, de la psychanalyse, des religions… – en la réagençant sous forme nouvelle, plus réflexive que jamais.
Ismaël est veuf. Carlotta, sa femme, a disparu il y a vingt ans sans laisser de traces. Il a fini par la déclarer morte. Désormais amoureux de Sylvia (Charlotte Gainsbourg) et en proie à des cauchemars violents, il se bourre d’alcool et de médicaments pour échapper au sommeil.
La nuit il écrit, quand il ne répond pas aux appels de détresse de Bloom (Laszlo Szabo), le père de Carlotta, grand cinéaste juif rongé par la perte de sa fille, hanté par la mémoire de la Shoah. Alors qu’il passe quelques jours avec Sylvia dans sa maison de la côte Atlantique, Carlotta (Marion Cotillard) refait surface et son frêle équilibre vacille.
Désertant le tournage de son film, Ismaël se terre dans la maison de son enfance, à Roubaix, tandis que le récit explose et voit se dédoubler, comme dans Vertigo, les reflets de ses personnages. Ceux-ci apparaissent pour ce qu’ils sont : des virtualités requalifiables à l’infini. Tout est affaire de perspective, comme le clame Ismaël en pleine crise maniaque, qui n’hésite pas à qualifier Jackson Pollock de peintre figuratif, et à considérer son tableau Lavender Mist comme une réinterprétation des Demoiselles d’Avignon.
Comme dans la tête d’un fou
Si Carlotta renvoie à cette femme au destin tragique qui hantait Madeleine, le premier des deux personnages que jouait Kim Novak dans le film d’Hitchcock, elle s’est aussi fait appeler Esther à une période de sa vie, reprenant à son compte le nom de l’amoureuse de Dedalus dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle et Trois souvenirs de ma jeunesse. Le nom d’Ismaël, lui, renvoie au fils d’Abraham et de sa servante Agar, dont l’Ancien testament et le Coran proposent des interprétations toutes différentes.
Autour de Bloom, Carlotta, Ivan, Ismaël, Sylvia et de leurs avatars, autour de Swy, producteur flamboyant (Hippolyte Girardot, génialement survolté), et d’Arielle (Alba Rochwacher), l’actrice qui couche avec Ismaël et joue la femme de Dedalus, les segments narratifs se télescopent comme dans la tête d’un fou.
Dans cet état de confusion, de trop-plein narratif qui flirte parfois avec le grotesque, s’esquisse un commentaire du processus créatif d’Arnaud Desplechin, cinéaste vampirique dont la vision se coule dans des formes empruntées à la vie de ses proches.
A défaut de provoquer le vertige, l’obstination qu’il met, tel une Pénélope, à remettre inlassablement ce même petit monde sur le métier, sidère autant qu’elle impressionne. Comment assumer plus crânement ce geste, de fait, qu’en fournissant comme il l’a fait deux versions d’un même film ?
« Les Fantômes d’Ismaël », film français d’Arnaud Desplechin. Avec Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard. (1 h 50 ou 2 h 10)
Festival de Cannes - Pedro Almodovar
CANNES : Charlotte Gainsbourg ouvre le bal
Elle partage avec Marion Cotillard l’affiche des « Fantômes d’Ismaël », d’Arnaud Desplechin, projeté ce soir en ouverture du Festival. Mais où en est-elle donc avec ses propres fantômes ?
De l’un de nos envoyés spéciaux Pierre Vavasseurà Cannes (alpes-Maritimes)
Ce soir, pour elle en haut des marches, ce sera tout pour le glamour et rien pour l’inquiétude. Présenté en ouverture du 70 e Festival de Cannes, « les Fantômes d’Ismaël », d’Arnaud Desplechin (« Comment je me suis disputé… », « Esther Kahn »…), dans lequel Charlotte Gainsbourg partage l’affiche avec Marion Cotillard, Mathieu Amalric et Louis Garrel, échappe par tradition à la compétition. « Une fois rentrée chez moi, je ne serai pas près du téléphone à attendre », sourit l’actrice de 45 ans.
La jeune femme, qui porte désormais les cheveux mi-longs encadrant avec élégance son visage, nourrit d’autant moins de regrets que Cannes a su la combler. Elle y a reçu en 2009 le prix d’interprétation féminine pour l’épique et sulfureux « Antichrist », de Lars von Trier. En 2001, l’année de « la Chambre du fils », de Nanni Moretti, elle a fait partie du jury. La fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg n’a pas très bien vécu l’expérience. « J’étais trop jeune et je n’assumais pas de juger des films avec mes armes à moi qui n’étaient qu’émotion. Je ne trouvais pas ça suffisant. Je ne me sentais pas assez cinéphile. »
Dans « les Fantômes d’Ismaël », qui sort aujourd’hui dans 260 salles*, Charlotte incarne une astrophysicienne qui partage la vie de Mathieu Amalric, cinéaste, lequel voit ressurgir son épouse (Marion Cotillard), disparue vingt ans plus tôt, qu’il croyait morte. Il émane de son personnage une résignation douce qui ne ressemble guère à la comédienne.
Son père, ce « mort-vivant »
« Elle est beaucoup plus posée que moi, qui ai tendance à monter très vite dans l’hystérie. Je l’ai d’abord trouvée trop gentille. Trop maternelle. J’avais dit à Arnaud ( NDLR : Desplechin) : J’espère que j’aurai assez à faire. Je n’ai pas envie d’être passive. Il m’a fait comprendre que je me trompais. Je me suis servie d’une timidité qui m’a longtemps accompagnée et de toute la maladresse qui va avec. » Dans la vie, elle n’est pas du genre à lâcher. « Parce que je suis têtue. Bêtement têtue. » Pour Desplechin, avec qui elle rêvait de tourner, l’ex-petite « Effrontée » révélée par Claude Miller a accepté d’être une femme « raisonnable ». Loin des « tourbillons » que lui a fait vivre le réalisateur danois Lars von Trier, qui ne lui font pas peur. Au contraire ! En héroïne de « Nymphomaniac », qui porte bien son titre, elle se souvient d’une aventure « paisible ». Quant à « Antichrist » ? « C’était éprouvant mais je l’ai vécu comme un rêve éveillé. Lars m’a donné la possibilité d’explorer des choses qu’on ne m’avait jamais demandées. »
Le film de Desplechin évoque les « fantômes » d’Ismaël. Où en est-elle, vingt-six ans après sa mort, avec le fantôme de son père ? « Je n’ai pas tellement avancé avec ça, dit-elle. Pas beaucoup mûri. J’ai encore à dealer avec le regard des gens. Comment peut-on faire le deuil de quelque chose que l’on vous remet dans la figure chaque jour de votre vie et qu’il serait malvenu de dénoncer parce que ça provient d’une telle bienveillance… Aujourd’hui je comprends que mon père, c’est un mort-vivant. » En octobre, Serge aura une belle occasion de se pencher sur l’épaule de sa fille. Charlotte sort un album de chansons qu’elle a écrites elle-même. Elle en est fière, confie-t-elle dans un large sourire qui est une aube à lui tout seul.
* La version cannoise a été écourtée de vingt-cinq minutes. C’est celle que la majorité des salles de France projettent. La version longue sort au cinéma du Panthéon (Paris V e) et dans quelques salles de province.



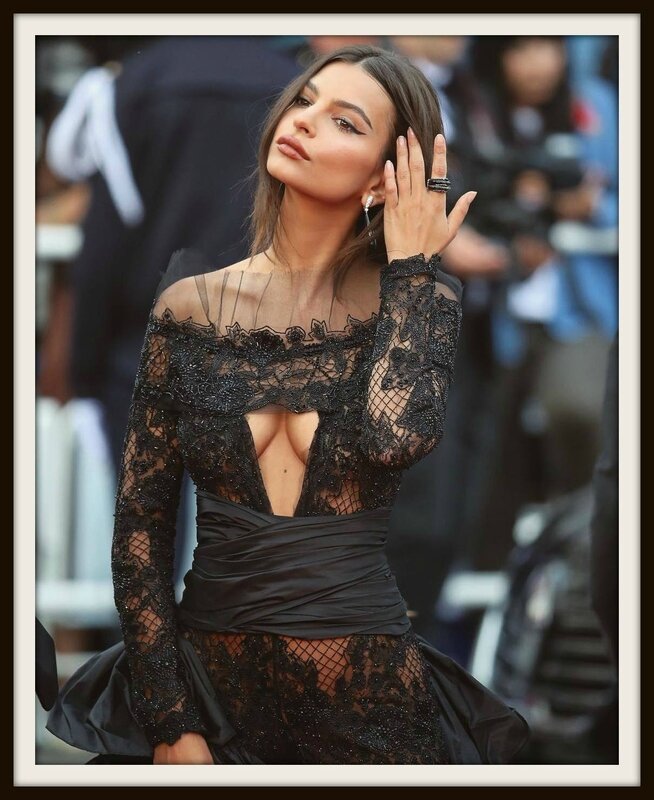

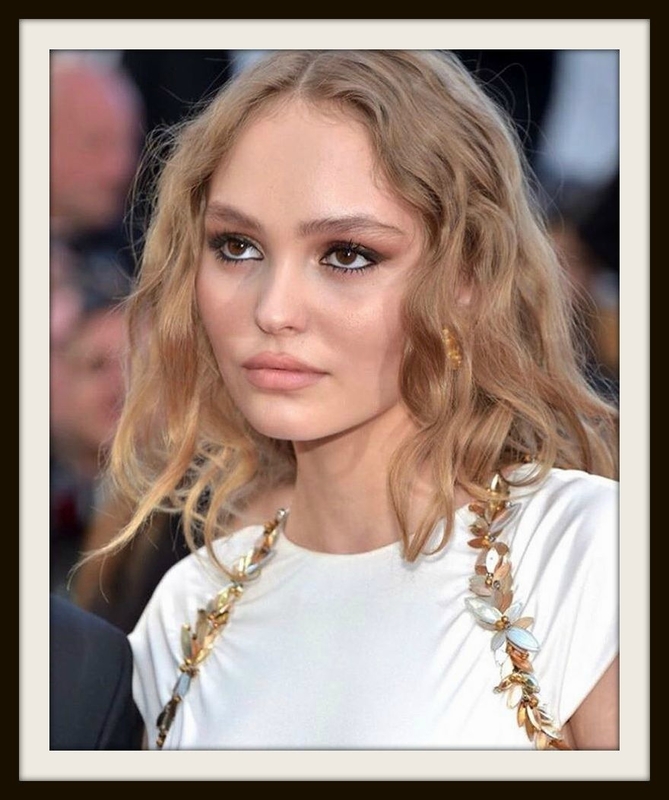


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)