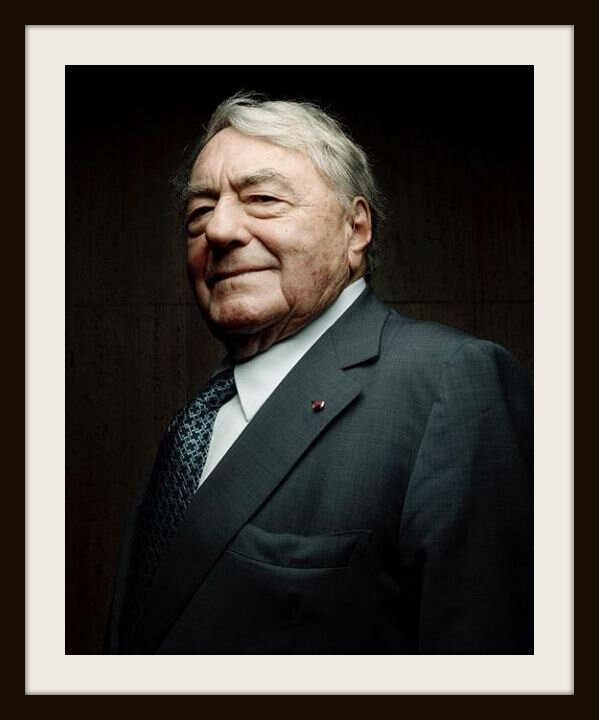
Par Jacques Mandelbaum - Le Monde
Pas d’images d’archives, aucune reconstitution, axé sur la parole des témoins directs, rescapés des camps ou nazis, et sur les paysages du crime : avec « Shoah », film titanesque, Claude Lanzmann a bouleversé son époque.
Avec Shoah, documentaire sorti en 1985 et consacré à l’extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale, Claude Lanzmann fut et restera l’auteur d’un film d’une envergure exceptionnelle dans l’histoire du cinéma comme dans celle des idées et des mentalités. Ce monument, d’emblée reconnu comme tel, a bouleversé son époque et il faut aujourd’hui rassembler ses souvenirs pour comprendre l’onde de choc qu’il a suscitée.
Premier choc : la portée historique du film, qui révèle par le détail au grand public l’existence et le processus d’un génocide partiellement occulté de la mémoire collective depuis l’après-guerre. Un lent travail de réappropriation de cette mémoire avait de fait commencé dès le début des années 1960, qu’il s’agisse de la tenue du procès Eichmann en Israël ou de la publication, aux Etats-Unis, de la somme de l’historien Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe.
Insoutenable réalité
Deuxième choc : la manière dont le film fait soudain advenir cet événement dans sa plus insoutenable réalité, contre la dissimulation des nazis qui en ont effacé les traces, contre le pieux oubli des nations qui l’ont laissé commettre et contre la banalisation des fictions qui le remettent au goût du jour, à l’instar du célèbre feuilleton américain Holocauste (1978). Shoah, de la même manière qu’il le configure, nomme d’ailleurs l’événement, comme pour la première fois.
Troisième choc, sans lequel tout cela serait sans doute resté nul et non avenu : la radicalité esthétique du film. C’est d’abord sa dimension titanesque. Onze années de préparation, trois cents heures de pellicule tournées, neuf heures trente de projection. Un projet littéralement fou, tenu par la volonté d’un homme seul qui consacre dix années de sa vie à parcourir le monde et les archives, à rencontrer des survivants, pour tenter de donner forme à une chose qui en est, a priori, totalement dépourvue : l’annihilation industrielle de six millions d’êtres humains, gazés, brûlés, éparpillés aux quatre vents avec les infrastructures qui ont permis au crime de s’exercer. Filmer, en un mot, le néant.
Quelques partis pris intangibles
Pour ce faire, Lanzmann se compare à un topographe. Il repère, il étudie, il mesure, il cherche à comprendre et à relier les choses entre elles. Il fait sienne la maxime de Raul Hilberg : « Je n’ai pas commencé par les grandes questions, car je craignais de maigres réponses. »
Concrètement, cela se traduit par quelques partis pris intangibles : pas une image d’archives, pas l’ombre d’une reconstitution, un film entièrement au présent fondé sur la seule parole des témoins directs (rescapés des commandos affectés aux chambres à gaz, nazis, citoyens polonais) et sur le pouvoir évocateur, jusque dans leur banalité, des lieux et des paysages du crime.
La pertinence du film, sa portée proprement pédagogique sur le mécanisme de l’extermination, doit à cette méthode à la fois modeste et scrupuleuse, qui se préoccupe davantage du comment que du pourquoi.
Sa dimension bouleversante, quasiment hallucinante, relève sans doute de raisons moins avouables. Elles tiennent à cette remarque du philosophe Jean-Luc Nancy : « Montrer les images les plus terribles est toujours possible, mais montrer ce qui tue toute possibilité d’image est impossible, sauf à refaire le geste du meurtre. »
Shoah, parce qu’il est un film qui s’efforce de regarder sans compromission ni consolation la mort en face, refait à bien des égards le geste du meurtre. Lanzmann y tient le rôle du passeur, qui extorque à ses passagers une parole ou un geste qui se révèlent vitaux pour le film. Par la ruse à l’officier nazi, par la violence aux paysans polonais, par l’insistance et la supplication aux rescapés, ces morts-vivants dont on sent bien qu’une part vitale d’eux-mêmes est restée là-bas, et qui ne doivent cesser de lutter de toutes leurs forces pour ne pas répondre à son funeste appel.
Art poétique de l’évocation
Shoah est un film qui réactive un passé monstrueux, honteux et infiniment douloureux par la force et la cruauté de sa mise en scène. Mais c’est aussi une œuvre qui émeut profondément par son art poétique de l’évocation, par sa manière de faire revenir les morts à travers le corps et la parole des vivants.
Tous ceux qui l’ont vu le savent : peu de films s’inscrivent dans la mémoire sensible comme celui-ci. Peu de films auront également été à ce point montrés dans les cinémas, les télévisions, les écoles du monde entier, ni suscité un tel nombre d’études, de commentaires, de débats, voire de polémiques.
Ces dernières, nombreuses, n’auront jamais cessé. Attisées par le caractère ombrageux du réalisateur, enflammées par la transformation de la Shoah en paradigme de la barbarie contemporaine, elles prennent des tournures souvent déraisonnables, parfois abjectes, notamment sur le terrain de la concurrence victimaire.
Les plus notables d’entre elles découlent toutefois d’un texte rédigé par Claude Lanzmann dans les colonnes du Monde à l’occasion de la sortie de La Liste de Schindler de Steven Spielberg (« Holocauste, la représentation impossible », le 3 mars 1994). Il y écrit notamment : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flamme, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu d’horreur est intransmissible : prétendre le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. La fiction est une transgression, je pense profondément qu’il y a un interdit de la représentation. »
Une querelle Lanzmann-Godard
Cette formulation, sans doute maladroite dans le choix de ces termes, mais juste sur le fond, déclenche à plus ou moins long terme des débats entre historiens sur l’unicité de la Shoah, et des controverses esthétiques autour de la représentation du génocide.
Sur un autre versant, celui de l’existence possible d’images de l’extermination, de la valeur qu’il convient de leur accorder et de l’usage qu’il convient d’en faire, une sourde querelle oppose Claude Lanzmann à Jean-Luc Godard, le premier prônant la destruction, le second espérant la rédemption. Faute d’un terrain d’entente, les deux hommes ne se rencontreront jamais sur Arte, qui leur propose, à l’invitation du philosophe Bernard-Henri Lévy, de filmer ce débat en 1998.
Si ces polémiques n’entament en rien la valeur et le génie intrinsèques de Shoah, elles sont en revanche une indication de ce qui change avec le temps dans la perception du film comme de l’événement qu’il évoque. Shoah cristallise en 1985 une prise de conscience, il est perçu, notamment par les cinéphiles, comme une inquiétude critique qui se situait dans la droite ligne du cinéma moderne et comme un moment en quelque sorte indépassable de la représentation du génocide.
Les choses ont changé
Dix ans plus tard, en dépit des signes de reconnaissance manifestés à l’égard de Claude Lanzmann par de jeunes cinéastes français tels qu’Arnaud Desplechin ou Arnaud des Pallières, les choses ont pourtant déjà changé. L’inflation mémorielle autour de la Shoah, la prolifération des travaux sur le sujet, la fiction classique, et le plus souvent médiocre, qui s’en empare de plus belle au cinéma, tout cela signifie sans doute que l’événement commence tout bonnement à entrer dans l’Histoire.
Mais Shoah ne doit pas faire oublier que son auteur a réalisé d’autres films, qui lui sont plus ou moins directement liés. En amont, il y a eu, dès 1973, Pourquoi Israël, documentaire passionnant sur l’existence de l’Etat d’Israël qui signe ses débuts de réalisateur. Le film, qui reconstitue le choc ressenti par Lanzmann vingt ans plus tôt lors de la découverte du pays, est une interrogation pleine d’empathie et de finesse sur l’hypothétique définition d’une normalité juive. C’est aussi une œuvre mosaïque sur les tensions et les contradictions de cet Etat où cohabitent de manière un peu miraculeuse des communautés, des croyances, des manières de penser radicalement différentes.
A la lisière du cadre
Lanzmann, en y imprimant sans doute beaucoup de sa personnalité, inaugure ici un style cinématographique qui a plus à voir avec l’essai subjectif et poétique qu’avec le documentaire classique. C’est une manière bien à lui de se tenir à la lisière du cadre, d’affirmer une présence opiniâtre, tantôt revêche, tantôt séduisante, de bousculer allègrement les règles du récit et de la pseudo-objectivité pour mieux pénétrer au cœur des choses.
En aval, il y aura ensuite Tsahal (1994), une mise en perspective, sans doute plus discutable, de l’armée israélienne, du rôle qu’elle a joué dans les différentes guerres menées par le pays, et plus encore de sa signification symbolique dans le processus de reconquête de l’Histoire, et partant de la violence, menée par le peuple juif au cours du XXe siècle.
Mais il y aura surtout eu les cinq films tirés de l’immense matériau laissé en friche par Shoah, et qui sont bien davantage que des séquelles de cette œuvre matricielle. Le premier est Un vivant qui passe (1997), long et édifiant entretien mené avec Maurice Rossel, un représentant de la Croix-Rouge qui avait visité, durant la seconde guerre mondiale, les camps d’Auschwitz et de Theresienstadt pour rédiger à son retour un rapport totalement insignifiant sur la situation. Une parabole sur l’incapacité du regard à surmonter l’aveuglement idéologique, doublé d’une radicale mise en doute du caractère d’évidence attaché au visible.
Fureur
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures (2001) évoque ensuite, à travers le récit du rescapé Yehouda Lerner, personnage à la fois héroïque, brisé et bouleversant, le soulèvement « réussi » des déportés dans le camp d’extermination de Sobibor. C’est un film lyrique, élégiaque, qui met en scène avec une folle élégance la dignité retrouvée d’un peuple de parias.
Le Rapport Karski (2010) naît d’une polémique violente, comme savait les nourrir Claude Lanzmann. Tout part du roman Jan Karski, de Yannick Haenel, paru en septembre 2009, qui s’approprie la figure historique de Karski, cet émissaire de la résistance polonaise qui avertit en vain les alliés du génocide en cours. Le romancier se prévaut de la fiction pour faire tenir à Karski des propos mettant en cause la complicité des alliés dans le génocide.
Fureur de certains historiens, fureur de Lanzmann également, qui avait longuement interrogé Karski pour Shoah, dans lequel il se montre bouleversant. Le cinéaste décide de montrer des passages restés inédits de cet entretien, touchant plus précisément à la rencontre de Karski avec les dirigeants alliés, dans un film délibérément destiné à ruiner l’intuition du romancier qui sera diffusé sur Arte.
Une mémoire opiniâtre
Le Dernier des injustes (2013) est quant à lui centré autour de la figure du rabbin viennois Benjamin Murmelstein, dernier « doyen » du Conseil juif de Therensienstadt, ce camp-vitrine utilisé par les nazis pour donner le change à l’opinion mondiale.
Le témoignage de Murmelstein, longuement rencontré à Rome par Lanzmann en 1975, ne sera finalement pas retenu dans Shoah. Quelque quarante ans plus tard, le cinéaste l’exhume pour signer un film de trois heures quarante, amer, brûlant, irrémissible, qui prend tout à coup une forte dimension testamentaire.
Lanzmann se place, avec la question des dirigeants juifs des ghettos, au cœur de la perversité nazie en même temps que d’une interminable polémique historique et morale. Il s’investit de surcroît comme jamais dans ce film, tant en termes de présence à l’écran que de prise de parole. Le vertige du film réside donc moins dans la terrible lucidité de Murmelstein que dans la manière dont la présence de Lanzmann, devenu un vieillard non moins intraitable, lui fait intimement écho quarante ans plus tard.
Attentat contre la survie
Ultime, mais non moins bouleversant matériau inédit prélevé par l’auteur aux rencontres insensées qui firent naître Shoah : Les Quatre Sœurs, diffusé en janvier 2018 sur la chaîne Arte. Ce long récit enchaîne le témoignage de quatre femmes survivantes, parole féminine de fait rare dans le film princeps, quand bien même deux d’entre elles y intervenaient déjà, mais de manière très concise.
Avec elles, un autre point de douleur d’un martyre qui ne fut que souffrances apparaît, le pire peut-être, qui tient à la proximité des femmes avec les enfants, avec leurs enfants, et qui désigne le crime nazi comme un attentat concerté non seulement contre la vie, mais au-delà encore, contre la survie.
Ainsi, à l’heure où la Shoah, cet événement qu’il contribua comme aucun autre à faire connaître et reconnaître, entrait dans la zone froide de l’Histoire, Lanzmann posait à son tour en « dernier des injustes », en « dinosaure sur l’autoroute », inquiétant le monde de sa présence et de sa mémoire opiniâtres, perclus dans son refus d’apaiser l’abjection accablant depuis lors l’humanité.
Quelque chose s’avouait ainsi, in fine, du rapport intime de l’homme et de l’œuvre. Pour l’universaliste et républicain convaincu que fut Lanzmann, mais aussi bien pour le juif sartrien dépossédé par l’Histoire de sa culture et de son identité, cette œuvre fut sûrement, de manière plus significative qu’il ne l’aura laissé paraître, un mouvement vivant et profond de reconquête personnelle et de lien restauré à la communauté martyrisée de ses ancêtres.
Chronique du destin juif au XXe siècle
Si tous ces films, qui constituent le noyau brûlant de son œuvre, esquissent une chronique du destin juif au XXe siècle, il n’en reste pas moins que l’un des derniers opus de Claude Lanzmann, homme décidément surprenant, quitte les rives du judaïsme pour nous emmener en Corée du Nord, à la poursuite d’un souvenir amoureux évoqué dès 2009 dans sa belle autobiographie, Le Lièvre de Patagonie.
En 2017, à l’âge de 91 ans, Lanzmann, vert vieillard et père récemment accablé par la mort d’un fils, signe ainsi Napalm, un documentaire totalement déconcertant qui sort discrètement au cinéma, relatant la brève passion sans lendemain qu’il vécut avec une infirmière lors du premier voyage d’une délégation occidentale en Corée du Nord en 1958.
Rien ne filtre dans le film de son compagnonnage avec le Parti communiste, guère plus sur ses propres compagnons de voyage qui s’appellent notamment Chris Marker ou Armand Gatti, mais au centre du film un récit à la première personne, assumé, torride, sensuel, tendu, sur cet amour interdit, sur cette femme marquée dans sa chair par le napalm et qui ne devait plus cesser de brûler sa mémoire.
La marque irrémissible de la mort combattue jusqu’au dernier souffle par la rage inextinguible de vivre : telle fut bien la marque de fabrique de Claude Lanzmann.








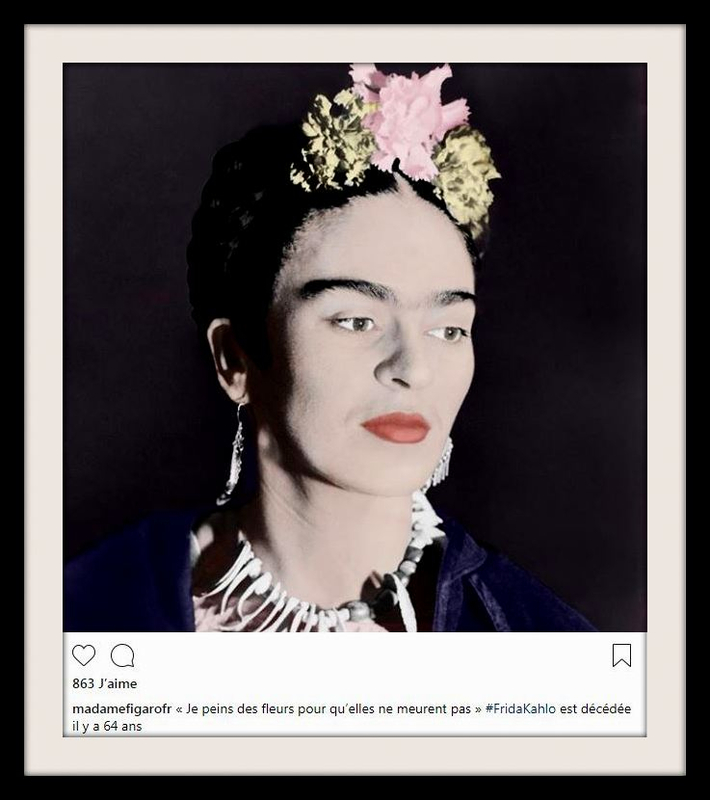
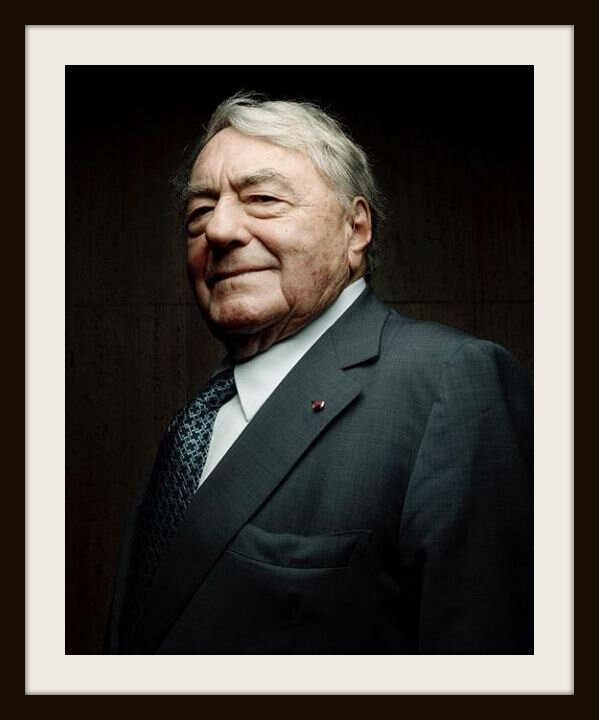

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)