Par Alain Frachon - Le Monde
L’ex-président républicain de 1989 à 1993 est mort vendredi à l’âge de 94 ans. Son mandat a été marqué par la fin de la guerre froide et la réunification de l’Allemagne.
Juillet 1990, l’été est chaud – et va le devenir plus encore. A mi-course d’un mandat paisible, sans grand relief, George H. W. Bush s’apprête à aller golfer dans sa patricienne résidence du Maine, à Kennebunkport. Les sondages sont médiocres, la bataille du budget 1991 est mal engagée, mais cela relève de la routine politique.
Tout n’irait pas trop mal pour cet aimable partisan du gouvernement minimum, si l’Irakien Saddam Hussein, enivré de son demi-succès dans la guerre contre l’Iran, puissamment armé par les Russes et les Occidentaux, ne cédait à son désir de domination régionale : le 2 août, les chars irakiens envahissent le Koweït. L’Irak double sa capacité pétrolière ; Saddam Hussein va acquérir les moyens de ses ambitions guerrières.
« Nous ne le permettrons pas. » George Bush est catégorique : les Etats-Unis useront de tous les moyens, y compris la force, pour que le Koweït recouvre sa souveraineté. Le reste de l’histoire est connu : ayant dépêché près d’un demi-million d’hommes en Arabie saoudite, brillamment assemblé une coalition hétéroclite de pays arabes et occidentaux, enfin s’étant assurés de la neutralité de l’Union soviétique (URSS), les Etats-Unis boutent Saddam Hussein hors du Koweït lors de l’opération « Tempête du désert » (du 17 janvier au 28 février 1991).
A l’origine de la détermination de George Bush, il y a, bien sûr, le pétrole (simple producteur de légumes, le Koweït n’aurait pas fait l’objet de tant de sollicitude), le souci de maintenir les équilibres au Proche-Orient, de contenir un Saddam Hussein de plus en plus agressif, etc. Mais, peut-être plus encore, il y a, au sortir de la guerre froide, la volonté de Moscou et de Washington d’empêcher l’éclosion de conflits régionaux nés de la dissolution des zones d’influence des super-grands. Pour George Bush, c’est une préoccupation centrale : le 41e président des Etats-Unis est attaché au statu quo de l’après-guerre.
Il n’aime pas le changement. C’est entendu, il fallait repousser l’agression irakienne, mais rien de plus. Quand, dans la foulée de la victoire américaine, les Kurdes et les chiites d’Irak, au départ incités par la CIA, tenteront de faire tomber Saddam Hussein, les Etats-Unis les abandonneront. Ne voulant pas d’un Irak démembré, Washington préfère alors le maintien au pouvoir d’un Saddam Hussein avec lequel l’administration Bush s’était d’ailleurs, avant le malencontreux épisode koweïtien, toujours bien entendue.
Le haut de l’échelle
Conservateur bon teint, centriste penchant à droite, le président Bush, mort le vendredi 30 novembre à l’âge de 94 ans, est à l’opposé de la flamboyance reaganienne et des bouleversements de la « révolution conservatrice » – souvent plus verbaux que substantiels. Il le prouve au lendemain de cette « Tempête du désert » qui sera le point fort de sa présidence. Il le prouvera quelques mois plus tard en appuyant Mikhaïl Gorbatchev qui tente de préserver l’URSS de la désagrégation. Pour George Bush, il faut que se maintienne à Moscou un pouvoir central, que perdure, sinon le système socialiste, du moins une forme d’union des Républiques ex-soviétiques. Dans un fameux discours à Kiev, il va même jusqu’à critiquer les indépendantistes ukrainiens !
Sur le plan intérieur, l’administration Bush se caractérisera par un immobilisme à peu près total. A tel point que quand il quitte le pouvoir en janvier 1993, deux journalistes de Time Magazine, Michael Duffy et Dan Goodgame, publient sur ses années à la Maison Blanche un ouvrage intitulé L’art du sur-place ou la présidence du statu quo (Marching in Place, the Status Quo Presidency of George Bush, Simon and Schuster).
C’EST UNE PRÉPARATION À DIRIGER ET À ADMINISTRER PLUS QU’À CONVAINCRE ET À ENTRAÎNER : BUSH APPREND À ÊTRE UN CHEF, PAS À AVOIR DES IDÉES
C’est qu’il en va souvent ainsi avec les gens biens élevés : ils ont le respect de ce qui est. Et George Bush est très bien élevé. En un sens, toute son éducation puis sa vie professionnelle ont d’ailleurs ressemblé à un parcours sans faute vers la présidence.
James Reston, l’ancien chef du bureau du New York Times à Washington, qui l’a suivi durant des années et l’aimait bien, écrivait : « Toute sa carrière n’a semblé qu’une préparation à la présidence. » En prenant ses fonctions, ajoutait-il, « il avait plus d’expérience personnelle du Congrès, des affaires, du renseignement militaire, de la guerre et de la diplomatie qu’aucun autre président de ma génération ».
Seulement, c’est une préparation à diriger et à administrer plus qu’à convaincre et à entraîner : Bush apprend à être un chef, pas à avoir des idées. Reagan, son prédécesseur, pouvait séduire, Bush gérera. Est-ce affaire de milieu familial ?
Il était né le 12 juin 1924, à Milton (Massachusetts) dans la haute société WASP (White Anglo-Saxon Protestant), soit dans ce qui ressemble le plus à une aristocratie américaine. Son père, Prescott Bush, banquier à Wall Street, puis sénateur du Massachusetts, est l’ami des Astor, Vanderbilt, Harriman, le haut de l’échelle.
Pas un « planqué »
Il grandit dans le domaine familial, dans le Connecticut, et accomplit tous les rites de la tribu : sports à outrance, études dans les meilleurs établissements privés. Mais le jeune homme que l’on conduit à l’école en voiture avec chauffeur n’est pas un planqué. A 18 ans tout juste, en juin 1942, il se porte volontaire dans l’aéronavale. Après avoir reçu une formation de pilote, il est affecté dans le Pacifique, sur le porte-avions San Jacinto, à l’escadrille VT-51, un squadron de choc qui a déjà perdu la moitié de son effectif dans des raids de bombardements contre les Japonais.
George Bush devient un pilote émérite. Le 2 septembre 1944, le VT-51 multiplie les attaques contre l’île de Chichijima où les Japonais ont installé un de leurs centres de communication. Bush est aux commandes d’un gros TBM Avenger, lesté de bombes, pour une énième mission, quand la DCA l’attrape. Moteur en feu, cabine envahie de fumée, la machine pique du nez… Blessé à la tête, il saute en parachute, puis, miraculeusement, récupère le canot pneumatique de l’avion. Il a été repéré par d’autres membres de l’escadrille et, deux heures et demie plus tard, un sous-marin vient le rechercher. Le lieutenant George Herbert Walker Bush termine la guerre bardé de décorations : Air Medal, Distinguished Flying Cross.
« J’ai fait ce que j’avais à faire », dira-t-il. Il sera paradoxal, des années plus tard, quand Bush se battra dans l’arène politique, de le voir traité par la presse de « poule mouillée », alors que Reagan, qui a fait toute la guerre à Hollywood – dans les services cinématographiques de l’armée –, projette une image de gros dur à la John Wayne… Une fois président, c’est d’ailleurs en partie pour se débarrasser de cette réputation de pusillanimité que Bush se lancera, en 1989, dans une intervention militaire au Panama sous le prétexte d’aller capturer le dirigeant de ce pays, Manuel Noriega, ex-agent de la CIA devenu trafiquant de drogue.
Paradoxe encore : après la guerre, des études à Yale (économie, lettres), une fois marié à Barbara Pierce, dont il aura cinq enfants – elle est morte le 17 avril –, il quitte le territoire des WASP, la côte Est, pour aller s’installer en pays redneck (« plouc ») au Texas, dans une bourgade nommée Odessa.
La petite histoire retient que le jeune Bush, l’argent familial aidant beaucoup, y fera fortune dans l’équipement pétrolier. L’histoire politique retiendra, elle, que George Bush, en s’installant au Texas, a peut-être voulu s’éloigner de son milieu familial ; il passera sa vie politique à s’efforcer de renier ses origines.
Elle commence en 1964 par une défaite à une élection sénatoriale au Texas (son chef de campagne est son partenaire de tennis, un nommé James Baker) ; il est élu à la Chambre des représentants deux ans plus tard, où il effectue deux mandats avant que le président Richard Nixon le nomme ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU (1971-1973), puis président du Parti républicain (1973-1974) en pleine tourmente du Watergate. Le président Gerald Ford l’envoie à Pékin installer ce qui n’est encore que le bureau de liaison américain dans la capitale chinoise (1974-1975), puis le rappelle à Washington où il dirigera brièvement la CIA (1976-1977). Bush est un bon gestionnaire de crise.
Un fidèle vice-président
La chronique politique de l’époque décrit un républicain modéré, un homme de bon sens, administrateur compétent, convaincu qu’il y a un savoir-faire du pouvoir, un art de diriger qui compte autant, sinon plus, que les idées. C’est sous cette enseigne qu’il mène une bataille féroce contre Ronald Reagan dans les primaires présidentielles républicaines de 1980. Le Californien, qui veut réduire le poids de l’Etat fédéral, diminuer les impôts tout en se lançant dans la course aux armements contre l’URSS, serait un illuminé. Le programme reaganien, c’est de l’« économie vaudoue », de la magie, lance Bush.
Sorti largement vainqueur des primaires, Reagan proposera à Bush de figurer sur son « ticket », histoire de ratisser large dans l’électorat républicain. Et George Bush, qui s’est prononcé pour l’avortement et contre la prière publique à l’école, n’en sera pas moins durant huit ans un fidèle vice-président : dans le sillage de son maître, il entonne les cantiques moralisants de la révolution conservatrice. Il en payera, plus tard, le prix politique. Car s’il est élu président en 1988 – à la suite d’une vile campagne contre le gouverneur Michael Dukakis, le candidat démocrate –, il entre à la Maison Blanche avec une image brouillée, trouble : républicain modéré avec Nixon, puis intégriste avec Reagan, le nouveau président serait un homme sans grande conviction.
Homme de la guerre froide, il va, cependant, devoir gérer une grande transition sur la scène internationale : la fin de l’URSS. Même s’il colle un peu trop longtemps à Mikhaïl Gorbatchev, méprisant ce mal élevé de Boris Eltsine, qu’il ne découvre que tardivement, lors du coup d’Etat d’août 1991, George Bush fait preuve d’un jugement sûr. Il sait ne pas humilier Gorbatchev et Eltsine, héritiers d’un empire qui s’effondre ; s’il ne crie pas victoire, il sait les convaincre de laisser l’Allemagne se réunifier tout en restant dans l’OTAN ; il saisit l’occasion pour conclure avec Moscou des accords de désarmement nucléaire historiques ; il rassure les pays d’Europe orientale et centrale qui viennent de reconquérir leur liberté. Ce n’est pas rien.
En ces temps de bouleversements, ses qualités de conservateur sans grande imagination font merveille : il calme, rassure, accompagne le mouvement de l’Histoire. Mais s’il promet béatement un « nouvel ordre international » de paix et de démocratie, il reste sans réaction devant la guerre qui éclate en Yougoslavie. Il ne prend vraiment l’initiative qu’au Proche-Orient où les Etats-Unis, après leur victoire contre l’Irak, parrainent un dialogue israélo-arabe qui débouchera en 1993, à Oslo, sur les premiers accords de paix – qui ne tiendront malheureusement pas leurs promesses – entre l’Etat hébreu et les Palestiniens.
Beaucoup moins engagé sur le front intérieur, qui ne l’intéresse pas autant que la diplomatie, il y est aussi beaucoup moins heureux. Il n’a pas la moindre idée de ce que devront être les Etats-Unis des années 1990. Au sortir des turbulences reaganiennes accompagnées d’une adaptation, à marche forcée, à la globalisation de l’économie, il promet une « Amérique plus douce ». Las, le pays est en pleine récession. Bush paye les excès des années 1980, la surchauffe, la spéculation, les déficits publics vertigineux – et reste sans réaction. Il donne l’impression de tout ignorer des dislocations économiques et sociales que vit l’Amérique en ces temps de compétition exacerbée ; il assiste impuissant et surpris aux émeutes raciales de Los Angeles qui dureront six jours et feront des dizaines de morts fin avril et début mai 1992.
Il ne fera pas de second mandat. Le vainqueur de « Tempête du désert » est battu de justesse par le démocrate Bill Clinton. Ayant occupé la Maison Blanche après Reagan et avant un jeune gouverneur du Sud, il laisse à son départ l’image d’un homme du passé, héritier d’un monde qui n’est plus, celui de la guerre froide, et de temps économiques révolus, quand l’Occident avait le monopole du développement.
Les tourments d’un père
Sa vie post-présidentielle prend l’allure d’une retraite malaisée. Même passé par le Texas, il reste un grand WASP : le pouvoir, pour cette élite, c’est un peu une affaire de famille. Son fils aîné, George « W » (Walker) Bush, est élu président en novembre 2000, puis réélu en 2004. Junior doit très largement son élection aux amis de la famille.
Le deuxième président Bush affronte les attentats du 11 septembre 2001. La campagne d’Afghanistan qui s’ensuit est approuvée par le clan. Mais George W. Bush s’embarque en mars 2003 dans une aventure beaucoup plus contestée, qui tourne vite au désastre : l’invasion de l’Irak. Volonté de faire mieux que son père, d’aller, lui, à Bagdad et de laisser « sa » trace dans l’histoire ? Dans les salles de rédaction, les commentaires politico-psychanalytiques vont bon train. L’ancien président Bush ne dit rien. Pas une intervention publique marquante. Mais les proches – le général Brent Scowcroft et « Jim » Baker, notamment – ne se privent pas de dire ce qu’ils pensent de l’intervention en Irak : une folie inspirée par des « néoconservateurs » qui n’ont jamais mis les pieds au Proche-Orient. Les folies d’un fils sont les tourments d’un père.
Dire qu’il ne se résigne pas aux atteintes de l’âge est faible. En juin 2014, pour fêter son 90e anniversaire, comme il l’avait fait pour ses 75 ans, ses 80 ans et ses 85 ans, il saute encore en parachute au-dessus de sa résidence du Maine. Mais cette fois, c’est un saut en tandem, accompagné par un professionnel, et sitôt qu’il a touché terre, est avancée sa chaise roulante. Depuis 2011, il ne se déplace plus qu’ainsi, sa mobilité ayant été atteinte par une forme de maladie de Parkinson.
Fin 2012, hospitalisé à Houston pour une bronchite, il en était ressorti sept semaines plus tard, suffisamment requinqué pour participer, le 25 avril 2013, à l’inauguration à Dallas du « centre présidentiel » accueillant les archives de son fils George Walker Bush, en présence de celui-ci, mais aussi de Barack Obama, de Bill Clinton et de Jimmy Carter. Après la bataille politique comme après un match de tennis, il met un point d’honneur à se montrer fair-play. Comme il se doit, pour l’un des derniers grands WASP.
Alain Frachon
George H. W. Bush en quelques dates
12 juin 1924 Naissance à Milton (Massachusetts)
1944 Blessé à bord de son avion lors de la guerre du Pacifique
1966 Elu à la Chambre des représentants
1971-1973 Ambassadeur à l’ONU
1973-1974 Président du Parti républicain
1974-1975 Installe le bureau de liaison américain à Pékin
1976-1977 Directeur de la CIA
1981-1989 Vice-président de Ronald Reagan
1989-1993 41e président des Etats-Unis
1989 Intervention militaire contre le Panama
1991 Lance l’opération « Tempête du désert »
1991-1993 Accords de désarmement nucléaire avec la Russie
1993 Parraine les accords d’Oslo entre Israël et les Palestiniens
30 novembre 2018 Mort de l’ancien président à l’âge de 94 ans















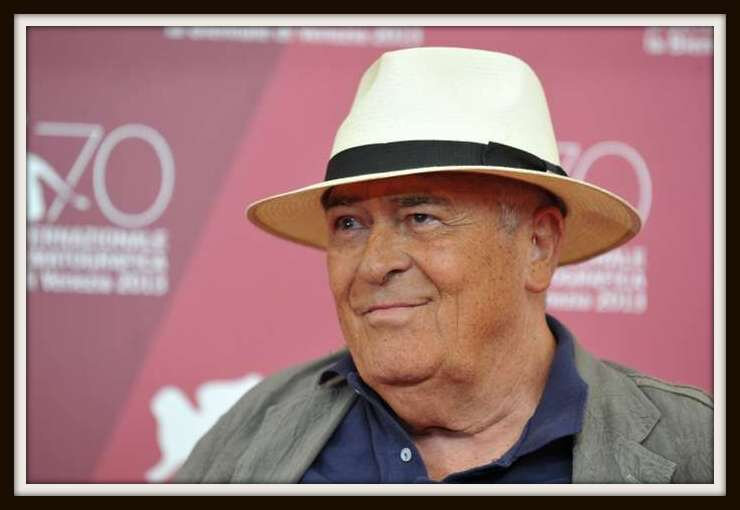
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)