Par Yves Bordenave - Le Monde
Sous les pavés, la droite (2/3). « Le Monde » revient, dans une série d’articles, sur la manière dont le camp conservateur a vécu les « événements ». Aujourd’hui, le Service d’action civique (SAC), considéré comme la « police parallèle » du pouvoir.
Il y a le feu. Un cocktail Molotov a traversé le carreau d’une fenêtre du rez-de-chaussée ; les rideaux flambent. Par chance, des barreaux empêchent les assaillants d’envahir la pièce, mais ils ne protègent pas des projectiles. Devant la façade, ornée d’une banderole « Comité de défense de la République », la foule lance des « CDR SS ! », « Les barbouzes assassins ! », « De Gaulle démission ! » A l’intérieur, c’est un peu la panique : il faut éteindre les flammes, bloquer les accès. Tables, chaises, dossiers, classeurs… tout fait barricade le long des portes et des fenêtres. Ce mercredi 22 mai 1968, le siège parisien du Service d’action civique (SAC) – organisation gaulliste réputée « musclée » – est assailli de toutes parts, et Jacques Godfrain, militant gaulliste et responsable des jeunes du SAC, qui depuis le début des « événements » passe ses journées et l’essentiel de ses nuits ici, cherche un extincteur. Par miracle, il en trouve un près de la loge du concierge, un certain M. Colinot. Mais il n’en maîtrise pas le fonctionnement. A peine l’a-t-il dégoupillé que la neige carbonique barbouille le pauvre concierge.
Il est près de 22 heures. Plusieurs centaines d’étudiants, un millier tout au plus, font le siège du bâtiment, un hôtel particulier de trois étages, situé au 5, rue de Solférino, dans le 7e arrondissement de Paris. L’endroit a une riche histoire : le Général en personne y avait pris ses quartiers durant sa traversée du désert, entre 1947 et 1958. Il fut aussi le siège du Rassemblement du peuple français (RPF, parti fondé en 1947), avant de devenir celui de l’association de soutien à ce même de Gaulle. Au premier étage, il accueille d’ailleurs son bureau – un véritable musée –, à l’étage supérieur celui d’André Malraux, et au dernier, donc, les hommes du SAC.
Dans la rue, les manifestants se déchaînent, bombardant sans relâche le bâtiment. Boulons et bouteilles atteignent parfois les étages. Les assiégés – une centaine au total – répliquent avec ce qu’ils ont sous la main : des caisses de bière et de « l’eau avec des bouteilles autour », comme le racontera ironiquement Jacques Foccart, l’éminence grise de Charles de Gaulle, dans le tome II de ses Mémoires, Le Général en Mai.
Parti de la place Saint-Michel vers 20 heures, un cortège de plusieurs milliers d’étudiants a d’abord remonté le boulevard jusqu’au jardin du Luxembourg, avant de bifurquer vers le boulevard Raspail, puis d’emprunter le boulevard Saint-Germain en direction de l’Assemblée nationale. Parvenus au carrefour Solférino, certains d’entre eux ont décidé de partir à l’assaut des locaux du SAC, à quelques dizaines de mètres de là.
Simples volontaires et militants aguerris
Ce soir-là, comme tous les autres, l’endroit est sous le contrôle des militants gaullistes. De simples volontaires, armés de matraques, auxquels on distribue des casse-croûte et de la bière, mais aussi d’autres, plus aguerris, qui, pour certains, dissimulent des holsters sous leurs vestes, sans que l’on sache trop s’il s’agit de pistolets d’alarme ou d’armes à balles réelles. Charles Pasqua, l’un des principaux dirigeants du SAC, se trouve à l’étage, pendu au téléphone avec Jacques Foccart, lequel, depuis son domicile de la rue de Prony (17e), leur demande de rester calmes en attendant les forces de l’ordre. L’attaque dure de longues minutes jusqu’à ce qu’un escadron de CRS, posté sur les quais de Seine, reçoive l’ordre de disperser les assaillants.
Ces derniers n’insistent pas. La rue se vide en un clin d’œil. Charles Pasqua, qui a réussi à retenir ses troupes, sort sur le trottoir et discute avec le commandant de la compagnie. Selon ses dires, certains de ses compagnons, parmi les plus irréductibles, voulaient en découdre avec les manifestants. A l’intérieur, l’heure est au bilan : l’attaque a fait de gros dégâts matériels, mais aucun blessé. « Au rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée et dans la loge du concierge, tout était sens dessus dessous, se souvient Jacques Godfrain. Heureusement que la porte de l’immeuble a résisté, sans quoi cela aurait été un carnage. »
A l’époque, Jacques Godfrain a 25 ans. Natif de Toulouse, il a décroché un diplôme à l’Institut d’étude politique de la ville, où il a fait ses premières armes en politique. En mai 1958, alors qu’il est élève de 3e au lycée Gambetta – rebaptisé par la suite lycée Pierre-de-Fermat –, il écrit « Vive de Gaulle ! » à la craie sur le tableau noir de sa classe pendant que ses professeurs manifestent place du Capitole au cri de « Non à la dictature militaire ! » Godfrain est un inconditionnel du Général. A la fac de droit et de sciences économiques, au début des années 1960, il se bat contre les partisans radicaux de l’Algérie française ou les communistes lors des meetings ou des nuits d’affichages. Cet engagement sans faille sera récompensé. A l’issue de sa carrière au SAC, où il a exercé de hautes responsabilités – il en a notamment été le trésorier –, Jacques Godfrain deviendra, en 1978, l’un des dirigeants du RPR. Sous cette étiquette, puis sous celle de l’UMP, il sera député de l’Aveyron (1978-2007), maire de Millau (1995-2008), ministre de la coopération dans le gouvernement Juppé (1995-1997) et préside, depuis 2011, la Fondation Charles-de-Gaulle.
« Un parfum de scandale »
Dès son installation à Paris, en octobre 1965, le jeune Toulousain se rend rue de Solférino, où il est orienté vers le dernier étage, réservé aux équipes du SAC. A l’en croire, il s’agissait alors d’une bande « de braves types qui voulaient aider le Général, des bénévoles qui ne cherchaient pas à faire carrière ». Mais aussi des gros bras, finira-t-il par admettre après qu’on lui eu suggéré. Dans le lot, d’anciens membres du service d’ordre du RPF, d’ex-militaires de la 2e DB, rappelés pour combattre l’Organisation armée secrète (OAS), constituée début 1961 par des partisans radicaux de l’Algérie française. Au fil des ans, les effectifs du SAC sont renforcés par des voyous, ex-détenus ou futurs condamnés de droit commun, petites frappes et gros gangsters, prêts à se servir de la carte tricolore de l’association comme d’un passe-droit.
Dans son livre Histoire du SAC, la part d’ombre du gaullisme (Stock, 2003), l’historien François Audigier raconte comment cette organisation, que ses nombreux détracteurs – y compris à droite – qualifient de « police parallèle », est née en 1959. Officiellement, elle est enregistrée à la Préfecture de police, le 4 janvier 1960, en tant qu’association de type loi de 1901. « A la fois légale et occulte, écrit François Audigier (…), elle traîne derrière elle un parfum de scandale. » En clair, toutes sortes de « barbouzeries » : des coups tordus, des opérations musclées contre des syndicalistes et des grévistes, voire des meurtres. Le SAC a pour pères fondateurs des fidèles du Général : Jacques Foccart, Roger Frey, Alexandre Sanguinetti et Jean Bozzi. Ses premiers responsables, Charles Pasqua, Paul Comiti et Pierre Debizet, dirigent des troupes dont les missions relèvent à la fois du service d’ordre, de l’affichage en campagne électorale, de la protection des dirigeants les plus exposés et, de manière plus officieuse, du renseignement et de l’infiltration.
Dès sa création, l’organisation a deux cibles : l’OAS et les communistes. A compter de 1961, alors que de Gaulle entame des négociations avec le FLN en vue de l’indépendance de l’Algérie, l’OAS fomente des dizaines d’attentats, tant en Algérie qu’en France, et s’en prend même à de Gaulle en personne. Le 22 août 1962, l’un de ses commandos tente de l’assassiner au Petit-Clamart, en région parisienne, en tirant à la mitraillette sur la DS présidentielle.
Système quasi militaire
Pendant la campagne pour les élections législatives de 1967, le SAC mobilise ses gros bras pour, à la nuit tombée, couvrir les murs des villes et des villages d’affiches aux couleurs des candidats de l’Union des démocrates pour la Ve République (UD-Ve), et accompagner dans leurs déplacements les membres du gouvernement. Sous la houlette de Charles Pasqua, 2 000 membres du SAC encadrent les meetings du parti gaulliste. Par exemple le 27 février, à Grenoble, quand le premier ministre Georges Pompidou se retrouve face à Pierre Mendès France, grande figure socialiste. La salle est surchauffée, l’ambiance électrique. Jean Lacouture, envoyé spécial du Monde, décrit ainsi la réunion : « On vit d’abord s’avancer en rangs serrés une cinquantaine de costauds qui prirent place au premier rang : les hommes du SAC. Plusieurs fois, au cours de la soirée, on les verra intervenir brutalement, salués de “Barbouzes assassins !” »
« ME VOYANT FAIRE, PASQUA ME LANCE : “NE COMMENCEZ JAMAIS UN LISTING PAR 001. COMMENCEZ PAR 10 001, COMME ÇA, ON IMAGINE QU’IL Y A DÉJÀ DU MONDE” »
JACQUES GODFRAIN, RESPONSABLE DES JEUNESSES DU SAC
Un autre jour, le premier ministre tient une réunion publique à Nevers. Cette fois, c’est un autre leader socialiste, François Mitterrand, qui lui porte la contradiction. Jacques Godfrain est chargé d’accompagner ce dernier dans la salle du marché aux bestiaux de la cité. Sa mission : protéger Mitterrand alors qu’il est accueilli par des bordés d’injures, et lui permettre de prendre la parole à trois reprises ainsi que cela a été négocié. « Mitterrand est arrivé dans une 403 noire, raconte Godfrain. Je le conduis vers la tribune. A la fin de la réunion, je le récupère. Le public était déchaîné. Ça hurlait, ça sifflait. Je lui propose de sortir par une porte dérobée. Il me répond : “Non. Je sors par là où est le peuple.” Nous voilà engagés dans les allées. Je le couvre de mon manteau pour lui éviter les crachats qui pleuvent autour de nous. »
Au printemps 1968, le noyau dur du SAC compte environ 3 000 hommes, auxquels il faut ajouter quelques milliers de sympathisants. Rue de Solférino, le QG fonctionne selon un système quasi militaire sous les ordres de Charles Pasqua, chargé de coordonner les groupes de province et les équipes parisiennes. Depuis l’Elysée, où il officie au plus près du Général, Jacques Foccart supervise l’organisation, que l’Etat finance sans barguigner avec des fonds secrets du gouvernement.
Infiltration du Quartier latin
Mi-mai, quand les troubles avec les étudiants s’enveniment et quand la grève se généralise, le duo Foccart-Pasqua bat le rappel des troupes. Au siège de l’UD-Ve, rue de Lille, Robert Poujade, patron du parti gaulliste qui, dans quelques semaines, deviendra l’UDR, s’escrime à remonter le moral des élus et à garder la maison en état de marche. Du côté du SAC, rue de Solférino, une question hante les esprits : comment sortir de cette « chienlit », selon l’expression du Général ? Intervenir aux côtés des forces de l’ordre ? Tant au ministère de l’intérieur qu’à la Préfecture de police, on est plus que dubitatifs sur cette hypothèse. Christian Fouchet, le ministre de l’intérieur, qui semble par moments dépassé par la tournure des événements, n’y est pas très favorable. Le préfet Maurice Grimaud s’y oppose avec fermeté.
Pourtant, dans la nuit du 11 mai, la fameuse « nuit des barricades », qui voit une grande partie du Quartier latin s’enflammer, quelques membres du SAC déguisés en étudiants se mêlent aux protestataires. Pas tant pour ouvrir la voie aux forces de l’ordre que pour recueillir des informations et signaler les principaux fauteurs de troubles. Certains groupes d’action constitués quelques jours auparavant prendront part directement à l’intervention des CRS durant cette nuit-là.
François Audigier a récemment exhumé des propos tenus en 1998 par Charles Pasqua dans Conflits actuels, une revue confidentielle de l’Union nationale interuniversitaire (l’UNI, le syndicat d’étudiants de droite né dans la foulée de Mai 68), au moment de la célébration du 30e anniversaire des événements : « C’est dans la nuit du 10 au 11 mai qu’a lieu le choc le plus dur entre gauchistes et forces de l’ordre, qui reçoivent l’instruction de reconquérir les rues à partir de 2 heures du matin. Il faudra cinq heures pour réduire une émeute à laquelle nous assistons la rage au cœur puis en soutenant activement les policiers et les gendarmes. Nos militants se tiennent également prêts à défendre l’Elysée, car le service de protection du Général, en dehors des hommes placés sous l’autorité de Comiti, nous apparaît peu sûr. »
« Répondre à la rue par la rue »
Au cours de cette période, le SAC ne se contente pas de prêter main-forte. A l’instar d’une véritable police parallèle, il développe son propre réseau de renseignement, en plaçant quelques « sous-marins » dans les assemblées générales. « Je pense qu’il y a des gens de chez nous qui ont infiltré certaines organisations gauchistes », lâche aujourd’hui Jacques Godfrain dans un doux euphémisme. Certains envisagent même de mettre sur pied des opérations plus radicales. A la fin du mois de mai, aux alentours des 24 ou 25, un projet se dessine « d’une façon extrêmement précise », assure Foccart dans ses Mémoires. « Les types du Service d’action civique étaient prêts à prendre de force l’Odéon », indique-t-il.
Depuis le 15 mai, le célèbre théâtre national, situé à deux pas du Luxembourg et de la Sorbonne, est en effet occupé par des centaines d’étudiants, des gens du spectacle et des militants. Exigée par le chef de l’Etat, son évacuation a été reportée en raison du scepticisme de Georges Pompidou et du préfet Grimaud. Si ce dernier dit tout haut le mal qu’il pense de l’idée d’envoyer des commandos du SAC à l’assaut du théâtre, il faut l’intervention de De Gaulle auprès de Foccart pour la chasser définitivement des esprits des cadres de la rue de Solférino. « Il faut que cela se fasse, mais il faut que cela soit fait par la police, s’indigne le Général. Ce n’est pas à des “civils” de la faire. »
Face à la succession des nuits de violences, au durcissement de la grève, aux occupations d’usines et à la mobilisation croissante des protestataires, les chefs du SAC et les responsables de l’UD-Ve hésitent sur la stratégie à suivre. Au sein du parti, nombre d’élus et de militants sont déboussolés. Comment en sortir ? Faut-il en appeler à la « France profonde », celle qui, depuis plusieurs semaines, reste silencieuse, comme paralysée par la tension ambiante ? Les leaders gaullistes réfléchissent à une initiative forte qui permettrait au peuple de droite de sortir de sa torpeur. « Répondre à la rue par la rue », s’enhardissent les plus déterminés.
Tenir la barre à droite
Qui, de Foccart, de Pasqua ou de Pierre Lefranc, proche conseiller de De Gaulle, a le premier suggéré l’idée ? La création des Comités de défense de la République (CDR) a pour but de relancer la machine gaulliste. Rue de Solférino, des membres du SAC sont sollicités. Objectif : rassembler des énergies afin de « défendre la République en danger ». Avec les partisans du Général bien sûr, mais au-delà, jusqu’aux nostalgiques de l’Algérie française, qui ne lui ont pourtant pas pardonné la signature des accords d’Evian avec le FLN, six ans auparavant. Jacques Godfrain enregistre bientôt les premières inscriptions. « Les gens faisaient la queue, se souvient-il. J’inscrivais les noms sur un carnet à souche en les numérotant par ordre d’arrivée : 001, 002, 003, etc. » Pasqua suit l’affaire de près. Et donne des conseils au jeune « recruteur ». « Me voyant faire, il me lance : “Vous n’y entendez rien. Vous n’irez pas loin dans la vie” », raconte Godfrain, hilare. « “Ne commencez jamais un listing par 001. Commencez par 10 001, comme ça, on imagine qu’il y a déjà du monde.” »
Les CDR recrutent large. Beaucoup plus que le SAC, dont la réputation demeure sulfureuse. Quand il s’agit d’organiser la manifestation géante du 30 mai (de 500 000 à 800 000 personnes sur les Champs-Elysées), les CDR se montrent très actifs et montent en première ligne, mais le SAC et Charles Pasqua restent à la manœuvre. Plus de 1 500 de ses membres encadrent l’imposant cortège.
Au plus fort de la tempête de Mai 68 qui a ébranlé le pouvoir gaulliste, le SAC a donc tenu le cap. Bien qu’étant en proie à de vives controverses, il a imposé ses méthodes au cœur d’une droite souvent désarçonnée. Durant la campagne électorale pour les législatives de juin, ses gros bras ne manqueront pas non plus à l’appel. Il faudra attendre l’été 1981 et l’implication de certains de ses membres dans la tuerie d’Auriol (six morts, près de Marseille) pour que cette officine, née de la guerre d’Algérie, soit dissoute par un gouvernement de gauche, après qu’elle eut sombré dans la criminalité.




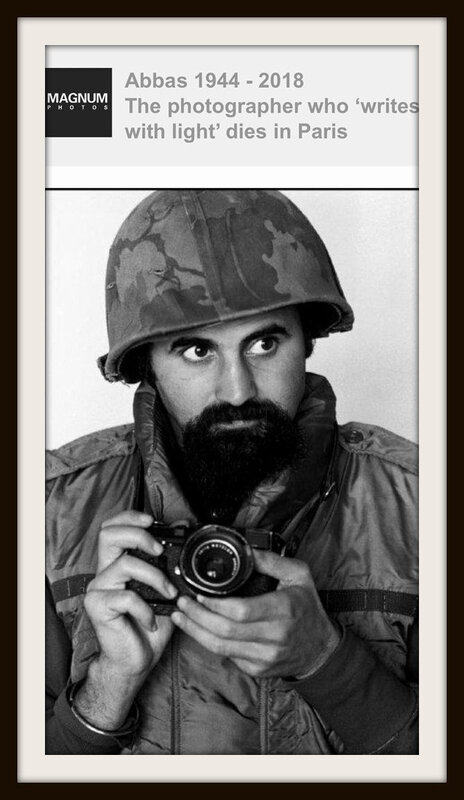





/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)