Un comité de soutien demande la libération du journaliste Loup Bureau
Le Français a été arrêté à la frontière turco-syrienne le 26 juillet puis mis en examen et incarcéré pour « participation à un groupe terroriste ».
Un comité de soutien au journaliste français Loup Bureau, détenu depuis la fin juillet en Turquie pour soupçon d’appartenance à une « organisation terroriste armée », à la suite d’un reportage sur les Kurdes syriens des YPG (unité de protection du peuple), a été lancé par ses proches, lundi 7 août.
Plus de 2 500 personnes ont déjà rejoint le groupe Facebook « Free Loup Turkey - Comité de soutien à Loup Bureau », géré par sa famille. Une pétition en ligne en faveur de sa libération, lancée sur Change.org par le même comité, avait, elle, récolté plus de 10 300 signatures mardi à 6 heures.
Loup Bureau, journaliste indépendant qui a notamment collaboré avec les médias TV5 Monde, Arte et Slate, a été interpellé le 26 juillet à la frontière entre l’Irak et la Turquie, après que des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG – considérées comme une organisation terroriste par Ankara – eurent été trouvées en sa possession.
« C’est effrayant »
Selon son avocat, Martin Pradel, il a été mis en examen par un juge qui l’a considéré comme suspect d’appartenance à « une organisation terroriste armée », et ce malgré ses dénégations, du fait de ce reportage qui avait été réalisé en 2013.
Selon son père, interrogé par RMC, Loup Bureau « est complètement isolé du reste du monde ». « On nous annonce qu’il ne pourra avoir qu’un coup de téléphone d’une dizaine de minutes toutes les deux semaines et évidemment aucune visite ». « C’est effrayant » et « je ne sais pas dans quel état moral il est », a-t-il poursuivi, redoutant une détention de plusieurs mois.
Dans un communiqué commun, les syndicats de journalistes français SNJ, SNJ-CGT et CFDT-Journalistes, soutenus par la Fédération européenne des journalistes (FEJ) et la Fédération internationale des journalistes (IFJ), ont exigé « que le gouvernement français mette tout en œuvre » pour obtenir sa libération. « Les propos convenus ne suffisent plus », disent-ils.
Pour les trois syndicats, « il est clair que les dirigeants turcs et le président Erdogan en tête abhorrent les journalistes étrangers trop curieux et n’hésitent pas à les arrêter pour imposer un mur du silence sur la réalité de ce pays, qui est la plus grande prison au monde pour les journalistes, où 160 de nos confrères sont derrière les barreaux ».
Clotilde Leguil : « Nous vivons à l’ère d’une hypertrophie du moi »
Par Clotilde Leguil, Psychanalyste et philosophe
Basculement du monde 4|6. Alors que le narcissisme de masse s’étend avec les relations numérisées, la psychanalyse représente un « Autre », en chair et en os, nécessaire en ce qu’il est capable d’entendre sans juger, observe la psychanalyste Clotilde Leguil.
Que devient la psychanalyse à l’époque de la mondialisation ? La question se pose de façon cruciale aujourd’hui, car les nouvelles technologies captent le psychisme de chacun et absorbent la libido de tous. Elles modifient le rapport des êtres à eux-mêmes en médiatisant les relations entre les individus. Elles changent le statut de la parole et du langage, celui de l’intimité et du secret, celui de l’image et du récit de soi. Les multiples applications régissant dorénavant les rapports sociaux, amoureux et amicaux s’introduisent par là même au cœur de l’existence de chacun. Elles réorientent le rapport à soi et à l’Autre en accélérant toujours davantage les processus de transmission d’informations et d’exhibition de l’intime.
C’est le rapport du sujet à sa propre temporalité existentielle qui s’en voit transformé. Les confessions, les aveux, les dévoilements foisonnent sur la Toile. La rapidité, la fulgurance, l’accélération, le « toujours plus et toujours plus vite » disent l’esprit de l’époque de ce nouveau moi mondialisé.
Car ce qui se mondialise, ce ne sont pas seulement les échanges économiques, les rapports sociaux et les relations politiques, mais l’intimité de chacun. Comme si le « noyau de notre être » – « das Kern unseres Wesen », disait Freud –, qui nous échappe à nous-même, était livré à un Autre sans visage, sans désir, sans incarnation, mais pas sans voracité : l’Autre de la Toile, des réseaux sociaux, des « like »et des « don’t like ».
Nous vivons donc à l’époque d’une hypertrophie du moi, corrélative d’une mondialisation de l’exigence pulsionnelle de chacun. Le narcissisme de masse est le trait distinctif du moment actuel. La promotion de soi ne connaît pas de limite. Le rapport à la sexualité que Freud a transformé en son temps en libérant la parole n’est plus frappé d’interdit et de répression. Chacun veut jouir plus et compte bien souvent sur les nouvelles technologies pour répondre efficacement au manque. Parfois même à l’angoisse et à la déréliction.
Se conformer à l’air du temps ?
A quelle condition la psychanalyse peut-elle continuer de produire un effet de dépaysement et de transformation subjective dans un monde où tout se dit, tout se sait, tout se montre ? La fonction de l’écoute et de l’interprétation a-t-elle encore sa place dans cet univers rhizomique où tout peut dorénavant être dévoilé, divulgué, publié, répercuté au niveau de la planète entière en un simple clic sans que l’on sache jamais à qui on s’adresse ?
On peut en effet se demander quelle place l’invention de Freud et de Lacan peut venir occuper dans ce paysage contemporain. Pour se présenter comme attrayante, la psychanalyse doit-elle se conformer à l’air du temps ? Le psychanalyste doit-il se présenter sous un jour nouveau en consentant à la virtualisation de sa présence ? S’il revient à chaque époque de réinventer la psychanalyse à partir des symptômes qui eux-mêmes se transforment, il revient à la nôtre de démontrer ce que devient la psychanalyse à l’ère du moi mondialisé.
Il serait en effet dangereux pour la psychanalyse de se couper de son temps en s’en désintéressant. Mais n’est-il pas aussi dangereux pour elle de répondre aux injonctions du temps en oubliant la valeur de la parole dans l’expérience analytique, son statut hors du sens commun, sa coloration singulière si étrangère à l’effet de la conversation courante et au bla-bla-bla dont le flux ne cesse pas sur les réseaux sociaux ?
Ne faut-il pas se méfier de ces déviations qui conduisent à faire croire que l’on peut rencontrer un psychanalyste comme on surfe sur l’écran de son iPhone et que l’on peut se défaire de ses angoisses en trouvant sur la Toile des experts qui répondent aux questions de tous ?
« Le sujet qui parle »
L’objet de la psychanalyse, depuis sa découverte par Freud au début du XXe siècle, est bien « le sujet qui parle ». Le territoire de l’expérience analytique, c’est le « je » en tant qu’il peut conduire à explorer son être depuis l’inconscient. C’est en pratiquant une talking cure que celui qui s’engage dans une analyse peut avoir accès à un rapport inédit à ses inhibitions, ses symptômes, ses angoisses.
Pour faire une analyse, il faut désirer savoir quelque chose de soi-même à partir de la parole adressée à un Autre, auquel il est fait confiance pour interpréter ce qui se dit. Ce n’est donc pas n’importe quelle parole du sujet qui a une valeur analytique, ce n’est pas non plus n’importe quel Autre qui est en position de recevoir la parole qui est demande de déchiffrement d’une souffrance qui fait énigme pour le sujet.
« A FORCE DE VOULOIR EXISTER IMAGINAIREMENT POUR UN AUTRE QUI NE CHERCHE QU’À JOUIR EN CONSOMMANT DES IMAGES, LE SUJET PASSE À CÔTÉ DE SA VIE »
Pour que la psychanalyse reste au XXIe siècle une expérience inédite parmi les expériences subjectives, il faut donc revenir à ce qui en fait le fondement. Le point de départ de Freud était la distinction radicale entre la conscience et l’inconscient. Le point de départ de Lacan est celui d’une distinction tout aussi fondamentale entre le « moi » et le « je ».
La thèse lacanienne des années 1950 contre l’Egopsychology des postfreudiens est que le « moi » n’est pas le « je ». Confondre le narcissisme du moi avec la parole du sujet sur son désir inconscient conduira à la mort de la psychanalyse. Car l’accès à l’inconscient suppose de traverser le narcissisme, c’est-à-dire la parole vide et la croyance dans une identité fabriquée à partir d’images de soi.
Signatures de l’inconscient
Cette distinction lacanienne entre le rapport narcissique à soi-même et le rapport étrangement inquiétant à son inconscient est plus que jamais éclairante pour saisir la place à part que la psychanalyse peut continuer d’occuper au XXIe siècle. Car l’inflation narcissique, qui est le symptôme de l’époque, ne donnera jamais accès au désir et au secret de l’être. La scénarisation de sa vie sur la Toile ne jugulera jamais l’angoisse. Les commentaires et jugements que chacun peut émettre sur les choix de vie des autres contribuent bien souvent à accroître l’angoisse de celles et ceux qui cherchent une réponse dans l’Autre à leur questionnement existentiel.
Pour pouvoir dire quelque chose de cette part d’étrangeté qui repose en chacun de nous et qui nous angoisse, il faut pouvoir s’adresser à un Autre incarné, qui n’est pas tout le monde et n’importe qui. Un psychanalyste est un Autre en chair et en os, qui prêtera son corps pour entendre ce qui ne s’entend pas, parce qu’il aura lui-même fait l’expérience de l’analyse et de ses effets subjectifs. Un Autre qui est présent pour répondre à ce qui se dit par-delà ce que le sujet veut dire. Un Autre qui s’intéresse aux rêves, aux actes manqués, aux lapsus, comme à des signatures de l’inconscient sur la chair du sujet.
Le psychanalyste, à l’envers de l’Autre de la Toile, n’est pas un Autre qui juge, qui émet des opinions, qui donne des conseils, qui « like » ou qui « don’t like ». C’est un Autre qui ne porte aucun jugement sur ce qui est dit, et autorise celui qui parle à dire ce qu’il ne comprend pas.
C’est dire que « lâcher les amarres de la parole » en analyse, ce n’est pas tout dire et à n’importe qui. Mais essayer de dire l’indicible à un Autre qui est en mesure de répondre. Le psychanalyste du XXIe siècle se distingue en ceci du destinataire anonyme de la mondialisation qu’il n’est pas un Autre qui veut jouir de ce qu’il voit et de ce qu’il entend. A l’ère du moi mondialisé, on peut considérer que cet Autre capable d’entendre sans juger ni jouir est nécessaire, car l’accélération de l’exigence de jouissance participe à la montée en puissance de l’angoisse.
« Ensemble dans une langue particulière »
Cet Autre-là s’intéresse à ce qu’il y a de plus singulier dans la parole de celui qui s’adresse à lui. Lacan le disait élégamment dans le texte fondateur de son enseignement, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Que veut-on dire quand on considère que l’on parle « le même langage » qu’un autre ? On signifie par là, non pas qu’on parle avec lui la langue de tous, mais que l’on se rencontre ensemble dans une langue particulière. La psychanalyse fait ainsi exception dans le paysage de la communication mondialisée en continuant de faire exister cette langue particulière qui est celle de l’inconscient de chacun.
Cette langue se parle à la première personne et se réalise dans un « nous » qui n’est pas celui de tous, mais celui qu’une séance fait exister le temps d’une énonciation inédite. Elle se parle en faisant passer les signifiants de sa destinée par la gorge, car elle se parle aussi avec sa voix, c’est-à-dire avec son corps. La tâche de la psychanalyse est de faire résonner cette langue particulière comme ce qui permet de s’arracher à la prison du narcissisme. Car le danger du narcissisme de masse est qu’il détourne finalement chacun du souci de sa propre existence. A force de vouloir exister imaginairement pour un autre qui ne cherche qu’à jouir en consommant des images, le sujet passe à côté de sa vie. Car il ne sait plus lui-même ce qu’il cherchait à retrouver en continuant de se perdre dans le monde de l’Autre.
A l’ère du moi mondialisé, la psychanalyse a changé. C’est vrai. Mais non pas au sens où elle deviendrait la servante du narcissisme de masse. Elle a changé au sens où elle a affaire à ce narcissisme hypertrophié comme à un mur qui sépare le sujet de son désir et l’abandonne bien souvent à sa pulsion.
En 1968, Lacan appelait cette accélération de l’exigence pulsionnelle le « plus-de-jouir ». Terme qui évoquait cette exigence nouvelle de « jouir plus ». On peut dire qu’avec le moi mondialisé et l’exhibition des jouissances, nous en sommes là. La psychanalyse lacanienne en ce sens a les moyens de s’inscrire dans son époque. En conduisant le sujet à apercevoir le point où il se perd dans une exigence de jouissance qui l’aveugle et en continuant de sauver la parole dans ce qu’elle a de plus extraordinaire, soit dans sa valeur de dévoilement d’une vérité et d’un désir qui peuvent redonner un sens à l’existence.
Clotilde Leguil Psychanalyste et philosophe, Clotilde Leguil est également membre de l’Ecole de la cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse, professeure au département de psychanalyse de l’université Paris VIII - Saint-Denis. Elle a notamment publié L’Etre et le genre. Homme/femme après Lacan (PUF, 2015).
Chronique : Etes-vous Trump ou Bush Junior ?
Par Arnaud Leparmentier, éditorialiste au Monde
Dans sa chronique, Arnaud Leparmentier, éditorialiste au « Monde », estime que l’actuel président américain finira parmi les pères fondateurs de l’Europe pour sa contribution à l’unification du Vieux Continent.
Jouons à choisir entre la peste et le choléra : qui fut le pire président des Etats-Unis pour l’Europe, Donald Trump ou George W. Bush (2001-2009) ? A ceux qui s’indignent du cavalier seul du premier sur le climat, de ses diatribes contre l’Allemagne ou de ses attaques contre l’OTAN, on est tenté de rafraîchir la mémoire : rappelez-vous du second !
A peine mal élu, George W. Bush commença par refuser le protocole de Kyoto, première tentative globale de lutte contre le dérèglement climatique. Après le 11 septembre 2001, le président républicain divisa le Vieux Continent en deux, son secrétaire à la défense Donald Rumsfeld opposant la « nouvelle Europe » – celle de Tony Blair, de José Maria Aznar et des anciens pays du bloc communiste –, à la « vieille Europe » de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, qui refusaient son expédition en Irak. Bush surtout bafoua les valeurs de l’Occident, avec les tortures dans les prisons de la CIA et l’arbitraire à Guantanamo.
Alors, comparé aux faucons de l’ère Bush, Trump a un air de catcheur, de faux dur qui ne ferait que du chiqué. Erreur, nous explique Hubert Védrine, l’ancien ministre des affaires étrangères : la remise en cause la plus fondamentale vient du nouveau président américain.
Certes, les actes de George W. Bush suscitaient autant de conflits, mais, rappelle Védrine, « jamais Bush n’a mis en doute l’OTAN et l’activation de l’article 5 », qui force à porter assistance à un pays attaqué. L’ancien conseiller du président Mitterrand décèle dans les « pulsions » de Trump une tendance plus lourde à l’éloignement, avec une Amérique où les habitants d’origine européenne deviennent minoritaires : « Les Etats-Unis et l’Europe risquent de redevenir ce qu’ils étaient au XIXe et au début du XXe siècle, des cousins issus de germains. »
La rupture est consommée
Avec Trump, la relation euro-américaine fait un bond de deux siècles en arrière. Un grand isolement qui rappelle la doctrine du président James Monroe de 1823 : que les Européens ne s’immiscent plus dans les affaires du Nouveau Monde et que les Américains ne s’ingèrent jamais en Europe.
La rupture est consommée si l’on en croit le centriste Jean-Louis Bourlanges, qui résume l’histoire Europe-Amérique en trois phases : « Jusqu’en 1940, pour les Etats-Unis, l’Europe est un modèle ; après 1945, elle était un enjeu ; depuis la chute de l’Union soviétique, elle n’est ni un enjeu ni un modèle. »
C’est le pacte de 1945 que Trump efface, celui fondé par un président américain méconnu, Harry Truman (1945-1953), dont aucune rue ne porte le nom en France. Le successeur de Roosevelt portait une tache indélébile, les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Mais il comprit les enjeux afin de contrer Staline et mit en place l’ordre de l’après-guerre, en tirant les conséquences des erreurs commises après 1914-1918.
Truman dut s’opposer à deux visions pernicieuses : celle de la France, qui ne voulait pas, au début, traiter l’Allemagne en égale ; celle du Royaume-Uni, qui croyait que le simple équilibre des puissances pouvait être un gage de stabilité, alors que l’expérience avait montré la nécessité d’institutions solides.
Quand les Etats-Unis vont mal, l’Europe se divise
L’administration Truman régla ces problèmes : l’Allemagne fut traitée avec égalité et retrouva un Etat avec la RFA. Deux institutions de poids fixèrent l’ordre européen : l’OTAN en 1949 pour la sécurité, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951 pour empêcher la guerre économique. Enfin, le plan Marshall garantit le redressement économique d’une Europe en ruines et bloqua le communisme. « La politique américaine a été formidable », résume Hubert Védrine.
Cette alliance-protection connut des hauts et des bas. Selon M. Védrine, la « première encoche » fut l’invention de la « riposte graduée » par Robert McNamara, secrétaire à la défense des présidents Kennedy et Johnson : avant d’entrer en guerre totale contre les Soviétiques, on limiterait le champ de bataille.
Cette doctrine était plus efficace que la menace peu crédible de destruction totale, mais elle ne rassura guère les Européens. Les Allemands commencèrent à craindre une guerre nucléaire qui ne tuerait que des Allemands tandis que le président Charles de Gaulle y trouva la justification de son cavalier seul : dissuasion nucléaire, sortie du commandement intégré de l’OTAN, double veto à l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe, etc.
La période fut glaciale avec le président Lyndon B. Johnson (1963-1969), qui ne s’intéressa pas à l’Europe, accaparé il est vrai par la guerre au Vietnam et la lutte pour les droits civiques. Comme plus tard sous George W. Bush, la leçon est claire : quand les Etats-Unis vont mal, l’Europe ne se renforce pas, elle se divise.
La « contribution » de Donald Trump
Une exception toutefois, l’abandon de la convertibilité or du dollar en 1971. « Le dollar, c’est notre monnaie, mais c’est votre problème », lança alors le secrétaire au Trésor de Nixon.
Il s’agit pourtant du seul exemple où les Européens surent profiter d’un chaos américain. Dès 1972, Georges Pompidou et Willy Brandt lançaient le serpent monétaire européen, lointain prélude à l’euro.
Au fil des décennies, les républicains se sont intéressés à l’Europe, soucieux de gagner la guerre froide – Nixon, Reagan, Bush père – tandis que les présidents démocrates élus sur un agenda intérieur ont cherché la paix, notamment au Proche-Orient – Jimmy Carter, Bill Clinton. Tous avaient une ligne rouge, la création d’une défense européenne.
Le retour complet de la France dans l’OTAN en 2009 et le pivot asiatique de Barack Obama ont été une occasion manquée : pour la première fois, un président américain n’était pas hostile à cette idée, estime M. Védrine. Trump remet le sujet à l’ordre du jour. A chaud, face à une Russie agressive. En Europe, chacun fait mine d’y croire.
Encore un effort et Donald Trump finira parmi les pères fondateurs de l’Europe pour sa contribution décisive à l’unification du Vieux Continent.

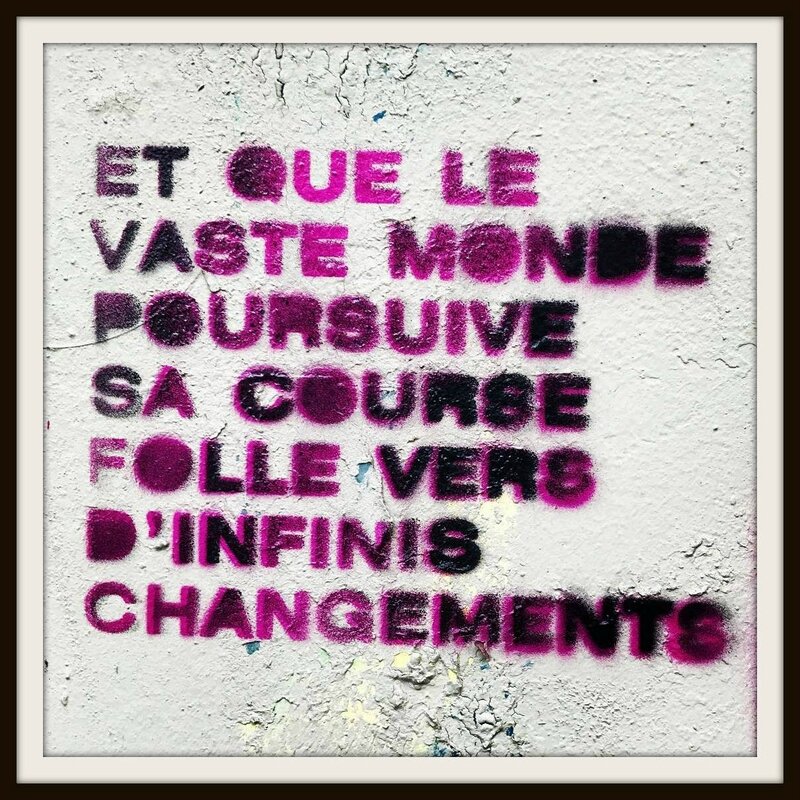





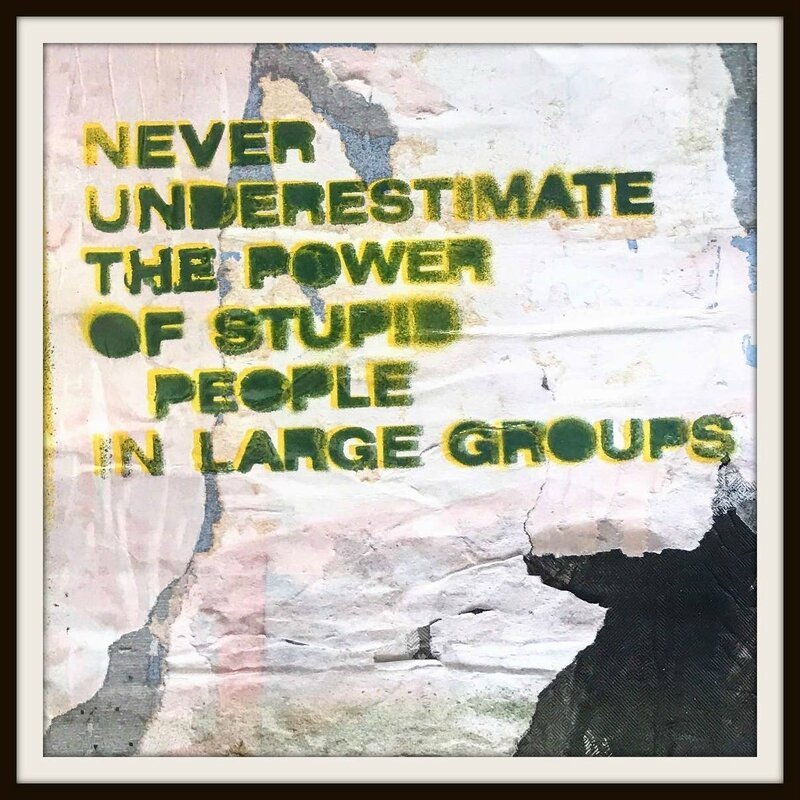



/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)