Par Stéphane Foucart, San Francisco (Etats-Unis), envoyé spécial Le Monde
Pour le médecin américain Robert Lustig, cette quête du plaisir, fondée sur la dopamine, est l’ennemie du bonheur, qui dépend, lui, de la sérotonine.
Cette fugace piqûre de bien-être, cette satisfaction éphémère, ce goût de reviens-y… De l’utilisation des réseaux sociaux à la consommation de sucre et d’aliments transformés, le plaisir bon marché n’a jamais été aussi pervasif, suscité en permanence par une multitude de nouveaux produits et de services, marketés comme autant de conditions sine qua non au bonheur.
Plaisir, bonheur : ces deux mots sont au centre de The Hacking of the American Mind (Penguin, 2017, non traduit), le dernier livre du pédiatre et neuroendocrinologue américain Robert Lustig, tout juste paru aux Etats-Unis. Célèbre pour ses travaux académiques sur le sucre – détaillés dans un ouvrage qui vient d’être traduit (Sucre, l’amère vérité, Thierry Souccar éditions, 400 pages, 19,90 €) –, le professeur de l’université de Californie à San Francisco (Etats-Unis) y expose une réflexion scientifique saisissante, aux implications majeures pour la société occidentale.
Non seulement le bonheur n’est pas la conséquence naturelle de l’accumulation du plaisir, explique-t-il, mais la recherche effrénée de celui-ci pourrait au contraire inhiber le sentiment de plénitude et de contentement.
Robert Lustig exploite la littérature scientifique récente sans faire mystère de la difficulté à, parfois, établir avec certitude certains liens de causalité entre des comportements et certaines réactions biochimiques. Mais il n’en développe pas moins un argumentaire révélant l’un des plus graves malentendus de notre temps, en montrant que le plaisir peut être l’ennemi du bonheur. Entretien.
Pour de nombreuses personnes, la recherche du plaisir est un préalable au bonheur, ou l’une de ses conditions. Pourquoi penser que bonheur et plaisir sont à ce point différents ?
Le bonheur et le plaisir ne sont en effet pas identiques. Ce sont des phénomènes distincts, très dissemblables, et si nous ne le percevons pas, c’est essentiellement parce que l’industrie vend ses produits ou ses services en faisant passer l’un pour l’autre. Je compte sept grandes différences entre les deux, que chacun peut comprendre aisément.
Le plaisir est de courte durée, le bonheur de longue durée ; le plaisir est viscéral, le bonheur est spirituel ; le plaisir s’obtient en prenant, le bonheur a plutôt à voir avec donner ; le plaisir peut s’obtenir seul, le bonheur est généralement atteint au sein d’un groupe social ; le plaisir peut s’obtenir grâce à des substances, mais ce n’est pas le cas du bonheur. Le plaisir extrême peut conduire à l’addiction – c’est par exemple le cas pour l’alcool, la cocaïne, la nicotine et d’une manière générale pour les comportements susceptibles de procurer un plaisir immédiat comme l’utilisation des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, le shopping, le jeu, la pornographie… Pour tout cela, il existe une forme d’addiction, mais il n’y a rien qui ressemble à une addiction au bonheur.
Enfin, la septième et dernière différence est que plaisir et bonheur dépendent de deux neurotransmetteurs distincts : dopamine pour le plaisir, sérotonine pour le bonheur. Le plaisir et le bonheur sont localisés dans deux sites distincts du cerveau, mobilisent deux modes d’action différents, deux types de récepteurs différents…
Pourquoi la dopamine peut-elle conduire à l’addiction ?
Pour comprendre, il faut savoir qu’un neurotransmetteur, une fois qu’il a été libéré par un neurone, franchit la synapse et se fixe sur un récepteur du neurone suivant. Là, il peut agir de deux façons : soit il excite le neurone qui le reçoit, soit il l’inhibe.
La dopamine est un neurotransmetteur exclusivement « excitateur ». Bien sûr les neurones sont faits pour être excités – et c’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont des récepteurs ! Mais ils aiment être chatouillés, pas brutalisés : lorsqu’un neurotransmetteur excitateur est fourni à des hautes doses chroniques, il devient neurotoxique.
Lorsqu’un neurone est chroniquement sur-stimulé, il a donc tendance à mourir. La dopamine, à des hautes doses chroniques, tue les neurones post-synaptiques – c’est le nom qu’on donne aux neurones qui reçoivent l’information. Mais ceux-ci, pour éviter de mourir, peuvent aussi activer un mécanisme d’autodéfense en régulant leurs récepteurs. En gros, lorsqu’un neurone se trouve sous les assauts constants d’un neurotransmetteur, il peut « éteindre » certains de ses récepteurs pour atténuer son excitation et éviter la mort.
Du coup, pour produire le même effet, il faut une quantité supérieure de neurotransmetteurs. C’est un mécanisme universel, appelé « tolérance », qui est propre à de nombreux types de cellules et pas uniquement aux neurones. Dans le cas particulier de la dopamine, en termes humains, cela signifie qu’il faut toujours plus de ce qui procure du plaisir pour obtenir la même satisfaction. Il en faut toujours plus pour produire le même effet. C’est ainsi que le plaisir intense et chronique conduit à l’addiction.
Mettre sur un même plan tout ce qui procure du plaisir – le sexe, l’alcool, le shopping, le sucre ou les réseaux sociaux – est plutôt contre-intuitif…
Toutes ces activités provoquent en effet des sensations différentes, parce qu’elles passent par des voies différentes. C’est pour cela que nous ne faisons pas le lien. Mais le cerveau, lui, ne s’y trompe pas. Il les interprète et les comprend de la même manière, comme une « récompense ». Or la clé du « circuit de la récompense », c’est la dopamine. C’est un mécanisme fondamental, essentiel à la survie de notre espèce : il est impliqué dans la motivation, le moteur de nos actions.
Le titre de mon livre fait référence au « piratage » [hacking en anglais] de notre esprit : c’est précisément ce mécanisme de la récompense qui a été « piraté » par les industriels, pour induire toujours plus de consommation… le tout en organisant, grâce au marketing, la confusion entre plaisir et bonheur (happiness en anglais). Il suffit de lire les slogans publicitaires : « Happy Meal » pour McDonald’s, « Open Happiness » pour Coca-Cola, « Happy Hour » lorsque vous entrez dans un bar…
Mais en quoi tout cela peut-il entraver l’accès au bonheur ?
Le neurotransmetteur impliqué dans le sentiment de plénitude et de contentement, la sérotonine, a un fonctionnement beaucoup plus complexe que la dopamine. Néanmoins, il est possible de mettre en avant un certain nombre de mécanismes par lesquels le niveau de sérotonine dans le cerveau est susceptible de baisser.
Par exemple, la synthèse de sérotonine ne se fait, dans les tissus cérébraux, qu’à partir d’une brique élémentaire, un acide aminé appelé tryptophane. Or deux autres acides aminés, la tyrosine et la phénylalanine, sont les briques élémentaires de la dopamine et sont en compétition avec le tryptophane pour être, eux aussi, transportés dans le cerveau.
Pour schématiser : plus les transporteurs d’acides aminés sont occupés à amener les briques élémentaires de la dopamine dans le cerveau, moins ils sont disponibles pour y acheminer le tryptophane… Il y a donc là une sorte d’antagonisme biochimique potentiel entre dopamine et sérotonine.
Il y a d’autres voies de réduction potentielle de la sérotonine. Par exemple, lorsque vous avez une interaction sociale avec quelqu’un, l’échange de regards avec cette personne active vos neurones dits « miroirs » – les neurones de l’empathie. Ce type d’interaction induit la synthèse de sérotonine. Mais si cette interaction se fait par le biais d’un réseau social comme Facebook, à travers les « likes » par exemple, elle active le circuit de la récompense, mais l’absence de contact visuel laisse les neurones miroirs de marbre… D’où, là encore, une baisse potentielle des niveaux de sérotonine et une moindre capacité au contentement.
D’autres phénomènes conduisent-ils à une baisse de la sérotonine ?
Oui. C’est en particulier le cas du stress chronique, associé à l’omniprésence de certaines technologies, en particulier le téléphone… Le stress se manifeste par la libération de cortisol. Cette hormone est nécessaire mais lorsque les niveaux de cortisol sont élevés en permanence, le fonctionnement du cortex préfrontal est inhibé.
Or il s’agit de la zone du cerveau qui vous permet de faire des arbitrages et des choix raisonnés. En gros, c’est ce qui vous empêche de faire n’importe quoi… En situation de stress, vous êtes ainsi plus enclin à céder face à la tentation du plaisir et vous êtes plus vulnérable à l’addiction. Attention toutefois : l’addiction et la dépression ne sont pas identiques. Des personnes souffrant de dépression ne souffrent pas nécessairement d’addiction, mais disons qu’il y a une forte superposition entre ces deux phénomènes. Il est fréquent que les personnes souffrant d’addiction soient déprimées.
En outre, des expériences sur les animaux ont montré que le niveau de cortisol baisse lorsqu’on s’élève dans la hiérarchie d’un groupe. Plus vous êtes au bas de l’échelle, plus vous êtes stressé. Des recherches indiquent que chez des singes auxquels on laisse la possibilité de s’autoadministrer de la cocaïne, les individus hiérarchiquement inférieurs deviennent plus probablement accros que les mâles « alpha ».
On retrouve des indices de cela dans les populations humaines : ce sont généralement les plus pauvres qui souffrent le plus des maladies chroniques associées à certaines addictions alimentaires (obésité, diabète de type 2…). Stress chronique et dopamine : voilà ce qui a le plus changé dans les sociétés modernes au cours des quarante dernières années.
Vous avez surtout travaillé jusqu’à présent sur l’alimentation et le sucre, pourquoi vous êtes vous penché sur cette question, bien plus vaste, des liens entre plaisir et bonheur ?
J’ai commencé à travailler il y a longtemps sur les liens entre sérotonine et dopamine. C’était au début de ma carrière et il y avait surtout des données animales. Le temps a passé, j’ai beaucoup travaillé sur le sucre et les addictions alimentaires, et j’ai vite réalisé que nous avions aujourd’hui autant, sinon plus, de données sur le lien entre le régime alimentaire et la santé mentale qu’entre le régime alimentaire et la santé physique ! Mais il fallait remettre ensemble toutes les pièces du puzzle.
Et puis, en 2014, j’ai visité les installations d’une université et la personne qui organisait la visite était une ancienne héroïnomane. Elle avait arrêté. Je lui ai demandé ce que cela voulait dire, pour elle, d’être clean. Elle m’a fait une réponse que je n’oublierai jamais tant c’était étonnant. Elle m’a dit : « Quand je me droguais j’étais heureuse, mais ma nouvelle vie me donne du plaisir. » Elle avait tout faux. Dans son esprit, tout était inversé. Elle confondait le plaisir avec le bonheur, et le bonheur avec le plaisir. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait écrire ce livre.






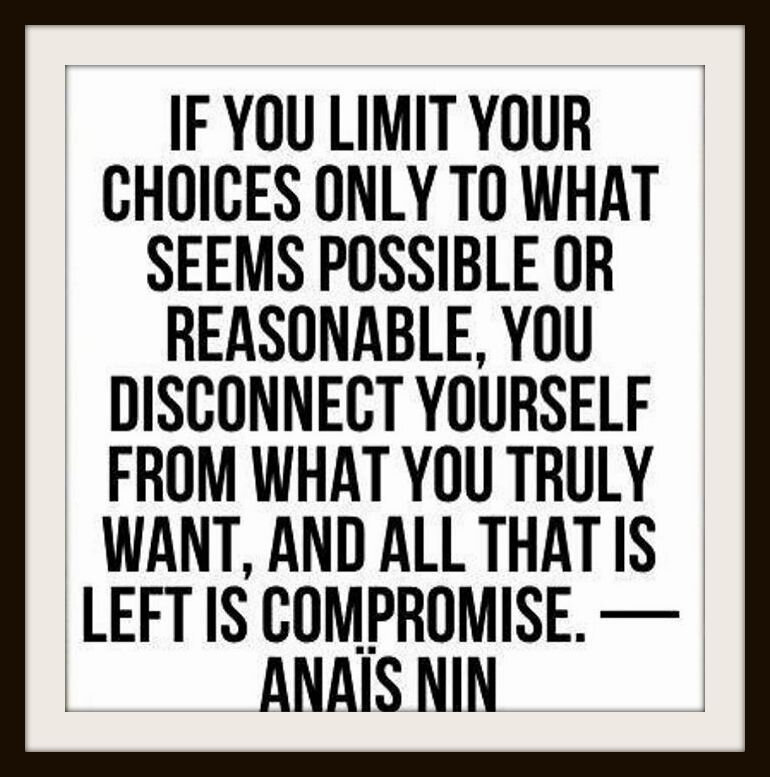
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)