Steven Spielberg : « La liberté de la presse n’a jamais été aussi menacée »
Par Propos recueillis par Samuel Blumenfeld - Le Monde
« Les femmes ont désormais trouvé leur voix », assure le réalisateur américain dont le film, « Pentagon Papers », met en lumière le rôle d’une femme, Katharine Graham, qui prend la décision de publier ces documents dans le « Washington Post ».
Avant la sortie française de Pentagon Papers, le 24 janvier, le réalisateur américain revient sur l’urgence qu’il a ressentie à faire ce film dans un contexte de multiplication des « fake news ». Il juge que son pays n’a jamais été aussi divisé et qu’il n’existe pas le « moindre espace commun, et donc plus de moyen d’avoir un débat ».
Les « Pentagon Papers » ont fait l’objet d’articles publiés en 1971 par le « New York Times » et le « Washington Post ». Vous souvenez-vous de cette époque ?
Je me souviens de tout, mais pas des « Pentagon Papers ». Je ne communiquais pas avec le monde extérieur. J’ai un souvenir plus clair du Watergate, en 1974, car il avait contraint Richard Nixon à quitter la Maison Blanche. J’étais occupé au moment des « Pentagon Papers » par deux séries télévisées, Columbo et Night Gallery. Ma carrière m’obsédait, je cherchais à réaliser mon premier long-métrage. Je ne regardais pas les informations, je ne lisais aucun journal. Je suis sorti de ma torpeur quand j’ai appris que des amis de l’université avaient perdu la vie au Vietnam. Puis l’affaire du Watergate a éclaté. Tout a changé pour moi.
Le centre de gravité de votre film est aussi dans le personnage de la dirigeante du « Washington Post », Katharine Graham, qui prend la décision de publier ces documents…
Avec le recul, cette histoire me fascine, tant elle pose la question du leadership. Nous parlons ici d’une femme, Katharine Graham, devenue patronne du Washington Post à la suite d’un concours de circonstances. Elle avait hérité du journal par son père, et confié la direction à son mari. Après le suicide de ce dernier, en 1963, elle avait pris les rênes du journal. Katharine Graham élevait ses enfants, pensait que sa place était à côté d’eux, pas à la tête de son journal. Nous parlons d’une époque où le leadership était masculin. Vous regardez le conseil d’administration du Washington Post, uniquement des hommes, qui se demandaient même s’il était nécessaire d’accorder la parole à la patronne de ce journal. Et elle se trouve dans une situation où sa prise de décision détermine l’avenir de son journal !
D’ailleurs, sans cette décision et sans la publication des « Pentagon Papers », le Washington Post ne serait jamais devenu le journal qu’il est aujourd’hui. On voit mal comment Katharine Graham et Ben Bradlee [directeur de la rédaction du Washington Post à l’époque] auraient laissé Bob Woodward et Carl Bernstein enquêter aussi longtemps sur un cambriolage dans les locaux du Parti démocrate à Washington, qui mènera au scandale du Watergate. Maintenant, ce qui me frappe, ce sont les analogies que l’on pourrait dresser entre 1971 et 2017, les éléments d’une possible tragédie sont déjà là. Quand j’ai reçu le scénario de Pentagon Papers, en février 2017, il m’est tout de suite apparu qu’il fallait réaliser ce film tout de suite.
Pourquoi était-il aussi important de réaliser un film sur la liberté de la presse aujourd’hui ?
Car elle n’a jamais été aussi menacée. Notre presse, de plus en plus remise en question, dont les informations et les enquêtes se trouvent relativisées, doit se battre dans un environnement qui nuit à la crédibilité de son travail. C’est l’ère des « fake news ». Jamais, à ma connaissance, un tel écran de fumée n’a été posé entre le public et la presse. C’est d’abord une question de vocabulaire. Que signifie l’expression alternative facts ? Y aurait-il une autre vérité à côté de la vérité, et donc, deux réalités parallèles ? C’est fou. C’est tout à fait nouveau pour moi, et je ne suis pas tombé de la dernière pluie.
Alors, retourner en 1971, pour raconter cet épisode où Nixon a usé de ses droits constitutionnels pour traîner un journal en justice – en somme, mettre au pas le quatrième pouvoir –, et donc limiter les libertés individuelles, ne signifiait pas seulement mettre en scène une page d’histoire. Il y a une scène dans mon film où Nixon dit : « Le New York Times est notre ennemi, je pense que nous devons y aller. » Ce qui signifie : « Il nous faut demander à John Mitchell, le procureur général, de les traîner devant les tribunaux et fermer leur publication. » Nous parlons d’un système organisé et légal. J’ai d’ailleurs tenu à ce que l’acteur incarnant Nixon s’exprime avec la véritable voix du président. Cette authenticité était indispensable. Aujourd’hui, les attaques de Donald Trump contre la presse sont plus confuses, avec cette expression de « fake news », un nom de code signifiant qu’il n’apprécie pas ce qu’on écrit sur lui. Cet écran de fumée placé sur les journaux m’inquiète davantage que les attaques judiciaires dont la presse était autrefois victime.
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus aux Etats-Unis à l’heure actuelle ?
En dehors d’un possible conflit nucléaire avec la Corée du Nord, je n’ai jamais été aussi frappé par les divisions de mon pays. C’est comme s’il n’existait plus de débat. Notre Chambre des représentants est scindée, ce qui n’est pas nouveau – j’ai d’ailleurs réalisé un film là-dessus, Lincoln, où le vote pour l’abolition de l’esclavage tenait à quelques voix près, après d’intenses négociations –, mais là, aujourd’hui, je n’ai jamais perçu autant de colère ou de ressentiment entre les deux camps. Il n’existe pas le moindre espace commun, et donc plus de moyen d’avoir un débat. Je ne vois pas d’issue.
Avez-vous rencontré les protagonistes de l’affaire des « Pentagon Papers » ?
Oui. Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte, l’analyste qui exfiltre la documentation secrète appartenant au Pentagone. Et Ben Bradlee, qui a été mon voisin pendant quinze ans, dans les Hamptons, là où je passe encore mes étés. C’est très étrange, d’ailleurs. A chaque fois que je lui posais des questions sur le Watergate, il me répondait : « Ne t’emmerde pas, va plutôt voir Les Hommes du président. » Bradlee avait aimé Il faut sauver le soldat Ryan. Il m’a raconté son passé de capitaine dans la marine, sur le torpilleur USS Philip, dans le Pacifique Sud, pendant la seconde guerre mondiale. En près de quatre ans, il a pris un cours de leadership accéléré, sauvant au passage plusieurs centaines de vies.
Cette expérience lui a permis, une fois journaliste, de viser des postes à responsabilité. Il m’expliquait qu’il devait motiver ses équipes sur une enquête, et la poursuite de celle-ci, avec la même vigueur qu’il avait dû exhorter ses soldats à faire face aux attaques des kamikazes. Pour lui, le commandement militaire et la direction d’une rédaction relevaient du même effort. J’ai déjeuné avec Katharine Graham en 1998. C’était étrange. Elle a dû me poser une dizaine de questions, quand moi j’ai pu en placer une. Un réflexe de journaliste, j’imagine. Ce n’est pas du sang qui circulait dans ses veines, mais de l’encre.
« Pentagon Papers » parle aussi de la difficulté pour une femme à s’inscrire dans un univers masculin. Et il sort au moment de l’affaire Weinstein…
Hollywood se trouve à l’épicentre de beaucoup de problèmes. L’épisode Weinstein et ses soubresauts, la question cruciale du harcèlement sexuel, ne se posent pas seulement dans le monde du cinéma, mais partout. J’espère que nous comprenons quand même que ce n’est pas une histoire hollywoodienne.
Avez-vous été surpris par l’ampleur des témoignages ?
Je devrais l’être, mais ne le suis pas. Nous savions tous que ce problème s’inscrivait dans notre horizon, il ne s’agit plus de se voiler la face, c’était là. Les compagnies que j’ai créées, Amblin et DreamWorks, ont toujours eu des femmes à leur tête. Vous pourriez expliquer cela par le fait que j’ai été élevé par une mère à forte personnalité. Je pense tout simplement que les femmes sont en général plus douées pour créer une culture familiale au sein d’une entreprise. Et c’est avec cette culture familiale que je m’exprime le mieux. Franchement, passer trois mois entouré d’hommes, comme ce fut le cas pour Il faut sauver le soldat Ryan, ce n’est pas mon truc.
Il faut donc au moins se réjouir qu’une révolution soit en marche. Je pense que l’instauration d’un code de conduite dans n’importe quelle entreprise est nécessaire. Nos enfants regarderont 2017 comme une année charnière, où ce qui était toléré par la loi du silence n’est plus possible. Les femmes ont désormais trouvé leur voix, et les récits dont nous avons été témoins depuis plusieurs mois auront au moins servi à ces femmes à se poser sans honte en victimes, pour des faits qui se sont produits il y a vingt ans ou il y a cinq minutes, et ces voix ne sont pas près de s’éteindre.
Vous avez lu le scénario de « Pentagon Papers » en février 2017. En novembre, votre film était prêt. C’est un délai inhabituellement court pour une production aussi lourde…
Je n’ai jamais travaillé aussi dur, en raison d’un calendrier aussi resserré. J’ai débloqué mon calendrier, sauf pour assurer la postproduction de mon prochain film, Ready Player One [sortie le 28 mars]. Ce sens de l’urgence m’est indispensable. Je ne deviens inventif que dans le contexte où tout n’est pas préparé. J’apprécie énormément les situations où je ne suis pas en équilibre. Je n’avais jamais réalisé un film comparable à Pentagon Papers, ce n’est pas un genre cinématographique que je maîtrise. Je dormais mal la nuit, j’avais la trouille d’aller sur le tournage le matin.
Lorsque je suis à ce point en panique totale, je trouve enfin des idées. Je n’avais jamais travaillé avec Meryl Streep auparavant, cela m’intimidait. Tom Hanks et Meryl Streep n’avaient jamais partagé l’écran, c’était un souci. Et voici cette histoire, cruciale en son genre, car nous parlons d’un président américain qui voulait mettre à genoux à la fois le New York Times et le Washington Post. C’est lourd. Et il faut rendre cela léger. Pas superficiel. Mais aérien.
Emmanuel Macron, fragile homme fort d’une UE convalescente
Par Cécile Ducourtieux, Bruxelles, bureau européen, Philippe Ricard, Jean-Pierre Stroobants, Bruxelles, bureau européen - Le Monde
Le président français est devenu un interlocuteur incontournable sur la scène européenne, mais sa capacité à convaincre sur de grandes réformes reste à démonter.
« France is back » : c’est indéniable sur la scène internationale, cela l’est aussi au niveau européen, surtout depuis qu’Angela Merkel tente de sauver son poste. Après un sommet avec Theresa May, la veille au sud de Londres, le président de la République Emmanuel Macron devait accueillir la chancelière à l’Elysée vendredi 19 janvier, pour parler de « l’avenir de l’Union européenne ». Quand il s’agissait d’adopter des décisions importantes, en pleine crise grecque ou au plus fort des tensions sur la migration, tout le monde prenait l’avion pour Berlin…
Autre symbole : c’est depuis l’ambassade du Portugal à Paris, que le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem a passé le témoin à Mario Centeno, nouveau président de l’Eurogroupe, vendredi 12 janvier. « Un hasard de calendrier », assure t-on dans l’entourage du ministre portugais des finances, mais un hasard très significatif. Tout comme la visite de Sebastian Kurz à Paris, le même jour. Le jeune chancelier autrichien, venu réitérer ses engagements proeuropéens alors qu’il a formé une coalition avec l’extrême droite, s’est aussi rendu Berlin. Mais cinq jours plus tard.
L’Europe était au cœur du programme du candidat Macron, et il assume aujourd’hui cette responsabilité de nouvel « homme fort » d’une Union toujours divisée et ébranlée par le Brexit. Il a multiplié les interventions – à d’Athènes sur la démocratie européenne, à la Sorbonne pour formuler des dizaines de propositions de réformes –, ou prôné une intégration plus poussée de la zone euro.
« Regardez notre époque, en face (…). Vous n’avez pas le choix ! », lançait t-il, lyrique, depuis la Sorbonne « à tous les dirigeants d’Europe ». Le chef de l’Etat défendait une Europe « à plusieurs vitesses » permettant d’avancer à quelques-uns sans être paralysée par d’autres, tout en plaidant pour le réveil une Union « trop faible, trop lente, trop inefficace ». « Au début il nous a fait un peu peur, témoigne un diplomate bruxellois. On craignait qu’il accentue les divisions, avec l’Est notamment. Mais il est très important qu’il soit là, on avait vraiment besoin que le moteur franco-allemand redémarre. »
Infléchir l’agenda européen
Au-delà des discours, M. Macron a su infléchir l’agenda européen. Si les premières pages du préaccord de coalition en Allemagne sont consacrées à l’Europe, c’est parce qu’il a donné une impulsion décisive à l’idée de relancer la convergence – en panne – entre les économies de la monnaie unique. Ou de les doter d’instruments de stabilisation budgétaire communs en cas de nouvelle crise. Des idées qu’il reste à négocier dans les détails avec Berlin et les autres capitales.
Fin octobre, après un travail de lobbying intense et avec le soutien de la Commission Juncker, le président a réussi à convaincre des pays de l’Est – sauf quatre, dont la Pologne et la Hongrie – d’adopter au conseil une révision de la directive sur le travail détaché. Un accord doit encore être trouvé avec le Parlement européen mais ce passage en force a constitué un premier succès très symbolique.
Ses appels répétés à la naissance d’un embryon de défense européenne, ont aussi payé. Dans ce domaine, il a pu célébrer il y a quelques semaines le projet de « coopération structurée permanente », qui devrait permettre de lancer des programmes communs d’armement, de combler une série de lacunes d’équipement ou de faciliter le lancement d’opérations extérieures. On est encore loin, cependant, des projets présidentiels – une force d’intervention et une doctrine militaire voire un budget communs.
M. Macron a aussi défendu la création d’une taxe sur les géants de l’Internet et une remise à plat de la politique commerciale de l’Union. Mais, là, les résistances sont fortes : le Luxembourg, l’Irlande ou les Pays-Bas freinent sur la fiscalité, soucieux de préserver leur modèle économique. La Suède et les Pays-Bas s’inquiètent aussi de sa demande d’une surveillance des investissements chinois dans l’UE et redoutent le retour de réflexes « protectionnistes ».
Effacement d’autres leaders européens
Les autres dirigeants ne sont donc pas tous prêts à suivre leur jeune collègue, mais ils l’écoutent avec attention. Même son idée de conventions démocratiques, qui suscitait le scepticisme, fait des émules. La Belgique, le Luxembourg ou l’Irlande évoquent des initiatives au printemps. L’attribution à Paris du siège de l’Agence bancaire européenne, même si elle tient beaucoup du hasard (Dublin a perdu au tirage au sort), a aussi renforcé l’impression que la France et ses réseaux étaient à nouveau incontournables.
Emmanuel Macron profite de l’effacement d’autres leaders européens, à commencer par Mme Merkel, victime de l’usure du pouvoir après douze ans aux responsabilités et son revers électoral de septembre 2017. Son approche très « austéritaire » de la crise des dettes souveraines a été mise en cause dans le Sud de la zone euro. Le choix de M. Centeno pour présider l’Eurogroupe, le gouvernement officieux de l’eurozone, est symptomatique de ce rejet. Les positions en matière migratoire de la chancelière, à l’origine d’une controverse sur le dispositif de répartition des demandeurs d’asile au sein de l’UE, ont braqué la plupart des pays d’Europe centrale.
A Londres, la première ministre Theresa May est marginalisée en raison du Brexit. A Rome, le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni est confronté, en vue des législatives du 4 mars, au Mouvement 5 étoiles et au retour de la droite berlusconienne. A Madrid, Mariano Rajoy doit lutter pour préserver l’unité de l’Espagne face aux velléités indépendantistes de la Catalogne. « Macron est devenu influent par défaut ; il remplit le vide, mais cette position ne sera pas facile à maintenir s’il ne se trouve pas des alliés solides, analyse Sébastien Maillard, directeur du laboratoire d’idées Notre Europe-Institut Jacques Delors. Sa capacité à convaincre reste à démontrer, même s’il sait imposer son agenda. »
Ce retour de la France aux avant-postes sera-t-il durable ? M. Macron aura-t-il, entre autres, la capacité de convaincre ses partenaires sur ses réformes de l’eurozone ? Si l’idée d’une capacité budgétaire spécifique fait son chemin, sa proposition d’un ministre des finances pour la zone euro est loin de faire l’unanimité et celle d’un parlement spécifique à l’eurozone paraît enterrée.
Sa « famille » politique européenne
Depuis sa victoire sur la candidate du Front national Marine Le Pen, le chef de l’Etat français surfe sur la menace de l’extrême droite pour mieux promouvoir son slogan d’une « Europe qui protège ». « Si l’extrême droite est là, c’est que nous avons échoué à répondre aux angoisses dont elle se nourrit », lançait-il lors de sa récente rencontre avec M. Kurz. D’où son insistance sur la nécessité d’une politique « humaine mais ferme » dans le domaine de la migration – avec une ambiguïté quant au principe des quotas de réfugiés, défendu par Bruxelles et Berlin.
Un autre test encore de l’influence française sera la capacité de M. Macron à peser sur les futures nominations des dirigeants de la Commission et du Conseil européens, en 2019. Le président n’a toujours pas choisi sa « famille » politique de rattachement au niveau européen, pourtant une nécessité pour avoir son mot à dire.
Rejoindra t-il le groupe des Libéraux et démocrates (ALDE) ou lancera t-il son propre « En Marche » européen, en tentant de siphonner le Parti populaire (PPE, celui de Merkel) et le Parti social-démocrate ? Il pourrait compter sur le soutien des trois premiers ministres libéraux du Benelux mais fera-t-il le poids si l’Italie bascule à droite ? Et saura t-il résister à l’offensive des gouvernements populistes polonais et hongrois qui contestent les valeurs de la démocratie libérale sur lesquelles est fondée l’Union ?
Pour que son président soit totalement crédible, il faudra par ailleurs que la France affiche enfin, et durablement, un déficit public inférieur à 3 % de son PIB (c’est bien parti pour 2017, à confirmer pour 2018). Et si Mme Merkel échoue à former une nouvelle grande coalition avec les sociaux-démocrates, ce qui entraînerait de nouvelles élections, la « fenêtre » pour des réformes d’importance avant les élections européennes de mai 2019 se refermera.
Faux départ pour le nouveau Vélib’ en Ile-de-France
Par Olivier Razemon - Le Monde
Le système de vélos en libre-service, qui devait se déployer à partir du 1er janvier dans Paris et 67 autres communes, rencontre de sérieux dysfonctionnements.
Enrobé noir, bandes blanches parfaitement tracées, bordures de protection, les toutes nouvelles pistes cyclables de Paris sont superbes. Mais en ce début janvier froid et gris, elles demeurent sous-utilisées. Pas seulement à cause de la météo : les abonnés au Vélib’, qui constituent en temps normal 40 % des cyclistes, sont absents.
Le nouveau Vélib’, qui devait se déployer à partir du 1er janvier dans les rues de la capitale et de 67 autres communes d’Ile-de-France, rencontre de sérieux dysfonctionnements. Initialement, 600 stations devaient être installées dans Paris au début de l’année, un nombre ramené à 300 fin 2017 lorsque les premières difficultés ont commencé à se manifester.
Mais le Jour de l’An, seulement 64 stations étaient identifiées sur le site velib-metropole.fr, et certaines n’étaient pas actives : on n’y trouvait aucun vélo… Dix jours plus tard, la situation s’est à peine améliorée. 68 stations étaient opérationnelles le 10 janvier au soir. L’opérateur Smovengo, qui a ravi en avril dernier le marché à JCDecaux, concessionnaire depuis 2007, assure que la mise en place va s’accélérer, avec l’ouverture de « 60 à 80 stations chaque semaine ».
Une ambition mise en doute par le site velib.nocle.fr, qui tient un décompte rigoureux mais non officiel des stations en service. « Pour atteindre le rythme de 80 par semaine, il faudrait 11 ou 12 nouvelles stations par jour (y compris le dimanche) », observe le créateur de cette plateforme, « JonathanMM », un « geek célibataire de 26 ans », comme il se définit sur son compte Twitter.
Compensations aux usagers
Le ratage commence à se voir. L’opposition à la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo s’est engouffrée dans la brèche. Les élus Républicains au Conseil de Paris ont dénoncé « un fiasco », tandis que le groupe UDI-MoDem évoque « la chronique d’une catastrophe annoncée ». Sur Twitter, l’édile elle-même s’est agacée, « en tant que maire de Paris et utilisatrice », de ces dysfonctionnements.
Le 9 janvier, le conseil du Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, qui rassemble les élus des 68 communes, a infligé à Smovengo des pénalités qui serviront à financer des compensations destinées aux usagers. Selon les termes du contrat passé avec l’opérateur, ces sanctions pourraient atteindre, chaque mois, un million d’euros si plus de 200 stations manquent par rapport au stock prévu. Or aujourd’hui, on en est à plus de 500 stations manquantes.
Smovengo, consortium entre la société montpelliéraine Smoove, Mobivia (ex-Norauto) et le groupe espagnol Moventia, justifie les dysfonctionnements de deux manières. Tout d’abord, le raccordement électrique des 45 000 bornettes connaît des ratés. Les nouvelles stations, qui pour la plupart sont installées au même endroit que celles de JCDecaux, ont besoin d’une alimentation puissante. Il ne s’agit pas seulement de faire fonctionner la station, mais de recharger les vélos à assistance électrique, qui constituent un tiers de la flotte.
Le sous-sol parisien étant « suréquipé » en raccordements en tous genres, l’opération « implique une coordination complexe avec les autres opérateurs de réseau (éclairage, signalisation) », ainsi qu’avec Enedis, le réseau de distribution d’électricité, explique le nouveau concessionnaire. Sous couvert d’anonymat, un élu parisien admet que ces travaux « risquent de durer, car le personnel manque pour les réaliser ».
Par ailleurs, Smovengo affirme aujourd’hui subir un retard de six semaines en raison du recours intenté, au printemps 2017, par son prédécesseur, un argument qui n’avait toutefois pas été invoqué avant la fin de l’année dernière.
Toutes les recettes sont bonnes à prendre
A ces délais s’ajoutent de nombreux bugs, dénoncés sur Twitter par des clients. Certains abonnés ont reçu leur nouvelle carte en deux exemplaires, le service téléphonique demeure la plupart du temps indisponible, l’application fonctionne de manière aléatoire sur Android, le temps d’utilisation est parfois mal décompté, et enfin il existe deux sites Internet présentant pratiquement les mêmes informations, velib-metropole.fr et velib2018.com.
Il est vrai que les ambitions des pouvoirs publics sont énormes. Le nouveau Vélib’ doit devenir, selon la formulation en vogue à la mairie de Paris, à la fois « électrique et métropolitain ». La version Decaux fonctionnait à Paris et dans les communes limitrophes, à moins de 1,5 km du périphérique. Mais il s’agit désormais de couvrir un vaste territoire correspondant à une bonne partie des trois départements de la petite couronne et même au-delà, puisque Juvisy-sur-Orge (Essonne) et Argenteuil (Val-d’Oise) ont adhéré au Syndicat mixte.
Cette transition s’accompagne en outre d’un détachement entre le marché du vélo partagé et celui de l’affichage publicitaire, contrairement au modèle qui a prévalu à Paris pendant 10 ans et qui fonctionne toujours à Lyon, Toulouse ou Nantes. Et ce n’est pas tout : les pouvoirs publics espèrent aussi réduire le coût du service pour la collectivité, très élevé en raison des dégradations mais aussi des redevances publicitaires.
Dans ces conditions, toutes les recettes sont bonnes à prendre. Le concessionnaire pourra ainsi baptiser une station du nom d’un annonceur, comme « BHV » pour la station située à proximité du célèbre grand magasin.
« Accident industriel »
Les circonstances de la mise en place du nouveau service suscitent la colère de l’association de cyclistes Paris en selle. Ses responsables parlent d’« accident industriel » et exigent une gratuité du service pendant trois mois. L’association dénonce en outre la tendance des élus à « faire de la com trompeuse », au sujet du Vélib’comme de la progression des aménagements cyclables.
L’omerta du Syndicat mixte agace aussi Mathieu Marquer, qui fut membre entre 2007 et 2009 d’un éphémère comité des usagers, et qui continue de suivre l’actualité du vélo. « On pouvait deviner dès l’automne qu’on n’atteindrait pas les 600 stations au 1er janvier, et pourtant le Syndicat mixte a observé le silence le plus complet pratiquement jusqu’à la veille du lancement », attaque-t-il.
Les déboires du Vélib’ parisien font écho aux difficultés rencontrées par d’autres systèmes de vélo en libre-service, sans même parler de la concurrence du free-floating – services de partage de vélos, de scooters ou de voitures « sans station ». Face à des coûts très élevés et à un nombre d’abonnés désespérément faible, plusieurs villes moyennes ont en effet abandonné leurs vélos partagés ces derniers mois. Perpignan a renoncé à son « Bip ! » fin décembre. A Caen, le V’eol, qui existait depuis 2008, a cédé le 1er janvier la place au Vélolib’, qui propose beaucoup moins de stations.
Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui rassemble 260 associations, juge sévèrement les choix des municipalités. « En France, le vélo en libre-service ne s’est jamais inscrit dans une politique cyclable. Il a fait office de politique cyclable. Si on avait créé des pistes cyclables et des places de stationnement sécurisé, si on avait agi contre le vol et le recel de vélos, les citadins seraient aujourd’hui beaucoup plus enclins à posséder leur propre vélo », estime-t-il. Et les pistes cyclables seraient bien plus utilisées qu’elles ne le sont aujourd’hui.














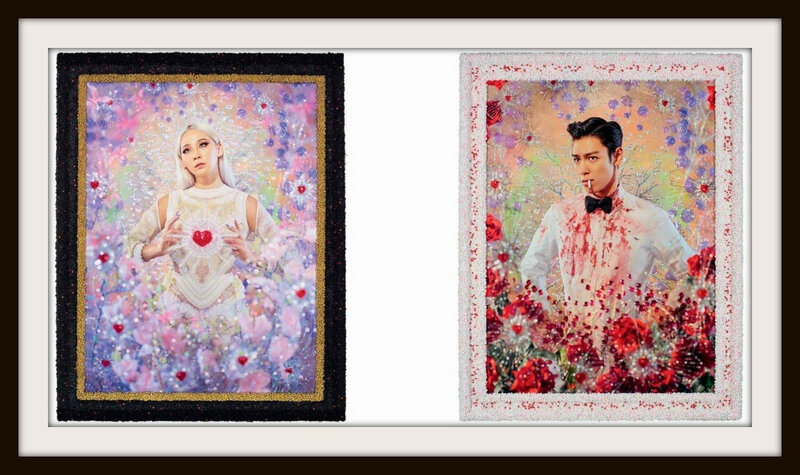


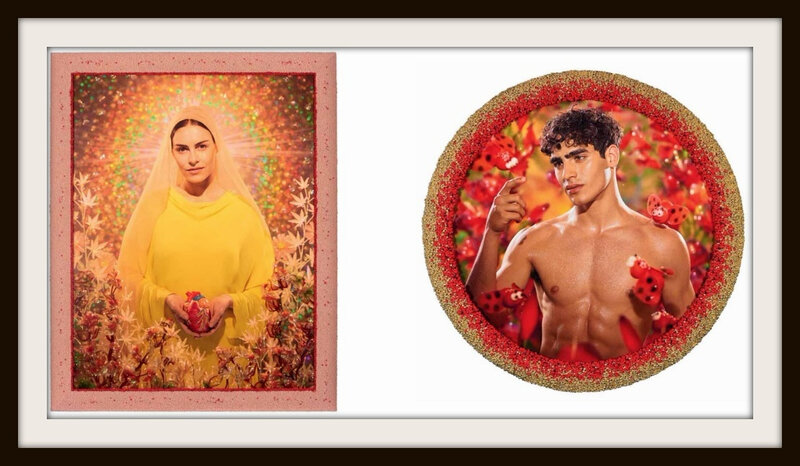








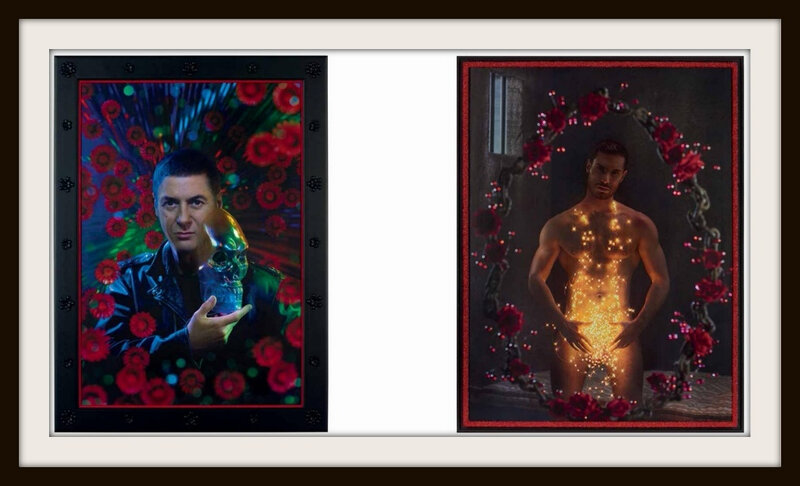

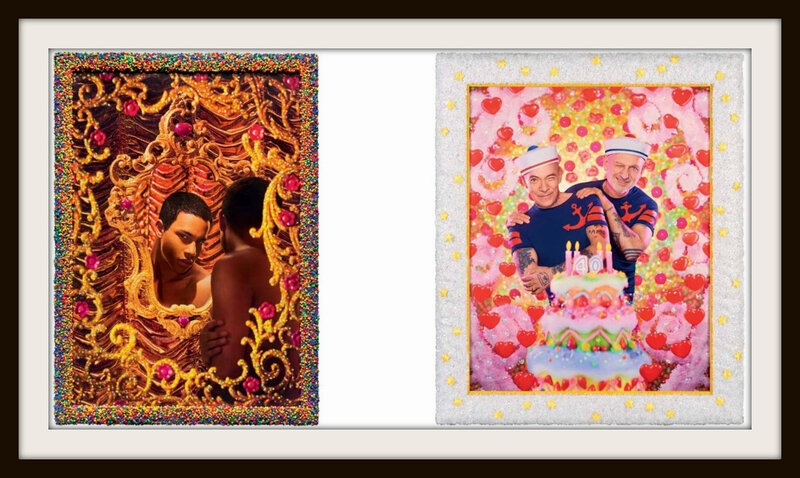
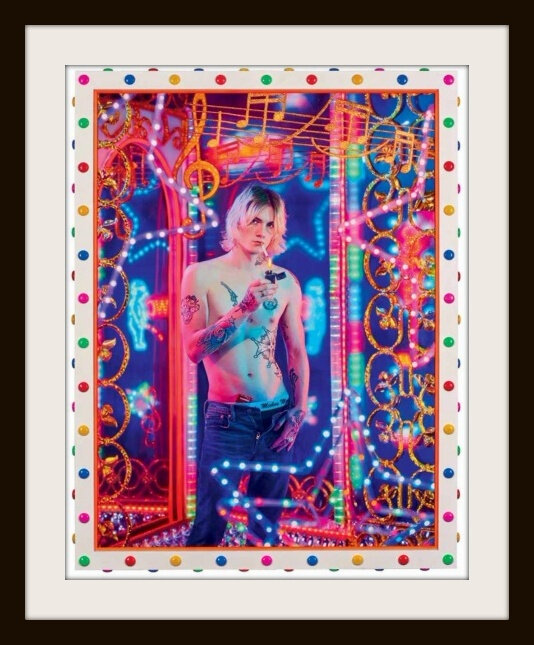











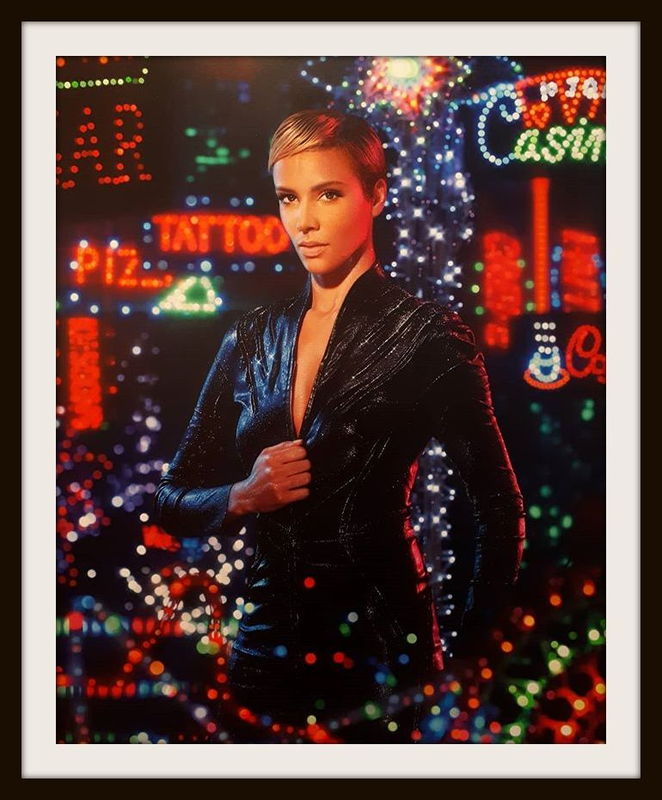













/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)