« Shéhérazade » et « Jusqu’à la garde » triomphent aux Césars
La 44e cérémonie des récompenses du cinéma français s’est déroulée, vendredi, sous les yeux de l’acteur américain Robert Redford.
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, qui traite du sujet des violences conjugales, est le grand vainqueur de la cérémonie des Césars 2019, qui s’est déroulée vendredi 22 février à Paris. Le long-métrage, qui faisait figure de favori avec dix nominations, est reparti avec quatre prix : meilleur film, meilleure actrice pour Léa Drucker, meilleur montage et meilleur scénario.
Le réalisateur a estimé, pendant la soirée, qu’il « serait temps de penser » aux victimes « à un autre jour que le 25 novembre », Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Léa Drucker, très émue, a aussi, appelé à réagir et elle a rendu hommage aux personnes qui sont dans la situation de Miriam – l’héroïne du film – ainsi qu’aux militantes féministes.
Alex Lutz a obtenu quant à lui la récompense du meilleur acteur pour son rôle dans Guy, qu’il a également réalisé et dans lequel il s’est vieilli de trente ans pour incarner une ancienne gloire de la chanson. « Je suis très impressionné (…) chaque volute et chaque cabossage de ce César me font penser à un parcours », a-t-il dit ému en recevant le prix.
Le cinéaste Jacques Audiard, 66 ans, a reçu le César de la meilleure réalisation pour Les Frères Sisters, un western franco-américain avec Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal et John C. Reilly. « Je suis ému (…) J’admire mes confrères et mes consœurs. Si je fais du cinéma, c’est parce que vous en faites », a-t-il déclaré.
« A tous les gens qui galèrent »
Shéhérazade, histoire d’amour à Marseille entre un caïd et une jeune prostituée, a reçu la statuette du meilleur premier film, tandis que ses deux interprètes principaux, Kenza Fortas et Dylan Robert, ont été récompensés par ceux des meilleurs espoirs féminin et masculin. « Je dédie ce film à tous les gens qui galèrent », a lancé le réalisateur, Jean-Bernard Marlin. Pour Shéhérazade, tourné avec des interprètes non professionnels, il a fait huit mois de castings sauvages dans des foyers de la cité phocéenne ou à la sortie des prisons.
Karin Viard a pour sa part reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Les Chatouilles. « Je tenais beaucoup à ce rôle, j’avais vraiment envie de faire partie de cette histoire », a-t-elle expliqué en recevant sa statuette.
A propos de son interprétation d’une mère dure, doutant des abus sexuels subis par son enfant, elle a décrit un « rôle épouvantable de mère si toxique qui condamne sa fille une deuxième fois en ne l’écoutant pas, en ne voulant pas la croire ».
Cinéma « plus indépendant et plus libre »
La 44e cérémonie de récompenses du cinéma français s’est déroulée sous les yeux du comédien et réalisateur américain Robert Redford, qui a reçu un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.
La présidente de la cérémonie, la Britannique Kristin Scott Thomas a, elle, rendu un hommage : « Vous m’avez permis, moi, étrangère, de devenir actrice (…). Vive le cinéma français. » « J’ai bien l’intention de continuer à vos côtés, oui, même avec ce Brexit », a-t-elle par ailleurs plaisanté.
« Tous ici nous aimons ce cinéma-là, un cinéma plus indépendant et plus libre que partout ailleurs, des films courageux, ambitieux, inattendus (…). vous pouvez être fiers de la diversité de vos productions. Il est vrai que je crains d’être retenue à la frontière avec ma panse de brebis farcie, mes stocks de jelly et mes disques d’Elton John, mais ce soir je suis là. »
Le palmarès complet
Meilleur film
Jusqu’à la garde
Meilleur réalisation
Jacques Audiard, pour Les frères Sisters
Meilleure actrice
Léa Drucker dans Jusqu’à la garde
Meilleur acteur
Alex Lutz, dans Guy
Meilleure actrice dans un second rôle
Karin Viard dans Les Chatouilles
Meilleur acteur dans un second rôle
Philippe Katerine dans Le Grand Bain
Meilleur scénario original
Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand
Meilleur premier film
Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin
Meilleur espoir féminin
Kenza Fortas pour Shéhérazade
Meilleur espoir masculin
Dylan Robert dans Shéhérazade
Meilleur documentaire
Ni juge, ni soumise, de Jean Libon et Yves Hinant
Meilleur film étranger
Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda
Meilleure adaptation
Andréa Bescond, Eric Métayer pour Les Chatouilles
Meilleur film d’animation long-métrage
Dilili à Paris, réalisé par Michel Ocelot et produit par Christophe Rossignon et Philip Boëffard
Meilleur film d’animation court-métrage
Vilaine fille, du réalisateur Ayce Kartal
Meilleurs costumes
Pierre-Jean Larroque pour Mademoiselle de Joncquières
Meilleurs décors
Michel Barthélémy pour Les Frères Sisters
Meilleur montage
Yorgos Lamprinos pour Jusqu’à la garde
Meilleur musique originale
Vincent Blanchard, Romain Greffe pour Guy
Meilleur son
Brigitte Taillandier, Valérie De Loof et Cyril Holtz pour Les Frères Sisters
Meilleure photographie
Benoît Debie pour Les Frères Sisters
A la frontière entre le Brésil et le Venezuela, l’angoisse de l’affrontement
WATCH: Venezuelan troops try to block a convoy headed to the Colombian border to collect humanitarian aid. pic.twitter.com/fU6M8JQp5x
— NBC News (@NBCNews) 21 février 2019
Al menos dos muertos y 15 heridos de bala dejó este viernes el ataque perpetrado por un grupo de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra manifestantes de la etnia indígena pemón.
— El Estímulo (@elestimulo) 22 février 2019
Nota completa: https://t.co/g5jJiWZLvu pic.twitter.com/klEn2wLC43
Par Claire Gatinois, Pacaraima, Brésil, envoyée spéciale
Alors que l’aide humanitaire promise par l’opposant Juan Guaido doit être acheminée samedi, les militaires fidèles à Maduro restent postés debout à la frontière.
Il était un peu plus de midi quand Margarita (le nom a été modifié), 71 ans, a franchi la frontière. Arpentant à pied les montagnes, le cœur battant la chamade, l’élégante vieille dame munie d’une petite valise emmagasinant toute sa vie, a défié le président Nicolas Maduro. Un « dictateur » qu’elle attend désormais de voir « tomber ». « Je veux que le Venezuela redevienne ce qu’il était », dit-elle.
Ce vendredi 22 février, dans un petit café de Pacaraima, ville brésilienne à la frontière avec le Venezuela, la septuagénaire se remet avec peine de son audace. A un âge où elle ne devrait plus se préoccuper que de ses petits-enfants, la voici clandestine, affolée à l’idée d’être ramenée dans son pays. Ou pire encore.
Depuis la veille au soir, le président du Venezuela a ordonné la fermeture de la frontière et de l’espace aérien du pays. Les Vénézueliens comme Margarita, fuyant la misère et la faim, n’ont eu d’autre choix que de prendre des chemins de traverse avant que la situation n’empire.
Deux morts, une quinzaine de blessés
Dans quelques heures, samedi 23 février, doivent arriver à Pacaraima les camions chargés de 200 tonnes de vivres et de médicaments venus des Etats-Unis qui tenteront de traverser une frontière désormais verrouillée. Une « guerre humanitaire », comme la qualifie le Brésil, censée faire plier les soutiens militaires de Nicolas Maduro et permettre à son opposant, Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale et chef d’Etat autoproclamé, soutenu par une vingtaine de pays européens, dont la France, d’accéder au pouvoir.
A vingt-quatre heures du coup d’envoi, les militaires postés à la frontière, debout derrière leur bouclier semblent toujours jurer fidélité au dirigeant Maduro qui se prétend l’héritier de la révolution bolivarienne. A 70 kilomètres de là, côté vénézuélien, à Kumarakapay des affrontements avec les forces de l’ordre ont tourné au massacre.
Deux personnes, sans doute des Pemons (indigènes), ont été tuées, une quinzaine d’autres sont blessées ; certaines sont dans un état grave. Ces Vénézueliens auraient subi des tirs de balles réelles en s’opposant aux barrages des soldats afin de laisser l’aide humanitaire entrer dans le pays. « Les militaires font aussi partie du peuple ! », se désole Marcel Perez. L’œil cabossé, le jeune homme faisait partie de la troupe attaquée.
Pour seule réponse, Nicolas Maduro a renforcé son soutien aux forces de l’ordre. « Morale maximale, cohésion maximale, action maximale. Nous vaincrons », a-t-il écrit sur Twitter.
Les morts, puis les propos belliqueux ont plongé Pacaraima dans l’angoisse. « La vengeance est inhérente à la culture des Pemons, on est en droit de craindre des représailles et une escalade », soupire le père Jesus, à la tête de la paroisse de Pacaraima. Arrivé il y a neuf ans dans cette petite ville sans charme, le prêtre a vu progressivement débarquer ces Vénézuéliens fuyant la misère et la faim considérant le lieu comme un « paradis ». Il a également assisté à la montée de la haine et de la xénophobie de la part de Brésiliens d’ordinaire si accueillants.
Cellule de crise à Brasilia
Venu à Pacaraima dans la matinée, le député Antonio Carlos Nicoletti du Parti social libéral (PSL), qui est aussi celui du président Jair Bolsonaro, s’est montré préoccupé face aux risques de dérives. Assurant s’être entretenu avec le chef de l’Etat le mercredi précédent, le parlementaire promet que rien ne sera fait qui puisse nuire aux intérêts des Brésiliens. L’Etat du Roraima dépend de l’énergie achetée au Venezuela. Et la station de combustible qui alimente la ville de Pacaraima, est aux mains des Vénézuéliens.
Alerté par la montée des tensions, le gouvernement a convoqué une cellule de crise à Brasilia avec le président Jair Bolsonaro. Sans renoncer à l’opération, le pays a prévenu que son action s’arrêterait à la frontière. Dit autrement à aucun moment le Brésil ne remettra en cause la souveraineté vénézuélienne pour forcer le passage de l’aide humanitaire, laissant les opposants ou les pro-Maduro, décider du cours des événements.
Une position prudente, souhaitée par les militaires en position de force dans le gouvernement. Et plus nuancée que celle qu’aurait défendu initialement Ernesto Araujo, le ministre des affaires étrangères, admirateur du président des Etats-Unis Donald Trump.
Allaitant son fils de deux ans à même le sol, Ariannis Esperalta, 20 ans, qui a traversé la frontière lundi, se fiche, elle, de savoir si l’opération humanitaire tournera à l’affrontement. Seul lui importe de savoir que Maduro quittera le pouvoir. « Qu’il s’en aille », supplie-t-elle.
Au Venezuela, où le taux d’inflation dépasse un million de pourcents, un salaire minimum ne suffit plus à acheter un poulet ou un kilo de fromage.
In memorem : Sophie et Hans Scholl
Il y a 76 ans, Sophie et Hans Scholl, du mouvement de résistance "La Rose blanche", étaient exécutés à Munich.
— Frédéric Sallée (@fred_sallee) 22 février 2019
Ils avaient respectivement 21 et 24 ans. pic.twitter.com/nRyVRxQy54
Comme le reste des jeunes Allemands, elle est embrigadée dans les jeunesses hitlériennes. Elle y ressent très tôt la restriction des libertés, en particulier de pensée et de religion. Chrétienne, elle est comme son frère profondément croyante1. Après le bac en 1940, elle devient garde d’enfants. Dans les « services du travail » et « service auxiliaire » qu'elle effectue en 1940-41 à Krauchenwies, elle parvient à garder, malgré l'interdiction de posséder des livres, les Confessions de saint Augustin ; elle garde en mémoire cette phrase : « Tu nous as créés pour que nous allions à Toi, et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il repose en Toi. » Elle entame ensuite des études de biologie et de philosophie en mai 1942 à Munich. Influencée par son éducation protestante, par l'opposition déclarée de son père Robert Scholl au nazisme, et par l’expérience vécue par son frère, militaire étudiant en médecine à Munich, puis infirmier dans les hôpitaux du front de l’Est, qui est témoin de la barbarie de l'armée à l'encontre des juifs et des populations russes, elle prend conscience de la vraie nature du régime nazi. À partir de juin 1942, elle tient des réunions avec son frère Hans et Carl Muth. Elle les aide à imprimer et à diffuser les tracts hostiles au régime nazi et à la guerre. Sophie Scholl distribue également des tracts dans la rue, glissant des feuillets sur les voitures en stationnement et elle effectue quelques voyages à travers le pays pour promouvoir les idées de la Rose blanche auprès d'étudiants sympathisants.
Le 18 février 1943, après avoir lancé avec son frère Hans des tracts dans la cour intérieure de l'université de Munich, elle est repérée par le concierge de l'université, Jakob Schmid. Ils sont remis au rectorat où, après plusieurs heures d'interrogatoire par l'inspecteur Robert Mohr, le doyen et le président de l'université, ils sont remis à la Gestapo. Conduite devant le « Volksgerichtshof » (« Tribunal du peuple »), elle est condamnée à mort après un procès mené en trois heures seulement. C'est Roland Freisler lui-même, le chef du Tribunal du peuple, venu spécialement de Berlin, qui annonce la sentence pour faits de « haute trahison, propagande subversive, complicité avec l'ennemi et démoralisation des forces militaires ». Elle sera guillotinée le jour même le 22 février 1943 à Munich à la prison de Stadelheim par le bourreau Johann Reichhart4, et cela malgré la législation allemande qui imposait un délai de 99 jours avant l'exécution d'un condamné. Selon le témoignage des gardiens de la prison, elle fait preuve de beaucoup de courage lors de son exécution.
Elle est ensuite enterrée dans le cimetière proche de la forêt de Perlach, aux côtés de son frère Hans et de Christoph Probst, exécutés le même jour.
Au Venezuela, le système sanitaire s’est effondré, « plus rien ne marche »
Par Jean-Pierre Bricoure, Caracas, correspondance
Ce secteur est devenu la face la plus douloureuse de la crise que traverse le pays. Au point d’être au cœur de la polémique sur l’aide d’urgence promise pour le 23 février par l’opposant Juan Guaido.
Dans une ruelle de Caracas, près du centre-ville historique et ses quelques rares magasins encore ouverts, l’endroit tient de la forteresse moderne. Derrière les grilles, l’entrée est gardée par un militaire en uniforme, l’arme à la main et le regard dilettante sur un hall entièrement vide. Devant la sortie, à l’autre bout de cet hôpital pédiatrique JM de Los Rios, le plus grand des quatre établissements pour enfants de la capitale vénézuélienne, un autre soldat est assis aux côtés d’un membre de la milice bolivarienne, ce corps spécial créé par le gouvernement et armé par les militaires.
Ici, chaque visiteur doit montrer patte blanche avant de quitter l’hôpital. Officiellement pour éviter les vols de médicaments et d’équipements. « Une aberration », souffle Laura, infirmière trentenaire, officiant depuis plusieurs années dans l’établissement et qui ne dira pas son vrai nom par peur de représailles : « C’est simple, nous manquons de tout, il n’y a plus rien, ni antibiotiques, ni ustensiles. Les gardes sont là dans tous les centres hospitaliers pour nous montrer que le pouvoir continue à contrôler la situation, et surtout pour éviter les fouineurs et les journalistes. »
En 2016, déjà, le New York Times avait publié un long reportage sur l’état catastrophique du système de santé au Venezuela. Il pointait l’indigence, l’état de délabrement et la situation catastrophique des soins dans plusieurs établissements de la capitale, la ville de Mérida et sur le littoral. Le papier rappelait comment la crise économique avait provoqué une situation d’urgence sanitaire où le taux de mortalité des jeunes mères était multiplié par cinq. L’article, illustré par des photos bouleversantes et amplement partagé sur les réseaux sociaux, avait provoqué un choc national. « Nous savions que la situation était désastreuse, que des enfants mourraient de dénutrition et d’autres par manque de personnel médical, mais pas à ce point et de cette manière globale », insiste la soignante.
A l’époque, le président Nicolas Maduro, successeur d’Hugo Chavez, avait écarté d’un revers de la main les critiques. Il affirma que « nulle part ailleurs au monde, excepté à Cuba, il n’existe un meilleur système de santé que le vénézuélien ».
« Le système s’écroulait de l’intérieur »
Depuis, et malgré les dénégations du régime, la situation a empiré. La santé est même devenue la face la plus douloureuse de la crise que traverse le pays. Au point de s’être installée au cœur de la polémique qui secoue le Venezuela ces dernières semaines sur l’aide d’urgence promise pour le 23 février par l’opposant Juan Guaido, président autoproclamé en janvier.
« Le système s’est effondré, plus rien ne marche », affirme le docteur Alejandro Risquez. Médecin pédiatre et épidémiologiste, il est une des voix critiques du système depuis plusieurs années. Reconnu dans le milieu, il a plusieurs fois participé aux réunions avec les représentants étrangers des Nations unies (ONU) pour dresser le diagnostic annuel des services de santé vénézuéliens.
« A partir de 2015, les officiels du régime ont commencé à ne plus divulguer leurs chiffres, affirme-t-il. L’année suivante, ils n’ont donné que le taux de mortalité infantile. Alors qu’il baissait chez nos voisins, il avait augmenté de 30 % au Venezuela. »
Pendant les premières années du régime chaviste, nombreux ont été les spécialistes à reconnaître que la mise en place des programmes gouvernementaux comme les Missions Barrio Dentro, touchant les zones les plus pauvres du pays, ont permis d’obtenir des avancées en matière de santé publique. Avec les accords signés par Fidel Castro, au début des années 2000, environ 35 000 médecins ou aide soignants cubains se sont installés dans les quartiers. Les Missions Barrio Dentro II sont ensuite venues en aide aux cliniques, aux petits dispensaires, les CDI.
« Jusqu’au mitan des années 2010, une époque où les dollars entraient, tout allait apparemment pour le mieux, explique le médecin. Mais la corruption s’est enracinée, et de manière endémique. Au ministère, les militaires ont pris les commandes. Les projets ont commencé à capoter. Des sommes colossales ont été investies dans les hôpitaux, de 2008 à 2013, mais rien n’a marché. En 2012, nous sommes soudainement devenus la risée du monde entier parce que nous n’avions plus de papiers toilettes. C’était un signe que le système s’écroulait de l’intérieur. »
En 2012, une année avant le décès d’Hugo Chavez, le prix du pétrole commence à dévisser. Sous Nicolas Maduro, le baril passe de 120 à 40 dollars, une catastrophe pour le pays qui possède les plus grandes réserves de la planète. C’est la chute. « La machine s’est arrêtée, dit M. Risquez. Soins défaillants, hyperinflation et pénuries : les gens ont fini par ne plus se soigner ou sont partis. Jusqu’en 2015, j’avais entre soixante et cent patients par jour. Ils ne sont plus que trois. »
Corruption, vols, trafics et détournements
Un rapport rédigé en novembre 2018 par Medicos por la Salud, un réseau de médecins qui récolte des données sur la crise sanitaire depuis 2014, est à ce titre cruellement révélateur. Selon l’enquête, la moitié des services de rayons X du pays ne fonctionnent plus, et 18 % ne marchent que par intermittence.
Plus de la moitié des laboratoires sont fermés. Plus de la moitié des hôpitaux ont des pannes électriques, trois-quarts manquent d’eau courante et deux-tiers connaissent des pénuries de médicaments – le chiffre monte à 83 % dans la capitale.
« C’est révoltant d’avoir autant de pétrole enfui sous nos pieds et de voir les gens mourir parce qu’il n’y a plus de médicaments », souffle Castro Mendez, professeur et docteur spécialisé en infectiologie à Caracas. D’après les statistiques de ce spécialiste proche de l’opposition, le pays a enregistré un excédent de décès de 180 000 individus sur dix ans, soit un mort toutes les vingt minutes pour des raisons dites « anormales » (traitement interrompu, dysfonctionnement de machine à dialyse ou respiratoire, absence d’oxygène dans une ambulance, etc.). « On meurt de malaria au Venezuela plus qu’ailleurs, ajoute-t-il. Les cas de tuberculoses et de diphtérie se multiplient. Il n’y a plus de traitement contre la leishmaniose dans tout le pays et que dire des traitements contre le cancer que l’on ne trouve plus que sur le marché noir… »
Corruption, vols, trafics et détournements : les histoires sordides finissent par constituer le lot quotidien le plus banal de ce Venezuela au bord de la consomption. A Barcelone, une ville sur la côte, les autorités ont arrêté le directeur de l’hôpital public parce qu’il a volé les machines respiratoires utilisées pour traiter les personnes aux poumons malades ainsi que des solutions d’intraveineuses pour les revendre. Il y a encore deux mois, raconte de son côté la jeune infirmière Laura, un camion entier de médicaments, envoyé par une fondation, était parvenu jusqu’à l’hôpital JM de Los Rios. Les caisses ont été déchargées. Puis tout a disparu. « Des enfants sont morts pour ça », glisse-t-elle.
Suivre cette jeune femme dans les couloirs de l’hôpital, c’est se laisser dériver sur une mer de souffrance et de solitudes. Ici, seules deux salles d’opération sur neuf sont encore en état de marche. « Et encore, il faut pour cela que les parents des enfants achètent tout, même les gants et le savon, pour l’opération et les traitements. »
Aux étages, les vitres sont cassées, les murs écaillés, les plafonds défoncés. Certains lits n’ont pas de matelas. Les fauteuils sont usés à l’os. Des couloirs entiers sont condamnés. Les quelques rares dessins d’enfants sont impuissants à consoler l’extrême désolation alentour.
Laura dit enregistrer une mort tous les quatre, cinq jours, parfois plus. « Mais les gens ne viennent plus, ils préfèrent mourir chez eux. »
Dans la première chambre, Luiza, 4 ans. Elle est ici depuis un mois avec une infection respiratoire. Elle a attrapé une maladie nosocomiale. Plus loin, dans une autre chambre, José, 3 ans. Il dort seul dans un lit sale, les yeux à moitié ouverts. Il est atteint de macrocéphalie. Opéré une première fois, il attend une deuxième intervention. « Je me souviens d’Ismaël, glisse Laura, il avait attendu un an pour une opération du cœur. »
Bien sûr, la jeune infirmière voudrait que l’aide humanitaire promise par l’opposition arrive au plus vite au Venezuela et ce malgré l’envoi, par Nicolas Maduro, de l’armée à la frontière. Elle sait que cette aide ne représente qu’une goutte d’eau. « Mais elle permettra peut-être de révéler enfin l’ampleur de cette catastrophe. »
Photographie : Luigi Ghirri, arpenteur de mirages
Par Claire Guillot
Le Jeu de paume, à Paris, offre une plongée dans l’œuvre conceptuelle et ludique du photographe et coloriste.
Qui n’a jamais rêvé, enfant, devant les pages ouvertes d’un atlas ? Qui n’a jamais vu dans ces petits points et ces lignes dessinés sur les cartes des promesses d’aventures glorieuses et de grands espaces ? Le photographe Luigi Ghirri, lui, est allé plus loin. Tel Philémon, le personnage de bande dessinée naufragé sur les lettres de l’océan Atlantique devenues des îles, il a plongé dans les pages de son atlas comme s’il s’agissait d’un paysage.
Au Jeu de paume, à Paris, la salle couleur bleu lagon qui abrite sa série de 1973, Atlante, est la plus poétique de l’exposition qui lui est consacrée : en collant au plus près des couleurs et des mots imprimés, l’artiste fait surgir des contrées abstraites, des terres fantomatiques, des ciels nouveaux où le regard se perd.
Pour l’Italien Ghirri, le géomètre devenu photographe mort bien avant l’Internet et le numérique, l’espace virtuel des signes était déjà bien réel. « Tous les voyages possibles ont déjà été décrits et tous les itinéraires tracés…, écrivait-il. Il me semble que le seul voyage aujourd’hui possible se situe dans les signes, les images. »
Entre l’idée et la sensation
Avec ses 250 photos d’époque, l’exposition du Jeu de paume est la première présentation d’envergure consacrée en France à ce photographe atypique, mort en 1992, à 49 ans, après avoir signé une œuvre singulière, entièrement en couleurs, et une somme d’écrits théoriques.
L’artiste est majeur et pourtant méconnu : beaucoup en France ne connaissent que des images un peu décoratives aux couleurs pastel, bords de mer mélancoliques ou cartes postales pop d’une Italie gagnée par la consommation de masse.
Au Jeu de paume, le commissaire James Lingwood a voulu rectifier le tir et se concentrer sur les photos des années 1970, ces « années formatrices » selon lui, où Luigi Ghirri met en place son vocabulaire conceptuel et sériel. Dès ses débuts, on le voit déployer son approche unique, entre l’idée et la sensation. A savoir des travaux très méthodiques – il photographie obstinément le ciel pendant trois cent soixante-cinq jours pour sa série Infinito –, mais aussi des embardées poétiques pleines de clins d’œil et d’humour, témoins d’une Italie en pleine transformation.
POUR LUI, LA PHOTO N’EST LÀ NI POUR CONSOLER NI POUR TRANSFORMER MAIS POUR DÉCRYPTER LE MONDE ET LA SOCIÉTÉ
Alors que, dans les années 1970, la photographie artistique se partage entre les héritiers de l’instant décisif à la Cartier-Bresson et les tenants d’une photographie plus intimiste, dite « créative », Ghirri ne se reconnaît ni dans l’un ni dans l’autre. « Je n’ai pas accepté l’idée que le hasard, transformé en professionnalisme, puisse être la structure édifiante de mon travail de photographe », écrit-il.
Il refuse aussi toute idée de « signature » : « La croyance qu’un auteur se reconnaît parce qu’il appose un copyright visuel sur le monde extérieur est le plus grand danger que court la photographie. » Pour lui, la photo n’est là ni pour consoler ni pour transformer mais pour décrypter le monde et la société : il opte pour un style direct, pour des « prises de vue frontales » au plus près de l’expérience, et ne se reconnaît d’affinités qu’avec le photographe Walker Evans, l’Américain inventeur du « style documentaire », explorateur comme lui des signes vernaculaires.
Ses autres influences seraient plutôt à chercher hors de la photographie, du côté d’artistes qui, comme Ed Ruscha, ont utilisé l’image pour archiver la banalité du monde. Luigi Ghirri néglige le noir et blanc, « puisque le monde est en couleurs », et se rapproche de la pratique amateur avec le Kodachrome – titre de son célèbre livre-manifeste paru en 1978. Mais contrairement aux coloristes américains comme Stephen Shore ou William Eggleston, il choisit des teintes douces, ambiguës, ni pop ni clinquantes.
Un monde d’artifices
Armé de son appareil, Luigi Ghirri dresse un inventaire du monde contemporain tel qu’il est bouleversé par l’irruption de l’image, partout et par tous. Il écrit : « Dans une large mesure, la réalité devient toujours davantage une colossale photographie et le photomontage est déjà là : c’est le monde réel. » Les posters, les publicités, les affiches, les enseignes, les papiers peints sont son terrain de jeu.
Ghirri creuse les limites de la représentation, il utilise ses images des clés et des guides pour décoder tous ces signes. Dans la série Diaframma 11, 1/125, luce naturale, le photographe suit des gens de dos, plongés dans des cartes, absorbés dans des panoramas, en train de se photographier, devenant tour à tour spectateurs, voyeurs, modèles, sujets et acteurs de l’image en train de se créer, nous entraînant dans ce jeu de rôle par la même occasion. Luigi Ghirri aime à dessiner des cadres dans le réel, multipliant les jeux sur l’échelle, les reflets, les quiproquos visuels.
SUR CE MONDE FAIT D’ARTIFICES ET D’ARTEFACTS, JAMAIS LE PHOTOGRAPHE NE POSE UN REGARD DÉSENCHANTÉ OU DÉNONCIATEUR
Sur ce monde fait d’artifices et d’artefacts, jamais le photographe ne pose un regard désenchanté ou dénonciateur. Dans ses séries intitulées Le pays des jouets en référence à Pinocchio, ou In Scala (à l’échelle), il se délecte visiblement des fictions et des mirages que créent les décors des fêtes foraines ou les villes miniatures qu’aiment à visiter les touristes. « L’appareil photo est pour Ghirri une lanterne magique », résume le commissaire.
C’est aussi sans nostalgie que le photographe, qui a passé sa vie loin des grandes villes et des monuments prestigieux, interroge le paysage italien moderne, fixant son appareil sur les paysages sans qualité à la périphérie des villes et sur la banalité du quotidien.
Il y capte les restes du passé et d’idéologies souvent figés dans une imagerie kitsch : le communisme avec ses drapeaux, le catholicisme et ses croix en néon, l’Antiquité transformée en statue de jardin…
Si l’exposition rend justice à la dimension sérielle et analytique de l’œuvre de Ghirri, le découpage en une quinzaine de mini-chapitres, les longs textes explicatifs, la scénographie austère et la circulation compliquée ne facilitent pas la tâche du spectateur peu averti. Il manque aussi toute une dimension de l’œuvre, plus ludique et plus contemplative, pour compléter le tableau de cet artiste singulier. On se reportera pour cela à son chef-d’œuvre de papier, le livre Kodachrome (1978, réédité aux éditions Mack, non traduit), qui fait dialoguer dans un même mouvement poétique le monde et ses reflets, le faux et le vrai, le ciel et la mer.
« Luigi Ghirri, cartes et territoires », jusqu’au 2 juin. Jeu de paume, place de la Concorde, Paris 8e. Catalogue éd. Mack/Jeu de paume.



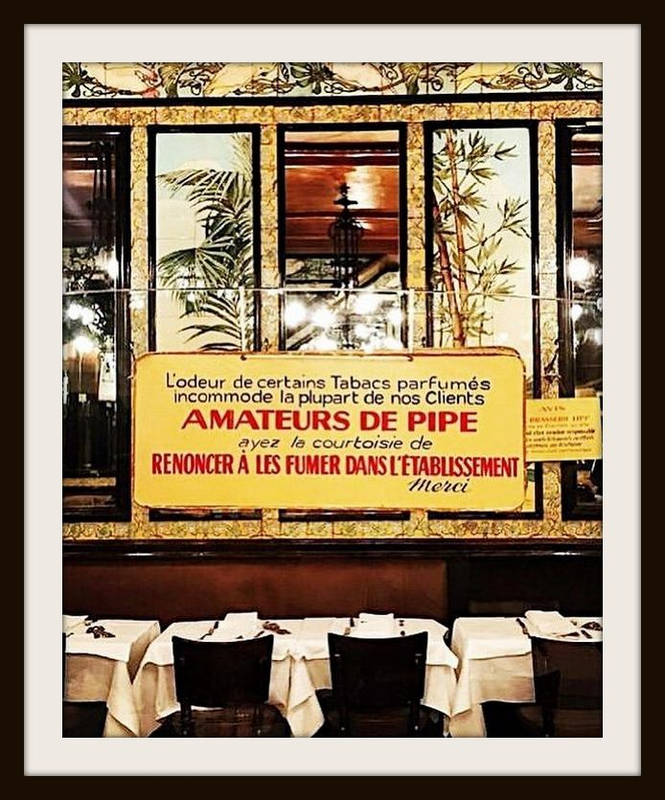













/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)