Par Vanessa Schneider
Actions coup de poing, slogans provocateurs, humour ravageur… Fondée en 1989, l’association de lutte contre le sida se démarque aussitôt par son positionnement radical. Un engagement total face à une maladie qui sème la mort à toute vitesse et dans l’indifférence générale.
Une foule dense prend silencieusement possession de la vaste terrasse. Entre sept et huit cents personnes se meuvent comme sonnées entre les tables éclairées de lampions. Certaines ont les yeux rougis, d’autres sont incapables de parler. Quelques instants auparavant, tous étaient assis dans les trois salles d’un cinéma des Lilas, près de Paris, pour assister à l’avant-première de 120 battements par minute, qui sort en salle le 23 août.
Parmi les centaines d’invités, des mines et des visages particulièrement bouleversés. Grand Prix au dernier Festival de Cannes, le film de Robin Campillo raconte une partie de l’histoire d’Act Up. Leur histoire. Militants des années 1990, ils viennent de découvrir un pan de leur vie posé sur pellicule. Des souvenirs douloureux et joyeux, une aventure intense qui a envahi leur biographie. Il y a là de nombreux anciens, Robin Campillo bien sûr, Philippe Mangeot, qui a participé à l’écriture du scénario, Hugues Charbonneau, l’un des producteurs, mais aussi Didier Lestrade, fondateur d’Act Up, ou la critique d’art Élisabeth Lebovici.
Après quelques minutes, quelques verres de vin ou quelques pintes de bière, alors que d’immenses enceintes crachent de la musique à haut volume, on se remet à parler. On se retrouve aussi. Certains ne se sont pas vus depuis des années. Il y eut à Act Up tellement de cris, de déchirements, de portes claquées.
Il y a les présents, qui se cherchent du regard parmi les dizaines d’inconnus qui n’ont pas partagé leur combat. Il y a l’ombre des absents aussi, les disparus, les trop nombreux fantômes. Et puis ceux qui n’ont pas été conviés à la fête, comme l’ancienne ministre Emmanuelle Cosse – douze ans de militantisme dont deux de présidence, pourtant – à qui les « orthodoxes » n’ont pas encore pardonné d’avoir été ministre de Manuel Valls, ou comme Pascal Loubet, cofondateur de l’association, désormais fâché avec Lestrade.
Empêcheurs de tourner en rond
La mémoire collective retient d’Act Up ses modes d’action spectaculaires : jet de fausses poches de sang et de faux sperme, dispersion de cendres sur des « cibles », « die-in », « menottages », pose d’une capote géante sur l’Obélisque, harcèlement de personnalités politiques. Les plus de 40 ans se souviennent de l’utilisation de formules chocs et efficaces « Action = vie », « Sida = mort », de visuels percutants, de cornes de brume et de sifflets, d’un triangle rose sur fond noir, de chars imposants lors des Gay Pride, de slogans qui claquent : « Le sida, c’est la guerre, Act Up en colère ».
Images et son d’un groupe d’enragés dérangeants qui jouaient les empêcheurs de tourner en rond en même temps qu’ils jouaient leur vie. Ceux qui sont restés, ceux qui ont survécu, savent que ce qu’ils ont bâti est bien plus puissant que ça, un engagement total, un militantisme cannibale, une expérience humaine hors du commun.
Act Up est né d’une urgence. Urgence face à la mort, cette mort qui décime alors la communauté homosexuelle, qui fauche les plus proches, que les « séropos » savent tapie dans leurs cellules, prête à les emporter en quelques mois. Act Up est né d’une colère immense, l’insoutenable sentiment d’être abandonnés de tous, rejetés, méprisés par les pouvoirs publics, niés par les laboratoires pharmaceutiques.
Act Up est né d’une trouille monumentale : celle de crever avant 30 ans dans l’indifférence générale. « C’est la peur, originellement, qui nous a réunis », a résumé Larry Kramer, le fondateur de la branche américaine.
La branche française est fondée en 1989
C’est parce qu’il était convaincu d’y passer que Didier Lestrade, critique musical, a voulu accomplir un dernier rêve : découvrir New York. Il y rencontre un amoureux et Act Up, fondé en 1987 aux États-Unis. De retour en France, il crée Act Up-Paris en 1989 avec deux copains, Pascal Loubet et Luc Coulavin, cinq ans après la naissance d’Aides, jugée trop passive dans sa lutte contre le sida.
Les premières réunions se déroulent dans le salon de Lestrade, autour de la conviction que seul un nouveau mode d’action provocateur et radical peut faire bouger les choses. Le groupe s’étoffe avec la progression de la maladie, avec l’agonie, et la sensation partagée qu’il vaut mieux mourir debout, en combattant, plutôt que cachés dans la honte de soi.
Philippe Mangeot les rejoint en septembre 1990. « J’ai découvert ma séropositivité à 21 ans, je me suis dit “je vais mourir”, j’ai fait mes études à toute allure. Pour moi, il y avait une évidence à faire partie d’une association axée sur la visibilité collective et coléreuse. » Sa première réunion est « un éblouissement. Il y avait vingt-quatre personnes autour d’une table. Pour la première fois de ma vie, j’ai posé un lapin à quelqu’un. Je devais dîner avec une amie à 21 heures, je suis sorti de la réunion à 23 heures. Je l’ai appelée et je lui ai dit : “Il s’est passé un truc énorme”. »
D’emblée, le jeune normalien est fasciné par « cette intelligence collective, cette joie rageuse, cette connexion immédiate entre le plus intime et le plus politique, la jubilation de penser ensemble, la vitalité de la parole sans narcissisme, la capacité à parler avec humour de la maladie ».
« Un lieu incroyable qui donne une énergie considérable »
Le journaliste Christophe Martet, qui sera président de l’association de 1994 à 1996, arrive en 1991. Séropositif depuis 1985, il ne prend d’abord pas la maladie très au sérieux, puis ses deux meilleurs amis meurent l’un après l’autre et il réalise que le sida « est beaucoup plus grave » que ce qu’il pensait. « J’arrive à Act Up avec mes angoisses de mort, isolé, coupé de ma famille à laquelle je ne pouvais pas en parler et là, je découvre un lieu incroyable qui me donne immédiatement une énergie considérable. Act Up est le meilleur antiviral que j’ai trouvé. »
Chaque mardi il y a, en ce début des années 1990, des nouveaux qui arrivent en réunion hebdomadaire (RH), car ils viennent d’apprendre qu’ils sont séropositifs ou malades, se souvient Emmanuelle Cosse, qui a rejoint l’association à l’âge de 17 ans avec un « ami pédé ». « Tout le monde déballait sa vie, c’était très fort. »
Le spectre de la mort est là, partout. Dans les têtes, dans les discours, déformant les corps, avec des Kaposi, ces effroyables tumeurs cutanées, symptôme le plus visible de la maladie, et des amaigrissements spectaculaires. Cette mort qui guette, chacun l’apprivoise à sa façon.
« J’ai supporté ces années en pensant au suicide, confie Didier Lestrade. Le suicide, ça me semblait l’ultime contrôle sur une maladie que l’on n’arrivait pas à contrôler. » « On se regardait, on sentait qui allait mourir, se remémore la voix soudainement plus éteinte, Robin Campillo. On voyait que certains ne supportaient pas les traitements et allaient de plus en plus mal. »
Les funérailles politiques de Cleews Vellay
Ils en ont fait des enterrements les garçons et les filles d’Act Up. « Je me disais qu’à 18 ans, ce n’était pas normal que je connaisse déjà par cœur le chemin du Père-Lachaise », se souvient Emmanuelle Cosse. Ils ont tous perdu des amis, des amants, des « maris » comme ils appelaient déjà leurs compagnons bien avant le mariage pour tous.
Mais les funérailles les plus désespérées et les plus marquantes ont été pour tous celles de Cleews Vellay, figure emblématique de l’association, crispant et attachant, mort le 18 octobre 1994 à l’âge de 30 ans.
Cleews le radical, Cleews le politique et le dialecticien brillant, Cleews la « grande folle » fan de Sheila, qui a inspiré l’un des personnages du film de Robin Campillo. Cleews la mauvaise tête qui rétorquait, si on lui demandait de sortir fumer dehors : « Fous-moi la paix, connasse ! Je fais ce que veux, je vais crever ! » Cleews l’agaçant et l’arrogant qui avait perdu toute patience et ne supportait plus les discussions sans fin. Cleews qui en faisait tellement que Philippe Mangeot et Didier Lestrade l’envoyaient parfois balader en lui disant : « Tu nous emmerdes avec ton sida ! »
Près de 500 personnes marchent ce jour-là entre le siège du Centre gay et lesbien de la rue Keller et le cimetière du Père-Lachaise. Militant jusqu’à sa dernière toux, Cleews Vellay a fait promettre à ses amis des funérailles politiques. Son vœu est respecté à la lettre. Ils sont tous venus, les anciens et les nouveaux, adhérents ou sympathisants, T-shirts noir et rose sur lesquels éclate l’équation « Action = vie », pancartes brandies à bout de bras, sifflets aux lèvres, accompagner le cercueil de celui qu’ils appelaient « la Présidente ».
« Le moment le plus intense que j’ai vécu de ma vie », murmure Robin Campillo. « On n’arrivait pas à croire qu’il était mort, raconte encore ému Christophe Martet. Quelques semaines avant, il était encore en train de gueuler sur tout le monde ! » « C’était horriblement triste, se souvient Philippe Mangeot. On avait toujours eu des morts, mais là… c’était Cleews. »
Les larmes et les slogans
Plus que jamais ce jour-là, tout s’est mélangé, les larmes et les slogans, le combat et l’amitié. Cleews Vellay est mort à l’hôpital Bichat, entouré d’une poignée de ses plus proches, rongé par la maladie, si maigre qu’à la fin, son corps ressemblait à celui d’un adolescent de 14 ans.
« On était anéantis et soulagés en même temps tant il souffrait, c’était un cauchemar, poursuit Mangeot. La machine Act Up s’est immédiatement remise en marche. On s’est retrouvés au local, on a écrit un communiqué de presse, on a acheté une page dans Libé, le journaliste Gérard Lefort a fait sa chronique sur Cleews sur France Inter. On a pu s’accrocher grâce au travail. »
Act Up, c’est un boulot de forçat, un investissement de dingue. Un militantisme total qui évite de penser à l’inéluctable. Une réunion hebdomadaire, la RH, qui dans les « grandes » années rassemble près de deux cents personnes, une mobilisation sans équivalent dans aucun mouvement politique ou associatif. La réunion du mercredi pour débriefer, le travail en commission (médicale, prison, toxicomanie, Nord-Sud…), la formation aux médicaments et à la recherche, la confection des pancartes, des banderoles, la préparation des actions (les « zap » – actions coup de poing – et les die-in), les heures à envoyer des fax, des courriers, à passer des coups de fil. Sans compter les journées dans les hôpitaux pour se relayer au chevet des amis malades.
« C’était tout le temps, se souvient Lestrade. La priorité était d’être fidèle au groupe. On lui a sacrifié nos vies, nos carrières. » « On ne faisait plus que ça, abonde Christophe Martet. Le monde n’existait qu’autour de ça. Mes amis qui n’étaient pas à Act Up, je ne les voyais plus vraiment. » « Pour ceux qui continuaient à travailler comme moi, il y avait une vie à côté, nuance Philippe Mangeot, enseignant. Mais l’intensité de la vie était à Act Up. »
« On se considérait limite comme un club privé »
Pascal Loubet, l’un des fondateurs, qui s’est chargé un temps de tester les nouveaux à la « SA » (section d’accueil), raconte : « Quand un type arrivait en disant : “Ça m’intéresse, mais je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer.” Je lui répondais : “Eh ben, barre-toi, petite conne !” On se considérait limite comme un club privé, c’est tout juste s’il n’y avait pas un physio à l’entrée ! »
Act Up, c’est la mort partout tout le temps, mais aussi la vie. L’association « attire presque tous les freaks de la terre à part les albinos », s’amuse Lestrade dans son livre Act Up, une histoire (éd. Denoël). « Un groupe de branques », complète Philippe Mangeot. « Une sacrée bande de caractériels », souligne le journaliste de Libération Éric Favereau, spécialiste du sida.
Une assemblée hétéroclite : des intellos comme le prof Philippe Mangeot, des prolos comme Cleews Vellay, qui travaillait dans un chenil après avoir passé un CAP de pâtisserie, des gosses à peine étudiants, quelques femmes, beaucoup de « folles furieuses », comme ils aiment à le dire. À Act Up, il y a des engueulades phénoménales et hystériques, des fous rires, de la grosse déconnade. On se déguise en pom-pom girls pour la Gay Pride, on joue à Un, deux, trois, soleil dans la cour du local pendant la « récré » de la RH.
Loïc Prigent, qui y a milité en 1994 et 1995, s’occupe alors des « pages idées folles » (pif) dans le fanzine distribué aux membres toutes les semaines : il s’amuse à glisser des photos des officiers des Renseignements généraux chargés de les surveiller en les légendant de commentaires désobligeants. Didier Lestrade dresse toutes les semaines le Top 5 des plus beaux mecs de la RH.
« Il y avait un humour “folle”, désespéré et irrésistible »
On ose tout ici, les propositions les plus baroques, les slogans les plus provocs (« Des molécules pour qu’on s’encule »). « Chacun faisait son job, on était là pour bosser et pour avoir des résultats tout en étant potaches », sourit encore Loïc Prigent, aujourd’hui journaliste et réalisateur de documentaires, spécialiste de la mode. « Il y avait un humour “folle” à la fois désespéré et irrésistible, comme l’humour juif », souligne Mangeot.
Lestrade estime que « le groupe n’aurait jamais pu faire des choses aussi violentes, subir des gardes à vue, la confrontation avec les flics sans autodérision et sans humour ». Pascal Loubet, avec lequel il s’est brouillé depuis – davantage sur des frictions d’ego que sur des divergences stratégiques –, partage ce constat : « C’est un truc de tafiole de ne pas se prendre au sérieux même dans les situations les plus dramatiques. »
Act Up, c’est presque une secte, accusent alors les opposants. Beaucoup, à l’intérieur de l’association, assument. « On nous prend pour une secte ? Pas peur », écrit Lestrade dans son livre. Et de décrire le « côté messianique de l’association » avec son prophète, Larry Kramer, ses saints et ses prêcheurs, les séropos, ses martyrs, les morts, son missel, les « 13 mesures d’urgence » (la plate-forme de revendications). À Act Up, on se fait des amis, on va danser, on finit les réunions dans des pizzerias pourries, certains partent en week-end ou en vacances ensemble.
Ça baise aussi pas mal. « Une libido triste », tempère Loïc Prigent. « Dans les réunions, on pouvait draguer, il y avait du sex-appeal. Le sentimental et notre côté midinette nous aidaient à nous confronter à nos propres peurs », dit Lestrade. Philippe Mangeot se souvient : « J’ai immédiatement trouvé tout le monde très beau. J’avais 25 ans et j’ai rencontré dans cette cour des miracles des mecs que je désirais. » « J’ai peu couché à Act Up », rigole avec une pointe de regret Robin Campillo. C’est pourtant dans les rangs de l’association qu’il a dragué celui qui est devenu neuf ans plus tard son mari.
Rupture biographique
À l’époque, plus encore qu’aujourd’hui, les homos étaient souvent violemment rejetés par leur famille. Quant aux séropositifs et aux malades du sida, la mise à l’écart était plus grande aussi. Né en 1962, Campillo parle, à cet égard, de « rupture biographique ». « Le sida nous coupe de notre génération, explique Philippe Mangeot. Ceux de notre âge ne connaissent pas les hôpitaux, la maladie. Moi, je me suis retrouvé veuf en même temps que mon grand-père. Le sida change les horloges, et puis il y avait ceux qui voulaient savoir et ceux qui ne voulaient pas savoir, pas entendre parler de la maladie. »
Y compris parmi les homos. Un soir de 1992, un groupe de militants décide de fêter une action à Notre-Dame de Paris dans un bar. Ils se font jeter de trois établissements du Marais : « Vous êtes la honte de la communauté ! », s’entendent-ils dire. « La communauté sida n’était pas superposable à la communauté homo », analyse Mangeot. Et d’ajouter joliment : « À Act Up, même les gens que je n’aimais pas, je les aimais. »
Dans les années 1990, les réunions hebdomadaires d’Act Up rassemblent jusqu’à 200 personnes. Des règles démocratiques strictes sont donc instaurées. Le photographe met ici en vis-à-vis la classe d’Hervé, un des piliers d’Act Up, avec un vote lors d’une réunion de l’association. | Jean-Marc Armani
Comme toute famille, Act Up a ses codes : ses prises de parole organisées de façon quasi militaire, la répartition très précise des rôles pour les actions, les claquements de doigts qui remplacent les applaudissements. Ces règles, c’est Pascal Loubet, venu du monde de l’entreprise, qui les a établies. « On n’avait pas de temps à perdre, alors il fallait structurer tout ça, explique-t-il. La démocratie est un truc monstrueux dans une association. Dix personnes, c’est dix points de vue différents et le risque de multiplier les discussions interminables et inintéressantes. »
Personne ne songe à remettre en cause le règlement. « On ne subissait pas, confirme Emmanuelle Cosse qui a récemment retrouvé un mémo de quinze pages destiné à la seule préparation de l’enterrement de Cleews Vellay. Le côté ultra-organisé faisait partie du groupe, c’était assumé et voulu. » « Tout était très réglé, mais dans la pratique on était parfois des pieds nickelés », se marre Campillo : « Un jour, on part faire un “zap” dans un labo pharmaceutique, mais il avait déménagé et on ne le savait pas ! Les filles à l’accueil étaient fans d’Act Up et voulaient nous acheter des T-shirts. Lestrade a failli faire une dépression ! »
« On était soit avec eux, soit contre eux »
Act Up a son langage aussi, les « zaps », les « die-in », les picketing (sit-in hebdomadaires devant un ministère ou une institution), cette manie de féminiser les mots pour désigner des hommes : « la Présidente », « la Conne », « la Patronne », etc. Ses gestes, aussi, comme le baiser systématique sur la bouche pour se dire bonjour.
Une famille soudée contre le reste du monde. À Act Up, on est contre : contre les pouvoirs publics accusés de ne rien faire, contre les labos pharmaceutiques qui freinent l’accès aux tests de médicaments, contre les politiques trop peureux, contre les autorités religieuses jugées criminelles, contre les autres associations de lutte contre le sida considérées trop timorées dans leurs actions, contre la presse « vendue » aux autres associations.
« Ils avaient un côté PCF à toujours accuser le gouvernement, ils étaient très moralistes, regrette encore Daniel Defert, l’ancien président de l’association rivale Aides, ils surjouaient le conflit, ils arrivaient et nous traitaient de fachos alors qu’ils savaient qu’on était du même camp. » « Ce n’était pas des tolérants, tempère le journaliste Éric Favereau, accusé par Act Up d’être à la solde des rivaux d’Aides. On était soit avec eux, soit contre eux. Si on n’écrivait pas qu’il y avait 600 000 séropositifs en France, ce qui n’était pas le cas, on était traités d’“assassins”, les ministres qui se succédaient avaient peur d’eux. »
Il reconnaît néanmoins que les méthodes contestées d’Act Up ont porté leurs fruits : « Ils ont fait un travail magnifique, ils ont fait bouger les labos et les pouvoirs publics et, en partenariat avec les autres associations, ont obtenu des avancées phénoménales. » « On était d’une impatience folle, on se vivait comme une forteresse assiégée, on était un peu pénibles », concède Emmanuelle Cosse.
Avec une certaine jouissance aussi à faire partie de ce groupe d’emmerdeurs : « On était vus comme des gens à part et on était fiers d’être différents », sourit Lestrade. « On avait le plus gros char à la Gay Pride, avec le meilleur slogan et la meilleure musique », jubile encore Loïc Prigent. « On faisait partie d’une avant-garde, ça nous plaisait de ne pas plaire aux gens », insiste Christophe Martet.
Aventure unique
Qu’ils aient milité deux ou dix ans, les anciens d’Act Up ont, sans exception, l’impression d’avoir participé à une aventure unique. « C’est le truc le plus fort que j’ai vécu, explique Emmanuelle Cosse, ancienne du militantisme lycéen puis passée en politique chez les Verts. Il y avait un sens inouï du collectif, c’était très engageant émotionnellement. » « J’ai rencontré des gens incroyables, affirme Robin Campillo. J’ai appris à mieux réfléchir, à mieux penser, à mieux vivre à leur contact. » « On avait conscience qu’on vivait quelque chose de particulier, poursuit-il. On se pensait historiquement, tout était noté, consigné, on avait sans cesse peur de perdre nos archives.
Que reste-t-il de cet Act Up des années 1990, de cette bande de malades à tous les sens du terme ? Des souvenirs émouvants, terrifiants, infiniment tristes. La conviction d’avoir été utile aussi. L’arrivée des trithérapies en 1996, si elle n’a pas mis fin au combat, a changé la donne. Le sida passe de maladie mortelle à maladie chronique. Les militants s’éparpillent doucement. À la fois soulagés, épuisés, un peu perdus aussi. « Ce n’est pas rien de réaliser que vous avez vu vos amis mourir, vos maris mourir et que vous n’allez pas prendre la charrette, avoue Philippe Mangeot. Il y a une forme de mélancolie très difficile à partager dans ce moment où l’on comprend qu’il faut refermer la tombe. »
Une forme de culpabilité aussi devant cette énigme terrible et scandaleuse qui fait que certains sont vivants quand d’autres sont morts. Participer au scénario de 120 battements par minute a été pour lui « une façon de poursuivre cette histoire, de ne pas laisser le dernier mot aux salauds et de saluer ceux qui sont morts ».
Mais une fiction, aussi réussie soit-elle, ne fait pas tout et certaines figures historiques de l’association aimeraient que leur histoire soit reconnue par les pouvoirs publics et l’opinion dans son ensemble. « Notre engagement associatif nous a mis au ban de la société », écrivait Didier Lestrade en mai dans une tribune à Libération. Il y rappelait qu’il a 60 ans, est chômeur depuis dix ans et probablement l’un des seuls à avoir monté les marches du Festival de Cannes en étant au RSA. Son texte s’intitule « Épargnez-nous vos louanges ». Un titre de film ou un ultime cri de colère.

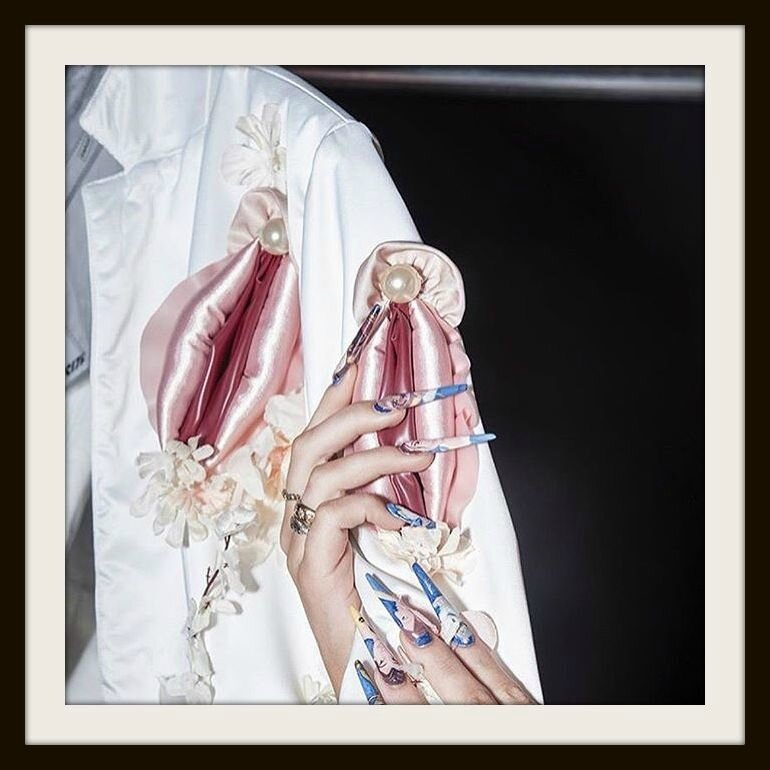




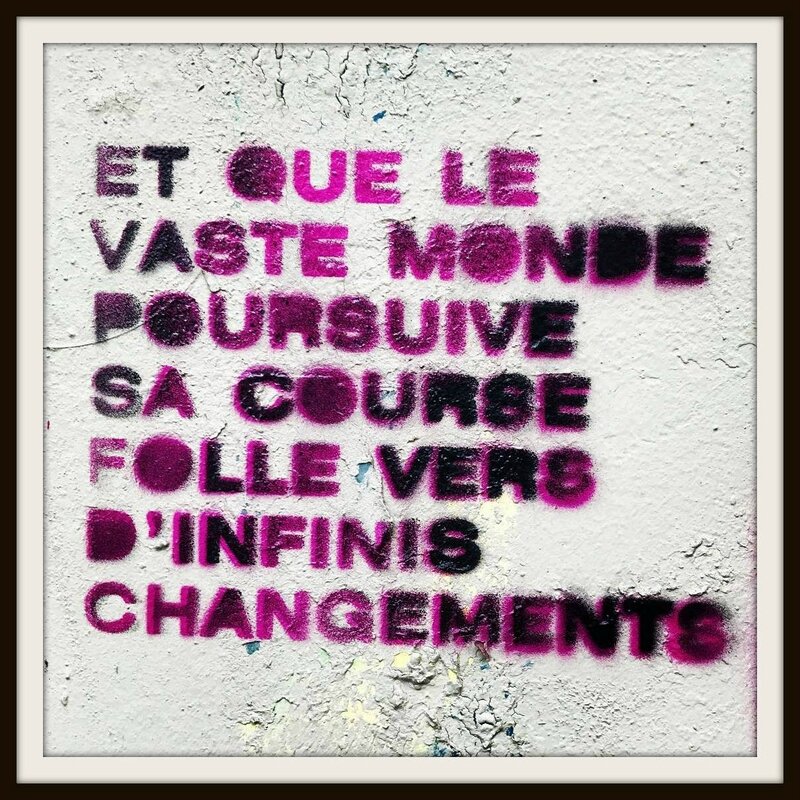
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)