« Jeff Koons donne l’impression de vouloir célébrer son œuvre et sa personne »
La ministre de la culture, Françoise Nyssen, et l’artiste Jeff Koons, à Paris, le 30 janvier 2018. STÉPHANE DE SAKUTIN/AFP
Par Michel Guerrin - Le Monde
Dans sa chronique, Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde » relie la polémique sur Charles Maurras et celle sur le « cadeau » de Koons à Paris. Au cœur de ces deux conflits culturels, la subtile frontière entre commémoration et célébration.
Commémorer ou célébrer ? La nuance est ténue. Et délicate. Elle est au centre de deux conflits qui agitent la culture depuis quelques jours. Une œuvre de Jeff Koons et l’œuvre de Charles Maurras (1868-1952).
Commençons par l’artiste américain qui souhaite offrir à Paris, en hommage aux victimes des attentats de 2015, une sculpture de 12 mètres de haut et de 33 tonnes, nommée Bouquet of Tulips, avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis, de la maire socialiste Anne Hidalgo et de mécènes qui en paieront l’installation. Cette main tenant un bouquet de fleurs colorées serait installée entre le Musée d’art moderne de la Ville de Paris et le Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement de la capitale. Embarrassé, le ministère de la culture dira oui ou non.
Le problème, c’est que ce cadeau, beaucoup d’acteurs du monde de l’art et de la culture, et non des moindres, n’en veulent pas. Ils le disent et ils l’écrivent. Koons réalise ainsi un petit exploit dont il se serait sans doute passé. Car il fut un temps où l’art contemporain était défendu par une tribu qui faisait bloc. La moindre critique contre ses pratiques, ses acteurs, ses artistes, ses expositions, était vécue comme un procès mené par des hurluberlus réactionnaires ou ringards. Koons a fissuré ce monolithe. Et c’est inédit.
Les arguments contre lui sont multiples – esthétique, coût, etc. Ajoutons celui-ci : la famille de l’art se sent en danger avec cette affaire Koons. Car, si l’art contemporain a largement remporté sa bataille de légitimité, tant il a contaminé les expositions, la mode, la musique, l’entreprise, les revues branchées, la publicité, les festivals et les ventes aux enchères, il traîne aussi une sale réputation, à cause d’une poignée d’artistes mondialisés qui pourraient fragiliser l’édifice.
Un univers « sans foi ni loi »
Ces noms mondialisés sont au cœur du livre de Jean-Gabriel Fredet Requins, caniches et autres mystificateurs (Albin Michel, 2017), qui décrit un univers de l’art contemporain « sans foi ni loi », régi par la spéculation, le blanchiment d’argent, la provocation cynique, et par quelques artistes qui affichent en public des élans sociaux et solidaires et qui, en privé, font tout le contraire. Jeff Koons en est l’emblème – une de ses œuvres figure en couverture du livre de Fredet. Du reste, on n’imagine pas combien la majorité de la famille de l’art déteste Koons. Beaucoup l’ont moqué en 2014 lors de sa rétrospective au Centre Pompidou, mais ils l’ont fait en sourdine.
En fait, tant que ces artistes mondialisés restent dans leur monde, la famille grince mais ne bouge pas. Elle a ri sous cape quand Koons a présenté au Louvre ses sacs Vuitton imprimés de tableaux de maîtres anciens. Ou quand LVMH, numéro un mondial du luxe, a annoncé des résultats record pour 2017 en partie grâce au succès de ces sacs.
Mais là, c’est différent. Une partie du monde de l’art entre en rébellion, estimant que, avec ses tulipes, Koons va trop loin. Il sort des lieux de l’art ou de l’argent pour gagner l’espace public. Il s’échappe du terrain de l’esthétique pour faire une percée dans le champ de la commémoration. Il n’est plus dans l’entre-soi, il tutoie la mémoire et la douleur collectives.
Et, là, ça ne passe plus. Comme ne passent plus ses mots pour justifier ses tulipes, d’une niaiserie rare – « Je propose un acte d’amour ». En fait, par ses états de service, et sa volonté d’installer son œuvre entre deux musées, il donne l’impression de vouloir moins commémorer les victimes du terrorisme que célébrer son œuvre et sa personne.
Accepter notre passé
Commémorer ou célébrer, c’est aussi le problème pour Charles Maurras. Qui n’est pas nouveau. Le 20 avril 1968, Le Monde publiait deux pages intitulées : « Faut-il se souvenir de Charles Maurras ? » Réponse : « Sa stature mérite mieux que le silence. Il a trop impressionné les esprits pendant cinquante ans. »
C’est pour cela que l’écrivain et homme politique d’extrême droite, raciste et antisémite, proche de Vichy et de ses infamies, condamné à la Libération, qui aurait 150 ans aujourd’hui, figure dans un livre de 340 pages visant à commémorer, en 2018, des noms et événements qui ont marqué notre histoire.
La ministre de la culture, Françoise Nyssen, vient de décider du contraire. Ou plutôt de changer d’avis. Elle a jeté au pilon un ouvrage déjà diffusé, qu’elle avait préfacé, pour le ressortir censuré des deux pages sur Maurras. Elle a suivi l’avis de Frédéric Potier, « M. Antiracisme » du gouvernement, ou de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), pour qui « commémorer c’est rendre hommage ».
Commémorer n’est pas rendre hommage, ni célébrer, comme l’ont bien dit les historiens Jean-Noël Jeanneney et Pascal Ory, qui font partie du comité d’experts qui avait retenu Maurras. Commémorer, c’est accepter notre passé, flamboyant ou noir, et l’affronter pour le comprendre. Du reste, dans ce livre, il n’y a pas que des saints, sinon il n’y aurait pas grand monde. On y trouve le sanguinaire Simon de Montfort, qui trucida l’Albigeois au XIIe siècle, la grippe espagnole, qui fut une hécatombe, la guerre de 1914-1918, qui fut une boucherie, et la date de 1768 quand la Corse devint française – pas sûr que tout le monde soit ravi sur l’île.
Panique morale des élites
Rayer Maurras, c’est refuser de voir l’influence énorme qu’il a eue sur les esprits au-delà de l’Action française et donc s’interdire de comprendre la société des années 1920-1940. C’est prendre en otage l’histoire au nom des enjeux actuels. C’est refuser d’affronter le passé antisémite du pays et ses connivences avec l’occupant nazi. C’est laisser la place aux fantasmes, notamment sur Internet, autour d’un réprouvé.
Outre que son revirement fait désordre, Mme Nyssen, bien de son époque, cède à une panique morale des élites, qui entendent trier dans notre histoire les bons, à glorifier, et les méchants, à mettre sous le tapis. C’est juste un peu plus compliqué.
Réseaux sociaux, sucre : la quête du plaisir nuit-elle au bonheur ?
Par Stéphane Foucart, San Francisco (Etats-Unis), envoyé spécial Le Monde
Pour le médecin américain Robert Lustig, cette quête du plaisir, fondée sur la dopamine, est l’ennemie du bonheur, qui dépend, lui, de la sérotonine.
Cette fugace piqûre de bien-être, cette satisfaction éphémère, ce goût de reviens-y… De l’utilisation des réseaux sociaux à la consommation de sucre et d’aliments transformés, le plaisir bon marché n’a jamais été aussi pervasif, suscité en permanence par une multitude de nouveaux produits et de services, marketés comme autant de conditions sine qua non au bonheur.
Plaisir, bonheur : ces deux mots sont au centre de The Hacking of the American Mind (Penguin, 2017, non traduit), le dernier livre du pédiatre et neuroendocrinologue américain Robert Lustig, tout juste paru aux Etats-Unis. Célèbre pour ses travaux académiques sur le sucre – détaillés dans un ouvrage qui vient d’être traduit (Sucre, l’amère vérité, Thierry Souccar éditions, 400 pages, 19,90 €) –, le professeur de l’université de Californie à San Francisco (Etats-Unis) y expose une réflexion scientifique saisissante, aux implications majeures pour la société occidentale.
Non seulement le bonheur n’est pas la conséquence naturelle de l’accumulation du plaisir, explique-t-il, mais la recherche effrénée de celui-ci pourrait au contraire inhiber le sentiment de plénitude et de contentement.
Robert Lustig exploite la littérature scientifique récente sans faire mystère de la difficulté à, parfois, établir avec certitude certains liens de causalité entre des comportements et certaines réactions biochimiques. Mais il n’en développe pas moins un argumentaire révélant l’un des plus graves malentendus de notre temps, en montrant que le plaisir peut être l’ennemi du bonheur. Entretien.
Pour de nombreuses personnes, la recherche du plaisir est un préalable au bonheur, ou l’une de ses conditions. Pourquoi penser que bonheur et plaisir sont à ce point différents ?
Le bonheur et le plaisir ne sont en effet pas identiques. Ce sont des phénomènes distincts, très dissemblables, et si nous ne le percevons pas, c’est essentiellement parce que l’industrie vend ses produits ou ses services en faisant passer l’un pour l’autre. Je compte sept grandes différences entre les deux, que chacun peut comprendre aisément.
Le plaisir est de courte durée, le bonheur de longue durée ; le plaisir est viscéral, le bonheur est spirituel ; le plaisir s’obtient en prenant, le bonheur a plutôt à voir avec donner ; le plaisir peut s’obtenir seul, le bonheur est généralement atteint au sein d’un groupe social ; le plaisir peut s’obtenir grâce à des substances, mais ce n’est pas le cas du bonheur. Le plaisir extrême peut conduire à l’addiction – c’est par exemple le cas pour l’alcool, la cocaïne, la nicotine et d’une manière générale pour les comportements susceptibles de procurer un plaisir immédiat comme l’utilisation des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, le shopping, le jeu, la pornographie… Pour tout cela, il existe une forme d’addiction, mais il n’y a rien qui ressemble à une addiction au bonheur.
Enfin, la septième et dernière différence est que plaisir et bonheur dépendent de deux neurotransmetteurs distincts : dopamine pour le plaisir, sérotonine pour le bonheur. Le plaisir et le bonheur sont localisés dans deux sites distincts du cerveau, mobilisent deux modes d’action différents, deux types de récepteurs différents…
Pourquoi la dopamine peut-elle conduire à l’addiction ?
Pour comprendre, il faut savoir qu’un neurotransmetteur, une fois qu’il a été libéré par un neurone, franchit la synapse et se fixe sur un récepteur du neurone suivant. Là, il peut agir de deux façons : soit il excite le neurone qui le reçoit, soit il l’inhibe.
La dopamine est un neurotransmetteur exclusivement « excitateur ». Bien sûr les neurones sont faits pour être excités – et c’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont des récepteurs ! Mais ils aiment être chatouillés, pas brutalisés : lorsqu’un neurotransmetteur excitateur est fourni à des hautes doses chroniques, il devient neurotoxique.
Lorsqu’un neurone est chroniquement sur-stimulé, il a donc tendance à mourir. La dopamine, à des hautes doses chroniques, tue les neurones post-synaptiques – c’est le nom qu’on donne aux neurones qui reçoivent l’information. Mais ceux-ci, pour éviter de mourir, peuvent aussi activer un mécanisme d’autodéfense en régulant leurs récepteurs. En gros, lorsqu’un neurone se trouve sous les assauts constants d’un neurotransmetteur, il peut « éteindre » certains de ses récepteurs pour atténuer son excitation et éviter la mort.
Du coup, pour produire le même effet, il faut une quantité supérieure de neurotransmetteurs. C’est un mécanisme universel, appelé « tolérance », qui est propre à de nombreux types de cellules et pas uniquement aux neurones. Dans le cas particulier de la dopamine, en termes humains, cela signifie qu’il faut toujours plus de ce qui procure du plaisir pour obtenir la même satisfaction. Il en faut toujours plus pour produire le même effet. C’est ainsi que le plaisir intense et chronique conduit à l’addiction.
Mettre sur un même plan tout ce qui procure du plaisir – le sexe, l’alcool, le shopping, le sucre ou les réseaux sociaux – est plutôt contre-intuitif…
Toutes ces activités provoquent en effet des sensations différentes, parce qu’elles passent par des voies différentes. C’est pour cela que nous ne faisons pas le lien. Mais le cerveau, lui, ne s’y trompe pas. Il les interprète et les comprend de la même manière, comme une « récompense ». Or la clé du « circuit de la récompense », c’est la dopamine. C’est un mécanisme fondamental, essentiel à la survie de notre espèce : il est impliqué dans la motivation, le moteur de nos actions.
Le titre de mon livre fait référence au « piratage » [hacking en anglais] de notre esprit : c’est précisément ce mécanisme de la récompense qui a été « piraté » par les industriels, pour induire toujours plus de consommation… le tout en organisant, grâce au marketing, la confusion entre plaisir et bonheur (happiness en anglais). Il suffit de lire les slogans publicitaires : « Happy Meal » pour McDonald’s, « Open Happiness » pour Coca-Cola, « Happy Hour » lorsque vous entrez dans un bar…
Mais en quoi tout cela peut-il entraver l’accès au bonheur ?
Le neurotransmetteur impliqué dans le sentiment de plénitude et de contentement, la sérotonine, a un fonctionnement beaucoup plus complexe que la dopamine. Néanmoins, il est possible de mettre en avant un certain nombre de mécanismes par lesquels le niveau de sérotonine dans le cerveau est susceptible de baisser.
Par exemple, la synthèse de sérotonine ne se fait, dans les tissus cérébraux, qu’à partir d’une brique élémentaire, un acide aminé appelé tryptophane. Or deux autres acides aminés, la tyrosine et la phénylalanine, sont les briques élémentaires de la dopamine et sont en compétition avec le tryptophane pour être, eux aussi, transportés dans le cerveau.
Pour schématiser : plus les transporteurs d’acides aminés sont occupés à amener les briques élémentaires de la dopamine dans le cerveau, moins ils sont disponibles pour y acheminer le tryptophane… Il y a donc là une sorte d’antagonisme biochimique potentiel entre dopamine et sérotonine.
Il y a d’autres voies de réduction potentielle de la sérotonine. Par exemple, lorsque vous avez une interaction sociale avec quelqu’un, l’échange de regards avec cette personne active vos neurones dits « miroirs » – les neurones de l’empathie. Ce type d’interaction induit la synthèse de sérotonine. Mais si cette interaction se fait par le biais d’un réseau social comme Facebook, à travers les « likes » par exemple, elle active le circuit de la récompense, mais l’absence de contact visuel laisse les neurones miroirs de marbre… D’où, là encore, une baisse potentielle des niveaux de sérotonine et une moindre capacité au contentement.
D’autres phénomènes conduisent-ils à une baisse de la sérotonine ?
Oui. C’est en particulier le cas du stress chronique, associé à l’omniprésence de certaines technologies, en particulier le téléphone… Le stress se manifeste par la libération de cortisol. Cette hormone est nécessaire mais lorsque les niveaux de cortisol sont élevés en permanence, le fonctionnement du cortex préfrontal est inhibé.
Or il s’agit de la zone du cerveau qui vous permet de faire des arbitrages et des choix raisonnés. En gros, c’est ce qui vous empêche de faire n’importe quoi… En situation de stress, vous êtes ainsi plus enclin à céder face à la tentation du plaisir et vous êtes plus vulnérable à l’addiction. Attention toutefois : l’addiction et la dépression ne sont pas identiques. Des personnes souffrant de dépression ne souffrent pas nécessairement d’addiction, mais disons qu’il y a une forte superposition entre ces deux phénomènes. Il est fréquent que les personnes souffrant d’addiction soient déprimées.
En outre, des expériences sur les animaux ont montré que le niveau de cortisol baisse lorsqu’on s’élève dans la hiérarchie d’un groupe. Plus vous êtes au bas de l’échelle, plus vous êtes stressé. Des recherches indiquent que chez des singes auxquels on laisse la possibilité de s’autoadministrer de la cocaïne, les individus hiérarchiquement inférieurs deviennent plus probablement accros que les mâles « alpha ».
On retrouve des indices de cela dans les populations humaines : ce sont généralement les plus pauvres qui souffrent le plus des maladies chroniques associées à certaines addictions alimentaires (obésité, diabète de type 2…). Stress chronique et dopamine : voilà ce qui a le plus changé dans les sociétés modernes au cours des quarante dernières années.
Vous avez surtout travaillé jusqu’à présent sur l’alimentation et le sucre, pourquoi vous êtes vous penché sur cette question, bien plus vaste, des liens entre plaisir et bonheur ?
J’ai commencé à travailler il y a longtemps sur les liens entre sérotonine et dopamine. C’était au début de ma carrière et il y avait surtout des données animales. Le temps a passé, j’ai beaucoup travaillé sur le sucre et les addictions alimentaires, et j’ai vite réalisé que nous avions aujourd’hui autant, sinon plus, de données sur le lien entre le régime alimentaire et la santé mentale qu’entre le régime alimentaire et la santé physique ! Mais il fallait remettre ensemble toutes les pièces du puzzle.
Et puis, en 2014, j’ai visité les installations d’une université et la personne qui organisait la visite était une ancienne héroïnomane. Elle avait arrêté. Je lui ai demandé ce que cela voulait dire, pour elle, d’être clean. Elle m’a fait une réponse que je n’oublierai jamais tant c’était étonnant. Elle m’a dit : « Quand je me droguais j’étais heureuse, mais ma nouvelle vie me donne du plaisir. » Elle avait tout faux. Dans son esprit, tout était inversé. Elle confondait le plaisir avec le bonheur, et le bonheur avec le plaisir. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait écrire ce livre.
Pensons aux réfugiés Rohingya.... Visit worldpressphoto.org to find out more and register now!
Mohammed Rafiq, 10, waits for a meal to be distributed by a Turkish organization in a camp for Rohingya refugees, Bangladesh, November 16. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ After decades of systematic discrimination and persecution against the Rohingya Muslims, in late August Myanmar's army began a campaign of what the United Nations has called ethnic cleansing. More than 620,000 have fled to Bangladesh in the last three months, arriving to squalid makeshift camps joining the more than 300,000 Rohingya who had escaped in previous influxes in recent years. Doctors Without Borders called the health conditions of the refugee encampments a time bomb. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hi, my name is Tomas Munita, I am a freelance photographer based in Chile. I work mostly for The New York Times covering news worldwide and this week as I am taking over World Press Photo Foundation Instagram feed. I will be sharing my latest work for the NYT documenting the current humanitarian crisis of the Rohingya people. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @nytimes #nytassignment __________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Entries for the 2018 Photo Contest are now open! Deadline: 4 January at 12 (noon) CET. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The contest is open to professional photographers and photojournalists, and entry coordinators submitting work on their behalf. It's free to enter and judged anonymously by an independent jury. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Visit worldpressphoto.org to find out more and register now!

3,663 Likes, 14 Comments - World Press Photo Foundation (@worldpressphoto) on Instagram: "Mohammed Rafiq, 10, waits for a meal to be distributed by a Turkish organization in a camp for..."
Weakened after days or weeks of walking and hiding in the jungle with little or no food to eat, Rohingya refugees walk from the border to the camps in Bangladesh, November 2. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ After decades of systematic discrimination and persecution against the Rohingya Muslims, in late August Myanmar's army began a campaign of what the United Nations has called ethnic cleansing. More than 620,000 have fled to Bangladesh in the last three months, arriving to squalid makeshift camps joining the more than 300,000 Rohingya who had escaped in previous influxes in recent years. Doctors Without Borders called the health conditions of the refugee encampments a time bomb. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hi, my name is Tomas Munita, I am a freelance photographer based in Chile. I work mostly for The New York Times covering news worldwide and this week as I am taking over the World Press Photo Foundation Instagram feed. I will be sharing my latest work for the NYT documenting the current humanitarian crisis of the Rohingya people. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @nytimes #nytassignment __________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Entries for the 2018 Photo Contest are now open! Deadline: 4 January at 12 (noon) CET. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The contest is open to professional photographers and photojournalists, and entry coordinators submitting work on their behalf. It's free to enter and judged anonymously by an independent jury. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Visit worldpressphoto.org to find out more and register now!

6,686 Likes, 33 Comments - World Press Photo Foundation (@worldpressphoto) on Instagram: "Weakened after days or weeks of walking and hiding in the jungle with little or no food to eat,..."
Les animaux ont-ils encore leur place au cirque ?
Par Rosita Boisseau - Le Monde
De nombreuses villes françaises et plusieurs pays interdisent les spectacles mettant en scène des bêtes, sauvages ou non.
Un double mouvement affole actuellement les boussoles du cirque. Du côté des artistes contemporains, la réapparition dans les spectacles d’animaux domestiques, en particulier des chevaux, peu présents depuis le début des années 1980, ouvre une nouvelle ère à plumes et à poils. Sur le front des enseignes traditionnelles, la présence des bêtes sauvages, vedettes de la piste, suscite les foudres des associations animalistes, qui font pression sur les pouvoirs publics pour les interdire.
Cette tempête soulève des discussions fiévreuses. La liste des pays, actuellement au nombre de 27, qui interdisent sur leur territoire les troupes avec animaux sauvages, s’allonge. « Ce mouvement risque de donner un coup supplémentaire aux cirques traditionnels, qui vont avoir du mal à s’en remettre, en particulier les petites compagnies, analyse Marc Jeancourt, directeur du Pôle national cirque d’Ile-de-France. Mais je crains aussi que, parallèlement, les arts de la piste soient malheureusement absorbés par l’esthétique grand show du Cirque du Soleil. » « Au-delà de la question des animaux, il y a un autre objectif, moins visible, commente Guy Périlhou, de l’association Cirque d’audace : celui de freiner l’installation des chapiteaux, de plus en plus difficile dans l’espace public, alors que le tout-sécuritaire menace. Cela met en péril tous les cirques. »
Pour l’heure, un collectif rassemblant 200 enseignes de cirque traditionnel s’est constitué. « On a l’habitude de ces associations pro-animaux et la loi est de notre côté, précise Gilbert Edelstein, patron de Pinder et président du Syndicat national du cirque. Nous avons un public. On reçoit chaque jour des appels téléphoniques pour savoir si nous avons bien des animaux sauvages. » Comme tous les ans, pour les fêtes, parallèlement au Cirque d’hiver Bouglione, Pinder a pris ses quartiers sur la pelouse de Reuilly, à Paris, aux côtés d’Arlette Gruss et de Phénix.
« Nous avons choisi de ne plus présenter d’animaux depuis 2002, mais il y a de la place pour tout le monde, affirme Alain Pacherie, directeur de Phénix. A nous trois, Pinder, Gruss et moi, nous vendons les samedis et dimanches 30 000 billets par jour. S’il y a des troupes avec animaux, c’est qu’il y a des spectateurs pour les voir. C’est la loi de l’offre et de la demande. Il faut arrêter d’être simpliste. Il n’y a pas d’un côté les gens vertueux qui aiment les animaux, et de l’autre les méchants dompteurs de cirque. »
« Le cheval n’est plus un agrès ou un accessoire »
Chez les contemporains, Barol d’Evel tourne Bestias avec deux chevaux et des oiseaux ; Romanès propose un numéro de trapèze avec Rani, le chat de la famille, dans Les nomades tracent les chemins du ciel ; la compagnie de cirque équestre Pagnozoo a fait appel à la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois pour sa nouvelle production, J’accrocherai sur mon front un as de cœur. Quant à Rasposo, il joue La Dévorée, sur le thème de Penthésilée, avec trois lévriers afghans. « Ce sont des instants de vie que nous mettons en scène avec des animaux, chèvres ou chiens, qui partagent notre quotidien, explique Marie Molliens, de Rasposo. Il faut arrêter de penser que, comme au XIXe siècle, les animaux sont maltraités dans les troupes traditionnelles comme contemporaines. Il y a des lois très strictes, des contrôles sanitaires réguliers. »
Le retour, modeste, des animaux domestiques dans le cirque contemporain suscite nombre de commentaires. Mais la présence de fauves passe encore moins. Lorsqu’en 2013 Marie Molliens se met en scène avec un de ces félins dans Morsure, elle se heurte à une opposition du milieu. « La polémique a été intense, se souvient Marc Jeancourt. Il faut se rappeler que l’absence de bêtes sauvages dressées a été le marqueur esthétique et éthique du nouveau cirque au début des années 1980. C’était la distinction majeure et un vrai point de repère. Transgresser cette interdiction était juste impossible. » Pour tourner en Europe, Marie Molliens a dû remplacer le tigre par un… acrobate. « Il est temps aussi que le cirque contemporain se libère de ses propres conventions », glisse-t-elle.
Si les lions et les tigres n’ont fait leur apparition sur la piste qu’au XIXe siècle, les chevaux sont en revanche à l’origine du cirque moderne, fondé au XVIIIe par l’écuyer Philip Astley. Aux côtés aujourd’hui des historiques – le traditionnel Alexis Gruss et les contemporains Zingaro, Pagnozoo et Théâtre du Centaure –, on compte une trentaine de compagnies équestres, dont beaucoup sont apparues depuis cinq ans. « Cela va de pair avec le besoin de nature que l’on peut observer un peu partout, pointe Guy Périlhou. Les artistes veulent explorer la part du sauvage en eux et se tournent vers les chevaux. »
« Il y a aussi, parallèlement à ce retour à la terre, un désir de renouer avec l’histoire et le patrimoine de l’art équestre et du cirque, ajoute Julien Rosemberg, codirecteur, avec Célia Deliau, du Pôle national du cirque et arts de la rue d’Amiens. Le cheval n’est plus un agrès ou un accessoire, il est considéré comme une personne. » Pour soutenir cette lame de fond, le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne met actuellement au point un certificat Cirque équestre, qui permettra à certaines compagnies, comme Pagnozoo, de former des artistes dans cette discipline.
Interdictions prononcées
Mais le mouvement animaliste se durcit. Les animaux domestiques commencent à entrer dans la ligne de mire des associations. La compagnie contemporaine Baro d’Evel et ses deux chevaux, son corbeau et ses perruches n’ont pas pu se produire ni à Madrid ni à Rome, après des interdictions prononcées en novembre 2016 et décembre 2017. Le festival de Prague, qui les accueillera à l’été 2018, a demandé aux deux metteurs en scène d’écrire un texte sur leur travail pour désamorcer les tensions.
« Que la société s’interroge à propos du bien-être animal est sain, mais interdire les animaux sur scène ne tient pas compte de l’évolution de la profession et de l’avancée des pratiques, affirme Camille Decourtye, de Baro D’Evel. Dans nos spectacles, les chevaux et les oiseaux sont libres : ils entrent et sortent seuls de scène. Il y a une part d’improvisation, car nous n’utilisons pas de méthodes qui viseraient à les mécaniser. Nous cherchons plutôt à inventer avec eux un langage commun. Un animal qui travaille n’est pas forcément victime d’une aliénation. »
Si les capitales européennes s’enfièvrent, Paris reste calme. Depuis six mois, l’adjointe au maire chargée de la biodiversité, Pénélope Komites, planche sur une mission « Animaux en ville », relative à la place de l’animal pour les particuliers comme pour les cirques. Les conclusions seront rendues au printemps 2018. Sans attendre, le Conseil de Paris a voté le 13 décembre un « vœu » souhaitant que « la capitale s’engage pour une ville sans animaux sauvages dans les cirques, à une échéance à préciser avec l’Etat et les circassiens ». Cet engagement a été pris après l’incident qui a coûté la vie à une tigresse échappée d’un cirque parisien, le 24 novembre. Sa mort avait suscité un torrent de protestations. La mairie souhaiterait une concertation rapide avec les artistes de cirque et l’Etat, décisionnaire sur le sujet. En attendant, Pinder, Gruss, Bouglione et les autres accueillent les spectateurs pour les fêtes.
Les nomades tracent les chemins du ciel, du cirque Romanès. Square Parodi, Paris 16e. Jusqu’au 7 avril 2018. De 10 à 20 euros. Tél. : 01 40 09 24 20.
J’accrocherai sur mon front un as de cœur, de la compagnie Pagnozoo. Espace cirque, Antony (Hauts-de-Seine). Jusqu’au 23 décembre. De 10 à 20 euros. Tél. : 01 41 87 20 84.
Bestias, de la compagnie Baro d’Evel. Espace cirque, Antony (Hauts-de-Seine). Du 19 janvier au 4 février 2018.




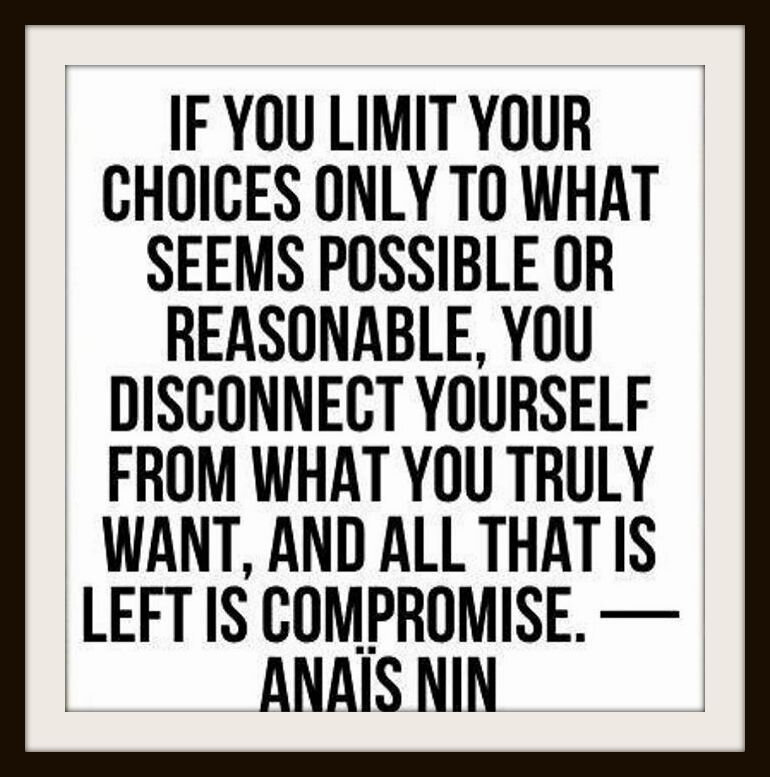


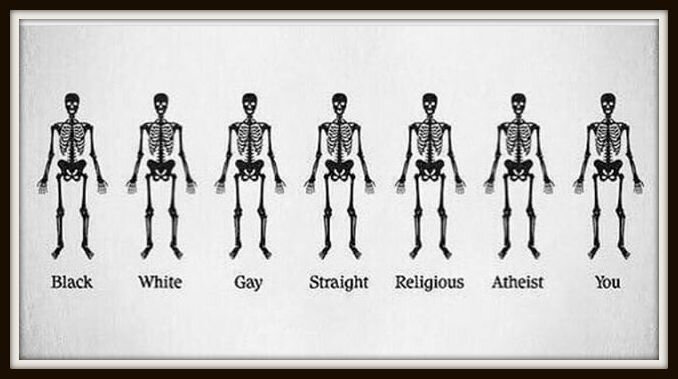


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)