A Paris, Edouard Philippe tente de calmer le jeu avant les municipales
Par Denis Cosnard
Le premier ministre a reçu Benjamin Griveaux et ses concurrents malheureux à l’investiture LRM pour, selon des proches, « faire retomber la tension ».
A tous ceux qui le pressent depuis des mois d’être candidat à la Mairie de Paris, Edouard Philippe a longtemps répété : « Je suis à Matignon. Les municipales, ce n’est pas mon actualité. » Ces deux dernières semaines, le premier ministre a cependant dû plonger dans le chaudron bouillonnant de la politique parisienne. Non pas comme candidat, mais comme pompier.
Mercredi 31 juillet, il a longuement reçu Benjamin Griveaux, son ancien ministre désigné par La République en marche (LRM) pour les prochaines élections municipales dans la capitale. Un rendez-vous qui n’était pas inscrit à l’agenda officiel. L’ex-porte-parole du gouvernement a effectué pour l’occasion un aller-retour depuis ses vacances en Bourgogne.
« Nous avons notamment discuté des rapports entre Paris et l’Etat, aujourd’hui dégradés, précise Benjamin Griveaux. On ne peut pas continuer à dire tous les matins, comme Anne Hidalgo : “C’est la faute du préfet, du ministre, etc.” Il faut sortir de cette défiance mortifère. Le prochain maire devra renouer une relation normale avec le gouvernement. »
Durant les quinze jours précédents, Edouard Philippe s’était déjà entretenu avec deux des concurrents malheureux de Benjamin Griveaux dans la course à l’investiture, les députés Hugues Renson et Cédric Villani, ainsi que l’a indiqué Le Canard enchaîné. Le premier ministre a revu le mathématicien, élu de l’Essonne, mercredi matin, à l’occasion d’une visite aux Ulis. Une rencontre discrète a également eu lieu à Matignon avec Pierre-Yves Bournazel, un député de la droite macroniste qui veut se présenter sans étiquette partisane à la Mairie de Paris.
« Faire retomber les tensions, en écoutant chacun »
Objectif d’Edouard Philippe : « Faire retomber les tensions, en écoutant chacun », confie un de ses proches. « En tant que chef de la majorité, il doit parler à tous et calmer le jeu quand il le faut », ajoute un autre.
Or c’est peu dire que les tensions sont fortes. Après des mois d’une compétition interne de plus en plus vive, l’investiture accordée le 10 juillet par la direction de LRM aurait dû aboutir à ce que tous les partisans parisiens d’Emmanuel Macron se regroupent derrière Benjamin Griveaux. Et qu’ils se mettent en ordre de bataille pour faire tomber la maire socialiste, Anne Hidalgo, en mars 2020.
Tel n’est pas le cas. Le 10 juillet au soir, il n’a pas été possible d’obtenir la traditionnelle poignée de mains entre anciens concurrents ni la « photo de famille » montrant l’unité retrouvée. Cédric Villani, le principal rival de Benjamin Griveaux, n’a au contraire pas caché son dépit. Son sentiment que les dés étaient pipés de longue date en faveur du favori de l’Elysée. Son amertume devant le retour des « habitudes d’appareil » au sein d’un mouvement censé « faire de la politique autrement ». Au lieu de féliciter son concurrent, le scientifique a laissé planer le doute sur ses intentions, y compris sur une possible candidature dissidente.
La colère aurait pu retomber. C’est alors qu’a explosé une petite bombe : la publication par Le Point, le 17 juillet, de propos tenus en privé par Benjamin Griveaux quelques semaines plus tôt. L’ancien ministre était semble-t-il dans un taxi et téléphonait à un interlocuteur auprès duquel il s’est lâché, qualifiant tous ses concurrents d’« abrutis ». Hugues Renson ? Un « fils de pute ». Mounir Mahjoubi ? « Bon… no comment. » Cédric Villani ? « Il n’a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir les balles, il va se faire désosser ! » Quant à Pierre-Yves Bournazel, Benjamin Griveaux s’est vanté de le tenir « par les couilles »…
Un homme sûr de lui, arrogant
Qui a enregistré cette discussion ? Comment s’est-elle retrouvée dans la presse ? Mystère. Malgré le caractère clandestin de l’enregistrement, Benjamin Griveaux n’a pas l’intention de porter plainte, ce qui aurait pu permettre d’y voir plus clair. Seule certitude : cette grosse « boule puante » a produit de l’effet. Pareils propos ont conforté dans leur opinion tous ceux qui voient en l’ancien ministre un homme sûr de lui, arrogant, un Janus capable d’être aussi violent qu’il peut se montrer charmeur. « En privé, il peut être colérique et parler vraiment comme cela », témoigne un de ceux qui ont eu maille à partir avec lui.
Le candidat a beau s’être immédiatement excusé auprès de tous ceux qu’il avait maltraités, l’affaire a aussi compliqué les retrouvailles au sein de LRM. Le lendemain, aucun de ses ex-rivaux ne participait au meeting de lancement de sa campagne.
Quelques jours plus tard, Cédric Villani et Benjamin Griveaux ont fini par se revoir dans un café, chacun avec un proche. Sans enterrer la hache de guerre pour autant. Ce n’est qu’en septembre que le scientifique compte dévoiler ses batteries. « Toutes les hypothèses peuvent être envisagées », glisse-t-on dans son entourage. Pas question de rallier Anne Hidalgo. En revanche, l’idée de listes dissidentes n’est pas écartée. Surtout, Cédric Villani pourrait constituer un recours si, à la rentrée ou à l’automne, Emmanuel Macron et les dirigeants de LRM jugent que Benjamin Griveaux ne fait pas l’affaire et qu’il faut changer de candidat, avancent certains.
Simples péripéties
Pour l’heure, l’ex-ministre assure que ces péripéties ne perturbent guère sa campagne. N’a-t-il pas intégré dans son équipe Benjamin Baudry, un proche de Mounir Mahjoubi ? Affiché sa proximité avec Delphine Bürkli, la maire (ex-LR) du 9e arrondissement ? Déposé des cartes postales dans plus de 1 million de boîtes à lettres, pour inciter les Parisiens à lui souffler des idées ? Ceux qui voudraient être candidats sur ses listes ont jusqu’au 15 août pour se faire connaître.
D’autres se montrent plus sévères. « Ça patine », observe un soutien de Cédric Villani. « Les sondages sont clairs : Benjamin Griveaux séduit à droite, mais ne plaît pas aux quartiers populaires de l’est et ne paraît donc pas en mesure de gagner Paris, surtout sans alliance », estime Anne Lebreton, une ancienne candidate à l’investiture qui a rejoint le mathématicien.
« Au sein même de LRM, il y a une sérieuse interrogation sur la capacité de Benjamin Griveaux à rassembler, confirme une figure parisienne de la macronie. A lui de fournir rapidement des preuves qu’il peut gagner. » Sinon, l’hypothèse Villani risque de revenir en force. Mais aussi celle d’une candidature d’Edouard Philippe, puisque celui-ci n’a jamais exclu formellement ce scénario et qu’il suit le dossier de très près.




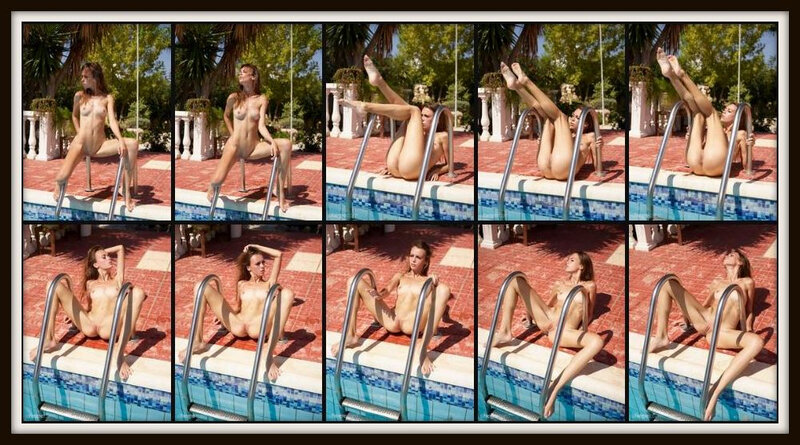







/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)