Entretien - Jean-Marie Delarue : « Au nom de la sécurité, toutes nos libertés sont menacées »
Par Louise Couvelaire
Le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme estime, dans un entretien au « Monde », que les libertés fondamentales sont en « très mauvais état » en France.
Jean-Marie Delarue, 74 ans, nommé le 10 avril à la tête de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), a consacré sa vie à la défense des libertés fondamentales. Pour le conseiller d’Etat, ex-directeur des libertés publiques au ministère de l’intérieur (de 1997 à 2001) et ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté (de 2008 à 2014), elles sont aujourd’hui en danger. Nommé pour un mandat de trois ans, le haut fonctionnaire, un temps président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, entend faire entendre sa voix.
Dans quel état sont les libertés fondamentales en France ?
En très mauvais état. En apparence, nous sommes un Etat de droit, et l’on s’en flatte assez, nous avons un corpus juridique étoffé, des juges chargés de protéger nos libertés… En apparence, rien de tout ça n’est menacé.
Dans la réalité, c’est autre chose. Au nom de la sécurité, toutes nos libertés le sont. On n’arrête pas de nous dire que « la sécurité est la première de nos libertés », selon une formule désormais consacrée. C’est faux ! La sécurité est éventuellement l’une des conditions de notre liberté. Cet aphorisme est une dangereuse illusion qui pousse depuis plusieurs décennies les gouvernements à grignoter nos libertés toujours davantage.
Depuis quand ?
Le point de départ est la loi Peyrefitte de 1981, qui portait un nom prémonitoire, « Sécurité et liberté ». La démocratie était-elle alors désarmée face au terrorisme ? Au point qu’il soit nécessaire de légiférer ? Personne ne se pose la question, alors que la réponse me paraît claire : nous n’avions pas besoin de nouvelles lois pour mettre en prison des terroristes. Et ça n’est pas plus le cas aujourd’hui.
Quelles sont les conséquences ?
Par ces lois nouvelles, on installe une distinction entre le français ordinaire, qui a tous les droits, et le français suspect, qui a droit à des procédures particulières, à des juges particuliers… Cette dernière catégorie ne cesse de s’élargir. D’abord les musulmans avec l’Etat d’urgence permanent, puis les « gilets jaunes » avec la loi dite anti-casseurs. Désormais, il suffit de se trouver dans les environs d’une manifestation pour devenir un français suspect faisant l’objet de mesures extraordinaires, comme des fouilles.
Il est par ailleurs très inquiétant de voir des gouvernements donner toujours raison à leur police. Les policiers sont des gens très estimables, mais comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs et avoir tort. La façon dont a été traité le journaliste Gaspard Glanz est de la même façon totalement anormale. Quarante-huit heures de garde à vue, ça n’était évidemment pas nécessaire, vingt-quatre heures auraient suffi.
Il faut faire attention : c’est à l’aune dont on traite ces personnes que se juge une société. La majorité des Français croit que cela ne les concerne pas et qu’il existe un rideau étanche, or ce n’est jamais le cas. La frontière est toujours beaucoup plus fragile qu’on l’imagine. Ce n’est pas parce que l’on croit que cela ne regarde que les musulmans, les « gilets jaunes » ou la presse qu’il ne faut pas s’en émouvoir.
Vous estimez que les Français ne s’en émeuvent pas assez ?
Non. Et c’est aussi ce qui m’inquiète beaucoup. Il y a trente ans, lorsque l’on touchait à une liberté fondamentale, des pétitions circulaient, des intellectuels s’indignaient, des citoyens se mobilisaient… Aujourd’hui, à l’exception de la déchéance de nationalité annoncée en novembre 2015 par François Hollande et de la rétention de sûreté voulue par Nicolas Sarkozy en 2008, on entend peu de protestations.
En ce qui concerne les migrants, les ONG ont été les seules à « sauver l’honneur de l’Europe en Méditerranée », comme l’a déclaré au Monde mi-avril le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), Pascal Brice. C’est grave ! Comme si toutes ces lois successives avaient fini par tétaniser la protestation, comme si tout cela n’intéressait pas l’opinion.
Quel est le risque ?
Les droits de l’homme, ce n’est pas un machin qu’on met en avant de temps en temps comme une cerise sur le gâteau, ce n’est pas une décoration, ni un sapin de Noël qu’on installe une fois par an, c’est la base de tout. Il ne faut pas les poser comme des principes du passé, mais comme des principes d’avenir, comme le socle sur lequel construire de nouvelles libertés. Les droits de l’homme doivent s’appliquer à tous, en tout temps et en tout lieu. Or, on en est loin.
S’il n’y a pas de voix qui s’élèvent pour incarner ce que nous prétendons être, il n’y a aucune raison pour que la France résiste mieux que les autres pays à la tentation de renoncement à nos grandes libertés, à laquelle les gouvernements successifs ont déjà en partie cédé. Avec notre système de protection sociale, c’est pourtant ce qui nous différencie du reste du monde. Si nous abandonnons cela, nous nous renierons.
Quelle est votre feuille de route à la tête de la CNCDH ?
La CNCDH est une voix pour exprimer ces inquiétudes. C’est ce qui me motive. Sa voix ne porte pas assez, et c’est regrettable, c’est pourtant une voix indépendante, celle de la société civile. Les dangers les plus graves pour la dignité humaine se situent souvent dans les interstices que personne ne voie.
Notre rôle, à la CNCDH, est de voir où se cachent les indignités. On peut saisir les Nations unies, on peut témoigner devant le Conseil constitutionnel – ce que nous avons fait au sujet de la loi dite anti-casseurs. Par nos avis, nous essayons de faire réfléchir les pouvoirs publics. Il est d’ailleurs regrettable de voir que depuis quinze ans le gouvernement saisit rarement la CNCDH en amont lorsqu’il réfléchit à des projets de lois. Nous ne sommes pas des imprécateurs mais des lanceurs d’alerte.
Comment allez-vous travailler avec le Défenseur des droits, qui, lui, a une autorité constitutionnelle ?
Ce qui m’intéresse, c’est qu’on aille dans le même sens. Je vais rencontrer Jacques Toubon début mai. Chacun a son rôle. Le Défenseur des droits fait écho aux plaignants, la CNCDH à la société civile. Nous sommes complémentaires, pas concurrents.











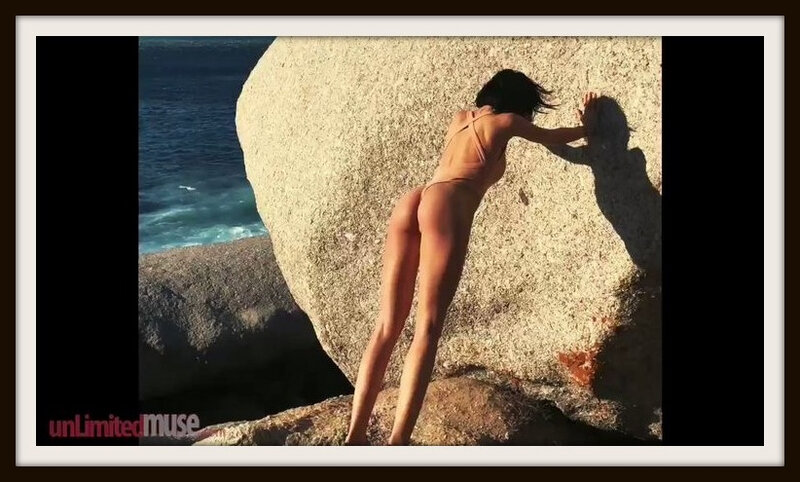










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)