Emmanuel Macron, fragile homme fort d’une UE convalescente
Par Cécile Ducourtieux, Bruxelles, bureau européen, Philippe Ricard, Jean-Pierre Stroobants, Bruxelles, bureau européen - Le Monde
Le président français est devenu un interlocuteur incontournable sur la scène européenne, mais sa capacité à convaincre sur de grandes réformes reste à démonter.
« France is back » : c’est indéniable sur la scène internationale, cela l’est aussi au niveau européen, surtout depuis qu’Angela Merkel tente de sauver son poste. Après un sommet avec Theresa May, la veille au sud de Londres, le président de la République Emmanuel Macron devait accueillir la chancelière à l’Elysée vendredi 19 janvier, pour parler de « l’avenir de l’Union européenne ». Quand il s’agissait d’adopter des décisions importantes, en pleine crise grecque ou au plus fort des tensions sur la migration, tout le monde prenait l’avion pour Berlin…
Autre symbole : c’est depuis l’ambassade du Portugal à Paris, que le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem a passé le témoin à Mario Centeno, nouveau président de l’Eurogroupe, vendredi 12 janvier. « Un hasard de calendrier », assure t-on dans l’entourage du ministre portugais des finances, mais un hasard très significatif. Tout comme la visite de Sebastian Kurz à Paris, le même jour. Le jeune chancelier autrichien, venu réitérer ses engagements proeuropéens alors qu’il a formé une coalition avec l’extrême droite, s’est aussi rendu Berlin. Mais cinq jours plus tard.
L’Europe était au cœur du programme du candidat Macron, et il assume aujourd’hui cette responsabilité de nouvel « homme fort » d’une Union toujours divisée et ébranlée par le Brexit. Il a multiplié les interventions – à d’Athènes sur la démocratie européenne, à la Sorbonne pour formuler des dizaines de propositions de réformes –, ou prôné une intégration plus poussée de la zone euro.
« Regardez notre époque, en face (…). Vous n’avez pas le choix ! », lançait t-il, lyrique, depuis la Sorbonne « à tous les dirigeants d’Europe ». Le chef de l’Etat défendait une Europe « à plusieurs vitesses » permettant d’avancer à quelques-uns sans être paralysée par d’autres, tout en plaidant pour le réveil une Union « trop faible, trop lente, trop inefficace ». « Au début il nous a fait un peu peur, témoigne un diplomate bruxellois. On craignait qu’il accentue les divisions, avec l’Est notamment. Mais il est très important qu’il soit là, on avait vraiment besoin que le moteur franco-allemand redémarre. »
Infléchir l’agenda européen
Au-delà des discours, M. Macron a su infléchir l’agenda européen. Si les premières pages du préaccord de coalition en Allemagne sont consacrées à l’Europe, c’est parce qu’il a donné une impulsion décisive à l’idée de relancer la convergence – en panne – entre les économies de la monnaie unique. Ou de les doter d’instruments de stabilisation budgétaire communs en cas de nouvelle crise. Des idées qu’il reste à négocier dans les détails avec Berlin et les autres capitales.
Fin octobre, après un travail de lobbying intense et avec le soutien de la Commission Juncker, le président a réussi à convaincre des pays de l’Est – sauf quatre, dont la Pologne et la Hongrie – d’adopter au conseil une révision de la directive sur le travail détaché. Un accord doit encore être trouvé avec le Parlement européen mais ce passage en force a constitué un premier succès très symbolique.
Ses appels répétés à la naissance d’un embryon de défense européenne, ont aussi payé. Dans ce domaine, il a pu célébrer il y a quelques semaines le projet de « coopération structurée permanente », qui devrait permettre de lancer des programmes communs d’armement, de combler une série de lacunes d’équipement ou de faciliter le lancement d’opérations extérieures. On est encore loin, cependant, des projets présidentiels – une force d’intervention et une doctrine militaire voire un budget communs.
M. Macron a aussi défendu la création d’une taxe sur les géants de l’Internet et une remise à plat de la politique commerciale de l’Union. Mais, là, les résistances sont fortes : le Luxembourg, l’Irlande ou les Pays-Bas freinent sur la fiscalité, soucieux de préserver leur modèle économique. La Suède et les Pays-Bas s’inquiètent aussi de sa demande d’une surveillance des investissements chinois dans l’UE et redoutent le retour de réflexes « protectionnistes ».
Effacement d’autres leaders européens
Les autres dirigeants ne sont donc pas tous prêts à suivre leur jeune collègue, mais ils l’écoutent avec attention. Même son idée de conventions démocratiques, qui suscitait le scepticisme, fait des émules. La Belgique, le Luxembourg ou l’Irlande évoquent des initiatives au printemps. L’attribution à Paris du siège de l’Agence bancaire européenne, même si elle tient beaucoup du hasard (Dublin a perdu au tirage au sort), a aussi renforcé l’impression que la France et ses réseaux étaient à nouveau incontournables.
Emmanuel Macron profite de l’effacement d’autres leaders européens, à commencer par Mme Merkel, victime de l’usure du pouvoir après douze ans aux responsabilités et son revers électoral de septembre 2017. Son approche très « austéritaire » de la crise des dettes souveraines a été mise en cause dans le Sud de la zone euro. Le choix de M. Centeno pour présider l’Eurogroupe, le gouvernement officieux de l’eurozone, est symptomatique de ce rejet. Les positions en matière migratoire de la chancelière, à l’origine d’une controverse sur le dispositif de répartition des demandeurs d’asile au sein de l’UE, ont braqué la plupart des pays d’Europe centrale.
A Londres, la première ministre Theresa May est marginalisée en raison du Brexit. A Rome, le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni est confronté, en vue des législatives du 4 mars, au Mouvement 5 étoiles et au retour de la droite berlusconienne. A Madrid, Mariano Rajoy doit lutter pour préserver l’unité de l’Espagne face aux velléités indépendantistes de la Catalogne. « Macron est devenu influent par défaut ; il remplit le vide, mais cette position ne sera pas facile à maintenir s’il ne se trouve pas des alliés solides, analyse Sébastien Maillard, directeur du laboratoire d’idées Notre Europe-Institut Jacques Delors. Sa capacité à convaincre reste à démontrer, même s’il sait imposer son agenda. »
Ce retour de la France aux avant-postes sera-t-il durable ? M. Macron aura-t-il, entre autres, la capacité de convaincre ses partenaires sur ses réformes de l’eurozone ? Si l’idée d’une capacité budgétaire spécifique fait son chemin, sa proposition d’un ministre des finances pour la zone euro est loin de faire l’unanimité et celle d’un parlement spécifique à l’eurozone paraît enterrée.
Sa « famille » politique européenne
Depuis sa victoire sur la candidate du Front national Marine Le Pen, le chef de l’Etat français surfe sur la menace de l’extrême droite pour mieux promouvoir son slogan d’une « Europe qui protège ». « Si l’extrême droite est là, c’est que nous avons échoué à répondre aux angoisses dont elle se nourrit », lançait-il lors de sa récente rencontre avec M. Kurz. D’où son insistance sur la nécessité d’une politique « humaine mais ferme » dans le domaine de la migration – avec une ambiguïté quant au principe des quotas de réfugiés, défendu par Bruxelles et Berlin.
Un autre test encore de l’influence française sera la capacité de M. Macron à peser sur les futures nominations des dirigeants de la Commission et du Conseil européens, en 2019. Le président n’a toujours pas choisi sa « famille » politique de rattachement au niveau européen, pourtant une nécessité pour avoir son mot à dire.
Rejoindra t-il le groupe des Libéraux et démocrates (ALDE) ou lancera t-il son propre « En Marche » européen, en tentant de siphonner le Parti populaire (PPE, celui de Merkel) et le Parti social-démocrate ? Il pourrait compter sur le soutien des trois premiers ministres libéraux du Benelux mais fera-t-il le poids si l’Italie bascule à droite ? Et saura t-il résister à l’offensive des gouvernements populistes polonais et hongrois qui contestent les valeurs de la démocratie libérale sur lesquelles est fondée l’Union ?
Pour que son président soit totalement crédible, il faudra par ailleurs que la France affiche enfin, et durablement, un déficit public inférieur à 3 % de son PIB (c’est bien parti pour 2017, à confirmer pour 2018). Et si Mme Merkel échoue à former une nouvelle grande coalition avec les sociaux-démocrates, ce qui entraînerait de nouvelles élections, la « fenêtre » pour des réformes d’importance avant les élections européennes de mai 2019 se refermera.


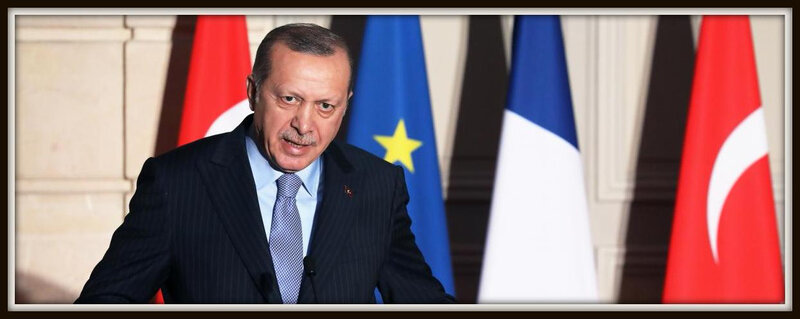










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)