La culture est-elle encore une affaire d’Etat ?
En arrière-plan, l'immeuble abritant le ministère français de la culture, à Paris le 26 juin 2014. Photo Pablo Porciuncula. AFP
Si dans les coulisses du pouvoir on se bagarre pour occuper la fonction ministérielle, on ne trouve personne aujourd'hui pour imaginer à quoi peut ressembler une administration culturelle nationale, digne de la patrie des Lumières.
D’où vient cette impossibilité dans notre pays de repenser sereinement les rapports entre l’art et le pouvoir ? Mais s’ils sont nombreux à les commenter aucun artiste et homme politique vivant n’imagine les reformuler sans l’existence de ce totem qu’est le ministère de la Culture. Comme si la France éternelle sommeillait en son sein, rassurée de savoir que l’Etat et la Nation ne font qu’un.
Pourtant cette administration républicaine imaginée en 1881 (l’artiste Antonin Proust fut le tout premier secrétaire d’Etat aux Beaux-arts) souffre en silence de douter de son utilité ; de ne jamais savoir si sa mission est anecdotique, mystique ou politique. Elle étouffe maintenant dans une technostructure digne de Kafka sans que personne en haut lieu ne s’en offusque. Quant à l’art qui tout de même la justifie il y a belle lurette que son épanouissement et son accès empruntent d’autres voies que celles imaginées en son temps par André Malraux, premier ministre d’Etat chargé des affaires culturelles sous la Ve République.
Artistes, intellectuels, et professionnels de la culture, conscients des vertus de l’action artistique dans un monde si consumériste et matérialiste, s’agitent régulièrement pour plaider une grande politique publique de la culture. On dirait juste que plus personne n’y croit. Que par le jeu d’un marché protéiforme et débridé l’art et la création se sont affranchis des valeurs de la République ; que la capacité des œuvres à permettre le «dépassement» n’est plus sollicitée par le sommet de l’Etat. Parfois dans le regard de ceux qui nous gouvernent, l’objet même de culture est devenu extravagant. Alors on fait comme si. Comme confier à l’actuelle ministre de la Culture un portefeuille amputé de la tutelle du livre et auprès de qui des personnalités éclairées comme Erik Orsenna ou Stéphane Bern jouent, sans moyens, les «ministres bis» dans leurs couloirs de compétences respectifs.
On «oublie» même de nommer à la tête des grandes administrations des Archives, du Patrimoine ou de la Création artistique du ministère des directeurs de plein exercice. Comment un chef de l’Etat apparemment préoccupé par les choses de l’esprit peut-il, sans y réfléchir à deux fois, réduire une politique culturelle à un «pass culture» dont chacun sait qu’il est le moyen le plus insidieux de favoriser plus encore la consommation de divertissements chez les plus jeunes ?
Voilà des années que les héritiers de Malraux, enivrés par le symbole et la noblesse de la tâche, se cassent les dents devant ce qui les attend. Depuis le début de la Ve République ils sont très exactement vingt ministres à avoir été possédés par le dessein de mener à bien une politique culturelle. Ou tout au moins de permettre à la France et aux Français de s’enorgueillir de ses créateurs et, pour ceux qui en ont les moyens, d’accéder à leurs bienfaits. Mais au nom de quel principe un ministère de la Culture aurait-il à célébrer un talent qui pour l’essentiel a été déniché voire financé par d’autres et qui parfois ne doit rien à personne ? Il en faut du sentiment patriotique, assumé ou non, pour accepter que l’Etat récupère à son compte les milliers d’actions artistiques qui fleurissent sur le territoire national.
Pour relativiser l’importance du ministère de la Culture, rappelons que De Gaulle installa son «ami génial» à sa tête pour, avant tout, le savoir à ses côtés. Sa présence le rassurait et permettait au demeurant à la République gaulliste de faire bon ménage avec le monde des artistes pour l’essentiel inféodés au parti communiste d’alors. Mai 68 mettra fin à cette chimère. Depuis, le ministère de la Culture n’aura tressailli qu’une seule fois : en 1981, quand la gauche mitterrandienne, persuadée qu’elle allait «changer la vie», constate qu’un ministre issu du sérail théâtral prend au mot ce slogan électoral et se met à œuvrer. Jack Lang aura été le dernier à incarner ce que Malraux appelait en son temps «le royaume farfelu de la rue de Valois». Malgré le talent de quelques-uns de ses successeurs, le ministère de la Culture s’est épuisé à administrer ce qui pouvait l’être, gérer des programmes en lieu et place des hommes et des idées, pire encore laisser croire qu’il disposait d’un pouvoir supranational pour faire battre en retraite les pourvoyeurs de loisirs télévisuels mondialisés. Malgré une impuissance politique constatée, on se bagarre encore dans les coulisses du pouvoir pour occuper la fonction, mais on ne trouve personne pour se préoccuper de sa raison d’être et, mieux encore, d’imaginer à quoi peut ressembler aujourd’hui une administration culturelle nationale digne de la patrie des Lumières. Et s’il était désormais impossible de mener une politique culturelle d’Etat ?
Tout semble aujourd’hui le laisser penser et ce, pour au moins cinq raisons : parce qu’en cinquante ans l’Etat a paradoxalement beaucoup fait et qu’il est difficile d’en faire plus ; que les institutions culturelles créées par sa volonté sont si réglementées qu’il s’avère impossible de les faire évoluer ; que dans son ensemble l’activité artistique et culturelle nationale relève d’une économie où les collectivités territoriales, des PME ou associations dédiées et des entreprises mécènes en sont les acteurs primordiaux ; que l’industrie culturelle et audiovisuelle planétaire est si dominante, si intrusive que plus aucune contrainte nationale ne l’empêchera désormais de faire ce qu’au siècle dernier la philosophe Hannah Arendt prédisait à savoir «transformer l’art en divertissement» ; qu’enfin et c’est peut-être l’essentiel, aucun président de la République depuis François Mitterrand ne pense plus sérieusement qu’une augmentation du budget du ministère de la Culture réglera le problème d’une absence de politique culturelle.
Puisque l’Etat a un bilan ; que dans leur grande majorité les créateurs sont désormais dans une économie artistique si diversifiée qu’elle échappe à une tutelle nationale ; que les institutions culturelles n’ont d’autres préoccupations que de retrouver des marges de liberté pour se renouveler, qu’enfin ce monde-là souffre plus que d’autres de ne jamais en finir avec les querelles d’ego, les guerres picrocholines et les effets d’annonces, pourquoi ne pas en profiter pour suggérer à l’Etat d’appliquer au pied de la lettre cette formule habile de Régis Debray : «Ce qui nous rassemble est ce qui nous dépasse» ? On verra alors qu’il y a matière à se surpasser.
Jean-Michel Djian est l’auteur de la Politique culturelle, la fin d’un mythe, Folio/Gallimard, 2005.
Jean-Michel Djian journaliste et essayiste
Entretien : Sylvain Tesson : « Éteignez tout et le monde s’allume ! »
Par Nicolas Truong - Le Monde
Vivre déconnecté. Pour l’écrivain et voyageur Sylvain Tesson, fuir le monde numérisé est vital pour retrouver l’espace et le temps, le silence et la durée, et faire l’expérience du sensible au cœur d’une réalité qui n’a pas besoin d’être augmentée.
Puisque le dispositif numérique dicte nos manières de vivre, l’écrivain Sylvain Tesson estime qu’il faut emprunter des lignes de fuite, chemins, forêts, grottes ou galeries, afin de vivre la vraie vie, loin du monde siliconé.
Que cherchez-vous à fuir lorsque vous partez au bord du lac Baïkal, sur les chemins de la retraite de Napoléon en Russie ou bien dans les steppes du Kirghizistan en side-car ?
Se carapater en des lieux retirés (« les déserts » de Port-Royal) offre deux évitements : son propre reflet et ses semblables. Toute échappée arrache à l’ennui du narcissisme et aux carnavals des masses. C’est ce que je cherche sur les parois, dans les grottes, au fond des bois : des arrière-postes où règne la possibilité du silence. Une carte d’un monde de 8 milliards d’êtres humains mobiles et connectés se dessine. La majorité des hommes vivra dans des villes-mondes où personne ne s’occupera de savoir d’où viennent les choses qu’il mange ni les êtres qu’il côtoie. Le monde se brouille.
Cette redistribution de l’homme à la surface du globe est peut-être appréciable, mais nous sommes quelques-uns à la goûter fort peu. Miroir de cette mise sous tension de la terre, surgit un archipel de sémaphores, de vires aériennes, de clairières, de refuges, de relais de chasse : ce sont des ZAD, « zones affectées à la dissimulation », où l’on pourra accomplir de très vieux gestes : regarder le ciel, faire de la minéralogie, se tenir à une table et converser longuement, en fumant, sans faire de gestes, ni consulter un écran. Vivre quoi ! Il faut connaître cette nouvelle géographie. C’est la géographie de la ruine contre celle du hub. Le vallon non siliconé contre le glacis. Là, seront respectées deux hautes et indépassables vertus auxquelles l’homme de 2018 a déclaré la guerre : le silence et la distance.
Quelles sont les manifestations sensibles de cette « immense souricière de coercition », comme vous l’écrivez, construite par la société numérique à laquelle vous cherchez à échapper ?
La première est la destruction du temps. Le trésor dont nous disposons est de traverser une journée avec une « idée fixe » pour reprendre la théorie d’Hector Berlioz sur la composition. Les sollicitations numériques pilonnent le temps. Le numérique est le Waterloo de la durée. Mais le plus immonde dans le dispositif, c’est que la machine commence à nous influencer, nous contrôler, nous requérir. Elle s’impatronise sous le manteau de nos vies.
N’appréciant pas le colonel Kadhafi, je ne vois pas pourquoi je mettrais dans ma poche un petit dictateur à puce de silicium qui m’intimerait de répondre, me sonnerait en valet, me dicterait où aller, que faire, quoi lire, comment me conformer, comment m’exprimer dans des limites « appropriées » et qui signalerait à une communauté virtuelle tout écart dont je serais coupable. Je pense que « Guillaume » Gates et monsieur [Mark] Zuckerberg sont des « criminels contre l’humanisme ». Un jour, parions-le, il y aura un tribunal pénal international où seront traduits ces dynamiteurs du charme de la vie. Ils ravagent, avec leurs breloques, le mystère organique, imprévu, violent, bizarre de la vie chatoyante.
Ne peut-il pas y avoir d’aventures numériques ?
Les démiurges de l’intelligence artificielle le croient. Ils croient nous entraîner vers une aventure enthousiasmante, un monde nouveau. Ils se voient en Christophe Colomb. Ils rêvent de nous augmenter. Mais qu’ils nous laissent nous déployer d’abord ! Les hackeurs aussi pensent vivre l’aventure. Ils veulent dynamiter la citadelle en menant leurs assauts contre les serveurs globaux. Mais les uns comme les autres, en ne vivant pas au soleil, en ne se contentant pas de la nature (sous leurs yeux déployée, sous leurs pieds saccagée), ne savent pas ce qu’ils perdent ! Car le soleil, notre dieu, est une réalité qui n’a pas besoin d’être augmentée.
L’aventure, c’est ce qui se vit dans l’éclat du jour, le plein-vent, l’amitié du sol et de ses fruits. C’est l’expérience du sensible, la vénération du visible, le charme de l’organique, le tressaillement de l’imprévu, bref, l’inverse de la vie sur écran. Je préfère le monde comme charmille peuplée d’oiseaux plutôt que comme Toile surveillée par des « voisins vigilants ». Caresser une peau, boire trop de vin, s’approcher du vide, regarder un crotale, renifler les fourmilières, embrasser une statue, demander à un pauvre cloche s’il veut boire un verre : voilà des choses aventureuses. Un iPhone ne les propose pas. Les démiurges de la Silicon Valley, qui « préparent l’avenir de notre civilisation » (Martine Aubry parlant de Steve Jobs), profitent du Pinocchio qui dort en nous. Pinocchio est le pantin faible. La fête foraine l’entraîne, sa bonne conscience le freine, les flonflons sont plus forts ! Les GAFA l’ont compris : l’homme est un Pinocchio qui cède à ses penchants. Il faut le reconnaître, il est plus facile, plus sympa de surfer vaguement sur le Web que de lire la description de la visite d’Eulalie à la tante de Marcel Proust le dimanche.
Etes-vous connecté lorsque vous voyagez ?
Oui, à fond ! Je pense aux morts que j’ai aimés, je me souviens d’un visage, je salue les bêtes que je croise, je palpe les roches, j’essaie de comprendre les tourments du paysage. Jadis, je buvais beaucoup de vin pour faire apparaître des spectres. Bref, connexion absolue ! L’ivresse, les souvenirs, l’imagination, la poésie, l’amour : c’est cela le wi-fi ! Eteignez tout et le monde s’allume.
Quelle est cette griserie recherchée qui s’oppose selon vous à la grisaille du confort et du conformisme contemporain ?
Cette griserie est une récompense. Le bilan comptable des journées au dehors. Je prends comme une victoire de me coucher en me disant : aujourd’hui je n’ai vu que de beaux paysages, j’ai regardé une couleuvre, j’ai croisé un vers de Hugo (« L’éternel est écrit dans ce qui dure peu »), je n’ai pas rencontré madame [Françoise] Nyssen qui veut « changer [ma] mentalité sur le terrain ». Voilà la griserie : des heures volées à la soumission et au brouhaha. Pour cela, la recette existe : le moindre chemin qui s’enfonce dans un bois, la moindre galerie entre les parois d’une bibliothèque, suivez-les !
En quoi l’aventure est-elle selon vous un « pas de côté » ?
Je me suis servi de l’expression quand je me suis installé dans une petite isba, dans la forêt, en Sibérie. Je me suis rangé sur le côté, sur la bande d’arrêt d’urgence. Et j’ai vécu comme je l’entendais. Loin de ma vie urbaine qui était un défilé du 14-Juillet permanent, en rang, au pas, sous l’œil de l’adjudant et au son du tambour.
L’aventure est-elle encore possible aujourd’hui, alors que les territoires semblent tous répertoriés, quadrillés, que les itinéraires sont presque tous balisés et que les individus sont géolocalisés par les outils de la télécommunication de notre modernité ?
Pas d’accord ! Tous les êtres humains ne sont pas « géolocalisés », il y a encore dans les ruelles de Naples de pauvres édentées non connectées qui chantent des mélopées très vieilles. Dans les canyons de l’Atlas, quelques Berbères ne captent pas les ondes mais connaissent l’emplacement des sources et les entrées des défilés.
« N’ÉCOUTONS PAS LES DÉFAITISTES QUI PENSENT L’AVENTURE TERMINÉE. ILS JUSTIFIENT LEUR PARESSE EN DISANT : “LE MONDE A LIVRÉ TOUS SES SECRETS, J’ARRIVE TROP TARD.” C’EST FAUX! »
A Paris, à Londres, des artistes vivent pour les 40 centimètres carrés de leurs toiles. Vingt pour cent des Français n’ont pas Internet. Beaucoup d’entre eux le vivent mieux que ne le pense le docteur [Laurent] Alexandre [chirurgien et entrepreneur qui promeut l’intelligence artificielle].
Le grand Pan n’est pas mort. Mais il s’est retiré, il faut le débusquer dans des interstices difficiles. Vivre des aventures est encore possible mais requiert l’amour du visible et une dose d’imagination. N’écoutons pas les défaitistes qui pensent l’aventure terminée. Ils justifient leur paresse en disant : « Le monde a livré tous ses secrets, j’arrive trop tard. » C’est faux ! J’ai rencontré Yvan Bourgnon, naviguant autour du monde sur un catamaran non ponté comme l’explorateur viking Erik le Rouge ! Il suffit de pousser les bonnes portes, de trouver des idées d’embarquement, d’accueillir les bons rêves. Alors, on pourra continuer l’aventure en récitant les vers « la nuit était fort noire et la forêt très sombre ».
Viser « l’intensification de l’existence » par le voyage et la mise à l’épreuve de soi, n’est-ce pas une autre façon de répondre à l’injonction du « dispositif », qui invite en permanence à se dépasser soi-même ?
Peut-être y a-t-il contradiction, je l’ignore. Il y a l’intensification par la diffraction telle que l’éprouve le voyageur frénétique. Il peut y avoir intensification par l’approfondissement. C’est à elle que j’aspire. Je m’agite, mais je suis un bateau avec pavillon d’attache. Je pars parce que j’ai un lieu où revenir. Je sais d’où je viens et vénère ce « quelque part » : un sol (le calcaire tendre du Bassin parisien), un paysage (la forêt d’Ile-de-France sous des ciels de pastel), une histoire (flèches gothiques, dômes d’or, portes défensives), un peuple des bords de Seine (noblesse d’Empire, bougnats et clochards, aristocrates parisiens, prolos gavrochiens). Je ne balancerai jamais mon port.
Comment pouvez-vous dire que les motards sont des « moines bouddhistes » ?
Comme le moine tibétain, le motard possède l’instrument de l’éternel retour. Le moulin à prières chez le premier, le moteur à explosion chez le second (en argot, moteur se dit moulin). Vous trouvez l’analogie tirée par les cheveux ? Moi aussi. Mais quand je roule sur mon « cheval funèbre » (André Pieyre de Mandiargues), j’entends la vibration des bielles, je visualise le remuement des pièces, j’imagine un monde en ordre, dont le fonctionnement entraîne l’explosion. Quand les kilomètres défilent, on ne pense à rien, on n’a besoin de personne. Extinction des désirs : pur bouddhisme !
Quelles sont les lectures contemporaines qui vous aident à fuir le dispositif ?
Presque contemporains : François Augiéras et sa mystique de la fugue. Joseph Delteil pour l’évasion stylistique. Proust pour la pathologie de l’appareil sensoriel ! Ponge pour l’amour du réel ! Mandiargues pour les fruits vénéneux ! Chardonne et Nimier pour l’affûtage des lames. Et les vers de Configuration du dernier rivage de Michel Houellebecq pour la musique d’un chagrin non violent.
N’est-ce pas une forme de grandeur, ou une geste perdue par l’Occident gouverné par des « assis », que vous cherchez à retrouver dans vos chevauchées et échappées nomades ?
Oui, voyager, c’est faire du théâtre. Un paysage pour décor. Une bonne virée un peu risquée comme intrigue. Des amis pour échapper aux amours. Et un peu de mise en scène pour le rêve éveillé. Enfin, une chute en guise de tombée de rideau.
===============
Sylvain Tesson est géographe, journaliste et écrivain. Membre de la Société des explorateurs français, il partage sa vie entre les expéditions au long cours, l’écriture et la réalisation de documentaires d’aventure. Ses nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine de récits, recueils de nouvelles et d’aphorismes. Il est notamment l’auteur de Sur les chemins noirs (Gallimard, 2016) ; avec Thomas Goisque, En avant, calme et fou (Albin Michel, 2017) ; Un été avec Homère (France Inter-Ed. des Equateurs, 252 p., 14,50 euros). Il a obtenu en 2011 le Médicis essai pour Dans les forêts de Sibérie (Gallimard) et a participé à l’ouvrage collectif « Philosophie de la marche » (L’Aube/Le Monde, 104 p. , 12 euros)..
Monde Festival : Les technologies doivent-elles faire le bien ? « Le Monde » organise dans le cadre du Monde Festival une rencontre avec Carlo d’Asaro Biondio de Google Partnerships, l’ancienne ministre de l’économie numérique Fleur Pellerin, Gérard Escher, de l’école polytechnique de Lausanne et le frère dominicain Eric Salobir. L’événement se tiendra samedi 6 octobre 2018 de 14 heures à 15 h 30 à l’Opéra Bastille (Amphithéâtre). Réservez vos places en ligne sur le site
Tribune - Marianne Durano : « Créer du lien, mais pas avec Mark Zuckerberg »
Par Marianne Durano, essayiste et professeure de philosophie
Vivre déconnecté (2/6). L’essayiste Marianne Durano, opposée à l’emprise des technosciences, prône la déconnexion d’Internet pour renouer des relations plus authentiques avec les autres et avec la nature.
Vous rentrez chez vous après une journée de travail. Dans votre salon, la température ne cesse de changer brutalement, et votre thermostat clignote d’un air menaçant. Sans prévenir, votre enceinte passe une musique angoissante. Votre caméra de surveillance tourne vers vous son œil métallique. Soudain, vous vous sentez observée.
Une adaptation high-tech du Horla ? Le nouveau David Lynch ? Non, le résultat d’une enquête menée le 23 juin dernier par le New York Times auprès de victimes d’un harcèlement 2.0. On croyait avoir tourné la page de l’affaire Weinstein, et voilà que les violences prennent un nouveau visage : celui, terrifiant, du cyberespionnage. Les femmes interviewées racontent comment leurs conjoints, même après avoir quitté le domicile, prennent le contrôle de leur smart home, en manipulant à distance leurs objets connectés grâce à des applications mobiles. L’une explique que le code de sa serrure connectée change chaque jour, l’empêchant d’accéder à son propre domicile, l’autre que l’interphone retentit à tout moment, sans personne au bout du fil. De quoi, littéralement, péter un câble.
Inquiétudes justifiées
Pas besoin d’en venir à de telles extrémités pour dénoncer l’emprise des objets connectés sur notre vie personnelle. En France, l’installation des compteurs électriques Linky, prétendus « intelligents », suscite des inquiétudes justifiées. Ces compteurs, qu’Enedis – anciennement ERDF – souhaite imposer à l’ensemble des foyers français d’ici à 2021, sont connectés à Internet et transmettent en permanence des informations très précises sur la consommation des ménages.
Vous ne prenez qu’une douche par semaine ? Enedis le sait. Vous vous absentez tous les mardis soir de 22 heures à minuit ? Enedis le sait. Et alors, qu’est-ce que ça change ? Rien, sinon que la technologie s’immisce un peu plus dans les moindres détails de notre intimité. Rien, sinon que nous nous préparons à vivre dans un monde où l’on ne peut plus aller aux toilettes sans y rencontrer une entreprise high-tech.
LA TECHNOLOGIE S’IMMISCE UN PEU PLUS DANS LES MOINDRES DÉTAILS DE NOTRE INTIMITÉ
L’exemple n’est pas gratuit. La société française LittleCorner propose à ses clients l’installation d’écrans publicitaires dans les WC d’établissements publics – restaurants, salles de spectacles, centres commerciaux. Leur slogan pourrait être celui de tout objet connecté : « Soyez là où tout le monde va seul ». Même si l’entreprise jure ses grands dieux ne pas installer de caméra de surveillance dans ses écrans, le dispositif fait froid dans le dos : « Grâce à un capteur thermique, nous savons combien de temps la personne est restée, explique le fondateur, Efraim Clam, au magazine Capital. On ne facture l’annonceur que si le spot a été vu jusqu’au bout. »
Après tout, pourquoi gaspiller du « temps de cerveau disponible » à fixer des graffitis obscènes quand on peut rêver à une vie meilleure en regardant des publicités gratuites ? Et puis, si ça vous dérange, vous pouvez toujours fermer les yeux – ou rester chez vous. Pourvu que vous ayez échappé au compteur Linky.
Mythe de la liberté du consommateur
Dans un monde où ce ne sont pas les hommes, mais les objets, qui sont connectés, déconnexion rime souvent avec exclusion. Parce que la technologie n’est pas neutre, elle structure un quotidien auquel il devient de plus en plus difficile d’échapper. Trouver un travail, voir ses amis ou connaître les horaires de la SNCF devient vite impossible sans smartphone. Comment peut-on encore prétendre que nous sommes libres d’utiliser les outils mis au point par la Silicon Valley ? Comment peut-on encore affirmer que la technique accroît nos possibilités sans diminuer notre autonomie ?
DANS UN MONDE OÙ CE NE SONT PAS LES HOMMES, MAIS LES OBJETS, QUI SONT CONNECTÉS, DÉCONNEXION RIME SOUVENT AVEC EXCLUSION
En réalité, nous ne vivons pas dans un monde avec des écrans, avec des téléphones portables, avec des compteurs connectés – nous vivons dans le monde des écrans, des téléphones portables, des compteurs connectés. Ce ne sont pas des gadgets auxquels nous pouvons aisément renoncer. Le mythe de la liberté du consommateur – individu rationnel et autonome derrière son caddie – n’est qu’un argument publicitaire, de même que la loi de l’offre et de la demande. Ce n’est pas parce que les enfants réclament des jouets connectés que l’entreprise américaine Genesis Toys a investi dans le secteur. C’est parce que la publicité impose ses produits dans l’espace public que les parents sont pris en otage. C’est l’offre qui crée la demande et s’aliène un public captif : allez offrir des cubes en bois à votre fils, après lui avoir présenté le robot i-Que, capable de répondre à toutes ses questions en se connectant au smartphone de papa !
Les enfants sont les premières victimes de cette nouvelle forme d’exclusion high-tech, non seulement parce qu’ils sont plus influençables, mais surtout parce qu’ils sont la cible privilégiée d’un marché en pleine explosion. Tablettes pour bébé, doudous interactifs, mobiles équipés d’une caméra de surveillance, smart-couches dotées de capteurs et de QR code qui changent de couleur quand bébé urine, biberon intelligent qui émet une alarme lorsqu’il est trop incliné : les perspectives sont infinies. On ne prépare jamais trop tôt le futur consommateur. Les entrepreneurs jouent sur la corde sensible : qui ne souhaite pas le meilleur pour sa progéniture ? Qui peut tolérer que son enfant soit banni des cours de récré parce qu’il n’a pas le dernier gadget connecté à la mode ?
Tablettes pédagogiques
Comment alors imaginer une déconnexion qui ne soit ni un isolement ni une simple pause cosmétique ? Je me souviens d’un épisode des « Maternelles » – une émission destinée aux jeunes parents diffusée sur France 5 – consacrée à la question. La mère censée représenter le camp techno-critique confessait ses difficultés à maintenir son bébé de 6 mois le dos tourné à l’écran lorsqu’ils regardaient la télévision. Devant l’admiration des autres invités, elle hochait la tête, pleine de gravité : « C’est vrai que je fais un peu figure d’illuminée face à mon entourage. »
Le discours moralisant qui accompagne la vente de tablettes pédagogiques permet aux parents et aux annonceurs de se donner bonne conscience, et masque l’aliénation que subissent les plus jeunes. Si la déconnexion se réduit à mettre son téléphone sur silencieux pendant les repas de famille ou à attendre ses 18 mois avant d’offrir sa première tablette à bébé, on perçoit ce qu’elle a d’illusoire et de superficiel.
C’est la promenade des prisonniers, la séance de massage offerte au cadre surmené : une récréation pour mieux nous faire oublier notre dépendance quotidienne. Le « droit à la déconnexion » le week-end implique le devoir d’être connecté toute la semaine, matin, midi et soir. Comme l’écrit le penseur décroissant Bernard Charbonneau dans son article « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire » : « Ce n’est pas d’un dimanche à la campagne que nous avons besoin, mais d’une vie moins artificielle. » Payer à ses enfants une semaine de déconnexion par an, pour oublier qu’on ne les voit pas le reste de l’année, c’est rendre supportable ce qui ne devrait pas l’être, c’est étouffer toute révolte et toute critique radicale.
Un déracinement réel
Car la connexion, c’est avant tout un lien. Nexus, en latin, est le participe de necto, qui signifie aussi bien « unir », « enlacer », qu’« enchaîner » ou « emprisonner ». Ce qui nous relie nous entrave, et la déliaison peut être une libération comme un délaissement. Alors, être déconnecté, est-ce être seul ? Comme souvent en philosophie, l’impasse naît d’une question mal posée. Le problème n’est pas « jusqu’où être connecté ? », mais bien plutôt « à qui, à quoi, être connecté ? ».
Nous voulons créer du lien, mais pas avec Mark Zuckerberg et ses amis transhumanistes. C’est un comble que l’écran – c’est-à-dire, étymologiquement, l’obstacle – soit devenu la principale médiation entre les êtres humains et l’accès privilégié à notre environnement. Au contraire, c’est parce que les individus sont isolés, séparés les uns des autres – par l’hypermobilité géographique, par leur rythme de vie – qu’ils ont besoin d’être virtuellement reliés par des gadgets électroniques. C’est le téléphone qui rend la distance tolérable, et la distance qui rend le téléphone nécessaire. Ce sont les réseaux dits « sociaux » qui rendent la solitude vivable, et la solitude qui rend ces réseaux si vivants. La connexion virtuelle est un déracinement réel.
Nous ne souhaitons pas la déconnexion. Au contraire, nous désirons plus de connexion : une connexion sans intermédiaire technologique, un lien immédiat avec ce – et ceux – qui nous entoure(nt).
Cette connexion authentique, ce lien humain avec les autres et la nature, a été théorisée par le penseur techno-critique Ivan Illich, dans un ouvrage intitulé La Convivialité. Une relation conviviale est un « rapport autonome et créateur, entre les personnes d’une part, entre les personnes et leur environnement d’autre part ». Autonome, car ne dépendant d’aucun outil – les amateurs de Tinder se reconnaîtront – et créateur, car respectant le caractère unique de chaque relation – à l’opposé d’une société industrielle qui uniformise les comportements. En clair, plutôt que de jouer tout seul avec un robot programmé en Chine dans une chambre encombrée de jouets manufacturés, votre enfant joue sans rien entouré des siens et développe la puissance créatrice de son imaginaire. Si, si, c’est possible.
Prendre le temps de vivre
Contre un système technicien qui ne cesse de créer de nouveaux besoins, nous défendons la sobriété heureuse et les low-tech. Comme Illich l’a montré, c’est l’outil, en effet, qui doit être convivial, et non l’homme qui le manie, parce que l’outil n’est pas neutre, mais façonne celui qui le manipule : « L’outil est convivial dans la mesure où chacun peut l’utiliser, sans difficulté, aussi souvent ou aussi rarement qu’il le désire, à des fins qu’il détermine lui-même. L’usage que chacun en fait n’empiète pas sur la liberté d’autrui d’en faire autant. Personne n’a besoin d’un diplôme pour s’en servir ; on peut le prendre ou non. » Bref, l’exact opposé d’un objet connecté.
SE DÉCONNECTER, CE N’EST PAS VIVRE EN DEHORS DU TEMPS : C’EST AU CONTRAIRE PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE
Le fossé entre la déconnexion proposée par les magazines de life-style et la convivialité d’Illich peut être comparé à l’abîme séparant une loupe de naturaliste d’une paire de Google Glass (lunettes connectées). Se déconnecter, ce n’est pas être technophobe : c’est au contraire promouvoir des outils à la mesure et au service de l’humain. Se déconnecter, ce n’est pas s’isoler : c’est au contraire tisser une toile qui ne soit pas virtuelle, un réseau vraiment social. Se déconnecter, ce n’est pas vivre en dehors du temps : c’est au contraire prendre le temps de vivre.
Marianne Durano est agrégée de philosophie, professeure en lycée à Dreux. Elle est membre fondatrice de la revue d’écologie intégrale « Limite » et auteure de « Mon corps ne vous appartient pas » (Albin Michel, 304 pages). Elle a pris part au mouvement de La Manif pour tous et elle est également l’une des instigatrices du mouvement des Veilleurs.
Monde Festival : Les technologies doivent-elles faire le bien ? « Le Monde » organise dans le cadre du Monde Festival une rencontre avec Carlo d’Asaro Biondio de Google Partnerships, l’ancienne ministre de l’économie numérique Fleur Pellerin, Gérard Escher, de l’école polytechnique de Lausanne et le frère dominicain Eric Salobir. L’événement se tiendra samedi 6 octobre 2018 de 14 heures à 15 h 30 à l’Opéra Bastille (Amphithéâtre). Réservez vos places en ligne sur le site
Bons baisers d’Instagram : des vacances approuvées par le réseau social
Par Catherine Rollot - Le Monde
Hashtags percutants, cadrages valorisants, selfies réussis, la photo de vacances est désormais plus importante que le voyage lui-même. Une tendance qui modifie l’offre touristique.
Sous le soleil californien, ils patientent de longues heures pour plonger dans une piscine de vermicelles colorés, se balancer sur une banane géante, grimper sur une licorne aux couleurs acidulées. Prêts à débourser 38 dollars (32 euros) pour pénétrer dans une pièce aux murs dégoulinant de faux Esquimau géants. L’attraction tient en quatre initiales, MOIC, pour Museum of Ice Cream (« musée de la crème glacée ») de San Francisco, un paradis rose, de la façade jusqu’à la tenue des employés, devenu destination de rêve pour toute une génération de touristes connectés.
DES GLOBE-TROTTEURS EN SMARTPHONE, POUR QUI L’INTÉRÊT D’UN LIEU TIENT PLUS À SA PHOTOGÉNIE ET À SON SUCCÈS SUR INSTAGRAM QU’À SON APPORT CULTUREL.
Dans la dizaine de salles d’exposition, point de chefs-d’œuvre d’Andy Warhol ou de Roy Lichtenstein comme chez le voisin SFMoma (San Francisco Museum of Modern Art) – l’un des plus grands musées d’art moderne du monde –, ni même d’histoire sur l’élaboration des sorbets et autres tranches napolitaines, mais des installations spectaculaires, écrins parfaits pour des selfies réussis. « Plus de 500 000 visiteurs venus du monde entier » – selon Maryellis Bunn, sa cofondatrice âgée de 26 ans – auraient déjà tenté « l’expérience de se mettre en scène » dans l’un des quatre espaces ludiques ouverts depuis 2016 (New York, Los Angeles, San Francisco et Miami). Et posté plus de 160 000 photos sous le hashtag #museumoficecream. Des globe-trotteurs en smartphone, représentatifs de ces nouveaux voyageurs pour qui l’intérêt d’un lieu tient plus à sa photogénie et à son succès sur Instagram qu’à son apport culturel.
A l’époque de la dictature du hashtag, l’application de partage de photos remplace l’agent de voyages. Sur les 40 milliards de clichés mis en ligne sur la plate-forme depuis ses débuts, plus de 300 millions se retrouvent sous l’item « travel », près de 6 millions sous sa version française, « voyage ». Une galerie planétaire plus efficace qu’une brochure touristique. « Instagram est un prescripteur redoutable, confirme la philosophe et psychanalyste Elsa Godart, auteure de Je selfie donc je suis. Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel (Albin Michel, 2016). Dépourvu de texte, le cliché posté fait office de publicité permanente. »
Plus fort que les étoiles
Trois quarts des 18-34 ans choisissent leur destination en fonction des contenus partagés sur les réseaux sociaux et, notamment, les photos, selon une étude du site de voyage Expedia (réalisée en ligne, en avril 2018, auprès de 1 480 Français ayant voyagé au moins une fois au cours des douze derniers mois). En matière d’hébergement, « l’instagrammabilité » est en passe de remplacer le nombre d’étoiles. Un tiers des voyageurs internationaux (32 %) y prêtent attention, selon une étude menée par le site Booking auprès de 19 000 voyageurs du monde entier en mai 2018.
« ON SUIT LES MÊMES RECETTES À BASE DE FILTRES ET DE HASHTAGS PERCUTANTS, DE SOURIRES FIGÉS, DE CADRAGES VALORISANTS, DE SELFIES ÉGOCENTRIQUES DEVANT UN PAYSAGE ULTRACONNU, DE POSES CLICHÉS. » ANAÏS GUYON, BLOGUEUSE
L’industrie touristique l’a bien compris, le bon emplacement, la qualité de service et le confort des chambres ne suffisent plus pour se distinguer dans la jungle des réseaux sociaux. Pour finir sur Instagram, il faut offrir le cadre naturel, la déco, l’ambiance, le petit plus qui donnera envie de partager sa séance photo. Bungalows de luxe disposés en arc de cercle sur un lagon turquoise, immenses hamacs, piscines à débordement, restaurant sous-marin où l’on dîne en regardant passer les poissons… toutes ces mises en scène ont permis au Anantara Kihavah Maldives de se voir décerner par un jury de visiteurs du site Luxury Travel le prix du meilleur hôtel « instagrammable » en 2017. Toujours dans l’archipel de l’océan Indien, le Conrad Maldives Rangali Island, autre resort de luxe, a lancé un service « Instagram Butler ». Un majordome est mis à disposition pour emmener les clients aux meilleurs endroits et à l’heure la plus propice pour réussir leurs clichés.
Mêmes points de vue, même lumière, même pause : les « reporters » tombés de leurs lits king size, téléphones greffés à la main, participent à la création d’un monde de plus en plus stéréotypé où les destinations se résument à quelques « spots ». « On suit les mêmes recettes à base de filtres et de hashtags percutants, de sourires figés, de cadrages valorisants, de selfies égocentriques devant un paysage ultraconnu, de poses clichés, type bras ouverts en signe de liberté, devant un coucher de soleil », analyse Anaïs Guyon, auteure du blog The Travellin’side, consacré au voyage et au bien-être. « Consciente de faire partie de cette génération qui collectionne les images plutôt que les expériences », elle a toutefois décidé de lever le pied dans sa course à la publication.
« Consommer des lieux plutôt que les contempler, c’est ce qui distingue le touriste du voyageur », rappelle le géographe Eudes Girard, coauteur de Du voyage rêvé au tourisme de masse (CNRS, 288 p., 22 euros). Et tant pis si « la réalité est en décalage avec l’imaginaire touristique savamment entretenu par la profusion d’images souvent retouchées, l’important c’est d’y avoir été et de le faire savoir ».
Le vacancier met à l’envi son périple en libre accès, convaincu que la splendeur de ce coucher de soleil sur les pyramides retombera un peu sur lui. « Les photos de vacances d’autrefois nourrissaient le récit familial, on les ressortait pour se remémorer des souvenirs, souligne Elsa Godart. Aujourd’hui, on en prend par milliers mais on ne les regarde pas, on les poste. Elles sont devenues un objet d’autopromotion. » En quête permanente de reconnaissance et de valorisation, le Narcisse en espadrilles n’a alors de cesse d’entretenir son potentiel Instagram, devenu le reflet de sa propre valeur.
"Macron estime avoir toujours raison"
Pour le politologue Roland Cayrol, le principal problème du macronisme est l'oubli du citoyen, le mépris pour le non-sachant.
Le politologue et essayiste Roland Cayrol* s'interroge, pour L'Express, sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, faite de "vision technocratique et impériale" et d'"oubli du citoyen".
L'Express : A quelle pratique du pouvoir présidentiel correspond, selon vous, la réforme constitutionnelle présentée aujourd'hui, en Congrès, à Versailles?
Roland CAYROL : Il y avait, dans la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron, un volet qui n'a pas du tout été respecté, et qui tenait à sa volonté d'un rassemblement non partisan de toutes les bonnes volontés, avec des accents de la deuxième gauche, empruntés notamment à la sensibilité rocardienne.
C'est-à-dire?
Je pense notamment à son leitmotiv lors des meetings : "Tous ensemble", "C'est notre projet". En héritier des idéaux démocratiques de la deuxième gauche, le candidat d'En marche semblait se faire le porte-voix d'une volonté de démocratie citoyenne. Or, un an et quelques semaines après, cette ambition a laissé la place à l'exercice désentravé de la décision jupitérienne.
Cela vous déçoit?
Disons que cela interroge l'analyste politique que je suis. Aujourd'hui, la gouvernance de Macron est formée d'une série de mesures technocratiques pour "réparer la France".
C'est plutôt positif, non?
Emmanuel Macron est incontestablement brillant, il privilégie toujours l'efficacité et maîtrise parfaitement ses dossiers. Cette très bonne connaissance l'autorise à adopter une certaine condescendance vis-à-vis de ceux qui les connaissent moins bien. Il pense volontiers que, quoi qu'il arrive, c'est toujours lui, en vertu de ses qualités, qui aura raison. D'où un fonctionnement des institutions reflétant une forte tendance à oublier l'ensemble des corps intermédiaires, nationaux ou locaux, les associations, et même les syndicats réformistes, a priori très proches. La révision constitutionnelle s'inscrit donc dans une optique d'amélioration minimale de l'efficacité du fonctionnement quotidien des institutions; à aucun moment n'est, en revanche, prise en compte une aspiration à un rééquilibrage des pouvoirs - aspiration profonde et ancienne, qu'attestent toutes les enquêtes d'opinion depuis une trentaine d'années. Certes, la plupart des Français ne sont pas férus du débat constitutionnel. Néanmoins, ils tiennent toujours : 1. / à l'élection présidentielle au suffrage universel; 2./ au renforcement des pouvoirs du Parlement. Le macronisme ignore ce souhait.
Arrive-t-il à Emmanuel Macron ce qui est arrivé, en son temps, à François Mitterrand, contempteur virulent du "coup d'Etat permanent" lorsqu'il était dans l'opposition, hyperprésident une fois à l'Elysée?
Oui, cela y ressemble... Pour un président, les institutions de la Vème République sont extrêmement confortables. Car elles le mettent par définition à l'abri des remous du débat démocratique. Aujourd'hui, le principal problème du macronisme n'est pas l'abandon supposé des objectifs de la gauche en matière sociale ; il n'est pas d'avoir laissé s'affaisser le flanc "progressiste" de sa majorité ; il est bien davantage l'oubli du citoyen et le mépris technocratique pour le non sachant. Or, on ne change pas une société par décret, comme le disait Michel Crozier. La vision trop technocratique et trop impériale du pouvoir nourrie par Macron paralyse les capacités transformatrices. Des mesures améliorant l'efficacité des mécanismes ne sauraient suffire à modifier le pays; il faut réellement que les gens, et ceux qui les représentent, soient au coeur du changement. Nul ne peut changer la société sans son concours : c'est ce que nous rappelle la tradition intellectuelle qui existe depuis Tocqueville.
Vu des macroniens, il était nécessaire de contourner l'inertie des notables. Qu'en pensez-vous?
Pourquoi pas, je n'ai rien contre... Si le pouvoir actuel ne s'en prenait qu'aux notables encrassés, dont le seul objectif est de préserver leurs acquis, il n'y aurait, au fond, rien à redire. Mais il va bien plus loin. Il met en cause l'ensemble des pouvoirs régionaux et locaux, les élus et le mouvement associatif, et les syndicats, notamment la CFDT, qui ne réclame qu'une chose - sa participation aux changements. Plus largement, il instabilise tous ceux qui, dans la société, se montrent disponibles à la réforme et souhaitent très concrètement agir. Faisant "tout seul", le pouvoir risque de ne pas faire avec la société. Et d'ignorer cette culture du compromis qui implique le débat permanent, auquel Rocard était très attaché.
Rocard, justement, se réclamait de la politique des "petits pas". Quels ont été, depuis Chirac, son condisciple et son contemporain, jusqu'à Macron, les principaux styles de gouvernance?
Depuis que la Vème République existe, tous les fils du pouvoir conduisent à l'Elysée. L'exécutif fut toujours fortement dominé par les décisions élyséennes. Jacques Chirac, roi fainéant dans toute sa splendeur, s'était sorti du problème en faisant peu et en reculant chaque fois qu'un risque de blocage se présentait. Nicolas Sarkozy voulait bousculer tous azimuts et proclamait "On va voir ce qu'on va voir". Moyennant quoi, il a souvent donné l'impression de louvoyer entre plusieurs caps stratégiques incompatibles. Macron, qui donne incontestablement le sentiment qu'il y a un pilote dans l'avion, montre, en revanche, le plus grand désintérêt pour les passagers. Et il tend encore plus le fonctionnement des institutions.
Le surplomb technocratique marque donc, selon vous, la conception macronienne de la présidence. Quelle place faut-il faire à une composante plus psychologique, le narcissisme?
L'émerveillement qu'Emmanuel Macron a visiblement de lui-même est évident. A la lumière de son parcours, en effet exceptionnel, il se pense comme ayant toujours raison. Il est grisé par sa capacité à improviser et à "avoir juste" malgré tout. Ce trait de la personnalité du président renforce beaucoup le sentiment qu'ont de nombreux Français d'être désormais en présence d'une République impériale.
*Il a signé, récemment, Les Raisons de la colère chez Grasset




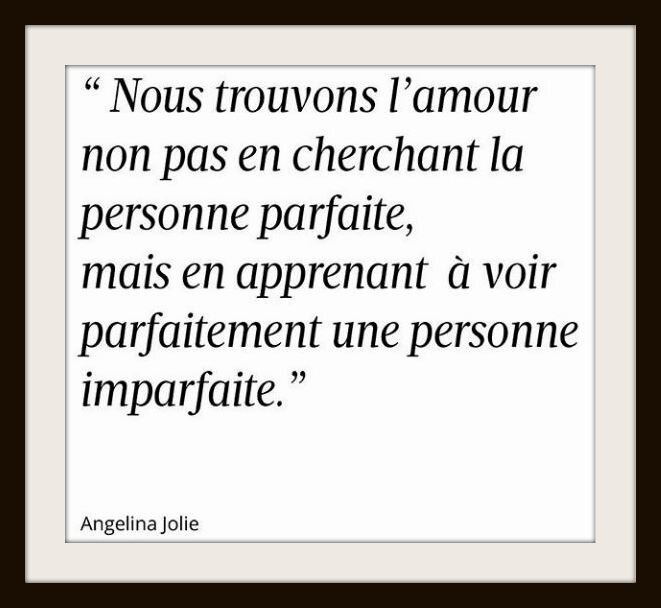



/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)