Cinq villes et monuments pour s’échapper virtuellement
Par Thomas Doustaly
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine encore, confinement oblige, il sera intérieur et par écrans interposés, de la Cité de l’espace à Toulouse pour jouer les astronautes sur canapé, à Tours pour flâner sur les bords de Loire. L’avantage ? Plus de foule, plus de file d’attente !
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous sommes cloîtrés chez nous vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On a décidé de vous aider à vous échapper, mais dans vos pensées !
A Toulouse, crimes et astronautes
A Toulouse, l’accès aux contenus numériques a été pensé aussi bien pour les visiteurs que pour permettre aux Toulousains eux-mêmes de redécouvrir la Ville rose. Fonds photographiques, collections des musées ou expériences inédites, telles que vivre comme un astronaute à la Cité de l’espace, les propositions ne manquent pas. Sur Urban-hist.toulouse.fr, on découvre un travail précis de géolocalisation des crimes les plus célèbres perpétrés dans la ville sous l’Ancien Régime, baptisés de noms extravagants : « Baby vitriol » rue Saint-Michel, « Fatal coup de pied » rue Peyrolières, ou encore « Les charrettes de la mort », rue de la Pomme, voilà une promenade vraiment inédite ! Les musées toulousains proposent, eux, des contenus pour les adultes et les enfants, notamment au Musée Saint-Raymond, où les sculptures de la villa romaine de Chiragan sont numérisées.
Toulouse-tourisme.com
Archives.toulouse.fr
A Rennes, couvent et beaux-arts
La capitale de la Bretagne n’est pas la ville la plus touristique d’une région qui compte tant de trésors. Elle mérite pourtant qu’on s’y arrête, même virtuellement. Des collections du Musée de Bretagne à l’Opéra (réputé le plus petit de France), qui se visite sur smartphone, la ville met des tonnes de contenus en ligne pendant le confinement. La visite en 3D du couvent des Jacobins est passionnante, qui retrace à la fois l’histoire du bâtiment et sa transformation, unique en Europe pour un lieu de vie monastique, en Centre des congrès. Le très important Musée des beaux-arts donne accès à son exposition « Etonnants donateurs » sous la forme d’interviews savoureuses. Enfin, sur le site 360rennes, de courtes visites guidées nous entraînent dans le cœur historique de la ville ou à la découverte de son côté insolite. On en sort avec l’envie de découvrir ou de redécouvrir Rennes.
Tourisme-rennes.com
A Strasbourg, Europe et cathédrale
En créant le hashtag #strasbourgchezvous, l’Office de tourisme de Strasbourg permet à ceux qui ne connaissent pas la capitale alsacienne ou qui ont envie d’y refaire un tour de la découvrir tout en restant confinés. Grâce à des liens partagés sur Twitter et Instagram, les lieux emblématiques de la ville et ses principaux monuments vivent une vie numérique nouvelle : sur Mon-week-end-en-alsace.com, on jette un œil sur le Musée Tomi-Ungerer ou sur le Lieu d’Europe ; sur Strasbourg.eu, on se fait peur avec la visite virtuelle de l’exposition « Magie religieuse et pouvoirs sorciers » au château Vodou (3 euros) et enfin, sur Cinema.seppia.eu, on regarde Le Défi des bâtisseurs sur la construction de la cathédrale de Strasbourg, merveille de l’art gothique. Sans création de contenus nouveaux, une façon d’agréger des initiatives et des images de la ville en attendant de pouvoir s’y balader à nouveau.
Visitstrasbourg.fr
A Tours et alentours, Clos Lucé et bords de Loire
Visiter la demeure de Léonard de Vinci, le Clos Lucé, découvrir les collections du Centre de création contemporaine Olivier-Debré – le musée d’art contemporain – ou encore parcourir les rues de Tours et les bords de Loire virtuellement sur Google Play, telles sont quelques-unes des propositions de la ville et de ses alentours.
Tours est aussi le point de départ virtuel pour surfer numériquement dans le Val de Loire. Inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, les châteaux de la Loire dévoilent leurs secrets sous la forme de visites virtuelles comme à Chambord, à Sully-sur-Loire ou à Chenonceau. Les 360° et les zooms font un peu tourner la tête mais les amoureux de la lenteur et des détails y trouveront leur compte. D’autres lieux apparaissent sous la forme d’expositions en ligne, notamment sur le jardin nourricier du château de Talcy ou encore sur le beau bestiaire du château d’Angers. Une occasion de revoir des sites visités ou de réviser dans la perspective d’une future visite.
Inattendue-tours-tourisme.fr
Du château d’Angers à celui de Pierrefonds
S’il faut trouver un avantage au confinement, la visite des monuments de France en solitaire, même virtuelle, est une alternative sereine aux files d’attente et à la cohue qui y règne souvent en période d’affluence. Le Centre de monuments nationaux donne ainsi accès à certains de ses plus beaux sites d’un coup de clic : le château d’Angers, le site archéologique de Glanum, à Saint-Rémy-de-Provence, ou la grotte de Font-de-Gaume, en Dordogne, sont ainsi accessibles malgré leur fermeture. Mais c’est la visite virtuelle du château de Pierrefonds, dans l’Oise, qui donne le plus clairement l’impression d’explorer comme par effraction un chef-d’œuvre en sommeil. Zoom sur les peintures ou des détails d’architecture, recoins, la visite s’adresse aussi bien aux grands qu’aux petits.
Monuments-nationaux.fr
Retrouvez tous les voyages du Monde sur Lemonde.fr/m-voyage/
Canards dans les rues de Paris, coyotes à San Francisco : « On remarque des espèces que l’on ne voyait pas »
Par Perrine Mouterde
Le confinement, lié au coronavirus, et l’arrêt des activités humaines dans les villes devraient avoir un impact limité sur la biodiversité.
Des canards se dandinant près de la Comédie-Française dans le centre de Paris ; des groupes de dauphins, des fous de Bassan ou des hérons cendrés observés avec une fréquence et une densité « inédite » par les agents du Parc national des calanques ; des coyotes dans les rues de San Francisco aux Etats-Unis… Les images, souvent vraies mais parfois fausses – il n’y a pas eu de dauphins dans les canaux de Venise, en Italie, ni d’éléphants saouls dans un village de Yunnan, en Chine –, d’animaux visibles dans des lieux inattendus, d’ordinaire fréquentés par des humains, ont largement circulé depuis le début de la pandémie de Covid-19. Si ces scènes ont pu procurer un certain réconfort à voir la nature « profiter » de cette période, les effets du confinement sur la biodiversité restent à mesurer et devraient, selon toute vraisemblance, n’être que marginaux.
« Il y a des canards toute l’année à Paris, des sangliers dans les forêts juste à côté de Barcelone, décrit Benoît Fontaine, biologiste de la conservation au Centre d’écologie et des sciences de la conservation du Muséum national d’histoire naturelle. Les animaux sont simplement plus visibles dans des espaces libérés par l’homme, mais tout cela est assez anecdotique par rapport aux dégradations subies par la nature depuis des dizaines d’années. »
« Cette plasticité de la nature, cette capacité de certains poissons ou oiseaux à fréquenter rapidement des espaces quand ils sont délaissés, c’est un phénomène que l’on connaît, ajoute Jean-David Abel, le vice-président de France Nature Environnement. Mais la nature ne reprend pas sa place. On regarde juste mieux : on remarque des espèces qui étaient à côté de nous mais que l’on ne voyait pas. »
L’utilisation de pesticides se poursuit
Pour les spécialistes, il faudrait que le confinement se prolonge pendant des mois pour induire des changements de cycle ou de comportements de certaines espèces et avoir un impact structurel sur l’état de la faune. En ville, Benoît Fontaine estime toutefois que les insectes sont les plus à mêmes de bénéficier de cette parenthèse. « Comme les parcs et les espaces verts vont être moins entretenus, il y aura peut-être un peu plus de fleurs et donc d’insectes, dit-il. Les insectes ont un cycle de vie court donc les changements peuvent être plus rapides. Pour les oiseaux en revanche, leur reproduction en ce printemps dépend des populations qui sont déjà présentes, donc on devrait être dans la continuité. »
Une baisse de la pollution lumineuse nocturne pourrait également avoir des effets bénéfiques pour certains insectes et pour les chauves-souris. L’impact de la diminution du bruit sur la faune est, lui, difficile à mesurer. Les oiseaux, par exemple, sont souvent davantage sensibles à la présence humaine qu’au niveau sonore. L’aéroport de Montpellier, bruyant mais peu fréquenté, est ainsi connu pour héberger l’outarde canepetière, un oiseau au cou noir rayé d’une étroite bande blanche et menacé d’extinction.
Par ailleurs, si le silence peut indiquer aux animaux l’absence de prédateur, il marque aussi l’absence de congénères et de contacts sociaux, notamment celle de parents pouvant offrir protection et ressources. « Les rats perçoivent ainsi l’immobilité d’un groupe et l’absence de sons due aux mouvements comme l’expression d’un danger », ont précisé des chercheurs de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité du Muséum au site The Conversation.
En dehors des villes, les activités agricoles, et avec elles l’utilisation de pesticides et d’autres substances chimiques polluant les sols et les eaux, n’ont pas été mises à l’arrêt par la crise sanitaire. Selon le rapport de 2018 de la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui alertait sur le risque d’extinction d’un million d’espèces, les changements d’usage des terres et les pollutions sont deux des cinq principaux facteurs de dégradation de la nature.
« Si on pouvait arrêter immédiatement l’agriculture intensive, dont les corollaires sont l’uniformisation des milieux et l’usage déraisonné des pesticides, ça aurait un impact très rapide sur les plantes, les oiseaux et les insectes, assure Benoît Fontaine. Par exemple, selon les derniers chiffres, depuis la fin des années 1980, près de 40 % des oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles ont disparu en France. C’est une hécatombe qui est avant tout liée à ce type d’agriculture. »
Un enjeu pour la recherche scientifique
Si ce confinement ne va pas inverser la tendance concernant la perte de biodiversité, il constitue néanmoins une situation unique et inédite, et donc un enjeu pour la recherche. « Pour tous les programmes de long terme de suivi de la biodiversité, c’est particulièrement intéressant. Que vont nous dire les résultats de cette année ? », s’interroge Benoît Fontaine. Le programme collaboratif Silent Cities, qui vient d’être lancé par des chercheurs du CNRS et de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) vise, lui, à mesurer l’effet de la diminution du bruit dans les villes sur la présence ou l’absence de certaines espèces, et sur leur activité. « On sait par exemple que des oiseaux ont modifié leurs chants pour s’adapter à l’environnement sonore en ville, précise Amandine Gasc, chargée de recherche à l’IRD. Vont-ils de nouveau modifier l’heure ou la fréquence à laquelle ils chantent ? »
D’autres programmes scientifiques participatifs et adaptés au confinement ont également démarré. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Muséum d’histoire naturelle appellent à contribuer à un comptage des espèces d’oiseaux depuis sa fenêtre, son balcon ou son jardin. Une façon de récolter des données, de pallier le manque d’observateurs sur le terrain mais aussi de sensibiliser la population à la protection de la nature.
« On sait que ceux qui participent à ce type de programmes changent ensuite leur façon d’entretenir leurs jardins, en utilisant moins de pesticides et en laissant plus de fleurs, explique Benoît Fontaine. Peut-être va-t-il y avoir, lors de ce confinement, une prise de conscience de l’importance d’avoir un peu de nature autour de nous pour aller bien. » Jean-David Abel pense aussi que cette situation peut amener des urbains à s’interroger sur la place qu’ils laissent d’ordinaire aux animaux, dans le bruit et l’agitation. « Certains auront peut-être touché du doigt le fait que l’on peut vivre un peu autrement, en profitant davantage du silence, du calme et de cette faune qui est juste autour de nous », dit-il.
Coronavirus : toute la planète cherche à acheter des masques de protection en Chine
Par Gilles Paris, Washington, correspondant, Florence de Changy, Hongkong, correspondance, Piotr Smolar, Sarah Belouezzane, Harold Thibault
Cette foire d’empoigne se fait dans l’urgence, car chaque pays est confronté à la pénurie et à des opinions publiques abasourdies par le manque d’anticipation.
C’est la grande cohue aux portes des usines chinoises, auprès desquelles toute la planète cherche à se procurer des masques de protection pour freiner la propagation du coronavirus. Dans cette foire d’empoigne se font concurrence les Etats entre eux, mais aussi les collectivités locales et les entreprises. Le tout dans l’urgence, car chacun est confronté à la pénurie et à des opinions publiques abasourdies par le manque d’anticipation de leurs dirigeants, et ce alors que l’essentiel du trafic aérien à destination de la Chine a été supprimé. « Il y a une course aux masques en Chine, il faut être prêt à dégainer tout de suite pour réussir à passer une commande », résume Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le gouvernement français a lancé ce qu’il compare à un « pont aérien » avec la Chine – des vols cargos payés au prix fort pour importer 600 millions de masques. Ils doivent notamment approvisionner les hôpitaux. Mais les régions conservent la responsabilité de trouver des masques pour les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et les soignants à domicile. La Nouvelle-Aquitaine devait réceptionner une commande de 2,6 millions de masques ce week-end, à l’issue d’un parcours du combattant : la cargaison devait d’abord décoller de Shenzhen (sud), grand centre industriel qui jouxte Hongkong. Mais face à l’engorgement du terminal cargo de l’aéroport, elle a été envoyée par camion jusqu’à Shanghaï (est). Là, l’attente s’annonçait si longue que le tout a finalement été convoyé pour un décollage depuis Zhengzhou, 950 km à l’ouest.
« Course contre la montre »
L’Ile-de-France a connu pire déconvenue. Lorsque, le 20 mars, le gouvernement lève sa réquisition des masques sur le territoire, Valérie Pécresse, présidente de la région, se précipite car les besoins sont grands. Elle procède à une commande de plusieurs millions de masques auprès d’un fournisseur chinois. Mais très vite, sans nouvelles de la cargaison, la région se rend compte que le stock a été tout simplement vendu à une autre partie, plus offrante. « Nous ne savons même pas qui l’a acheté finalement, on parle d’Américains, mais en réalité, c’est difficile à dire », précise-t-on dans l’entourage de la présidente.
Cette situation ubuesque est la conséquence d’une demande en flux hypertendu et d’une concurrence impitoyable. Il faut désormais payer rubis sur l’ongle dès l’ordre passé, parce que les producteurs peuvent se permettre de l’exiger, mais aussi en raison du coût de leurs matières premières. « Auparavant, il fallait un premier versement, d’environ 30 %, puis le reste après livraison. La nouveauté, c’est que les usines veulent 100 % comptant à la commande, sinon les autres passent avant », explique Melvin Gerard, consultant dans l’import-export avec la Chine.
L’Ile-de-France a fait appel aux réseaux de ses entreprises, mais également à la communauté d’origine chinoise afin de trouver un producteur fiable. « Nous nous sommes battus car la recherche de masques est une course contre la montre pour identifier les producteurs et, surtout, faire décoller les cargaisons. Nous avons pu sécuriser une filière d’approvisionnement grâce à la communauté franco-chinoise en Ile-de-France », explique Valérie Pécresse.
Les différents chefs d’Etat, Emmanuel Macron en tête, ont beau promettre de réfléchir à terme à cette dépendance à la Chine, dont ils prennent conscience avec la crise sanitaire, la République populaire se révèle plus incontournable que jamais. Dès janvier, alors que le virus faisait ses premiers ravages, sa propre demande et celle de ses voisins asiatiques l’ont poussée à augmenter ses capacités de production : 3 000 nouveaux fabricants se sont lancés sur un marché qui en comptait déjà 4 000. La Chine – qui, l’année dernière, livrait la moitié des masques sur la planète – aurait dopé sa capacité de production à 110 millions d’unités par jour fin février, selon les chiffres officiels, cinq fois plus qu’un mois plus tôt.
Le constructeur automobile BYD se targue d’avoir lancé en deux semaines la plus grosse ligne de production mondiale, et assure au Monde qu’elle sort désormais 10 millions d’unités par jour. Le géant de l’assemblage des smartphones Foxconn s’est jeté dans la mêlée au même moment. Un producteur de serviettes de protection contre l’incontinence de la province rurale de l’Anhui, U-Play, explique s’être converti aux masques en trente-cinq jours car le gouvernement local peinait à en trouver, confronté à la demande des autres provinces.
Dans cette bataille, la qualité laisse souvent à désirer. Les Pays-Bas ont rappelé 600 000 masques FFP2 défectueux, réceptionnés le 21 mars d’un fabricant chinois. Mais Pékin est soucieux de son image, et se pose désormais d’autant plus en position de sauveur qu’il a été accusé d’avoir étouffé la révélation, par des médecins de la ville de Wuhan, de l’existence d’un nouveau virus, fin décembre 2019. Depuis mardi 31 mars, les usines du pays ne peuvent plus exporter de matériel médical ou de protection si elles n’ont pas reçu la licence les autorisant à vendre sur le marché chinois. Selon une source au ministère français de la santé, aucun problème de qualité n’a été décelé sur les premiers arrivages en France, par deux avions affrétés lundi 30 mars et mercredi 1er avril par la société Geodis, qui ont ramené près de 20 millions de masques.
L’amertume des pilotes
L’autre défi est logistique. Outre Geodis, qui doit affréter une quinzaine de vols Antonov pendant ce mois d’avril dans le cadre du « pont aérien » avec la Chine, Air France prévoit six rotations par semaine. Les deux premiers vols de la compagnie française ont eu lieu dimanche 29 mars et mercredi 1er avril, acheminant chacun 80 tonnes de matériels – essentiellement des masques, près de 8 millions au total – à destination de la France. Une grande partie, le 29 mars, a été importée à l’initiative du groupe LVMH. Le prochain vol est prévu le 5 avril. En privé, le président Emmanuel Macron a critiqué la lenteur du ministère de la santé, qui s’est fait prendre de vitesse, pour des raisons administratives, dans la prise en charge des masques sur le terrain, en Chine.
Les équipages qui participent à ces vols à vide dans le sens de la Chine sont soumis à un protocole sanitaire très strict. C’est dans ce cadre qu’un pilote d’Air France a été retenu sur place, selon nos informations, confirmées par Air France. A la suite d’un test positif au Covid-19, il a été « placé en observation dans un centre médicalisé » chinois le 31 mars, précise la compagnie, qui s’efforce d’obtenir son retour « le plus rapidement possible ».
Du côté des syndicats de pilotes, une certaine amertume s’exprime en raison de l’écho donné aux vols affrétés par Geodis. « On aimerait que le travail d’Air France soit davantage mis en valeur par le ministère des affaires étrangères, dit une source syndicale. On s’offusque du fait que les vols d’Antonov soient tant évoqués, alors qu’ils sont à un tarif délirant de 1,5 million d’euros pièce. »
La ruée mondiale sur le matériel de protection chinois est source de vives crispations diplomatiques. Le ministre de l’intérieur du Land de Berlin, Andreas Geisel, a ainsi accusé les Etats-Unis de « piraterie moderne » dans un article de vendredi du Tagesspiegel révélant qu’une cargaison de masques de type FFP2 de la marque américaine 3M, produits en Chine à destination des soignants de la capitale allemande, a été « confisquée » lors d’un transbordement à l’aéroport de Bangkok. L’entreprise du Minnesota résiste à une injonction de l’administration de Donald Trump d’expédier l’intégralité de sa production asiatique vers les Etats-Unis et de cesser de fournir le Canada et l’Amérique latine. Cet ordre, qui aurait des « implications humanitaires importantes », selon l’industriel, suscite l’ire du premier ministre canadien, Justin Trudeau.
Les Etats américains eux-mêmes se plaignent de voir l’administration fédérale se montrer plus offrante à chaque fois qu’ils tentent de passer une commande aux Etats-Unis. Au point que le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a utilisé un avion de l’équipe de football des New England Patriots pour aller chercher une livraison en Chine pour sa région. Cette concurrence américaine nourrit la guerre au plus offrant. Un membre de l’état-major américain, l’amiral John Polowczyk, chargé de l’approvisionnement, a assumé avoir une équipe qui « parcourt le monde » pour prendre tous les équipements nécessaires que les Etats-Unis peuvent récupérer. Il a précisé que six avions-cargos avaient déjà ramené du matériel médical et que 28 autres avions étaient prévus dans les jours à venir. Il parle lui aussi de « pont aérien ».
THE BRADFORD - 'HAPPINESS HIDDEN' {EDITORIAL EXCLUSIF / NSFW}
Après un congé sabbatique de 18 mois, il est de retour avec une nouvelle exclusivité intitulée «Happiness Hidden» du photographe Christopher Bradford . Avec le modèle Romi, ils ont créé l'idée de ce tournage; une vision fantaisiste de la folie extérieure du monde, avec un rappel de rester curieux, ludique et de s'amuser. Il a été inspiré par Wayne Dyer, qui a déclaré:
«Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. » -Wayne Dyer
Modèle: Romi
Photographe: Christopher Bradford
My stockings from Annas Workshops on Vimeo.
My stockings from Annas Workshops on Vimeo.
Entretien - Dennis Carroll, immunologiste : “L’épidémie actuelle était prévisible”
NAUTILUS (NEW YORK)
Notre démographie galopante, nos incursions dans des écosystèmes jusque-là préservés et nos habitudes de consommation composent un cocktail parfait pour l’apparition de zoonoses et l’émergence de nouvelles pandémies, alerte ce chercheur en biologie médicale dans un entretien accordé à Nautilus.
Dennis Carroll ne veut pas avoir l’air trop brutal quand il dit que l’épidémie de coronavirus était prévisible. Au contraire, il comprend parfaitement qu’on puisse avoir peur de la maladie. Tout autour du monde, il a vu des gens atteints de tels virus. Carroll a surtout l’air de savoir de quoi il parle.
Depuis plusieurs décennies, il met en garde contre la menace des zoonoses, la transmission d’agents pathogènes des animaux à l’homme. Les scientifiques sont convaincus que l’épidémie actuelle, apparue à Wuhan, en Chine, venait d’un virus propre aux chauves-souris. En 2009, après plusieurs années à étudier les maladies infectieuses aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ainsi qu’à l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), Carroll a mis sur pied un programme Usaid nommé “Predict”, qui menait un travail novateur sur les virus présents chez les animaux du monde entier et qui pourraient un jour nous contaminer.
“Dennis est un visionnaire, assure Christine K. Johnson, épidémiologiste au One Health Institute (université de Californie à Davis), où elle est professeure à l’école de médecine vétérinaire. Il a hérité d’une démarche fondée sur la réaction aux maladies infectieuses, et il en a pris le contre-pied. Il a dit : ‘Nous allons anticiper pour aider les différents pays à se préparer à l’émergence des maladies infectieuses’”.
Dennis Carroll (photo). Johnson, qui a été chercheuse au sein de Predict pendant dix ans, affirme que Carroll a fait œuvre de pionnier en ne se contentant plus d’examiner seulement le bétail. “Dennis a compris que les nouvelles maladies infectieuses, un peu partout dans le monde, venaient principalement des espèces sauvages, et qu’il fallait donc investir dans la recherche sur ces espèces.” Pendant dix ans, Predict a bénéficié d’un financement fédéral annuel variant entre 15 et 20 millions de dollars. En 2019, son enveloppe a été supprimée. Carroll a quitté l’Usaid et lancé un nouveau programme, le Global Virome Project, afin, dit-il, d’“exploiter les découvertes et l’expérience de Predict”.
Lors de cet entretien, Carroll, qui parle de sa propre expérience, répond parfois avec causticité, qu’il parle de la biologie des virus ou du manque de réactivité de la Maison-Blanche à l’épidémie. Je commence par lui demander quelles sont les origines de ce fléau.
NAUTILUS. Comment l’actuel coronavirus est-il passé d’une chauve-souris à l’homme ?
DENNIS CARROLL. Nous ne savons pas précisément, mais le virus était sans doute présent dans un animal sur un marché, où il y a eu des contacts répétés. Il est possible aussi que des gens aient directement manipulé l’animal. Il peut également y avoir eu un hôte intermédiaire [les soupçons se portent sur le pangolin]. En 2002, lors de l’épidémie de Sras en Chine, la source de l’infection ne nous est pas apparue comme étant l’exposition directe à des chauves-souris. Il y avait un hôte intermédiaire, la civette.
En 2018, vous et vos collaborateurs écriviez dans Science : “Notre capacité à contenir l’apparition des maladies est compromise par notre mauvaise compréhension de la diversité et de l’écologie des menaces virales.” Que devons-nous faire pour comprendre la diversité et l’écologie de ces menaces virales ?
La première chose à comprendre, c’est que les menaces auxquelles nous allons être confrontés à l’avenir, quelles qu’elles soient, existent déjà : elles circulent parmi les animaux sauvages. On pourrait comparer cela à une matière noire virale. Une importante population de virus circule, et nous n’en découvrons l’existence que lorsque la transmission franchit la barrière des espèces et que certaines personnes tombent malades.
Y a-t-il un risque particulièrement élevé de transmission de la chauve-souris à l’homme ?
Absolument. Nous avons pu identifier les chauves-souris comme réservoirs du coronavirus, et nous avons répertorié certaines populations spécifiques de chauves-souris comme étant des réservoirs du virus Ebola. Nous voudrions maintenant comprendre comment chacune de ces espèces de chauves-souris agit au sein de son écosystème. Ont-elles certains comportements et pratiques qui les maintiennent soit éloignées, soit en contact avec les populations humaines ? La population de chauves-souris au sein de laquelle nous avons isolé le virus Ebola en Afrique de l’Ouest était une espèce qui a elle aussi tendance à se percher dans les habitations, ce qui accroît les possibilités de transmission à l’homme.
Y a-t-il eu des perturbations de leur environnement qui auraient obligé les chauves-souris à se rapprocher de nous ?
Nous sommes à 100 % à l’origine de ces perturbations. Nous avons pénétré encore plus avant dans des écosystèmes que nous n’occupions pas auparavant.
Avez-vous un exemple parlant de telles invasions ?
En Afrique, on constate de nombreuses incursions qui sont motivées par les forages pétroliers ou l’extraction minière, dans des zones qui n’abritaient autrefois que de faibles populations humaines. Le problème n’est pas tant lié à l’arrivée de travailleurs et à l’implantation de chantiers dans ces zones qu’à la construction des routes, qui permettent des mouvements de population encore plus importants. Les routes rendent possible également les déplacements d’animaux sauvages, parfois dans le cadre d’un commerce alimentaire, vers des agglomérations. Tous ces changements spectaculaires accroissent les risques de transmission des infections.
Les épisodes de contamination interespèces sont-ils plus fréquents qu’il y a cinquante ans ?
Oui. EcoHealth Alliance et d’autres ONG ont passé en revue toutes les épidémies déclarées depuis 1940. Elles en ont conclu avec une relative certitude que les cas de transmission interespèces sont deux à trois fois plus importants qu’il y a quarante ans. Et la hausse se poursuit. Elle s’explique par le fort accroissement de la population humaine et par notre expansion vers les zones abritant de la faune et de la flore sauvages. Le meilleur indicateur des épisodes de contamination interespèces est les changements dans l’utilisation du sol – davantage de terres vont à l’agriculture, et plus spécifiquement à la production de bétail.
Les virus qui se transmettent des animaux à l’homme ont-ils quelque chose de spécifique ?
On peut affirmer que les virus ne sont pas des organismes vivants. Ils sont constitués de couches de protéines renfermant un certain ADN ou ARN. Au-delà de cela, ils ne disposent d’aucun mécanisme pour vivre indépendamment. Ils doivent trouver un écosystème qui possède tous les mécanismes cellulaires indispensables à leur réplication. Ils ne peuvent pas vivre en dehors d’une population animale, ils ont besoin de cet animal pour se répliquer. Et nous sommes un animal parmi d’autres. Nous nous croyons très particuliers. Mais nos virus nous infectent exactement dans le même but qu’ils infectent une chauve-souris ou une civette.
L’existence des virus repose sur un équilibre délicat, n’est-ce pas ? Ils doivent être capables de prospérer sans tuer leur hôte.
Exactement. Ceux qui tuent leur hôte vont rapidement disparaître. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’en tuant [environ] 10 % de ses hôtes le virus du Sras n’ait pas réussi à se propager pour devenir une pandémie planétaire.
Y a-t-il des signes qui indiquent que ce coronavirus va se tuer lui-même ?
[À l’heure actuelle], ce coronavirus présente une plus faible pathogénicité que d’autres. Moins il est virulent, plus il aura de chances de faire partie d’un épisode endémique saisonnier. C’est l’un des grands problèmes dont il va falloir se préoccuper. Si jamais il est en sommeil pendant les mois d’été, alors il faudra se demander s’il continue à infecter des gens. Nous pouvons par exemple déambuler en été parmi les virus de la grippe, sans qu’ils soient actifs. Ils sont juste en sommeil. Quand l’écologie redevient favorable, qu’il se met à faire froid et humide, le virus recommence à se répliquer comme un fou. Si le coronavirus est capable de se mettre en retrait et de ne pas tuer son hôte pendant les mois d’été, alors nous aurons affaire à un virus qui a toutes les chances de s’installer durablement, de faire partie du paysage, pour notre malheur.
Pensez-vous que l’épidémie actuelle était inévitable ?
Oui, absolument. Elle était même prévisible. C’est comme s’il n’existait pas de Code de la route et que des piétons se fassent sans cesse renverser quand ils traversent la rue. Faudrait-il s’en étonner ? Non. Ce que nous devons faire, c’est bien choisir l’emplacement des passages protégés et réglementer la circulation. Nous ne le faisons pas.
Nous ne mettons pas en place les bonnes pratiques qui minimiseraient les risques de transmission interespèces. Si nous comprenions mieux où circulent ces virus et que nous en déterminions l’écologie, nous réduirions les possibilités d’épidémie.
Pourquoi les pouvoirs publics ne le font-ils pas ?
Premièrement, on est confrontés à un problème grandissant, lié à un changement démographique sans précédent. C’est seulement depuis les cent dernières années que la hausse de population s’est accélérée à un rythme qui entraîne des perturbations des écosystèmes dans leur ensemble. Il y a cent ans, nous étions 6 milliards de moins sur cette planète. Notre espèce a mis la plus grande partie de son existence, soit 300 000 ans, pour atteindre le seuil du milliard d’individus. Nous sommes 6 milliards de plus qu’il y a cent ans, et nous serons encore 4 ou 5 milliards de plus avant la fin du siècle.
Deuxièmement, dans leur ensemble, les gouvernements et la société ont du mal à s’arracher à l’inertie. Nous mettons du temps à changer, à nous adapter. Et l’humanité ne mesure toujours pas bien à quel point elle vit dans un monde fondamentalement nouveau pour notre espèce. On dit que si on lâche une grenouille dans un récipient d’eau bouillante, elle s’échappe d’un bond. Mais si on plonge cette même grenouille dans de l’eau à température ambiante et qu’on fasse monter lentement la température, elle restera dans l’eau et finira par mourir ébouillantée. Elle perd la notion du changement de son milieu ambiant. Nous sommes cette grenouille dans l’eau à température ambiante. Nous perdons de vue les conditions qui ont permis aux virus des animaux sauvages de migrer parmi nous.
Qu’est-ce qui vous a ouvert les yeux sur l’échelle de la contamination interespèces ?
Vous voulez dire : quand ai-je trouvé mon chemin de Damas ?
Exactement.
C’était la grippe aviaire dans les années 2000. Ce qu’on a vu avec la grippe aviaire était la conséquence directe de la manière dont les volailles étaient élevées pour nourrir la population. Aujourd’hui, la Chine produit environ 15 ou 20 milliards de volailles par an. Mais si l’on remonte en arrière et qu’on examine les chiffres des années 1960, on voit que la production atteignait tout au plus quelques centaines de millions de volailles par an. Il y a cinquante ans, que ce soit au Bangladesh, au Vietnam ou dans d’autres pays d’Asie, notamment en Indonésie, la quantité de volailles produite était considérablement inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui. Ce phénomène résulte de la croissance démographique et de la hausse du pouvoir d’achat. L’une des choses que l’on sait à propos du pouvoir d’achat des ménages, c’est que lorsque les gens ont un revenu disponible, ils passent d’un régime à base de racines ou de céréales à un régime à base de protéines animales. Et c’est ce qui s’est produit.
Vous écrivez, dans votre article de Science, qu’il existe 1,67 million de virus sur la Terre, et qu’entre 631 000 et 827 000 d’entre eux ont la capacité de nous infecter. C’est tout à fait effrayant, non ?
D’un certain point de vue, effectivement, c’est effrayant. Mais il faut savoir qu’il n’existe pas nécessairement de corrélation entre la possibilité d’infecter et la maladie ou la mort. Certains virus peuvent n’avoir aucune conséquence pour nous. Et certains peuvent contribuer à améliorer notre propre biologie. Ils pourraient s’intégrer à notre microbiome, ce ne serait pas nouveau au cours de l’évolution. Nous devons nous faire à cette idée que les virus ne sont pas simplement nos ennemis, qu’ils peuvent jouer un rôle important et positif pour nous. Nous l’avons découvert en ce qui concerne les bactéries. Dans le même temps, nous devons rester en alerte et demeurer prudents quant aux produits pharmaceutiques que nous prenons. Si nous nous soignons avec des antivirus à large spectre, ceux-ci pourraient entraîner de nouvelles complications.
Comment décririez-vous l’attitude des autorités fédérales américaines vis-à-vis de la menace que représentent les zoonoses ?
Ce sont tous les pays qui sont laxistes, et aussi le secteur privé – nous n’investissons pas dans le risque. Parler de zoonoses, ce n’est pas la même chose que de parler de tuberculose ou de paludisme. Ce sont des maladies tangibles, des problèmes évidents, actuels. Les zoonoses sont un problème émergent. Mais nos sociétés n’investissent pas tant qu’elles ne sont pas confrontées à un danger immédiat.
Or le coronavirus est plus que jamais un danger immédiat, n’est-ce pas ?
Oui, on ne parle plus que de ça. Mais le moment venu, ce coronavirus va cesser de faire les gros titres et on assistera alors à une diminution des investissements qui lui sont consacrés.
Nous avons des budgets en temps de guerre, puis en temps de paix on n’a plus de sous. Dès lors, tout le problème va être d’arriver à convaincre les députés et les investisseurs de miser sur les risques. C’est vraiment difficile.
Les adversaires politiques de Donald Trump, qui ne cache pas son mépris pour les sciences, dénoncent le fait qu’il ait interrompu le financement de votre programme Predict. Pensez-vous qu’il y ait un lien entre la fin de Predict et ce qui s’est passé avec le coronavirus ?
Non, je ne pense pas. Predict était un beau projet. Il était bien exécuté scientifiquement, il était tourné vers l’avenir. Mais nous travaillions à petite échelle. Nous avons découvert à peine plus de 2 000 virus. Si l’on veut avoir des résultats en matière de santé publique, trouver 2 000 virus sur une population de 600 000, sur dix ans, c’est rester très loin du compte. Et Predict n’a pas su résoudre cette équation délicate : transformer la science en outil politique. Nous ne l’avons pas conçu dans ce but. Et puis, même un budget annuel de 20 millions de dollars n’est pas suffisant. Il faudrait environ 100 millions de dollars par an pour mener le type de programme mondial qui nous donnerait les éléments pour transformer notre attitude vis-à-vis des risques viraux et qui nous permettrait de nous y préparer. C’est ce que vise mon nouveau Global Virome Project.
Qu’est-ce qui vous inquiète à propos de ce coronavirus ?
Il y a les aspects évidents qui inquiètent tout le monde. Mais il y a aussi des choses dont on ne parle pas. Or ce sont celles qui me préoccupent le plus. Il s’agit d’un événement mondial, il va frapper partout dans le monde. Mais il n’aura pas partout les mêmes conséquences, car dans certaines régions du monde les systèmes de santé sont bien plus fragiles qu’ils ne le sont en Chine ou en Europe. Nous savons que lorsque des systèmes de santé fragiles sont ultrasollicités, ils courent un énorme risque d’effondrement – notamment en Afrique et dans des régions où il y a des troubles sociaux ou des guerres.
En 2014, quand le virus Ebola s’est abattu sur trois pays d’Afrique de l’Ouest, l’une des premières conséquences de l’épidémie a été la fermeture des services de santé. Le personnel de santé était exposé, écœuré, effrayé. Pendant cinq mois, les services de santé n’assuraient plus les soins les plus élémentaires. Les femmes enceintes n’avaient plus accès aux services de maternité, les enfants n’avaient plus accès aux antipaludéens, les gens n’étaient plus immunisés. Vous aviez toute une population dont la vie était en danger parce qu’elle ne pouvait plus accéder aux services de santé. Ma crainte est que cela ne se reproduise. Si le coronavirus continue à être aussi virulent qu’il en a l’air, nous allons nous retrouver avec des services de santé surchargés, qui ne seront plus capables ni de faire face à l’épidémie ni de traiter les problèmes de santé courants. Aucun de nos responsables politiques ne semble parler de cela.
En 2005, pendant la grippe aviaire, George W. Bush était régulièrement au téléphone avec des dirigeants du monde entier afin d’organiser une riposte planétaire. Barack Obama a fait de même en 2009 pour la deuxième pandémie de H1N1, et en 2014 pour l’épidémie d’Ebola. On a vu des présidents prendre l’initiative et jouer un rôle de catalyseurs en vue de trouver des solutions mondiales à un problème mondial. Rien de tel avec cette Maison-Blanche. À mon sens, si Trump parle de coopération internationale, et encore du bout des lèvres, c’est parce que la Bourse est en chute libre. Il s’agit de calmer les marchés boursiers, cela ne va pas plus loin.
Comment expliquez-vous le silence de cette Maison-Blanche [en matière de coopération internationale] ?
Tout ce qui intéresse le gouvernement Trump, c’est l’Amérique d’abord. Le populisme ici aux États-Unis, mais aussi en Europe et ailleurs, a fragmenté les réseaux mondiaux qui avaient été si déterminants quand il s’était agi de définir une stratégie planétaire pour affronter de tels problèmes. À ma connaissance, tandis que la Chine s’efforçait de contenir le virus, notre président n’a pas pris contact avec Xi Jinping pour réfléchir à une action coordonnée. Je suis très frappé par l’absence totale de dialogue planétaire alors que nous sommes plongés dans une crise planétaire. À l’heure actuelle, on peut même se demander si l’Union européenne existe. Vu d’ici, j’ai l’impression que chaque pays improvise, au fur et à mesure. L’Italie ne se coordonne pas avec Bruxelles. Bruxelles ne se coordonne pas avec l’Allemagne. Il n’y a pas de stratégie régionale cohérente face à ce problème en Europe, alors même que les États européens disposent du cadre nécessaire pour définir une stratégie.
Alors que va-t-il falloir pour que les gens prennent conscience de la menace planétaire des zoonoses ?
Il n’y a rien de tel qu’une série d’attaques pour réveiller les esprits, et c’est ce à quoi on assiste aujourd’hui. Nous sommes dans un cycle où une épidémie survient environ tous les trois ans. Et chaque fois que cela se produit, on est de plus en plus sensibilisés à la nécessité de réaliser des investissements et de les poursuivre. Toute la difficulté consiste à obtenir que ces fonds servent à financer annuellement des projets, en dehors des situations d’urgence.
Le partage des données entre les scientifiques et les généticiens a été exemplaire, vous ne trouvez pas ?
Oui. Mais songez à ce syllogisme de Socrate : une pensée juste conduit à une action juste. Or nous savons que ce n’est pas le cas. Vous pouvez penser dans la bonne direction, tandis que vos pratiques vont dans un tout autre sens. La science nous permet de mieux mesurer le danger, elle va nous apporter des connaissances. Mais ces connaissances doivent se concrétiser par une évaluation des risques systématique, tournée vers l’avenir.
Que devons-nous faire, dans l’idéal ?
Ces virus ont une capacité intrinsèque à muter. Ce que nous observons aujourd’hui aura peut-être changé dans quelques mois. Le virus pourrait devenir plus mortel, ou bien il pourrait s’atténuer, comme le rhume banal [ou rhinopharyngite].
Toute la question est de savoir si nous allons effectuer un suivi de la maladie. Avons-nous suffisamment de données ? Y a-t-il suffisamment de transparence ? Les échantillons sont-ils disponibles ? Qu’a découvert l’Iran ? Qu’a découvert Israël ? Qu’a découvert l’Italie ? Que découvre-t-on aux États-Unis ? Y a-t-il assez de transparence en temps réel pour que nous puissions garder la main sur le pouls du patient ?
Je suis un internationaliste. Il faut réfléchir aux moyens de prendre soin de notre population. Et aussi être attentif aux groupes humains dans le monde qui ont besoin d’assistance. Nous faisons tous partie d’un seul et même écosystème. C’est un problème planétaire. Soit nous nous y préparons, et nous y réagissons dans un contexte planétaire, soit nous ne le faisons pas. Si nos mesures de précaution et nos réactions sont étroitement nationales, nous allons au-devant de gros ennuis.
Kevin Berger








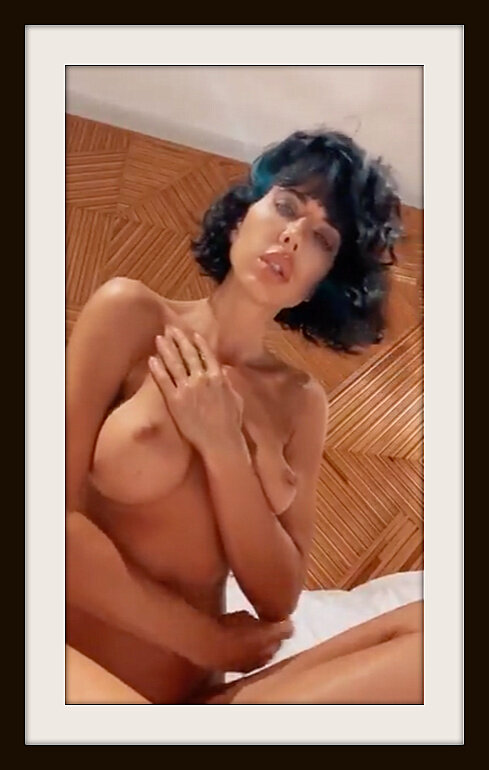





















/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)