Illectronisme : les oubliés de la start-up nation
Par Aline Leclerc, (avec Manon Rescan)
La dématérialisation des démarches administratives est un des piliers de la « révolution numérique » que le gouvernement appelle de ses vœux. Une mesure potentiellement excluante.
Sur la table de sa salle à manger, Annie, 71 ans, a étalé tous les courriers qu’elle range habituellement bien précautionneusement dans des pochettes à rabats. Il y a là des lettres de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), de la Caisse d’allocations familiales (CAF), des avis d’impositions.
Cette ancienne gardienne d’immeuble, en Seine-Saint-Denis, cherche à comprendre pourquoi sa retraite de base est passée de 1 145,94 euros à 1 106,38 euros. Et depuis quand exactement ? Elle a beau chercher, elle ne trouve pas. Les derniers courriers de la CNAV remontent à 2015. Où sont passés les autres ? « Ah mais je n’en reçois plus maintenant, c’est tout par Internet, explique-t-elle, et Internet, moi j’y connais rien. »
Se lancer seule dans la création de son « espace personnel » ? Annie ne l’imagine même pas. Il lui faudrait remplir sans se tromper numéro de Sécurité sociale, date de naissance, mais surtout inventer un mot de passe et franchir l’étape de sécurité qui oblige l’internaute à recopier des lettres biscornues pour prouver qu’elle n’est « pas un robot » : « Qu’est ce que c’est que ce machin-là ? », se cabre la retraitée.
Comme elle semble loin de ce HLM de Seine-Saint-Denis, la « start-up nation », cette nation qui « pense et bouge comme une start-up », cette France bientôt « leader de l’IA [intelligence artificielle] et des deeptechs [des produits ou des services sur la base d’innovations de rupture] » dont rêve le président Emmanuel Macron, comme le 9 octobre à Paris, devant les start-upers de la Station F. Lors de sa présentation de la réforme de l’Etat, lundi 29 octobre, le premier ministre Edouard Philippe a d’ailleurs redit son « ambition » : « que 100 % des services publics soient accessibles en ligne à l’horizon 2022. » La dématérialisation des démarches administratives devenant ainsi l’un des piliers de la « révolution numérique » que le chef du gouvernement appelle de ses vœux.
« Le côté humain disparaît derrière les écrans »
« C’est à la fois terriblement démocratique et potentiellement excluant », observe Jean Deydier, fondateur et directeur d’Emmaüs Connect, une branche de l’association Emmaüs qui lutte contre l’exclusion numérique. « Pour une très grosse majorité de la population, la dématérialisation est une aubaine, tout sera plus simple. Mais dans le même temps, on risque de laisser une masse de population sur le bord de la route », poursuit-il.
Car Annie n’est malheureusement pas la seule à redouter les démarches en ligne. Des personnes confrontées aux mêmes difficultés, Le Monde en a croisé partout en France.
Comme Indira, 26 ans, qui doit se faire aider pour remplir son dossier en ligne dans un Pôle emploi de Belfort – à l’heure où l’opérateur met en avant ses « applis » pour smartphone ou son site « Emploi store » pour « booster sa recherche d’emploi ». Ou Marie, 48 ans, qui vient chercher de l’aide au Secours catholique à Paris pour actualiser son dossier de revenu de solidarité active (RSA). « Partout, le côté humain disparaît derrière les écrans, dit-elle. Avant, quand on avait un problème, on pouvait espérer être reçu. Maintenant, c’est tout par informatique. »
A Bourg-Achard (Eure), c’est encore cette retraitée qui confie son désarroi à sa députée lors d’un repas des Anciens organisé par le centre communal d’action sociale : « Comment fait-on quand on n’a pas d’ordinateur ? » Et qui n’a pas reçu l’appel d’un parent ou d’un voisin, en recherche d’une assistance technique face à l’outil informatique ?
Perdu, aussi érudit ou diplômé soit-il, devant un test de sécurité qui demande d’identifier des détails dans une image, ou devant l’élaboration d’un mot de passe sécurisé avec « caractères spéciaux » ? Des consignes évidentes pour les initiés mais qui ont tout d’une langue étrangère pour les néophytes. Une forme d’illettrisme appelée illectronisme.
Le secrétariat d’Etat chargé du numérique compte treize millions de Français qui n’utilisent pas ou peu Internet dont 6,7 millions qui ne s’y connectent jamais. Une enquête CSA de mars révélait que 15 % de nos concitoyens trouvaient l’usage des équipements de nouvelles technologies « difficile », et jusqu’à 39 % des 70 ans et plus.
Les plus concernés sont les publics les plus fragiles. Une étude publiée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) en 2017 faisait de la dématérialisation « la double peine des personnes en difficulté » : personnes âgées, personnes handicapées ou souffrant de maladie chronique, allocataires de minima sociaux, habitants de zone rurale. Ce sont à la fois ceux qui ont le plus de difficultés d’accès au système qui en sont les plus tributaires pour toucher les allocations auxquelles ils ont droit.
« 20 % à 25 % de personnes en difficulté »
Les freins sont de deux ordres : il y a ceux qui manquent d’équipement – pas d’ordinateur ou de smartphone, ou pas de connexion Internet à domicile. Mais il y a aussi les difficultés d’usage. « Des gens qui comprennent à peu près comment marche un ordinateur bloquent devant l’enjeu : ils savent qu’une erreur peut leur coûter cher, indique Jean Deydier. C’est là qu’on constate un effet contraire de la dématérialisation : on crée un nouveau canal mais qui génère du stress et crée un afflux au guichet. »
Il suffit en effet de se rendre dans une CAF ou dans un centre des impôts pour constater que les files d’attente n’ont pas diminué.
Assistante sociale depuis 1981 dans un département défavorisé, Nicole voit ainsi de plus en plus de personnes venir lui demander de faire des démarches à leur place, à commencer par la création d’une adresse mail.
« La fracture numérique on la voit au quotidien », déplore-t-elle en pointant les risques du système : « avant, pour le RSA, les gens recevaient un courrier tous les trois mois. Maintenant, l’actualisation se fait par mail. Mais, s’ils n’ont pas d’ordinateur, ou ne savent pas se connecter, ils n’y ont pas accès… Or au moindre retard, l’arrêt du paiement est immédiat. »
Le phénomène n’est pas nouveau : en 1999, Lionel Jospin, alors premier ministre, redoutait déjà que l’essor des technologies de l’information crée « un fossé numérique ». Mais l’accélération de la « révolution numérique » – Edouard Philippe a encore annoncé, lundi, une nouvelle vague de services accessibles en ligne – a accru les inquiétudes.
« Si en 2022, on oblige les gens à accéder aux services publics par le numérique, il y aura 20 % à 25 % de personnes en difficulté », a alerté le Défenseur des droits Jacques Toubon, le 18 octobre, lors de la quatrième convention de ses délégués, qui s’est tenue en présence du secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi. M. Toubon, qui a appelé à « simplifier et réhumaniser les services publics offerts aux citoyens », publiera en décembre un premier rapport entièrement consacré à la dématérialisation.
Déjà, certaines démarches administratives ne se font plus qu’en ligne. C’est le cas pour la prime d’activité. Et pour la première fois en 2019, ce sera également le cas pour la déclaration de revenus, mettant tout le monde au pied du mur. De nouveaux documents vont également être dématérialisés dans les années qui viennent, comment les ordonnances médicales (une expérimentation aura lieu en 2019) ou encore l’inscription (en ligne) sur les listes électorales.
« Soit on forme les gens et on booste leurs capacités, soit on ne fait rien et on les perd », résume Jean Deydier. Emmaüs Connect a d’ailleurs lancé, en octobre, une campagne pour étoffer son volant de bénévoles chargés de la formation des personnes victimes de cette fracture numérique.
« Ticket-restaurant » du numérique
Conscient des risques, M. Mahjoubi a lancé, mi-septembre, un « plan national pour un numérique inclusif ». L’objectif est de détecter les publics en difficulté et de les rendre le plus autonome possible : 10 millions d’euros vont ainsi permettre de financer des « pass numériques », sorte de ticket-restaurant du numérique, donnant droit de 10 heures à 20 heures de formation. Et 5 millions d’euros doivent permettre de faire émerger partout en France des « hubs » – la rhétorique de la start-up nation n’est jamais loin –, soit la création de structures référentes, dédiées à l’inclusion numérique.
Le gouvernement espère créer ainsi un « effet levier » qui permette de monter en puissance sur le sujet. Pôle emploi financera par exemple des « pass numériques » pour que certains demandeurs d’emploi puissent accéder à des cours.
Les jeunes ayant choisi de faire un service civique ont par ailleurs été identifiés comme autant d’accompagnateurs potentiels à l’inclusion numérique. A Pôle emploi, ils sont déjà 3 200 à épauler les demandeurs. L’objectif affiché par le gouvernement est de former 1,5 million de personnes confrontées à l’illectronisme par an. « C’est très ambitieux », reconnaît-on dans l’entourage de Mounir Mahjoubi, où l’on est conscient que cet objectif ne sera pas atteint la première année. « Il faut que l’opinion publique s’empare du sujet qui reste encore confidentiel », ajoute-t-on au secrétariat d’Etat chargé du numérique.
Présenté le même jour que les annonces gouvernementales sur la pauvreté, le plan Mahjoubi est d’ailleurs passé un peu inaperçu. Il a néanmoins été salué par les associations qui y ont vu un premier pas encourageant. Mais tout reste à construire. L’élaboration des « hubs » n’en est encore qu’au stade de l’appel à projet.
Et dans le milieu associatif, certains pointent le risque de voir cette nouvelle manne de financement mal utilisée. « Jusqu’ici il n’existait rien, ce plan est une base. Mais il n’est pas adapté au public que nous connaissons », estime Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits Frères des pauvres, qui aide des personnes âgées en situation de précarité. « Ce public âgé ne se rendra pas dans des endroits inconnus pour prendre des cours », redoute la responsable associative.
« Est-ce qu’on va aider seulement ceux qui sont les plus proches du numérique, ou aussi ceux qui en sont le plus loin ? », interroge, lui aussi, le directeur d’Emmaüs Connect, Jean Deydier.
En présentant la réforme de l’Etat lundi, le gouvernement a précisé que les Français désireux de faire part de leurs difficultés d’accès aux services publics, notamment liées à la dématérialisation, pourront bientôt le faire… en ligne, via la plateforme « Vox Usagers ».






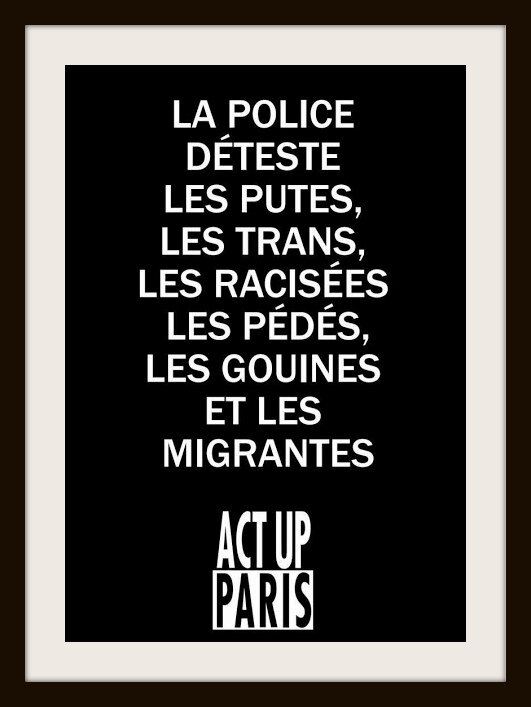





/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)