
Par Béatrice Gurrey
Je ne serais par arrivée là si… « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, l’actrice italienne évoque ses diférentes carrières et la force vitale qui la guide.
A 55 ans, après une soixantaine de films, Monica Bellucci s’est lancée dans le théâtre avec Maria Callas. Lettres & Mémoires, un spectacle mis en scène par Tom Volf, qu’elle reprend aux Bouffes parisiens du 28 février au 28 mars. Une expérience bouleversante pour l’actrice italienne qui évoque le changement radical de la place des femmes, survenu en quarante ans.
Je ne serais pas arrivée là si…
Si c’était Maria Callas qui répondait à cette question, elle dirait : « Si je n’avais pas eu une foi absolue en moi-même. » C’est ce qu’elle écrit dans ses Mémoires. Mais moi, si je regarde les différents parcours de ma vie, je pense que je n’aurais pas pu les suivre si je n’avais pas cru en ce que j’appelle la force vitale. C’est elle qui m’a toujours guidée. Comme une énergie qui me pousse à aller de l’avant. Quelque chose qui me fait croire en l’avenir. C’est peut-être une manière de vivre « à l’italienne » qui me porte à penser à la positivité, à la vitalité.
Votre ville d’origine, Citta di Castello, est mentionnée dès l’Antiquité, florissante à la Renaissance. Cela fait partie de votre identité ?
Ma région, l’Ombrie, au milieu de l’Italie, est très proche de la Toscane et les influences artistiques s’y sont croisées. C’est une région d’art et de saints. Elle est connue pour ses peintres, Il Perugino [Le Pérugin], un des grands maîtres de la Renaissance italienne est né à Citta della Pieve. Santa Chiara, comment dit-on, sainte Claire, est originaire d’Ombrie, elle aussi. Alberto Burri, un artiste plasticien du XXe siècle, est né dans ma ville, Citta di Castello, la ville du château, en italien. Et aussi une célèbre cantatrice du XIXe siècle, l’Alboni, qui est enterrée au Père-Lachaise car elle a vécu à Paris. Tout cela pour dire que ce n’est pas un hasard qui me lie à la France et à l’art !
Quand j’étais jeune, j’ai vu beaucoup de films italiens, ceux des grands metteurs en scène, Rossellini, Visconti, De Sica, mais j’ai aussi découvert le cinéma français, à travers Carné, Truffaut, Godard. Tous ces réalisateurs passaient à la télévision italienne. Notre génération connaissait ces films et cette culture. Si je demandais à des jeunes aujourd’hui s’ils ont vu La Dolce Vita, s’ils connaissent son réalisateur, Federico Fellini, ou s’ils ont entendu parler d’Anita Ekberg, je ne suis pas sûre qu’ils le sauraient. Il y a moins, désormais, cette protection de notre culture, pourtant nécessaire. Mais moi je viens de là.
Votre père avait une petite entreprise de transport, votre mère s’occupait de la maison. Ce milieu n’avait « rien à voir avec le cinéma », avez-vous dit. Mais y avez-vous puisé la force qui vous a poussée à le quitter ?
Il n’avait rien à voir, mais mes parents aimaient le cinéma et ils y allaient souvent. Je suis fille unique et on voyait beaucoup de films, on en parlait ensemble. Peut-être que le cinéma était une manière d’échapper à la routine de la vie de province. Quand j’y repense, je n’étais pas dans le refus de la province. Parce que je crois que j’ai eu une forme de protection et de liberté que quelqu’un qui vit dans une grande ville n’aurait peut-être pas eue – ou moins. Mais c’est vrai que, pour ma personnalité, au bout d’un moment, j’ai senti le besoin de m’éloigner de tout cela, pour pouvoir me construire autrement.
Très jeune, je suis allée à Milan, puis à Paris, ensuite à New York. Quand j’ai commencé dans le cinéma je n’étais pas si jeune que cela, parce que j’avais déjà eu une expérience dans la mode. J’avais vécu dans plusieurs villes, dans plusieurs pays et je connaissais le monde du travail. Le cinéma représentait ma deuxième vie, ma deuxième expérience. Quand j’ai fait mon premier film, j’avais déjà 25 ans.
Ce n’était pas si vieux, même à la fin des années 1980 !
Oui, mais j’ai commencé à travailler quand j’étais encore au lycée ! J’ai fait mes premiers pas dans le mannequinat à 16 ans et j’étudiais en même temps. J’ai approché très tôt l’univers des adultes. Ce qui me plaisait, c’est que je travaillais et, après, je retournais à l’école. Dans la mode, j’évoluais avec des mannequins qui avaient dix ans de plus que moi et ensuite je retrouvais des jeunes de mon âge. J’aimais l’idée de me construire aussi d’un point de vue culturel, j’ai toujours pensé que l’école était très importante dans la formation de quelqu’un. Au moins pour ce qui me concerne.
C’est aussi ce que je dis à mes filles. Dans une classe, il y a déjà une petite société, à laquelle il faut s’adapter. L’esprit d’adaptation nous aide à nous construire, à nous accepter et aussi à accepter les autres. La formation que donne l’école, ce ne sont pas seulement les matières, les disciplines, mais c’est cette capacité à comprendre les différences et à vivre en groupe.
A 15 ans, votre fille aînée, Deva Cassel, devient l’égérie d’une marque de luxe italienne comme vous l’avez été vous-même. Souhaitez-vous qu’elle poursuive des études ?
Mais c’est seulement une campagne, et oui, bien sûr je le souhaite. Et elle va à l’école. Elle a voulu tenter cette expérience qu’on lui a proposée. Je pense qu’elle a voulu se prouver à elle-même qu’elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu’elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu’elle était apte à gérer tout cela. Et en même temps, voilà… Je pense qu’elle a l’envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu’il y a à être une adolescente.
A l’âge de 14 ans, un professeur vous envoie vous démaquiller dans les toilettes du lycée, alors que vos grands-mères, vos tantes, votre mère encouragent les signes extérieurs de féminité. C’est en vous très tôt, ce sentiment d’être une femme ?
Si je le savais ! Si l’on pouvait s’analyser de l’extérieur, ce serait tellement plus facile… On ne sait pas pourquoi on est attiré par une chose plus qu’une autre. Mais la féminité m’a toujours inspirée. Quand je regardais des films, des photos, des images de femmes qui avaient cette force tirée de leur féminité – cela peut-être une force comme une fragilité –, en tout cas, cela me touchait. Je ne sais pas pourquoi cette féminité m’a permis de me construire. Probablement parce que cela faisait partie de moi.
La féminité, je la vois aussi comme une forme de sensibilité, une aptitude à percevoir les choses. C’est une forme de passivité assumée qui n’est pas à juger. On peut penser que c’est une faiblesse, mais moi je ne la vois pas comme cela. Cette capacité qu’ont les femmes de porter un enfant neuf mois dans leur ventre, d’allaiter, d’avoir le calme nécessaire, de chanter des berceuses, toute la maternité fait partie de cette passivité assumée. Mais il est sûr que quand une femme sort cette part d’elle-même, elle a besoin de protection autour d’elle. Quand on est dans cet état-là, s’il n’y a pas de bienveillance autour de soi, tout peut être perçu comme une faiblesse. Nous possédons tous une part féminine et une part masculine, hommes et femmes, et c’est à chacun de trouver son équilibre intérieur.
Votre mère ne vous interdisait donc pas de « rester plus de cinq minutes devant un miroir », comme celle de Callas…
Ah non, elle ne m’interdisait pas cela ! J’avais beaucoup de féminité autour de moi. Je ne sais pas si ce sont des codes italiens. Chez Maria Callas, ce qui m’a beaucoup touchée, c’est que j’ai senti profondément cette recherche de sa propre féminité. Cette femme est le fruit de sa propre création. Elle a cherché au fond d’elle-même son vrai soi. Son art venait aussi d’une grande souffrance, comme c’est souvent le cas.
C’est le vôtre ?
A travers l’art, on exorcise toujours quelque chose qui vient de l’intérieur. Quelquefois c’est conscient, parfois c’est inconscient. Au théâtre, on m’avait déjà fait plusieurs propositions mais je n’avais jamais voulu. Parce que je devais faire un film, parce que je ne me sentais pas prête, parce que j’avais peur. Et d’un coup, quand ce projet de la Callas est arrivé, je ne sais pas… J’ai lu une lettre, ses Mémoires et j’ai senti qu’il y avait quelque chose de tellement attachant pour moi. Par exemple, cette contradiction entre, d’un côté, sa grande vulnérabilité, cachée, et d’un autre côté la dureté, la sévérité qu’elle montrait envers ses élèves pendant ses master class, parce qu’elle-même avait été élevée comme ça.
Ce que je porte, c’est sa vulnérabilité qui était aussi la source de son chant. Ce que, humblement, je cherche à montrer, ce n’est pas la Callas que tout le monde voyait, c’est la partie cachée, c’est Maria. Pour moi, cette pièce est un petit bijou. Et sûrement l’une des choses les plus délicates et les plus précieuses que j’ai faites jusqu’à maintenant. Parce que là, tu ne peux pas mentir. Ce que tu ressens, le public le ressent.
Le papillon qui se pose sur votre cou lors de la générale, les robes de la cantatrice qui vous vont comme un gant. Vous croyez aux signes dans votre vie ?
Ecoutez, des gens disent que les coïncidences n’existent pas. Que les coïncidences sont la manière qu’a Dieu de se montrer incognito (rires). Je ne sais pas si c’est le cas, mais c’est vrai que c’était incroyable. Un grand papillon vert et brun a tourné autour de moi, puis il s’est posé sur mon cou. Ensuite, il s’est envolé vers le public. C’était fou ! Fou ! (Elle rit.) Un moment… je ne sais pas… magique. Je suis très reconnaissante à la vie de me donner toutes ces expériences artistiques. Je pense toujours que l’existence est un croisement entre ce que l’on veut et ce qui arrive. Mais il faut des opportunités pour pouvoir choisir.
Ce contact presque charnel avec le public, n’est-ce pas ce qui manque aux émotions du cinéma ?
En effet, au cinéma, l’œuvre se sépare de l’artiste. Elle voyage sans toi. Alors qu’au théâtre, ça n’est pas possible ! Tu pars avec ton œuvre. Si je fais une tournée, je prendrai mon canapé, ma robe de Callas et je partirai… Avec Tom Volf [biographe de Callas et metteur en scène de la pièce] évidemment, j’espère qu’il me suivra ! J’aimerais bien la jouer en anglais, qui était la langue maternelle de Callas, née à New York, ou en italien, qu’elle parlait parfaitement. Ce qu’elle dit parle à tout le monde. Maria avait un accent dans toutes les langues, même si elle les maîtrisait très bien. Cela m’aide aussi quelque part, je ne m’éloigne pas trop du personnage.
Qu’avez-vous appris sur vous-même en lisant, en jouant, ces textes ?
Maria avait ce qu’ont les artistes : la recherche de quelque chose qui est en soi. Et pour cela, on a besoin de solitude. Il faut de la communion avec un public, mais l’essentiel du travail d’artiste se fait dans la solitude. Je vous l’ai dit, je suis fille unique et cette solitude m’est nécessaire pour me ressourcer.
Ce que cette pièce m’a révélé aussi, c’est le passage du temps, entre les femmes de cette époque et la nôtre. Maria Callas et sa douleur sont le produit d’une époque et d’une culture qui ont changé. C’est incroyable ce qui est arrivé en très peu d’années. En trente ou quarante ans, la réalité des femmes a été bouleversée. Bien que Callas soit plus libre que d’autres et que sa vie d’artiste lui donne cette liberté et cette indépendance, elle est complètement conditionnée. C’est un monde où les femmes peuvent très peu s’exprimer. Aujourd’hui, elle n’aurait pas vécu comme cela et elle ne serait pas morte non plus comme cela, à 53 ans. Elle est moderne car elle se rebelle contre un système, mais elle l’a payé très cher.
J’ai eu une communion naturelle avec elle. Je viens d’un pays où les femmes apprennent encore, tout doucement, à s’affirmer. Il faut du temps avant de pouvoir parler sans peur. Cette culture méditerranéenne, je la connais très bien. Je sens ce qu’elle ressent. Je comprends ce que disent ses yeux profonds qui parlent sans rien dire, parce que la parole n’est pas permise.
Elle ne connaît pendant longtemps que l’abnégation de son travail et sa féminité explose avec Onassis. Mais elle vit sous domination masculine. Je parle de cela sans faire la guerre aux hommes. C’est une évolution qui prendra du temps mais un changement radical est en route. L’affrontement ne servirait à rien. Il faut trouver une manière intelligente de se parler.
Callas éprouve une ambition professionnelle absolue, presque démesurée. Vous comprenez cette ambition, vous la ressentez ?
Cette ambition lui vient de sa mère. Cette forme de réussite totale, ce n’est rien d’autre qu’un besoin d’amour. C’était une femme qui, lorsqu’elle avait l’amour, pouvait tout réussir. L’amour de sa mère était directement proportionnel à ses performances. Chanter Norma comme personne, cela voulait dire, finalement on m’aimera, on comprendra que j’ai de la valeur. Mais au fond de cette femme si extraordinaire vivait le désir tout simple d’avoir une maison, des enfants. Qu’elle n’a jamais eus.
Personnellement, je ne crois pas que ce soit l’ambition qui me pousse. C’est plutôt la curiosité, comme si à travers toutes ces expériences j’avais la possibilité de comprendre des choses de moi-même et des autres, et les raisons de mon passage sur terre.
Elle a le monde à ses pieds mais se demande sans cesse si on l’aime et évoque ses sentiments « qui ne valent rien ». Faut-il se poser ces questions ?
Elle a ouvert les portes de son intimité et au lieu de la protéger, on l’a broyée. On a brisé la femme et par conséquent on a brisé l’artiste. On lui a volé sa force. On a détruit son cœur et elle est morte. C’est cette Callas-là que je porte. Quand on est aimé, on le sent et on le voit dans le regard des autres. Mais quand on fait ce métier, qui implique une relation avec le public, il faut faire une vraie différence entre ce que l’on est et ce que l’on représente. Ce que le public voit, ce n’est pas ton vrai toi. Ton jardin secret, ta partie cachée, que tu ne montres pas à la terre entière. On n’est pas ce que l’on fait. Ou du moins on est un peu ce que l’on fait, mais pas complètement. Ce serait un jeu dangereux.
« Maria Callas. Lettres & Mémoires », du 28 février au 28 mars, au Théâtre des Bouffes parisiens






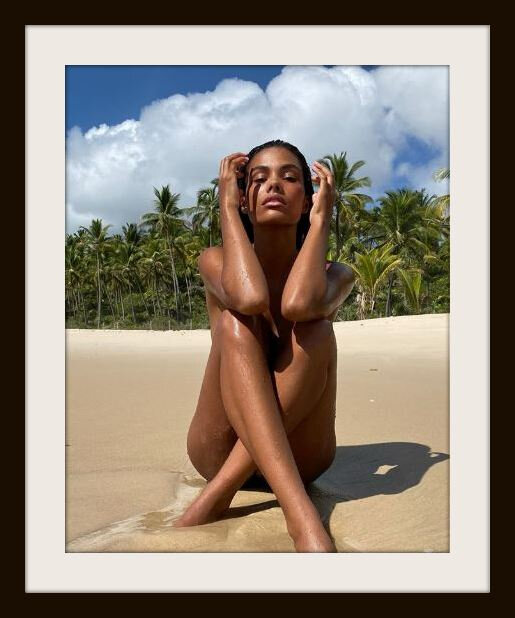








/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)