Abattre un missile nord-coréen ? Une option risquée pour les Etats-Unis
Par Harold Thibault - Le Monde
Washington a les moyens de frapper un engin en vol. Mais cette éventualité pose des problèmes légaux, stratégiques et techniques.
La multiplication des tirs de missiles nord-coréens – une vingtaine depuis le début de l’année dont trois de type intercontinental – est un défi aux injonctions américaines. Avec la nouvelle provocation de Pyongyang, mercredi 29 novembre, l’exaspération se fait ressentir. Un représentant républicain de Californie, Dana Rohrabacher, lançait ainsi en septembre :
« J’espère que la prochaine fois que les Nord-Coréens tireront un missile, particulièrement s’il survole notre allié le Japon, nous l’abattrons pour envoyer un message aux Nord-Coréens ainsi qu’aux peuples, comme le Japon, qui comptent sur nous. Tant que nous ne démontrons pas notre volonté d’employer la force, il n’y a aucune raison pour eux d’y croire. »
La doctrine américaine n’a pas fondamentalement changé pour l’heure. « La position actuelle est de s’attaquer à un missile s’il pose une menace », résume Ian Williams, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné le secrétaire américain à la défense, James Mattis, lorsque la presse lui a demandé la raison pour laquelle les Etats-Unis n’ont jusqu’à présent pas intercepté les tirs de Pyongyang. « D’abord, ces missiles ne menacent aucun d’entre nous directement », avait répondu M. Mattis, le 19 septembre, ajoutant que si un de ces vecteurs constituait un danger pour les Etats-Unis ou le Japon, « cela susciterait une réponse différente de notre part ».
Une interception créerait un précédent
Mais un débat semble s’être installé, ou du moins le Pentagone veut-il en donner le sentiment, ce qui laisse planer le doute. Un responsable de l’administration Trump, sous couvert de l’anonymat, s’est demandé, interrogé par CNN, si le programme balistique nord-coréen n’était pas devenu une « menace inhérente ». Une qualification qui serait de nature à convaincre la défense américaine d’intercepter un missile, « même si sa trajectoire n’indique pas qu’il va frapper les Etats-Unis ou ses alliés ».
Au premier abord, l’idée de réaliser un geste fort en abattant un missile nord-coréen peut sembler tentante à l’armée américaine. « Ce serait un signal, le reste n’ayant pas marché, et cela démontrerait la capacité de nos systèmes à ceux qui sont sceptiques », relève M. Williams, du CSIS. Mais ce dernier ajoute que les arguments contre sont nombreux. A commencer par la question de la suite des opérations. Une interception créerait un précédent, mais que faire lors du tir suivant ? Les systèmes d’interception sont conçus comme un filet temporaire, pour faire face à une première frappe, le temps ensuite pour l’aviation de tenter de détruire les sites de tir clés, mais certainement pas comme des outils de blocage systématique.
La légalité d’une telle frappe au regard du droit international serait par ailleurs discutable. « Envoyer un missile dans l’océan, dans une zone où il n’y a rien autour, comme le fait la Corée du Nord, ne constitue pas un acte de guerre », souligne Joshua Pollack, chercheur à l’Institut Middlebury d’études internationales et rédacteur en chef de la Nonproliferation Review.
C’est le même raisonnement du côté du Japon, contraint au pacifisme par sa Constitution de 1947. Certains tirs atterrissent dans sa zone économique exclusive, la ligne des 200 milles nautiques depuis la côte à l’intérieur de laquelle un Etat est souverain en matière d’exploitation des ressources naturelles.
« Plus difficile qu’on l’imagine »
Le territoire de l’Archipel a été survolé à deux reprises cette année par les missiles nord-coréens mais à une altitude élevée (environ 550 km pour le tir du 15 septembre) indiquant, malgré le caractère anxiogène de l’opération, que le pays n’était pas la cible.
Mais dans un entretien au Financial Times en octobre, le ministre japonais de la défense, Itsunori Onodera, estimait :
« Que ce soit fait par le Japon ou un autre pays, je pense qu’abattre un missile balistique pourrait être interprété comme une action militaire. A moins que vous jugiez que c’est une attaque contre votre propre pays, il est difficile d’abattre de tels missiles. »
Les armées américaine et japonaise ont théoriquement la capacité technique d’abattre un tel missile mais c’est un jeu risqué – quelle serait la réaction de Pyongyang ? –, voire contre-productif. Il faudrait en effet, pour abattre un engin ne descendant pas vers le sol nippon ou américain, qu’un des navires dotés du système d’interception Aegis, des radars et batteries de missiles, s’approche dangereusement des côtes nord-coréennes et touche le missile en phase ascendante.
Quant à intercepter le missile en phase descendante, il faudrait pour cela qu’un bâtiment américain se positionne au large dans le Pacifique et non à proximité du Japon ou d’autres îles relevant des intérêts américains. « Cela reviendrait à soustraire des ressources employées à la protection de l’Archipel pour une zone du Pacifique où il n’y a que du poisson, résume M. Pollack. L’interception est bien plus difficile qu’on l’imagine. »
Enfin, le risque d’un échec ne peut être exclu. En juin, l’armée américaine avait procédé à un test d’interception avec un missile SM-3 depuis le destroyer USS John Paul Jones au large d’Hawaï. Le radar à bord avait bien identifié le missile cible, le SM-3 l’avait suivi mais n’était pas parvenu à l’atteindre. Une telle déconvenue face à un missile nord-coréen porterait un coup sévère à la crédibilité des sommations américaines.




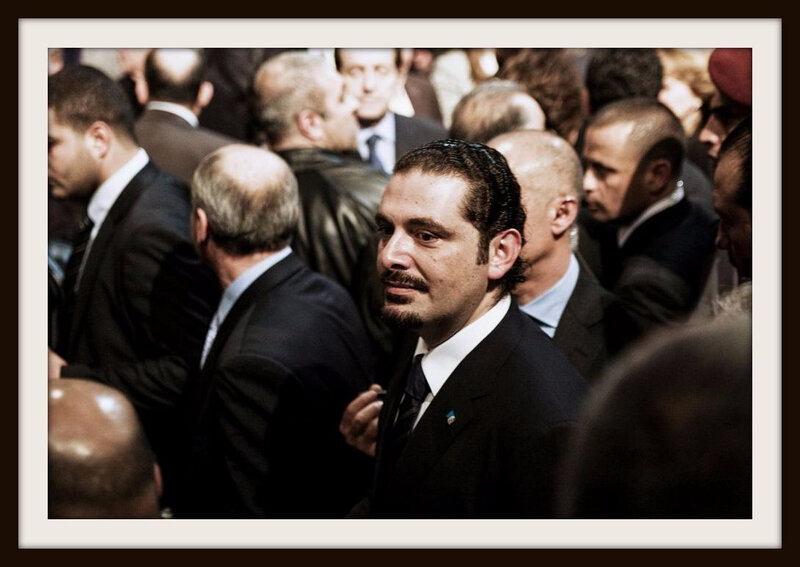
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)