La Corée du Nord poursuit ses activités nucléaires
D’après un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique, tout indique que laboratoires et réacteurs nord-coréens sont encore en activité.
La Corée du Nord poursuit ses activités nucléaires malgré les intentions affichées au printemps par son dirigeant Kim Jong-un, d’après un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dont l’AFP a eu connaissance mardi 21 août. L’agence onusienne souligne que Pyongyang poursuit la construction de son réacteur à eau légère, ainsi que l’extraction et la concentration d’uranium sur son site de Pyongsan.
L’AIEA affirme également disposer d’indications sur des activités liées au « laboratoire radiochimique » nord-coréen et au réacteur expérimental de Yongbyon « entre fin avril et début mai 2018 », soit après le sommet intercoréen d’avril, lors duquel Kim Jong-un et son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, s’étaient engagés à travailler à la « dénucléarisation complète de la péninsule ».
Un engagement pourtant réitéré le 12 juin, lors d’une rencontre sans précédent avec le président américain Donald Trump à Singapour, qui avait été suivi, en juillet, par le démantèlement d’un site de missiles. Le département d’Etat américain jugeait d’ailleurs, encore récemment, que les discussions avec la Corée du Nord allaient « dans la bonne direction », évoquant la tenue de réunions à huis clos entre Washington et Pyongyang.
Nouveau sommet en septembre
Jugeant « préoccupantes » et « profondément regrettables » ces activités violant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), Yukiya Amano, le directeur général de l’AIEA, appelle une nouvelle fois la Corée du Nord à « remplir pleinement ses obligations » internationales.
Il souligne que l’agence est prête à reprendre très rapidement ses inspections sur place, stoppées net en 2009 après l’expulsion de ses inspecteurs.
Le 3 août, un document confidentiel remis au Conseil de sécurité de l’ONU assurait déjà que la Corée du Nord n’avait pas cessé « ses programmes nucléaire et balistique, et [continuait] de défier les résolutions (…) avec une augmentation massive des transferts illicites de produits pétroliers, ainsi qu’avec des transferts de charbon en 2018 ».
Les deux Corées doivent tenir un nouveau sommet en septembre, à Pyongyang.
Cachez ce téton que je ne saurais voir ! STOP à la CENSURE (Facebook, Instagram, etc...)
L’ère révolue de l’acronyme « GAFA »
Par Vincent Fagot - Le Monde
Regrouper Google, Apple, Facebook et Amazon n’a plus de sens, tant leurs défis divergent.
« Le doute gâte la foi, comme le sel gâte le miel. » Les observateurs du Nasdaq, la Bourse américaine des valeurs technologiques, pourraient méditer ce proverbe algérien.
D’un été marqué par le décrochage de l’action Facebook (− 17 % en un mois), puis la consécration d’Apple, première entreprise à dépasser les 1 000 milliards de dollars (870 milliards d’euros) de valorisation, les investisseurs semblent avoir perdu leurs certitudes. Leur foi dans les « GAFA » (acronyme utilisé en Europe pour désigner Google, Apple, Facebook et Amazon) vacille.
« L’heure du réveil a sonné. On ne peut plus parier aveuglément sur ces valeurs », résumait Ari Shrage, le patron d’Aliya Capital cité par le Financial Times après la chute du titre Facebook, le 26 juillet. « On dirait que c’est le début de la fin de l’ère des “GAFA” », proclamait même Mike O’Rourke, chargé de la stratégie marchés chez JonesTrading. En fait, les investisseurs se font à l’idée que les trajectoires de ces groupes sont appelées à diverger.
Certes, leurs points communs sont nombreux : ces sociétés à forte valeur technologique, conçues comme des plates-formes, ont rapidement réussi à asseoir leur domination à l’échelle mondiale. Elles demeurent les quatre fleurons les plus rutilants de la Bourse américaine, avec des capitalisations excédant les 500 milliards de dollars. Et leur rythme de croissance est toujours insolent (+ 96 % pour Amazon sur les douze derniers mois, + 21 % pour Alphabet, maison mère de Google, + 35 % pour Apple).
Cela dit, les défis à relever pour continuer à entretenir cette dynamique sont très différents. En outre, leur horizon paraît plus ou moins dégagé.
Facebook multiplie les faux pas
Celui de Facebook est de loin le plus bouché. Accusée de propager des fausses informations (lors du référendum sur le Brexit, en juin 2016, ou lors de l’élection présidentielle américaine, en novembre de la même année) et de ne pas protéger suffisamment les données de ses utilisateurs, comme l’a illustré le scandale Cambridge Analytica, l’entreprise de Mark Zuckerberg multiplie les faux pas depuis deux ans.
Confronté à l’émergence de régulations de plus en plus restrictives – dont le règlement général sur la protection des données (RGPD), en Europe – et à une défiance croissante, Facebook, qui affiche 2,23 milliards d’utilisateurs mensuels actifs au compteur, a vu la croissance du nombre de ses membres atteindre un plus bas historique au deuxième trimestre de cette année.
Obligée de retisser un lien de confiance avec ses « clients » (utilisateurs comme annonceurs), la firme californienne s’est engagée dans un coûteux programme pour faire le ménage sur sa plate-forme. Avec pour résultat une marge appelée à être durablement rognée.
Mark Zuckerberg peut toutefois compter sur Instagram, et dans une moindre mesure sur WhatsApp, deux sociétés acquises respectivement en 2012 et 2014, pour générer de nouveaux revenus. Avec un milliard d’utilisateurs (+ 100 % en deux ans), le réseau de partage d’images pèse déjà 20 % du chiffre d’affaires de Facebook.
Google face à la Commission européenne
Leader incontesté des moteurs de recherche, Google se heurte aussi à des obstacles réglementaires. A la mi-juillet, le géant de Mountain View (Californie) s’est vu infliger une amende record de 4,34 milliards d’euros pour abus de position dominante, la Commission européenne lui reprochant d’imposer ses applications mobiles par le biais de son système d’exploitation Android, qui équipe 85,9 % des smartphones dans le monde. De nouvelles sanctions pourraient suivre si des mesures correctives n’étaient pas prises d’ici à septembre.
En juin 2017, déjà, une autre condamnation pour abus de position dominante, concernant cette fois son comparateur de prix Google Shopping, lui avait valu une amende de 2,42 milliards d’euros de la part de l’exécutif européen. Mais le niveau des sanctions reste pour l’instant trop peu significatif pour freiner une entreprise qui a réalisé 3,2 milliards de dollars de bénéfices au cours du seul deuxième trimestre et qui a vu son chiffre d’affaires encore progresser de 26 %.
Comparativement, les perspectives paraissent plus réjouissantes pour Apple et Amazon. Malgré un marché du smartphone de plus en plus saturé, et une âpre concurrence (le chinois Huawei s’est hissé au deuxième rang des constructeurs mondiaux sur le deuxième trimestre, selon IDC), la firme à la pomme parvient à maintenir le niveau de ses ventes, tout en dégageant une marge beaucoup plus élevée que ses concurrents. Il en va de même dans le domaine des applications : le groupe accapare deux tiers des revenus de ce marché.
De son côté, Amazon reste le champion incontesté du commerce en ligne, et ce d’autant qu’il permet, moyennant commission, à d’autres vendeurs d’utiliser sa plate-forme, voire son service de livraison. Aujourd’hui, ce service représente la moitié des ventes réalisées par la firme. Le groupe profite aussi de sa stratégie de diversification, avec des paris gagnants, telle la publicité numérique – secteur dans lequel il est parvenu à devenir en peu de temps un acteur qui compte – ou plus encore le cloud (l’informatique dématérialisée), de loin sa division la plus rentable et celle qui connaît la plus forte croissance.
« En concurrence directe »
C’est ce qui en fait peut-être le mieux loti de la « bande des quatre ». Pour continuer à alimenter leur croissance, ces entreprises sont appelées à se diversifier. Facebook a ainsi misé sur la réalité virtuelle, sans succès pour l’instant. Google, de son côté, investit dans le cloud et dans la voiture autonome… domaine sur lequel planche aussi Apple. A chercher de nouveaux relais de croissance, les géants américains sont appelés à entrer en concurrence de plus en plus frontale.
Comme l’écrit Scott Galloway, auteur de The Four, le règne des quatre (Ed. Quanto) : « Les quatre sont désormais en concurrence directe, car leurs secteurs respectifs sont à court de proies faciles. Ils se sont battus pour accéder à leur position actuelle et ils la défendront chèrement. »
Bien sûr, ils ont tout pour se défendre : la puissance financière, la maîtrise des technologies de pointe et une parfaite connaissance des consommateurs, grâce à l’étude des données des utilisateurs. Mais la menace la plus dangereuse pourrait provenir de Chine, où, à l’abri des murailles protectionnistes dressées par Pékin, se sont développés de puissants rivaux, comme le moteur de recherche Baidu, la plate-forme d’e-commerce Alibaba, la messagerie Tencent ou le constructeur de téléphone Huawei.
La chose est entendue pour François Lévêque, auteur de Les Habits neufs de la concurrence (Ed. Odile Jacob, 2017) : « Aujourd’hui, on ne voit pas qui pourrait détrôner les “GAFA”, à moins d’une bataille entre les géants américains et chinois. » De cet affrontement pourrait émerger un nouvel acronyme.
La culture est-elle encore une affaire d’Etat ?
En arrière-plan, l'immeuble abritant le ministère français de la culture, à Paris le 26 juin 2014. Photo Pablo Porciuncula. AFP
Si dans les coulisses du pouvoir on se bagarre pour occuper la fonction ministérielle, on ne trouve personne aujourd'hui pour imaginer à quoi peut ressembler une administration culturelle nationale, digne de la patrie des Lumières.
D’où vient cette impossibilité dans notre pays de repenser sereinement les rapports entre l’art et le pouvoir ? Mais s’ils sont nombreux à les commenter aucun artiste et homme politique vivant n’imagine les reformuler sans l’existence de ce totem qu’est le ministère de la Culture. Comme si la France éternelle sommeillait en son sein, rassurée de savoir que l’Etat et la Nation ne font qu’un.
Pourtant cette administration républicaine imaginée en 1881 (l’artiste Antonin Proust fut le tout premier secrétaire d’Etat aux Beaux-arts) souffre en silence de douter de son utilité ; de ne jamais savoir si sa mission est anecdotique, mystique ou politique. Elle étouffe maintenant dans une technostructure digne de Kafka sans que personne en haut lieu ne s’en offusque. Quant à l’art qui tout de même la justifie il y a belle lurette que son épanouissement et son accès empruntent d’autres voies que celles imaginées en son temps par André Malraux, premier ministre d’Etat chargé des affaires culturelles sous la Ve République.
Artistes, intellectuels, et professionnels de la culture, conscients des vertus de l’action artistique dans un monde si consumériste et matérialiste, s’agitent régulièrement pour plaider une grande politique publique de la culture. On dirait juste que plus personne n’y croit. Que par le jeu d’un marché protéiforme et débridé l’art et la création se sont affranchis des valeurs de la République ; que la capacité des œuvres à permettre le «dépassement» n’est plus sollicitée par le sommet de l’Etat. Parfois dans le regard de ceux qui nous gouvernent, l’objet même de culture est devenu extravagant. Alors on fait comme si. Comme confier à l’actuelle ministre de la Culture un portefeuille amputé de la tutelle du livre et auprès de qui des personnalités éclairées comme Erik Orsenna ou Stéphane Bern jouent, sans moyens, les «ministres bis» dans leurs couloirs de compétences respectifs.
On «oublie» même de nommer à la tête des grandes administrations des Archives, du Patrimoine ou de la Création artistique du ministère des directeurs de plein exercice. Comment un chef de l’Etat apparemment préoccupé par les choses de l’esprit peut-il, sans y réfléchir à deux fois, réduire une politique culturelle à un «pass culture» dont chacun sait qu’il est le moyen le plus insidieux de favoriser plus encore la consommation de divertissements chez les plus jeunes ?
Voilà des années que les héritiers de Malraux, enivrés par le symbole et la noblesse de la tâche, se cassent les dents devant ce qui les attend. Depuis le début de la Ve République ils sont très exactement vingt ministres à avoir été possédés par le dessein de mener à bien une politique culturelle. Ou tout au moins de permettre à la France et aux Français de s’enorgueillir de ses créateurs et, pour ceux qui en ont les moyens, d’accéder à leurs bienfaits. Mais au nom de quel principe un ministère de la Culture aurait-il à célébrer un talent qui pour l’essentiel a été déniché voire financé par d’autres et qui parfois ne doit rien à personne ? Il en faut du sentiment patriotique, assumé ou non, pour accepter que l’Etat récupère à son compte les milliers d’actions artistiques qui fleurissent sur le territoire national.
Pour relativiser l’importance du ministère de la Culture, rappelons que De Gaulle installa son «ami génial» à sa tête pour, avant tout, le savoir à ses côtés. Sa présence le rassurait et permettait au demeurant à la République gaulliste de faire bon ménage avec le monde des artistes pour l’essentiel inféodés au parti communiste d’alors. Mai 68 mettra fin à cette chimère. Depuis, le ministère de la Culture n’aura tressailli qu’une seule fois : en 1981, quand la gauche mitterrandienne, persuadée qu’elle allait «changer la vie», constate qu’un ministre issu du sérail théâtral prend au mot ce slogan électoral et se met à œuvrer. Jack Lang aura été le dernier à incarner ce que Malraux appelait en son temps «le royaume farfelu de la rue de Valois». Malgré le talent de quelques-uns de ses successeurs, le ministère de la Culture s’est épuisé à administrer ce qui pouvait l’être, gérer des programmes en lieu et place des hommes et des idées, pire encore laisser croire qu’il disposait d’un pouvoir supranational pour faire battre en retraite les pourvoyeurs de loisirs télévisuels mondialisés. Malgré une impuissance politique constatée, on se bagarre encore dans les coulisses du pouvoir pour occuper la fonction, mais on ne trouve personne pour se préoccuper de sa raison d’être et, mieux encore, d’imaginer à quoi peut ressembler aujourd’hui une administration culturelle nationale digne de la patrie des Lumières. Et s’il était désormais impossible de mener une politique culturelle d’Etat ?
Tout semble aujourd’hui le laisser penser et ce, pour au moins cinq raisons : parce qu’en cinquante ans l’Etat a paradoxalement beaucoup fait et qu’il est difficile d’en faire plus ; que les institutions culturelles créées par sa volonté sont si réglementées qu’il s’avère impossible de les faire évoluer ; que dans son ensemble l’activité artistique et culturelle nationale relève d’une économie où les collectivités territoriales, des PME ou associations dédiées et des entreprises mécènes en sont les acteurs primordiaux ; que l’industrie culturelle et audiovisuelle planétaire est si dominante, si intrusive que plus aucune contrainte nationale ne l’empêchera désormais de faire ce qu’au siècle dernier la philosophe Hannah Arendt prédisait à savoir «transformer l’art en divertissement» ; qu’enfin et c’est peut-être l’essentiel, aucun président de la République depuis François Mitterrand ne pense plus sérieusement qu’une augmentation du budget du ministère de la Culture réglera le problème d’une absence de politique culturelle.
Puisque l’Etat a un bilan ; que dans leur grande majorité les créateurs sont désormais dans une économie artistique si diversifiée qu’elle échappe à une tutelle nationale ; que les institutions culturelles n’ont d’autres préoccupations que de retrouver des marges de liberté pour se renouveler, qu’enfin ce monde-là souffre plus que d’autres de ne jamais en finir avec les querelles d’ego, les guerres picrocholines et les effets d’annonces, pourquoi ne pas en profiter pour suggérer à l’Etat d’appliquer au pied de la lettre cette formule habile de Régis Debray : «Ce qui nous rassemble est ce qui nous dépasse» ? On verra alors qu’il y a matière à se surpasser.
Jean-Michel Djian est l’auteur de la Politique culturelle, la fin d’un mythe, Folio/Gallimard, 2005.
Jean-Michel Djian journaliste et essayiste
Karl Lagerfeld et la sensation Warhol
Par Raphaëlle Bacqué - Le Monde
Les visages de Karl Lagerfeld (2/6). Octobre 1970. Le styliste, désormais établi à Paris, rencontre le maître du pop art, venu faire des repérages pour son prochain film. Le personnage encore en devenir est aux premières loges pour observer le savoir-faire de ce monstre médiatique.
Une perruque argentée dont on voit à dix pas les cheveux synthétiques, les sourcils décolorés à l’eau oxygénée et un petit magnétophone dans la poche du blazer… Andy Warhol fait sensation lorsqu’il arrive à Paris, en octobre 1970.
Partout, on s’arrache le maître du pop art. Marie-Hélène de Rothschild convie à sa table cet invité dont l’allure kitsch détonne parmi les smokings. Les critiques d’art courent les antiquaires où il achète des meubles Art déco. On le réclame dans les salons en vue, on le veut à toutes les soirées. Il y a dans son sillage un parfum d’excitation, depuis qu’ancien dessinateur publicitaire, il est devenu la star de l’underground.
Depuis quelques années, ses Campbell’s Soup Cans et ses séries sur des vedettes américaines, comme Marilyn Monroe, l’ont placé à l’avant-garde des mouvements artistiques. Il n’est pas encore tout à fait consacré par l’art contemporain, mais ses aphorismes aimantent les journalistes. Très préparés en coulisses, ils lui ont taillé la réputation d’un esprit profond et incisif. Les milieux de la mode et de l’art parisien le trouvent chic en diable et subversif.
L’homme est pourtant déroutant. Il parle peu, ponctuant seulement la conversation des autres de « Gee ! » (ça alors !) lâchés d’une petite voix aiguë. Entouré d’une cour de jolis garçons, Warhol observe tout de son air myope et marche avec raideur. Deux ans auparavant, une militante féministe a vidé sur lui le chargeur d’un pistolet, dans le hall de la Factory, cet atelier installé au cœur de Manhattan où il produit ses sérigraphies. Depuis, il est obligé de porter un corset. « J’ai plus de coutures qu’une robe Dior », dit-il, pince-sans-rire, en débarquant à Orly.
L’esthétique parisienne
Si l’artiste est à Paris, c’est qu’il veut y tourner L’Amour, un film dont il a coécrit le scénario avec Paul Morrissey. Ses premiers films étaient souvent expérimentaux, dupliquant à la manière de ses toiles un même motif, comme dans Sleep, où l’on voit le poète américain John Giorno dormir pendant 5 heures et 21 minutes.
Cette fois, il a promis une histoire : deux filles de l’Amérique profonde débarquent à Paris à la recherche d’un riche mari. « Gold diggers 71 » (« croqueuses de diamants 71 »), c’est le nom de code du script. Tout ce que la mode compte de beautés audacieuses espère y jouer un petit rôle. Le tournage doit avoir lieu au Sept, la boîte de nuit la plus chic du moment, située rue Sainte-Anne. Fabrice Emaer, le propriétaire des lieux, qui accueille chaque soir ses invités d’un « Bonjour, bébé d’amour », en est enchanté. Deux ans plus tôt, comme Warhol, lui aussi a été blessé de douze balles dans la peau lorsqu’un voyou a surgi chez lui, un revolver à la main, pour rafler la recette du samedi soir. Autant dire qu’il plane sur L’Amour une électrisante atmosphère de danger.
« SAINT LAURENT, BERGÉ ET MOI ÉTIONS ALLÉS VOIR UNE CARTOMANCIENNE TURQUE DANS UN ENTRESOL DE LA RUE DE MAUBEUGE. ELLE AVAIT DIT À YVES : “C’EST BIEN, MAIS CELA SE TERMINE ASSEZ VITE.” ET À MOI : “ÇA COMMENCE QUAND ÇA SE TERMINE POUR LES AUTRES.” »
KARL LAGERFELD
Andy Warhol et Karl Lagerfeld, c’est la rencontre d’un monstre médiatique avec un personnage en devenir. Depuis son arrivée à Paris, en 1952, à l’âge de 19 ans, Lagerfeld n’est plus le jeune Allemand qui s’appliquait à s’exprimer dans un français parfait dans un pays qui parlait encore des « Boches ». Les codes, les snobismes de la capitale, il les a dévorés avec la même gourmandise qui allume son regard lorsqu’il commande des saucisses de Francfort au café de Flore. « Pour être plus français que français, il faut être étranger, a-t-il compris. Ce n’est pas une affaire patriotique : c’est purement esthétique. »
C’est un dessinateur hors pair et un styliste de talent. Les jupes et les blouses vaporeuses qu’il crée depuis 1963 pour la griffe Chloé rencontrent un grand succès. Les petits blousons de cuir et zibeline, les jodpurs en poulain qu’il imagine à Rome pour les sœurs Fendi, une marque italienne de prêt-à-porter de luxe, marchent tout aussi bien. C’est une constante chez lui : il sait dessiner vite et avec brio des vêtements « vendeurs ». Mais il n’a pas encore la reconnaissance à laquelle il aspire.
Des Etats-Unis, Warhol n’a encore jamais entendu parler de lui. Yves Saint Laurent, oui, il connaît. Depuis déjà quelques années, la presse new-yorkaise l’a sacré « King of fashion ». L’élégance de ses robes, l’audace de ses smokings portés par Catherine Deneuve, l’actrice française la plus connue à l’étranger, la séduction de ses sahariennes ont valu à Saint Laurent un succès mondial. A 37 ans, Lagerfeld, lui, n’a encore rien révolutionné, et personne ne peut encore imaginer l’icône mondialisée qu’il deviendra plus tard.
« Tu seras un fournisseur »
Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld ont pourtant débuté ensemble, en gagnant, seize ans plus tôt, le même concours organisé par le Secrétariat international de la laine et l’entreprise Woolmark. Sur la photo, prise le 25 novembre 1954, on reconnaît les yeux marron légèrement inquiets du jeune Karl, avec ses cheveux bruns coiffés comme les James Dean de l’époque.
A ses côtés, un mannequin porte le manteau en cheviotte couleur jonquille pour lequel il a remporté, à 21 ans, un 1er prix. « Il a fallu que je refasse le dessin devant huissier, afin que le jury soit certain qu’il était de moi. » Boutonné sur le devant, long jusqu’au dessous du genou, le manteau serait presque classique, sans ce jaune éclatant. L’audace vient du large décolleté dans le dos, qui lui donne une touche moderne et sexy.
Le second jeune homme, celui qui semble se cacher, bien qu’au centre du petit groupe, est Yves Saint Laurent. Comme il paraît efflanqué dans son costume sombre, avec ces grosses lunettes qui mangent son visage mince ! « Un air de petit curé », a-t-on dit l’année suivante dans les ateliers Dior en le voyant arriver.
Depuis, Saint Laurent a pris son envol. Avec Pierre Bergé, cet amant pygmalion, il a fondé sa propre maison et présente ses collections de haute couture sous son nom. Warhol a vu, en 1965, ses robes s’inspirant du peintre Piet Mondrian et l’année suivante, son défilé, carrément baptisé « Pop Art », en hommage au pionnier du genre, Andy lui-même.
« Je n’étais pas jaloux, affirme Lagerfeld aujourd’hui. Yves, Bergé et moi étions allés voir une cartomancienne turque dans un entresol de la rue de Maubeuge. Elle avait dit à Yves : “C’est bien, mais cela se termine assez vite.” Et à moi : “Ça commence quand ça se termine pour les autres.” » Comment se construit une légende… Dans ce Paris frivole, il est plus cultivé, plus discipliné, plus travailleur que la plupart des gens de la mode. Mais il n’a pas le génie névrotique de Saint Laurent. « Tu seras donc un fournisseur », lui avait dit, à ses débuts, sa mère, Elisabeth, avec sa rude franchise. Il n’est pas fait pour l’ombre, cependant.
Bouffée d’air frais
Depuis un an, il a changé de cercle. A Paris, le prince Yves règne sur les nouveaux canons de l’élégance et sur une petite cour admirative. Ce sont des jeunes gens beaux et un peu décadents qui viennent place Vauban, où il a emménagé avec Bergé, s’enivrer et fumer du kif marocain. La silhouette blonde et longiligne de Betty Catroux danse dans la pénombre, Loulou de la Falaise rit dans la cuisine, c’est chic et follement snob.
Karl Lagerfeld peut bien s’être acheté une Rolls, il est plus accessible, moins élitiste au fond. Depuis la mort de son père, en 1967, il loge chez sa mère, Elisabeth, cette statue du commandeur qui le pousse toujours à aller de l’avant. Sans doute pour se donner plus de force sur le chemin qu’il sait devoir accomplir, il s’est aussi constitué une tribu.
Le « groupe de Karl », comme on dit désormais, est plus international et on y parle anglais, cette langue que Saint Laurent doit se faire traduire par son amie Loulou de la Falaise.
Moustaches noires sexy, anneau d’or à l’oreille, santiags mexicaines, Antonio Lopez et Juan Ramos en sont les piliers depuis leur arrivée à Paris, en 1969. Le premier est un illustrateur de grand talent, le second son directeur artistique et son ancien amant. Le magazine Elle les a chargés de réaliser une série d’illustrations pour Chloé, dont Karl Lagerfeld est devenu, trois ans plus tôt, le directeur artistique, et c’est peu dire que ces deux Portoricains venus des Etats-Unis l’ont vampé. Ensemble, ils travaillent sur les tendances et sur les collections, inventent des esthétiques nouvelles. Antonio est un dessinateur génial et créatif. Juan, grand connaisseur de l’histoire de la peinture, nourrit son ami de références. « Antonio voulait que tout le monde soit beau, note Lagerfeld. Parfois trop beau. Dans ses dessins, il refusait de reproduire les imperfections de ses modèles. »
Les deux New-Yorkais croyaient arriver dans la Ville Lumière, et ils ont trouvé Paris terne, sale et morne. Depuis, Lagerfeld voit sa cité d’adoption par leurs yeux et aspire à autre chose : « C’était un air frais dans un milieu confiné, trop régional… » « Régional », la grande peur de cet homme qui, en changeant de pays, a ouvert ses frontières.
Le soir, quand ils dînent ensemble à Saint-Germain-des-Prés, il souffle sur la table un vent de séduction et de modernité. « Juan était le plus exubérant, Antonio le plus créatif, remarque Florentine Pabst, une journaliste de Hambourg qui fait leur connaissance dans ces années 1970, mais c’est Karl qui restait au centre, parce qu’il était le plus intelligent. »
« Flamboyant, bien habillé et musclé »
Lagerfeld est aussi celui qui entretient le petit groupe. Depuis quelques mois, il loue pour Antonio et Juan un studio rue Bonaparte, et bientôt un appartement boulevard Saint-Germain. C’est sa manière à lui de s’attacher des amis : il règle les notes de restaurants, distribue chemises, robes et cadeaux somptueux.
Bientôt, dans leur sillage, vont débarquer de Manhattan de nouveaux visages, Corey Tippin, un beau garçon blond qui tente de poser pour des photos, Pat Cleveland, la première métisse à défiler sur les podiums, et une jolie fille aux dents du bonheur, Donna Jordan, qui attire les regards en chaloupant sur des talons trop hauts. Ces trois-là étaient de la jeunesse branchée qui, au 33rd Union Square, fréquentait la Factory d’Andy Warhol.
« Dès qu’il l’a vu, Andy a voulu avoir Karl dans son film », se souvient Corey Tippin. A New York où l’on retrouve cet ancien mannequin devenu maquilleur, à deux pas de l’ancienne Factory et de l’atelier d’Antonio Lopez, Tippin assure : « Je crois que tout lui plaisait. Le côté sexy de Karl, sa culture, mais aussi son kitsch et sa drôlerie. »
C’est lui, chargé de tenir un petit rôle dans L’Amour, qui a organisé la rencontre. Warhol était en repérage pour son futur tournage. Karl Lagerfeld a proposé son appartement, au 35, rue de l’Université, pour filmer quelques scènes. Une table de Dunand en laque, des meubles Fontana et des Lalanne, lui aussi collectionne l’Art déco. L’endroit est somptueux, au premier étage d’un hôtel particulier, et Lagerfeld lui donne un attrait supplémentaire en déclarant partout qu’il y a un fantôme : « L’immeuble est maudit. » Mais c’est Karl en personne qui plaît à « Andy ». Il le trouve « flamboyant, bien habillé et musclé », rapporte Corey Tippin.
Karl Lagerfeld a changé depuis la photo de 1954. Il s’est mis à la musculation, dans une salle de la rue Sainte-Anne où s’entraînent des gigolos. Il est beau, avec ses cheveux bruns qu’il porte dans le cou, à la mode de ces « seventies » débutantes. A la piscine Deligny, son corps sculpté par le culturisme et moulé dans un maillot d’haltérophile fait sensation quand il déambule en mules à petits talons sur les planches.
On le croit fils excentrique d’une famille d’aristocrates allemands – ou suédois, selon le flou qu’il entretient sur les origines de son père –, parce qu’il raconte toujours des histoires de châteaux et paye généreusement les dîners chez Lipp. Le « Milk Rich », c’est ainsi que l’appellent ceux qui le pensent héritier direct des laits concentrés Nestlé.
Un baiser de cinéma
Reprenant son scénario, Andy Warhol a aussitôt écrit pour Lagerfeld un rôle sur mesure : celui d’un aristocrate allemand que les deux coureuses de mari cherchent à séduire. Les intrigantes sont interprétées par Donna Jordan, la fille aux dents du bonheur qui fait toujours les quatre cents coups avec Corey Tippin, et Jane Forth, une jeune beauté diaphane aux sourcils totalement épilés.
« DÈS QUE WARHOL FRANCHISSAIT LA PORTE D’UNE BOÎTE, MÊME BONDÉE, ON LUI FAISAIT UNE PLACE AINSI QU’À SA COUR. SA SEULE PRÉSENCE ÉTAIT LE GAGE D’UNE SOIRÉE RÉUSSIE »
PHILIPPE MORILLON, PHOTOGRAPHE
Il y a entre Warhol et Lagerfeld des proximités inattendues. La petite bande d’acteurs amateurs est chahuteuse. Sexe, drogue et rock’n’roll, Jane, Corey, Donna et les autres flirtent et se défoncent tous les soirs, dorment jusqu’en début d’après-midi, travaillent quand ça leur chante ou quand ils n’ont plus un sou.
Andy et Karl se tiennent à bonne distance des pilules d’amphétamines servies dans des coupes comme des bonbons. « Je n’aime pas l’alcool, je n’aime pas la drogue, je n’ai jamais été un obsédé sexuel », affirme Lagerfeld, qui ne boit que du Coca-Cola.
Warhol adore s’entourer de beaux garçons, mais il est complexé par son physique et les cicatrices laissées par les multiples opérations liées à son agression. Provocateur, il peut poser des questions crues à une femme sur le sexe de son mari et, lorsqu’un jeune homme lui plaît, jouer les adolescents timides et amoureux. Mais c’est un voyeur qui préfère filmer les gens sous leur nez et, mieux encore, les enregistrer avec ce petit magnétophone qui ne le quitte pas. Lagerfeld n’est pas plus entreprenant. Quand, dans les gouffres sombres des lieux gays, ses amis succombent au premier frôlement, il les fait rire en assurant : « Non merci, j’ai ce qu’il faut et je ne m’en sers pas. »
Il ne s’est pas dérobé, cependant, lorsqu’avec malice, ce voyeur d’Andy a prévu une scène de baiser avec Patti d’Arbanville, l’actrice et mannequin qui vient d’inspirer à son petit ami Cat Stevens une chanson portant son nom. Derrière la caméra, il a demandé à ce que l’on refasse la scène plusieurs fois. « Il avait un côté pousse-au-crime que je n’ai pas », s’amuse Lagerfeld. Ce baiser vorace sera, lorsque le film aura été oublié, le seul souvenir de ce moment. Car L’Amour est loin d’être un chef-d’œuvre. A sa sortie, il est étrillé, sauf par le critique cinéma du Monde, qui le compare (trop) aimablement à un film d’Eric Rohmer… A l’écran, l’image tressaute et les acteurs jouent comme des pieds, mais Karl Lagerfeld s’en sort plutôt bien. En chemise de soie, jean blanc et gros ceinturon, il glisse dans cette improbable histoire avec naturel, quand les mannequins recrutés par Warhol ânonnent leur texte. La presse le mentionne à peine cependant : il est inconnu du grand public.
Les portraits et les leçons
« Un soir, Saint Laurent et Bergé ont donné chez eux une fête en l’honneur d’Andy », raconte encore Corey Tippin. Ce soir-là, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent croisent le petit groupe de Lagerfeld à la Coupole, boulevard du Montparnasse. Karl n’est pas là, mais Corey et Donna Jordan, beaux et provocants en diable, sont aussitôt invités.
Yves n’a encore jamais rencontré le peintre américain. Pour l’occasion, il a rassemblé place Vauban toute sa petite bande. « Il régnait une atmosphère d’excitation déjantée, tout le monde courait après le chien d’Yves ; Donna Jordan cherchait à se faire remarquer en jouant les enfants mal élevés ; Helmut Berger fumait avec Omar Sharif. Dans un salon, une télévision diffusait des pornos. » Les invités boivent trop, la drogue circule, Patti d’Arbanville se bat avec Donna, bref, la soirée est un triomphe. Toute l’équipe de L’Amour parade autour d’Yves. Le seul absent est Karl Lagerfeld.
Warhol sait susciter le désir. A chacune de ses visites parisiennes, il loge chez la comtesse Brandolini, belle-sœur de Gianni Agnelli, et laisse son manageur, Fred Hughes, vendre aux riches familles leur portrait. Le soir, il sort. « Dès qu’il franchissait la porte d’une boîte, même bondée, on lui faisait une place ainsi qu’à sa cour. Sa seule présence était le gage d’une soirée réussie », note le photographe Philippe Morillon, qui travaillera bientôt dans son sillage. « Il est ennuyeux et n’a aucune conversation », reconnaît Pierre Bergé, qui l’a invité plusieurs fois à sa table. Moyennant quoi, il lui a commandé pour 25 000 francs le portrait d’Yves Saint Laurent sérigraphié.
Karl Lagerfeld, lui, n’a jamais été peint par celui qu’on qualifiera plus tard de « brillant miroir de notre époque ». Mais c’est sans doute lui qui en a le mieux retenu les leçons. Il était aux premières loges pour observer le savoir-faire warholien. Sa façon de détourner les images et de subvertir les conventions. Son sens de ce que l’on n’appelle pas encore la communication, aussi.
Désormais, il distribue les aphorismes qui plus tard feront son succès. Elabore des légendes. Construit son personnage. Il commence à s’inventer des accessoires qui le rendent immédiatement reconnaissable, comme Warhol avec sa perruque peroxydée. Un grand éventail en soie peinte, acheté lors d’un voyage au Japon, vient inaugurer une panoplie. Bientôt, il se laissera pousser les cheveux pour les nouer en catogan. Avec son style d’aristocrate européen, tous ces « trucs » lui composent une allure chic ou vaguement ridicule, c’est selon. Ce « look » le distingue, c’est l’essentiel. « Ne fais pas attention à ce que l’on écrit sur toi, disait Warhol. Contente-toi de le mesurer. »
Monde Festival : Déshabillez-les ! La mode racontée par ceux qui la font. « Le Monde » organise dans le cadre du Monde Festival un débat sur les coulisses de la mode, samedi 6 octobre, de 17 h 30 à 19 heures, au Théâtre des Bouffes du Nord. Avec Simon Jacquemus, Marine Serre, Clara Cornet et Frédéric Godart. Une table ronde animée par Elvire Von Bardeleben, journaliste au « Monde ». Réservez vos places en ligne sur le site









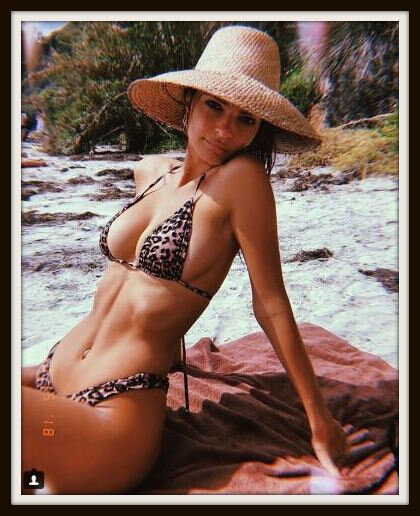








/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)