Les photographes, précaires de guerre
Par Claire Guillot
Pendant longtemps, les reporters ont été considérés comme des trompe-la-mort. Mais, ces dernières années, les initiatives se sont multipliées pour limiter les risques.
Avant d’être envoyé en Ukraine, en 2014, Yannis Behrakis avait un mauvais pressentiment. Sans le dire à sa femme, ce photographe grec de l’agence Reuters est passé voir un notaire et il a fait son testament. La répartition de ses biens, le devenir de ses photos… Tout était prévu, y compris ses funérailles : une crémation, pas d’église, et « la musique des Beatles ». De retour chez lui, il a donné une copie à son épouse. « Je lui ai dit : “Bébé, j’ai un cadeau pour toi !” Elle a été un peu choquée, puis elle a compris. Elle sait que ça peut arriver. Et moi aussi. » Yannis Behrakis a finalement survécu à la crise ukrainienne et à bien d’autres conflits. Mais cela ne l’empêche pas, à 57 ans, de s’interroger avant chaque reportage en zone dangereuse : « Suis-je prêt à mourir ? »
Chaque année, l’association Reporters sans frontières (RSF) dresse la liste des journalistes tués dans l’exercice de leur métier (22, à ce jour, en 2017). Les photoreporters, contraints d’être au plus près de l’action pour récolter des images, y figurent en bonne place. Ainsi, ces dernières années, les « printemps arabes », la guerre en Syrie et en Irak ont coûté la vie, entre autres, aux Français Rémi Ochlik ou Lucas Dolega.
« QUAND J’EN VOIS QUI VONT À MOSSOUL SANS GARANTIE, SANS COMMANDE D’UN JOURNAL, SANS ASSURANCE, JE LEUR DIS : “MAIS VOUS ÊTES FOUS !” »
JEAN-FRANÇOIS LEROY, DIRECTEUR DE VISA POUR L’IMAGE
Si les photographes sont les plus exposés, ils sont aussi les moins protégés. En Europe, selon un sondage de la fondation World Press Photo, près des deux tiers d’entre eux travaillent en « free-lance » : ils sont pigistes, engagés au coup par coup par des médias, pour des commandes ponctuelles. Mais la crise de la presse a rendu ces missions rares, moins longues, moins bien rémunérées. Beaucoup travaillent donc « en spéculation » : ils se rendent seuls sur le terrain, avec l’espoir de vendre ensuite leurs photos. Ce phénomène préoccupe la profession, au point qu’un panel a été organisé au dernier festival de photojournalisme Visa pour l’image, à Perpignan.
Jean-François Leroy, directeur de la manifestation, a confié son inquiétude à l’AFP : « Quand je vois des gamins et des gamines qui vont à Mossoul sans garantie, sans commande d’un journal, sans assurance, je leur dis : “Mais vous êtes fous !” » Il cite l’exemple du Sud-Africain Joao Silva, amputé des deux jambes après avoir sauté sur une mine en Afghanistan en 2010 : « S’il n’avait pas eu derrière lui tout le service juridique et d’assistance du New York Times, il n’aurait jamais survécu à cela. »
Hausse des incidents
Le photographe Pierre Terdjman, 38 ans, regrette lui aussi de voir de jeunes confrères risquer leur vie pour pas grand-chose. « Il y a l’idée que, pour se faire un nom, il faut aller au front. Moi aussi, j’ai fait comme eux, mais au moins à l’époque ça me permettait de bouffer ! Aujourd’hui, pour gagner sa vie, il vaut mieux faire un sujet original en bas de chez soi que de la photo de guerre. » Car les tarifs ont plongé. En Irak, entre l’emploi du fixeur (assistant local) et la location de voiture, une journée de travail coûte au bas mot 250 euros, quand une photo vendue à l’unité à un journal atteint la moitié de ce prix. Sans compter le coût psychologique d’un tel reportage. « Ce n’est pas anodin de voir des gens mourir, assure Pierre Terdjman. Même avec une assurance, il y a de la casse. »
Cette question de l’assurance est désormais cruciale. Avec de fortes disparités d’un cas à l’autre. Si les photographes en mission pour des journaux sont couverts comme des salariés, rapatriés et soignés grâce à l’assurance de l’employeur, les photographes seuls sur le terrain ne doivent leur salut qu’à eux-mêmes. Les polices d’assurance pour les pays en guerre sont si coûteuses que certains préfèrent s’en passer. En France, les photographes font souvent appel à la compagnie Audiens, qui, pour 300 euros par an, propose un capital en cas d’invalidité ou de décès. Devant les besoins, l’association RSF, qui prête des gilets pare-balles et des casques, a aussi créé une assurance destinée aux pigistes.
La hausse des accidents est telle que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a monté une équipe d’urgence chargée d’informer sur les risques et de soutenir les reporters en difficulté. L’association britannique Rory Peck Trust se consacre, elle, aux free-lances, offrant des bourses pour les assister, ainsi que leurs familles, en cas d’accident. Elle intervient énormément en faveur des journalistes locaux, la catégorie la plus fragile : « Depuis la mort horrible de James Foley [journaliste américain exécuté en Syrie par l’organisation Etat islamique en 2012], les médias ont de plus en plus recours à eux, précise Mary O’Shea, directrice des programmes de l’association. Or ils n’ont pas le luxe d’avoir une assurance. Nous les aidons à se soigner, à être exfiltrés du pays. »
Stopper l’hémorragie
Pendant longtemps, les reporters de guerre ont été considérés comme des trompe-la-mort à l’expérience incommunicable. Mais, ces dernières années, les médias se sont mis à chercher des moyens pour limiter les risques. « On est passé de la génération de l’hommage à celle de la formation », résume Matthieu Mabin, reporter à France 24, qui a fondé « Le Manoir », un centre de formation au reportage en zone dangereuse, à Sourzac (Dordogne), après la mort de deux confrères de RFI au Mali, en 2013.
« MON BUT, C’EST D’AIDER LES JOURNALISTES À OPTIMISER LEURS PERFORMANCES EN SITUATION DE FORTE CONTRAINTE. LEUR PERMETTRE DE SE PROTÉGER, D’ÊTRE LUCIDES ET DE RÉUSSIR À TRAVAILLER »
EMILIE PELOSSE, PSYCHOLOGUE
La majorité des formations aux « milieux hostiles » dispensées à travers le monde sont assurées par des militaires. A Collioure (Pyrénées-Orientales), le Centre national d’entraînement commando (CNEC), géré par le ministère de la défense, plonge les journalistes dans des conditions extrêmes : simulation de bombardements, d’enlèvement… Un stage jugé réaliste et utile par le photographe Edouard Elias, 26 ans, qui fut otage en Syrie. « Tout est fondé sur la façon dont on gère sa fatigue et ses limites. Je trouve ça important, car, sur le terrain, on court des risques, mais on en fait aussi courir aux autres : en étant dans le champ, en ralentissant les opérations… ou en ayant une crise de panique. » Son confrère Victor Blue, qui a couvert Mossoul pour le New Yorker, doute davantage de ce type d’entraînement. « Ces formations à 3 000 dollars sont surtout un moyen pour les médias de se couvrir en disant qu’ils ont formé les gens. »
Lui a préféré suivre, à New York, la formation RISC (Reporters Instructed in Saving Colleagues), imaginée par le journaliste Sebastian Junger après la mort du photographe Tim Hetherington, en 2011 : après des tirs, en Libye, personne ne savait comment stopper une hémorragie. Cette formation gratuite, réservée aux pigistes, est centrée sur l’assistance médicale. Victor Blue a pu tester son efficacité à Mossoul. Un jour, les soldats irakiens qu’il accompagne trouvent un enfant de 8 ans blessé par des tirs de mortiers. Il perd son sang, aucun médecin n’est disponible. « J’ai pu évaluer son état et stopper l’hémorragie, se souvient le photographe. A ma grande surprise, aucun soldat ne savait quoi faire. Je pense qu’on lui a sauvé la vie. »
Risques physiques et sécurité numérique
Beaucoup, comme lui, doutent de la capacité des militaires à former des journalistes. Pour Matthieu Mabin, lui-même ancien officier de la Légion étrangère, « la façon dont on évolue sur le terrain dépend de ce qu’on y fait. Ce n’est pas le même métier ». A Sourzac, il fait appel à des militaires, « pour les connaissances techniques, précise-t-il, mais on n’enseigne pas la sécurité, on enseigne le reportage ». Ces sessions de six jours (3 200 euros) sont financées par les médias employeurs, mais des pigistes peuvent en bénéficier grâce au soutien d’organes de presse ou d’associations de journalistes.
Les formations ne se limitent plus aux risques physiques. Elles intègrent aussi la sécurité numérique, essentielle pour empêcher l’espionnage informatique et protéger sa vie et celle de ses sources. « Et de plus en plus de gens réclament aussi un soutien psychologique », note Mary O’Shea. Le syndrome post-traumatique (PTSD), connu chez les soldats, a longtemps été un sujet tabou dans les rangs des photographes de guerre, alors que les études menées par le psychiatre canadien Anthony Feinstein prouvent que ces derniers sont particulièrement touchés. Après les témoignages de grands noms du métier, de Patrick Baz (Agence France-Press) à Finbarr O’Reilly (Reuters), la parole s’est libérée. Un peu trop, peut-être… « Tout le monde parle du PTSD, mais il reste rare, assure la psychologue Emilie Pelosse, intervenante régulière à Sourzac. En revanche, le stress aigu est courant. Mon but, c’est d’aider les journalistes à optimiser leurs performances en situation de forte contrainte. Leur permettre de se protéger, d’être lucides et de réussir à travailler. »
Une attention particulière est aussi portée aux femmes, confrontées à des dangers spécifiques. La photographe Laurence Geai, qui a couvert elle aussi la bataille de Mossoul, confirme qu’elle doit toujours « s’imposer, dès le début, pour être prise au sérieux ». Cette trentenaire menue prend donc des précautions, en évitant notamment de rester seule avec des soldats. Mais elle relativise : « La seule vraie agression sexuelle que j’ai connue, c’est dans le 7e arrondissement de Paris. » A Sourzac, un médecin a mis au point, pour les femmes, une trousse d’urgence avec une pilule du lendemain, un kit de prélèvement et un antibiotique à spectre large contre les maladies sexuellement transmissibles.
Plus d’assurances, moins de reporters
Les journaux français n’exigent pas de formation particulière pour les photographes, contrairement aux titres anglo-saxons. « C’est simple, pour travailler pour nous, la formation est une condition incontournable », témoigne David Furst, chef du service photo du New York Times. Le Français Olivier Boulot, formé en sécurité médicale et numérique aux Etats-Unis et ex-animateur d’une académie dédiée aux journalistes, s’inquiète du retard pris en France. « Les journalistes ne voient pas l’intérêt d’une formation, ou bien ils se forment chez les militaires ou à la Croix-Rouge. Ces sessions sont inadaptées au terrain, et même carrément dangereuses, car elles donnent un faux sentiment de sécurité. Quant à la sécurité numérique, elle est lamentable. On dirait que ça n’intéresse pas les médias français de mettre en place un canal sécurisé pour recueillir les témoignages des gens sans qu’ils se fassent griller. »
Certains photographes, surtout chez les plus expérimentés, voient d’un mauvais œil ces nouveaux impératifs de sécurité et les exigences de formation. « Le refus du risque est croissant, estime Laurent Van der Stockt, présent pour Le Monde à la bataille de Mossoul. Et plus on mettra de contrôle autour de ce métier, plus il sera difficile de le faire. La réduction du nombre de reporters de terrain est liée, entre autres raisons, à des questions d’assurance. » Selon Matthieu Mabin, la prévention des risques est pourtant cruciale. « Certains grands médias anglo-saxons envoient désormais sur le terrain des agents chargés de la sécurité choisis par leur assureur. Leur seul intérêt est que le journaliste revienne en un seul morceau ! Mais, si personne n’entre dans Mossoul, on ne saura pas ce qui s’y passe. » Entre protection des journalistes et protection du métier, l’équilibre demeure difficile à trouver.



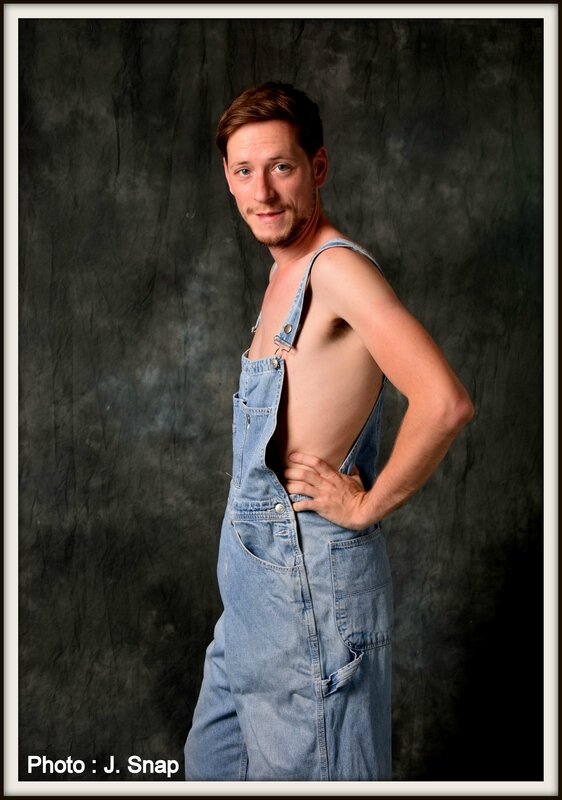





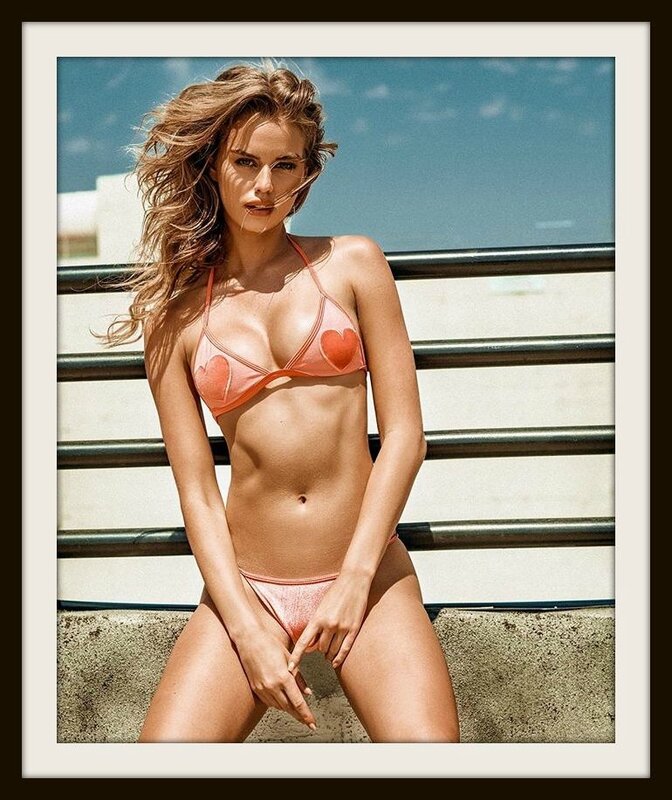




/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)