Par Pascale Krémer
Je ne serais pas arrivé là si… « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, le chanteur populaire raconte sa rencontre décisive avec Laurent Voulzy, le succès, mais aussi ses blessures et ses doutes.
J’ai 10 ans, Bidon, Jamais content, Ultra moderne solitude, C’est déjà ça, Foule sentimentale, Allô maman bobo… Ses chansons poétiques et mélancoliques, sur les musiques de son compagnon de création Laurent Voulzy, lui ont valu, en quarante-cinq années de carrière, neuf Victoires de la musique. A 75 ans, Alain Souchon sort, le 18 octobre, un nouvel album studio, Ame fifties avant une série de concerts.
Je ne serais pas arrivé là si…
Si je n’avais pas rencontré Laurent Voulzy, c’est évident. Je suis très amoureux de la musique, mais j’en suis un mauvais créateur. Laurent, lui, compose des airs simples avec des harmonies sophistiquées. C’est ça, le charme des grandes chansons, comme celles des Beatles. Il a charpenté mon travail, lui a apporté une finesse. Parce que l’important dans la chanson, c’est la musique. Le signal. Le « Pin-Pon ! » Après, seulement, on écoute les paroles.
Parfois, avec Laurent, on se regarde. Il me dit : « Quand même, si tu n’avais pas écrit les paroles d’un tas de mes chansons, je n’en serais pas où je suis. » Je lui réponds : « Ni moi sans ta musique. » Grâce à lui, les gens me sourient dans le métro. J’éprouve une gratitude. On est un couple. Un duo de faiseurs de chansons. On ne couche pas ensemble, mais on a besoin l’un de l’autre. On se rassure, on s’entraide, c’est un compagnon de vie. Oh, il arrive qu’on reste six mois sans se voir. Mais on sait qu’on est là…
Comment a commencé cette collaboration unique qui dure depuis quarante-cinq ans ?
Par une invitation du PDG de la maison de disques RCA, pour un goûter dans son jardin, en 1973. Chacun venait avec sa guitare interpréter une chanson. Il y avait Antoine, Yves Simon, Laurent Voulzy qui faisait l’admiration de tous grâce à la finesse de ses accords de passage. Des pointures, tous ces mecs ! Et moi j’avais ma petite chanson : « Moi, l’amour 1830/Pathétique, romantique/Je trouvais ça démodé… » J’avais conscience d’être faible musicalement. C’était déjà ça… Et là je me suis retrouvé dans l’ascenseur avec Laurent, qui m’a assuré : « Ta chanson, elle est vachement bien. » J’ai cru qu’il se foutait de moi.
J’ai gagné le prix de la presse au concours de la Rose d’or d’Antibes. Donc la maison de disques m’a commandé un album. Il me fallait un arrangeur qui ne coûte pas des milliards. Alors le directeur artistique de RCA, Bob Socquet, a pensé à « un chanteur très doué musicalement mais qui comme toi ne marche pas ». Laurent Voulzy. Je suis allé chez lui, à Nogent-sur-Marne. Je lui ai joué mes chansons musicalement nulles, il a eu l’élégance d’accepter d’en faire les arrangements. On est allés chercher ensemble, en métro, un manuel d’harmonisation des cordes, place de la Madeleine.
Un jour, je lui ai fredonné une idée qui m’était venue. « Ta-Toum-Ta-Toum/J’ai 10 ans… » Il m’a dit que mon air n’« était pas terrible ». Il a saisi un annuaire, des baguettes… Et il a inventé J’ai 10 ans. Comme ça. Pratiquement la mélodie finale.
Ces paroles enfantines, avec les « Tar’ ta gueule à la récré », les « quilles à la vanille », les « gars en chocolat », d’où venaient-elles ?
Je ne pouvais pas me prendre au sérieux. Je n’étais pas baraqué. Je voyais à la télé les Claude François, les Mike Brant. Moi je n’étais pas crédible en séducteur. Donc je jouais au gamin resté dans son monde d’enfant, dans ses rêves. Je m’affirmais comme un idiot, un peu. C’était nouveau, à l’époque.
« J’ai 10 ans » a rencontré un succès immédiat, en 1974 ?
Non, on l’a sortie sur un album avec tout un tas d’autres chansons emmerdantes. Il ne s’est rien passé. Jusqu’à ce que, six mois plus tard, on l’entende, avec Laurent, dans la voiture. Monique Lermarcis, la directrice artistique de RTL, l’avait découverte et trouvée sympa. Toutes les radios s’y sont mises. C’était la seule chanson dont Laurent avait composé la musique qui plaisait. On s’est dit qu’il fallait en inventer une autre ensemble. Ça a été J’suis bidon. J’étais au milieu de musiciens professionnels extraordinaires, comme le percussionniste Marc Chantreau ou le batteur Pierre-Alain Dahan. Quelle chance j’avais ! Moi, à côté, j’étais bidon.
Avec Laurent, il y avait déjà une connivence. Cela allait vite. En une après-midi, paf ! J’suis bidon. Et on a vendu beaucoup de disques. Evidemment, on a continué. Y a de la rumba dans l’air, une chanson très différente, mais qui a aussi marché. Le banquier m’a appelé pour m’annoncer que j’avais 600 000 francs sur mon compte. Là, c’était dingue ! Je me suis mis à faire le chanteur à la télé. Ça m’effrayait et m’amusait. On passait notre temps à rigoler sur le plateau de Guy Lux avec Bob Socquet, si cultivé, qui me parlait d’André Gide.
Deux jeunes chanteurs qui s’épaulent et parviennent à sortir de l’ombre… Enfin, surtout vous. Vous seul chantiez…
Oui, alors Laurent a suggéré : « Si on faisait une chanson pour moi, quand même… » Avec un petit air de par derrière. J’ai trouvé ça tout à fait normal. Il m’a parlé de son idée : « Je me souviens que telle année, y avait tel tube. » « Oui, je lui ai dit, mais tes paroles, on va les refaire. » Et j’ai écrit RockCollection. Il a mis trois mois à l’enregistrer parce qu’il prenait plaisir à ce que les différents passages soient absolument identiques aux originaux. Et il a vendu 6 millions de disques dans le monde entier.
On était sidérés. On avait bien fait de se rencontrer ! Avant, on n’avait aucun succès, ni lui ni moi. Et d’un seul coup, tous les deux, boum ! Comme un arc électrique ! Une magie qui nous dépassait… Ça venait tout seul, en se marrant. Idéalement. C’est injuste, mais on ne peinait pas beaucoup. Et surtout, c’était plutôt plaisant de le voir, ce garçon extraordinaire de gentillesse, de drôlerie, d’intelligence. J’adorais les histoires qu’il me racontait. Lui venait de la banlieue est, il avait connu la vie de chanteur en boîte à 2 heures du matin pour gagner trois sous. Moi j’étais d’une famille bourgeoise du 16e arrondissement parisien.
QUAND LES GENS S’INQUIÈTENT POUR LES ENFANTS, AU MOMENT D’UN DIVORCE, JE LEUR DIS : « CE N’EST RIEN, ILS SERONT CHANTEURS »
Une famille particulièrement portée sur la musique ?
Mes parents n’avaient pas d’argent, mais ils étaient obsédés par la culture. Leurs stars, ce n’étaient pas des joueurs de foot, mais Lamartine, Montaigne, Hugo… Mon père était professeur agrégé d’histoire, il enseignait au lycée Henri-IV. Avec ma mère, ils allaient tout le temps au concert ou au théâtre. Ils me laissaient avec une bonne très gentille et une grande bibliothèque – il n’y avait ni télé ni radio. Donc j’étais dans le couloir, je regardais les titres, les couvertures, je feuilletais, je lisais parfois. L’Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, à 12 ans. Ou Onze ans dans les bagnes soviétiques (de Lipper Elinor). Et surtout de la poésie.
Avant ces lectures, à 7 ans, votre père biologique est entré dans votre vie…
Je n’aime pas trop raconter cette histoire, ma mère passe pour une femme légère, ce qu’elle n’était pas du tout. Elle a rencontré un agrégé d’anglais, Pierre Souchon, pendant que son mari était parti passer une année à la Villa Médicis de Rome. Elle a fini par quitter son époux et épouser mon père quand j’ai eu 7 ans. J’ai donc eu une première famille, puis une autre. Tout le monde a été extrêmement aimant et bienveillant avec moi, mais évidemment, ça m’a déstructuré la tête. C’est ce qui fait que j’ai écrit des chansons, sans doute. Que je cherche quelque chose. Un équilibre. Quand les gens s’inquiètent pour les enfants, au moment d’un divorce, je leur dis : « Ce n’est rien, ils seront chanteurs. »
Ce bouleversement a-t-il eu des répercussions à l’école ?
Je ne sais pas. J’essaie de me trouver des excuses pour ne pas penser que, simplement, je suis idiot. A l’école, je n’arrivais à rien, je n’étais pas concentré. Je faisais rire mes copains, pour compenser. A un thème latin, j’avais reçu la note d’un quart. C’était monstrueux… Je décevais. Dans ma famille, il fallait faire des études. J’ai un frère agrégé de lettres, un autre docteur en géologie.
Si ce n’était l’école, quels étaient vos bonheurs d’enfant ?
Etre dans la nature tout seul. Mes grands-parents possédaient une maison en Sologne. Avec mon petit vélo, je partais dans les bois. C’était la liberté ! A Paris, on était petitement logés et je m’emmerdais. Là, je construisais des cabanes dans les arbres, je tuais des taupes pour les amener à la mairie et récupérer quelques centimes. Je passais ma vie avec les cultivateurs des environs qui labouraient avec des chevaux. Je montais dessus, je me prenais pour un cow-boy. Fier !
Votre père biologique est décédé en 1959 dans un accident de voiture. Vous aviez 14 ans. Comment avez-vous vécu ce nouveau choc ?
J’ai eu envie de cacher mes sentiments. Je voulais pleurer tout le temps et en même temps, je me disais qu’il n’allait plus m’engueuler. C’était monstrueux de penser ça, mais en contrepartie, je gagnais une liberté. Maman s’est mise à écrire des histoires d’amour à l’eau de rose pour gagner sa vie. On ne roulait pas sur l’or, il fallait toujours faire attention. J’en ai gardé un petit côté radin. Des fois, je me dis : « Ces chaussures-là sont trop chères. »
J’ai traînassé dans des boîtes à bac. Dans une pension en Haute-Savoie, où mon frère vivait. Il était guide de montagne et prof. La pension était une prison, on portait l’uniforme, on formait les rangs… Mais on était dans le même bateau, avec les copains. Et il y avait les filles, externes, qui venaient au lycée. Comme tout le monde, je les regardais croiser les jambes, j’essayais de leur dire des bêtises sans oser les approcher. Et puis j’avais le Lagarde et Michard. Ça me bottait, les peintures, les portraits de Lamartine, de Montaigne. Je m’évadais là-dedans.
Comment avez-vous réussi à filer à Londres à 16 ans, en 1960, l’année où les Beatles se formaient ?
Je suis parti passer le bac là-bas parce que mon père y avait des amis. Ma mère avait pensé qu’au moins, j’apprendrais l’anglais… Mais une fois arrivé, je me suis rendu compte que le Lycée français coûtait trop cher pour nous. J’ai convaincu ma mère au téléphone de mon intention de préparer le bac par correspondance, tout en travaillant dans un pub, trois heures par jour – je nettoyais les toilettes et les pompes à bière. J’étais « Mister Frenchman ». Les Anglaises m’embrassaient facilement sur la bouche pour la simple raison que j’étais français. Je trouvais ça usurpé mais génial.
Je n’ai pas décroché mon bac, malgré trois tentatives. Alors je me suis dit que j’allais faire ma vie d’une manière humble en commençant par des travaux manuels. Je suis retourné chez mon frère, j’ai trouvé un emploi d’apprenti peintre en bâtiment à Megève (Haute-Savoie), chez un patron gentil comme tout. Il fallait vernir des volets dans des chalets en construction, en pleins courants d’air. Ça caillait, à Megève, l’hiver.
Mais alors, comment en êtes-vous venu à vous imaginer chanteur ?
J’ai toujours cherché des mots. A 9 ans, j’ai trouvé : « Il est beau, majestueux et grand, dans la belle ville de Rouen » – cela parlait d’un fleuve, la Seine. J’étais content de moi, dans la forêt chez ma grand-mère ! J’ai couru lui réciter cette phrase. Plus tard, j’ai commencé à adorer la poésie. Les textes racontant des histoires avec des rimes et des rythmes. Je retrouvais ça dans les chansons françaises bien écrites, celles de Léo Ferré, Guy Béart, Georges Brassens, Jacques Brel… En classe de 5e, un professeur nous a fait étudier La Légende des siècles de Victor Hugo durant toute une année. J’ai été fasciné. La cadence, les rimes et ce que ça racontait, la folie moyenâgeuse, les excès de partout ! Puis, comme tout le monde, j’ai été faire un tour chez Apollinaire, Rimbaud, chez Ronsard, aussi, beaucoup…
J’essayais d’écrire des chansons dans mon coin, que je jouais sur ma guitare d’occasion. Elles étaient bébêtes : « J’suis un pauvre garçon… » Chanter, c’était comme un rêve que je n’osais pas m’avouer. Je n’y croyais absolument pas.
Pourquoi ne pas vous être rêvé écrivain, vous qui appréciiez tant les mots ?
D’abord, j’aime bien qu’il y ait de la musique. Et puis il y a ce côté clinquant des chanteurs qui rayonnent sur scène, qui sont applaudis. Ça pète, c’est rigolo. J’avais vu Gilbert Bécaud, un dimanche après-midi avec ma mère, les places n’étaient pas chères. J’avais été épaté par la force du son, et la sienne, et celle des applaudissements. J’essayais des chansons dans ma chambre en me demandant : « Est-ce que ça pète quand je dis ça ? »
Un copain m’a entraîné dans les cabarets de la rive gauche. Je voyais des mecs chanter, je pensais : « C’est pas mal, on ne les entend pas à la radio, mais ils gagnent leur vie. » J’ai passé des auditions avec trois, quatre chansons. Personne n’a voulu de moi. Mes chansons n’étaient pas terribles. « Est-il possible que tes cheveux soient descendus sur tes épaules/Est-il possible que tu sois si belle ? »
« QUELLE CHANCE D’AVOIR UN PETIT DON ! JE NE FAIS PAS PLUS D’EFFORTS QU’UN AUTRE… »
Par quel miracle, alors, avez-vous trouvé une maison de disques et démarré votre carrière la trentaine venue ?
J’ai fini par me convaincre que je devais écrire des chansons faciles pour des gens comme Frédéric François, qui marchait bien. Des chansons populaires, c’était de mon niveau. J’ai écrit Moi, l’amour 1830. J’ai cherché dans l’annuaire « Edition de chansons », j’ai téléphoné partout. Il y a un type qui m’a donné rendez-vous, Michel Larmand, aux éditions Chappell. J’y suis allé avec ma guitare, je n’avais pas de magnétophone. Il téléphonait, les pieds sur le bureau. « Allez-y, faites voir… »
Je lui ai chanté Moi, l’amour 1830. Il a conclu : « C’est bien. » Alors j’ai suggéré qu’on la propose à quelqu’un comme Frédéric François. Il m’a répondu : « Oui, mais vous avez une douceur dans la voix, un truc… J’ai un ami directeur d’une maison de disques qui cherche quelqu’un pour le concours de la Rose d’or d’Antibes ». C’était Bob Soquet, chez RCA, qui recrutait de nouveaux talents pour remonter la boîte. Je me suis présenté au concours, puis j’ai enregistré la chanson en studio avec un grand orchestre, des violons… J’étais terrorisé, et en même temps, un peu grisé.
Vous avez rencontré Laurent Voulzy, enchaîné les succès, engrangé neuf Victoires de la musique depuis 1986, dont celle de « Chanson des vingt dernières années », pour « Foule sentimentale ». Quelle est votre plus grande fierté ?
Associé à Laurent, oui, j’ai récolté des Victoires. Ça ne me rend pas fier, ça me sidère. Quelle chance d’avoir un petit don ! Je ne fais pas plus d’efforts qu’un autre… C’est un plaisir d’écrire des chansons et je suis récompensé par la société d’une manière inimaginable.
Il y a bien une chanson qui, à vos yeux, est plus précieuse que les autres ?
Ultramoderne solitude. C’est comme si j’étais inspiré, ce jour-là. Sans prétention ! C’est fascinant ce qu’on vit en ville. Cette espèce d’angoisse qui peut prendre tout le monde à n’importe quel moment. Cette solitude au milieu de la foule. On est tous un peu timides et perdus dans ce monde.
La chanson d’amour n’est pas vraiment votre fonds de répertoire. Préférez-vous dénoncer les travers de notre société ?
Pour avoir l’air intelligent vis-à-vis des filles, alors que je ne le suis pas tellement… Mais je ne dénonce pas, je donne mon petit point de vue sur le monde. Je suis là pour raconter. Je ne cherche pas à changer les choses, elles sont immuables. Evidemment, les gens qui s’imaginent que le bonheur, c’est de posséder, d’avoir une Porsche et deux téléphones, cela me donne envie de pleurer donc j’en fais une chanson comme Foule sentimentale. Mais je ne vais pas dire : « Tous des cons ! »
« A 75 ANS, BIEN SÛR QU’ON A PEUR D’ÊTRE MOINS BRILLANT. J’AI ÉTÉ POUSSÉ PAR LA MAISON DE DISQUES, PAR MA FEMME, PAR MES FILS. ÇA A L’AIR DE SE PASSER PAS MAL, JE SUIS CONTENT »
Dans votre nouvel album, la chanson « Ame fifties » évoque le poste Radiola, la Peugeot 203 et l’accordéoniste André Verchuren. Avez-vous sombré dans la nostalgie ?
Ce n’est pas une chanson nostalgique, c’est une photo. Les voitures actuelles sont mieux que les 203 qui démarraient à la manivelle et tombaient en panne tout le temps ! Par contre, j’ai écrit une chanson qui dit : « On se ramène les cheveux vers l’avant pour que tout soit comme avant. » Ça, c’est un petit peu nostalgique. Les garçons, quand ils perdent leurs cheveux, c’est leur jeunesse qui s’en va.
J’ai vu les cultivateurs dans les années 1950. Ils mouraient jeunes. C’est mieux maintenant, quand même. Dans les usines aussi. Et les filles sont si jolies. Et il y a des tas de gens intelligents, de films merveilleux. Et Internet, qui ne m’intéresse pas, mais rend la jeunesse heureuse visiblement. Une fois, j’ai dit : « Quand même, Macron, il a une vie romanesque… Si brillant, arriver au sommet et tout le monde lui tape dessus. » Vous n’imaginez pas ce que j’ai entendu ! « Connard ! Quand je pense que j’aimais bien tes chansons, c’est fini ! » Ça m’a surpris. Je croyais que je laissais indifférents ceux qui n’écoutaient pas mes chansons. Grâce à Internet, maintenant, je sais que les gens peuvent me haïr.
Vous allez de nouveau vous produire sur scène. Est-ce un plaisir pour vous ?
Le côté hystérique de se montrer, je trouve ça un peu bébête. Moi, ce qui me plaît, c’est de faire des chansons, puis que les gens me disent : « Elle est bien ta chanson. » Je ne vais pas vous faire croire que je n’aime pas les applaudissements. C’est très physique, la scène, c’est dangereux, faut pas se casser la gueule, on transpire comme une vache pendant deux heures, mais on fait ça avec sa tête, quand même. J’aime la réponse immédiate.
Quand 6 000 personnes vous renvoient leur satisfaction, comme un seul être énorme, on vit des moments merveilleux. Par exemple, j’ai fait une chanson (Et si en plus y a personne) sur la détresse des hommes qui ont besoin de se créer des dieux parce qu’ils sont perdus, qu’ils ont peur de l’infini, et puis qui s’égorgent à cause de ces dieux. Sur scène, les applaudissements n’en finissent plus. On est comme des frères.
Et le cinéma, avez-vous aimé ?
Non, ça ne m’a pas intéressé. Je ne me sentais pas habité par le truc. C’est le réalisateur Claude Berri qui m’avait entraîné là-dedans. J’ai aimé être proche de Jane Birkin, de Catherine Deneuve, d’Isabelle Adjani – Ah la beauté d’Isabelle dans L’Eté meurtrier… Côtoyer Pierre Granier-Deferre, Jacques Becker, Jacques Doillon… Quand vous endossez le rôle principal, le metteur en scène veut que vous soyez lui, ça crée des liens forts.
J’ai passé des après-midi entiers à attendre dans une voiture avec Jean-Louis Trintignant. Ce sont de merveilleux souvenirs, vous savez. Il me racontait : « Hier, j’ai fait un béret. » Pardon ? « Une course de voitures et je me suis retrouvé sur le toit. » Quel mélange ! Un mec si raffiné, si intérieur, qui se déchaînait sur une Porsche !
Moi, j’aurais adoré être drôle, être Thierry Lhermitte ou Edouard Baer. C’est charmant, ça fait du bien aux gens. Les Florence Foresti, on devrait les canoniser. Moi j’essaie et ça rate. Il n’y a pas pire…
A 75 ans, le temps qui passe est-il devenu source d’angoisse ? Craignez-vous le disque de trop, la tournée de trop ?
Bien sûr qu’on a peur d’être moins brillant. J’ai été poussé par la maison de disques, par ma femme, par mes fils. Ça a l’air de se passer pas mal, je suis content. Maintenant, sur scène, je vais peut-être m’effondrer, on verra. « Angoisse », le mot est trop fort. Je commence un texte et puis je demande « Ça va, ça ? » à Laurent Voulzy, à mes deux fils qui sont très actuels et très doués. « C’est presque toi, presque moi », tout le monde adore cet air qu’ils ont trouvé.
On ne peut pas rester assis à regarder le mur en se disant : « Je vieillis. » Autant s’agiter. L’avantage de la chanson, c’est que ce n’est pas un travail. C’est juste une envie d’amuser les filles.
Nouvel album Ame fifties (Parlophone/Warner Music France), sortie le 18 octobre
En concert du 14 au 17 novembre au Dôme de Paris puis en tournée dans 35 villes jusqu’en juin 2020.














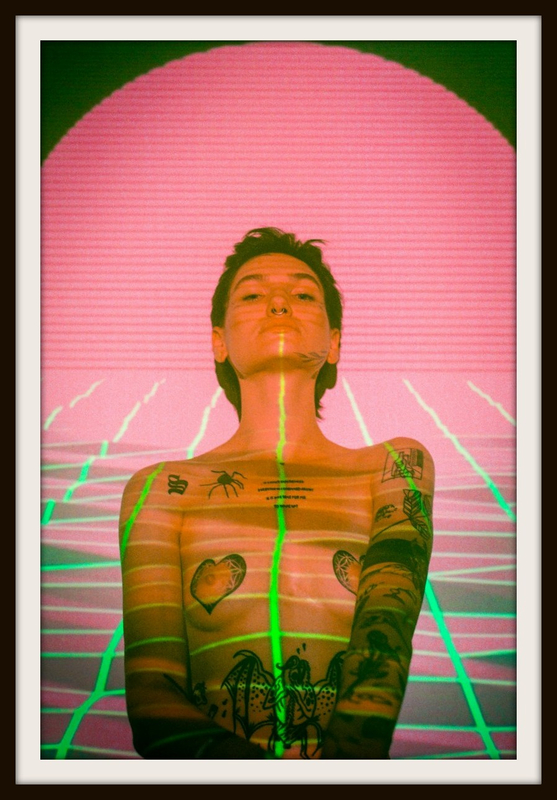





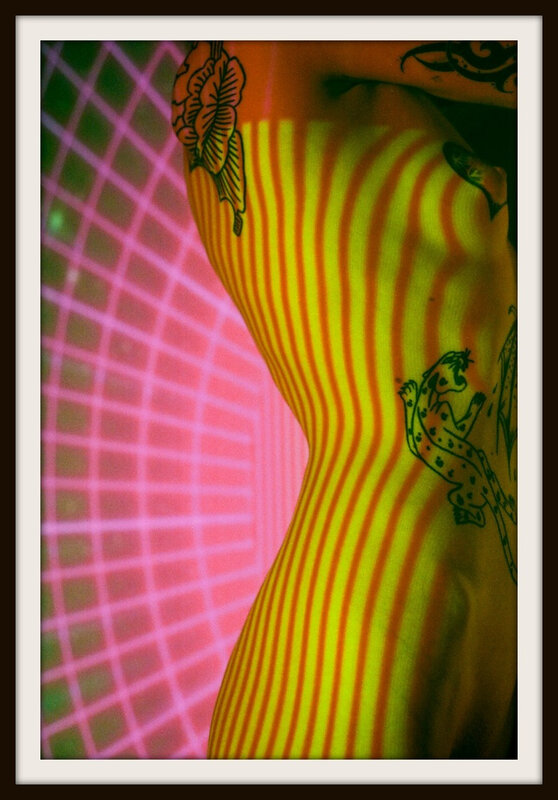
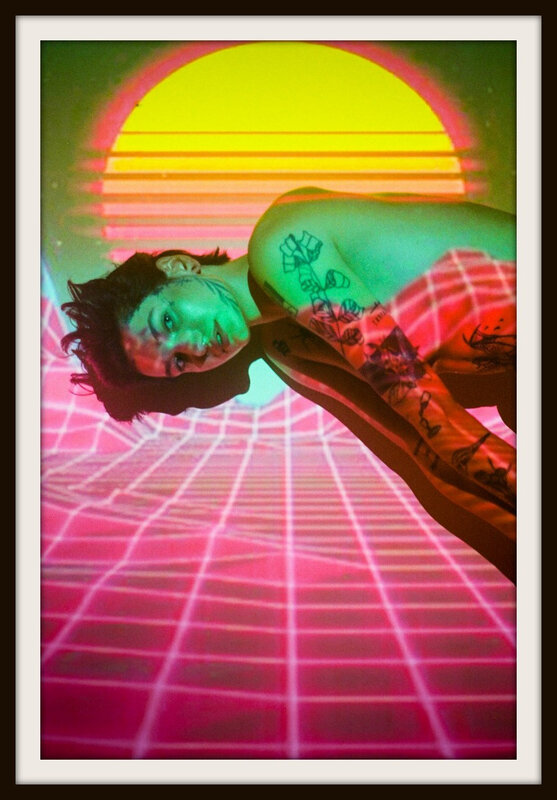






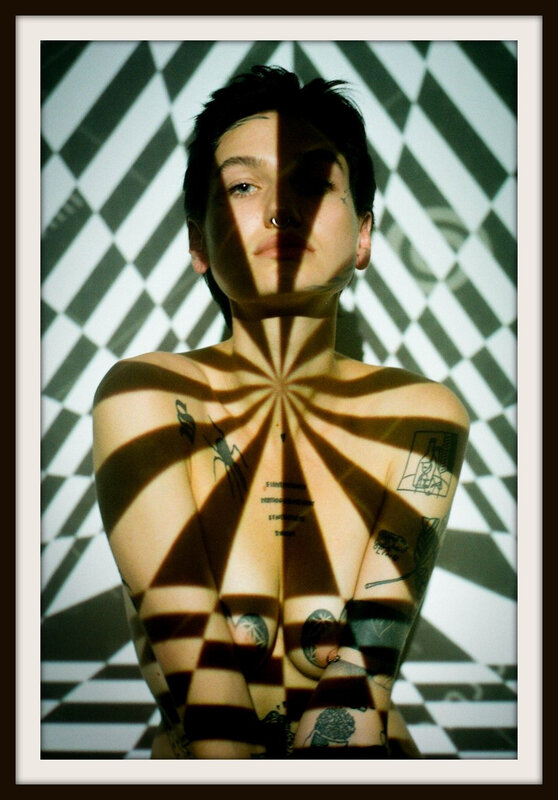

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)