Par Alexandre Piquard
Après Amazon, c’est au tour de Google de voir son assemblée générale perturbée par des revendications éthiques portées par certains de ses salariés. Une rébellion qui a pris une ampleur nouvelle après l’élection de Donald Trump, fin 2016.
Ingénieure chez Google, Irene Knapp devait s’exprimer, mercredi 19 juin, devant l’assemblée générale annuelle des actionnaires du géant technologique américain.
Trois minutes pour défendre, face à un auditoire, l’une des trois résolutions déposées cette année par des salariés. « Toutes sont liées à des thèmes qui nous intéressent en tant qu’employés engagés dans les mouvements de mobilisation au niveau interne comme le “Google Walkout” », raconte-t-elle.
Avec 20 000 des 100 000 salariés du groupe, Irène Knapp avait participé, le 1er novembre 2018, à la grande marche devant plusieurs bureaux de l’entreprise dans le monde, pour dénoncer le traitement des cas de harcèlement sexuel et les inégalités au sein de la firme de Mountain View (Californie). Elle est aussi un pilier des autres protestations qui agitent Google depuis plus d’un an. Ainsi, elle a fait partie des 4 000 employés signataires de la pétition pour l’arrêt du contrat Maven de collaboration avec l’armée américaine ou encore des 700 salariés réclamant l’arrêt du projet Dragonfly, un moteur de recherche adapté à la Chine.
De surcroît, elle a corédigé la lettre ouverte, signée par 2 000 de ses collègues, contre la nomination, au comité d’éthique de Google sur l’intelligence artificielle, d’une personnalité conservatrice jugée antitrans, anti-LGBTQ et antimigrants. Des employés de ces différents mouvements étaient appelés à se rassembler, mercredi, devant l’assemblée générale et les bureaux de Google dans douze villes.
Croisade écologique
La résolution 14 défendue par Irene Knapp demande que les dirigeants soient payés en fonction de leur capacité à respecter des « critères de diversité et d’inclusion », afin d’éviter les discriminations selon des critères ethniques, de genre ou d’orientation sexuelle. Elle-même se définit comme « transgenre » et souhaite, en anglais, être désignée par le pronom pluriel neutre « they » ou « them ».
Cette « autodidacte » de 38 ans explique avoir « toujours voulu travailler dans la tech », mais ne s’être fait embaucher chez Google qu’à la trentaine, en 2014, après avoir connu des périodes « de pauvreté ». « Je voyais les entreprises de la tech comme un repaire d’idéalistes où l’on cherche à régler les problèmes des gens. Mais j’ai été déçue de voir qu’on n’y était pas assez conscients des effets réels de la technologie sur la société », explique-t-elle.
L’histoire originale d’Irene Knapp n’est pas un cas isolé. Kathryn Dellinger est encore secouée par « l’expérience vraiment émouvante » qu’elle a vécue, deux semaines plus tôt, en se rendant, elle aussi, à l’assemblée générale de son entreprise, Amazon. Cette trentenaire, programmatrice d’interface utilisateur sur Amazon.com, était venue soutenir sa collègue Emily Cunningham, désignée porte-parole de leur résolution.
Appuyé par une pétition de 7 000 employés, le texte demandait au PDG, Jeff Bezos, d’adopter une politique beaucoup plus active contre le changement climatique. « Jeff, es-tu prêt à être un leader ? Nous oui », disait la petite pancarte que Mme Dellinger tenait dans sa main droite.
Quand on lui demande pourquoi elle s’est lancée dans cette croisade écologique sur son lieu de travail, la jeune mère explique que « c’est dur de voir » les tempêtes qui frappent de plus en plus souvent les côtes de sa Virginie natale ou les feux de forêt qui obligent régulièrement les gens à porter des masques antiparticules dans la région de Seattle (Etat de Washington), le fief d’Amazon.
« A Google, la culture a changé »
Que des salariés aient des choses à redire sur les choix de leurs dirigeants n’est pas étonnant. Ce qui surprend, dans le mouvement qui touche actuellement la Silicon Valley, c’est sa dimension publique. Les entreprises américaines de la « tech », fort généreuses mais dépourvues de syndicats, sont réputées pour être assez secrètes. « A Google, la culture a changé. Au début, ça ressemblait à un département de fac hors de contrôle. Au niveau interne, les gens débattaient ouvertement de leurs projets », note Colin McMillen.
Au cours de ses neuf années passées chez Google, il était très actif sur les nombreuses listes email internes et sur le réseau social Google+, avant de démissionner, en février 2019. « Google disait : “Nous vous donnons de l’info, mais ne la faites pas fuiter”. Les gens tenaient leur langue, parce qu’ils avaient le sentiment d’être écoutés par la direction. » Cet « équilibre » a été rompu, selon l’ingénieur, conscient qu’une « spirale » a été enclenchée : plus de fuites, moins d’informations partagées.
Cet ancien employé, qui se sentait « en famille » au bureau de Boston, prend pour exemple un symbole de la culture d’ouverture interne revendiquée par Google : les réunions du jeudi soir, « Thank God it’s Friday », lors desquelles les employés pouvaient écouter les fondateurs, Larry Page ou Sergei Brin, dans la salle en sirotant une bière ou en visioconférence. « Leur fréquence a diminué, ainsi que la possibilité de poser des questions en direct au micro. Il y a moins d’annonces ; les réponses ressemblent plus à de la communication », estime M. McMillen. Il a ainsi trouvé « faiblardes » les explications données en août 2018 par le PDG Sundar Pichai sur le projet de moteur de recherche chinois, décrit comme « exploratoire ».
Colin McMillen fait partie des quinze employés qui, en janvier 2018, ont décidé de parler à la presse. Sur le site Wired, ils ont fustigé le « harcèlement » dont ils faisaient l’objet de la part d’internautes d’extrême droite venus de forums comme 4chan. Ces derniers réagissaient à des propos que lui et des collègues avaient tenus dans des forums internes à propos du mémo publié par James Damore.
Avant d’être licencié, cet ingénieur avait fait scandale en justifiant le manque de femmes aux postes à responsabilité par « des différences biologiques » et en accusant Google de « discriminer » les hommes, les Blancs et les conservateurs. M. McMillen et ses collègues avaient regretté le manque de soutien des ressources humaines et les sanctions dont certains avaient fait l’objet.
Treize mois plus tard, M. McMillen démissionnait, invoquant une accumulation de « problèmes éthiques » : l’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser des images de drones militaires pour Maven ; l’intégration de critères de censure du régime chinois pour Dragonfly ; le départ négocié, avec un chèque de 90 millions de dollars (environ 80 millions d’euros), d’un haut cadre accusé de harcèlement sexuel dans le cas du « Google Walkout »... Autant de polémiques révélées par des médias en contact avec des employés par le biais de messageries cryptées, et relayées par des comptes Twitter ad hoc : @EthicalGooglers, @GoogleWalkout...
« Il y a une désillusion croissante »
Si les « Googlers » sont particulièrement actifs, le mouvement de révolte éthique touche d’autres entreprises. De fait, la collaboration avec les agences américaines de l’immigration a déclenché des pétitions de salariés chez Amazon, qui livrait des outils de reconnaissance faciale, mais aussi chez le fournisseur de logiciels d’entreprise Salesforce, ainsi que chez Microsoft, où deux lettres ouvertes ont dénoncé la vente de casques de réalité virtuelle ou d’hébergement de données à l’armée.
Le 4 avril, des salariés de Microsoft ont interpellé le PDG, Satya Nadella, à l’occasion d’une réunion publique consacrée au traitement des femmes et des cas de harcèlement sexuel. Chez Facebook, le groupe Workers For Workers bataille contre la différence de traitement entre les salariés et les nombreux employés contractuels, largement répandue dans le secteur. Chez Uber, des employés se sont élevés contre la culture interne considérée comme sexiste, dans le sillage du mouvement #metoo. Sur les réseaux sociaux, les salariés mobilisés s’échangent des messages de soutien, misant sur la convergence des luttes.
« Les employés du secteur sont sur la ligne de front : ils construisent les outils technologiques et en voient les conséquences. Le fait qu’il y ait de plus en plus d’objecteurs de conscience est parlant », estime Erica Anderson, l’une des organisatrices du « Google Walkout », qui, après quatre ans chez Google, a démissionné pour rejoindre le site Recode, en janvier.
La journaliste new-yorkaise avait pourtant délaissé dès 2010 la chaîne traditionnelle CBS pour le réseau social Twitter, croyant que la tech amènerait « de l’ouverture et de la transparence dans la société ». Passée par Google, elle a quitté la société, frustrée du peu « d’impact » de son travail, notamment dans le combat contre la désinformation en ligne.
« Objecteur de conscience », c’est aussi le mot utilisé par Jack Poulson dans une tribune publiée en avril dans le New York Times. Cet ingénieur trentenaire spécialisé chez Google dans les systèmes de recommandation a donné sa démission une semaine après la révélation du projet Dragonfly. « L’histoire de la tech aux Etats-Unis inclut la remise en cause de la liberté pour accéder à des marchés », juge cet ex-enseignant, après avoir récemment découvert que Cisco était accusé d’avoir vendu en Chine, il y a vingt ans, des outils ayant servi à la répression du mouvement religieux dissident Falun Gong.
« Il y a une désillusion croissante au sujet de la tech. Se faire offrir de la nourriture gratuite, ce n’est pas assez pour rester calme en tant qu’employé », observe Liz Sullivan, une ingénieure en intelligence artificielle qui, elle aussi, a claqué la porte de sa start-up Clarifai après avoir appris qu’elle envisageait de collaborer avec l’armée. Comme référence, la trentenaire cite la lutte contre la guerre du Vietnam ou le « Never Again Pledge », lancé en décembre 2016, en référence à la collaboration du géant informatique IBM avec le régime nazi. Des centaines d’ingénieurs y promettaient de ne jamais participer à participer au « fichage » des musulmans envisagé par Donald Trump.
L’élection de Donald Trump, un « tournant »
Au-delà des références éthiques et historiques, l’un des moteurs de cette rébellion est politique : « La victoire de Donald Trump a été un signal d’alarme, se rappelle l’ex-ingénieur de Google Tyler Breisacher, sidéré de la défaite de « l’expérimentée » Hillary Clinton, en novembre 2016. Quand on a vu les photos des patrons des grandes entreprises de la tech rencontrant le président dans la Trump Tower [à New York], ça a été un tournant : on a réalisé que nos dirigeants n’avaient pas les mêmes intérêts que nous. »
Les PDG du numérique devraient-ils refuser de voir les représentants de l’exécutif ? Cela n’est pas évident, alors que Donald Trump accuse régulièrement Facebook, YouTube ou le Washington Post de Jeff Bezos d’avoir un « biais » partisan défavorable aux conservateurs. Ou que les républicains reprochent à Google de manquer de patriotisme en préférant collaborer avec le régime chinois plutôt qu’avec l’armée américaine. Sous pression, la direction de Google tente de ne froisser aucun bord, mais est accusée d’en faire trop, par exemple en nommant à son comité d’éthique sur l’intelligence artificielle Kay Coles James, la présidente du groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation.
M. Breisacher, 31 ans, assure que le soutien financier de Google à des campagnes des républicains a autant joué que le projet Maven dans sa décision de démissionner : « Google ne réalise pas qu’il continuera d’être accusé de pencher à gauche, quels que soient ses gestes envers les conservateurs. L’entreprise n’y gagne rien, mais perd ses employés », déclare celui qui a rejoint une petite start-up de 85 personnes.
L’essor du mouvement de mobilisation des employés de la tech reflète aussi une évolution de la gauche américaine : l’heure est moins aux « liberals » libertaires et probusiness de la Silicon Valley, bien considérée sous le mandat de Barack Obama, duquel certains dirigeants de Google étaient proches. Arrive une gauche venue de la côte Est, plus radicale, collective et hostile aux grands groupes. Ses figures sont les candidats à l’investiture démocrate Bernie Sanders ou Elizabeth Warren – elle veut « démanteler » Google, Facebook, Amazon ou Apple –, ou encore la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez.
« Cols blancs » et droits des salariés
La génération de nouveaux salariés protestataires dans les géants du numérique a été aidée par des militants extérieurs. « J’ai été embauchée après l’élection de Trump, pour répondre à l’afflux d’appels de salariés de la tech demandant des conseils sur la manière de s’organiser », relate Yana Calou, figure désormais incontournable du mouvement de protestation, au sein de Coworker. Dans cet hybride à mi-chemin entre ONG et syndicat, on était plutôt habitué à défendre les cols bleus, ces travailleurs mal payés de la grande distribution ou du gardiennage. On se sentait regardé de haut par les salariés de Facebook ou de Google qui, avec un salaire médian de 200 000 à 250 000 dollars par an, n’avaient pas le sentiment d’avoir besoin de défendre leurs droits.
« La participation des cols blancs est quelque chose de tout à fait nouveau, relève Michelle Miller, qui a mené, au nom de Coworker, de nombreuses réunions avec des employés de ces entreprises pour leur parler de droit du travail et d’éthique.
Plusieurs organisations soutiennent les employés mobilisés, de Silicon Valley Rising au collectif de bénévoles Tech Workers Coalition. Membre de ce collectif, M. Breisacher se rappelle s’être senti « peu à l’aise » lors de sa première « action » : « sensibiliser » à la défense de leurs droits les deux vigiles de sécurité de son bâtiment, au siège de Google. Depuis, le choc des cultures a bien été dépassé.
Face à ces frondes internes, les sociétés concernées ont parfois affiché une certaine bienveillance. « Je comprends la colère et la déception que beaucoup d’entre vous ressentent », a écrit Sundar Pichai dans un courriel adressé aux participants du « Google Walkout ». Il a ensuite mis fin à la pratique de l’arbitrage obligatoire qui substituait une négociation aux poursuites judiciaires, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Les employés révoltés de la tech ont connu plusieurs victoires : en juin 2018, trois mois après la pétition, Google a annoncé le non-renouvellement du contrat Maven et énoncé « des principes éthiques » sur l’intelligence artificielle, renonçant à fabriquer « des technologies qui causent des dommages ». « Google a fait passer ses principes éthiques avant ses intérêts commerciaux et renoncé à des contrats de millions de dollars », insiste la direction. Officiellement, le projet chinois Dragonfly, révélé en août, n’est plus à l’ordre du jour. Et le comité d’éthique sur l’intelligence artificielle a été suspendu.
Malgré cela, les employés restent déterminés : « La direction a cédé à l’une des cinq revendications du “Google Walkout”, mais il y en avait d’autres », déclare Tanuja Gupta, une des organisatrices, chef de projet chez Google à New York. Le collectif avait exigé « un engagement à mettre fin aux inégalités de salaire et d’opportunité de carrière » ou « la nomination d’un employé comme représentant au conseil d’administration ».
Crise de croissance
Surtout, chez Google, un épisode récent a fait remonter la pression. Fin avril, deux fers de lance des mobilisations ont dénoncé des « représailles » menées à leur encontre. Meredith Whittaker déplore qu’on lui ait demandé de changer de poste et « d’abandonner » son travail sur l’éthique de l’intelligence artificielle – sa spécialité – et sa fonction de chercheuse à l’Institut AI Now de l’université de New York.
Claire Stapleton, employée au « marketing social » chez YouTube, affirme qu’elle allait être « rétrogradée » avant que ses avocats interviennent. Google a démenti toutes « représailles » et assuré que de telles évolutions de poste étaient courantes. Mais Mme Stapleton a fini par démissionner le 31 mai, après douze années au sein de la société. Cela échaudera-t-il les protestataires ? Ces derniers estiment opérer dans une zone grise juridique. En effet, divulguer des informations internes est proscrit par le règlement de Google, mais le fait de s’exprimer sur ses relations de travail est protégé par le droit américain.
«En tant que femme dans la tech, plus je pense aux accusations de représailles de Google contre des salariées mobilisées, plus je suis en colère », répond Emily Cunningham, l’employée d’Amazon en pointe sur le changement climatique. En écho, Amazon a annoncé, en février, la politique « Shipment Zero » qui vise la neutralité carbone pour la moitié de ses livraisons d’ici à 2030. Mais le géant ne s’est pas engagé à faire baisser la valeur absolue de ses émissions de CO2 ni à renoncer à collaborer avec l’industrie pétrolière, rétorque l’ingénieure.
Sur le travail avec l’armée, Jeff Bezos a assumé, affirmant que les Etats-Unis « [avaient] besoin d’être défendus ». Microsoft aussi. Mais l’entreprise cofondée par Bill Gates a lancé un appel à « réguler » la reconnaissance faciale, soutenu par Amazon. Microsoft a également revu, mi-avril, ses pratiques de ressources humaines, créant une cellule pour soutenir les salariés dans les cas d’enquêtes internes.
Parmi les employés, ces sujets ne font pas toujours consensus. Des salariés de Google pensaient qu’amener leur moteur de recherche aux Chinois serait un progrès. M. Poulson se souvient aussi d’un collègue vétéran selon lequel refuser de collaborer avec l’armée américaine, « c’était l’insulter ». « Elever tous les employés de Google au rang de révolutionnaires serait faux. La plupart ne font que prendre leur chèque à la fin du mois », blâme M. Poulson, calculant que les pétitions et le « Walkout » n’ont réuni qu’entre 5 % et 20 % des salariés de la firme.
Du côté du géant de Mountain View, on présente les protestations comme un symptôme d’une crise de croissance, ou du passage de l’entreprise à l’âge adulte : « Le défi, c’est de continuer à grandir, en préservant notre culture d’ouverture de débat interne, mais en prenant aussi en compte le fait qu’à 100 000 employés, on ne peut pas diriger comme avant. ».
Google assume le fait de chercher des relais de croissance. « Dans un univers très concurrentiel, l’entreprise doit se réinventer côté business, sans renoncer à ses valeurs. Tout est une question de curseur. » Férue de statistiques, la direction dit écouter ses salariés, qui ne sont plus « que » 74 % à faire confiance au PDG, contre 92 % un an auparavant, d’après une enquête annuelle. L’enjeu est de taille. « Les “talents” de la tech sont puissants. Ils peuvent facilement être embauchés ailleurs. C’est difficile de les ignorer », commente Kara Swisher, rédactrice en chef de Recode.
« Le génie est sorti de la lampe »
On pourrait pourtant taxer les révoltés de la Silicon Valley de naïveté. Découvrent-ils que leurs employeurs sont des entreprises ? Qu’une multinationale s’intéresse au marché que constitue 1,4 milliard de Chinois ? Que les revendications des salariés ne sont pas toujours entendues ? Ce mouvement révèle un paradoxe : les employés critiques vis-à-vis de leur entreprise sont aussi, souvent, ceux qui veulent la voir tenir ses propres promesses, celles de respecter des « valeurs » et d’avoir une utilité sociale.
Parmi les pancartes brandies lors du « Walkout », on trouvait souvent la profession de foi originelle de Google : « Don’t be evil » (« Ne soyez pas malveillants »). Comme si les rebelles se voyaient détenteurs de la « vraie » identité de l’entreprise.
« La priorité, pour l’année à venir, c’est de demander la création d’une structure de responsabilité qui permette aux communautés de l’entreprise de se faire entendre sans avoir à passer par la presse, estime Irene Knapp. Google pourrait être quelque chose de merveilleux, si seulement l’entreprise avait une conscience. » Tanuja Gupta, elle, se bat « sur son temps libre » pour mettre fin aux arbitrages forcés chez Paypal, Netflix, Tesla...
Pour d’autres, la remise en cause doit aller encore plus loin et il est nécessaire de s’engager pour changer la place du numérique dans la société. « La technologie, c’est la nouvelle finance. Vous y allez pour gagner beaucoup d’argent », souligne Jack Poulson, qui s’est lancé dans deux projets d’ONG : l’un est un réseau destiné à aider des employés de la tech à s’exprimer à l’extérieur, notamment dans la presse ; l’autre, Tech Inquiry, propose de jouer le rôle d’experts « indépendants » sur la régulation du numérique auprès des responsables politiques.
« Il faut des lois », insiste Liz Sullivan, elle aussi active dans Tech Inquiry. Cofondatrice d’une nouvelle start-up, elle s’inquiète de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour déterminer « quels coins de rue la police doit surveiller ou qui va sortir de prison ». « Le génie est sorti de la lampe, mais nous pouvons encore faire pression sur ces grandes entreprises de la tech », pense l’ingénieure, qui surveille les débats législatifs sur la reconnaissance faciale et la vie privée, à New York et dans les autres Etats américains.
L’approche du scrutin présidentiel de novembre 2020 outre-Atlantique pourrait nourrir la contestation, alors que républicains et démocrates ne semblent s’accorder que sur la volonté de réguler les géants de la tech. « Il y a tellement de mouvements de justice sociale qui convergent sur Amazon et les grandes entreprises du secteur technologique. 2020 arrive. Ce n’est qu’une question de temps avant que ces géants aux pouvoirs sans limite se mettent à agir de façon plus responsable », croit Sijal Nasralla, de l’ONG SumOfUs, qui a porté des résolutions aux AG d’Amazon et Google.
Pour le secteur technologique, pressions internes et externes se rejoignent. « Il nous faut plus de décisions comme celle-là », a commenté sur Twitter Meredith Whittaker, figure de la protestation chez Google, à propos de l’interdiction de la reconnaissance faciale par San Francisco, la « capitale » de la Silicon Valley, à la mi-mai.



















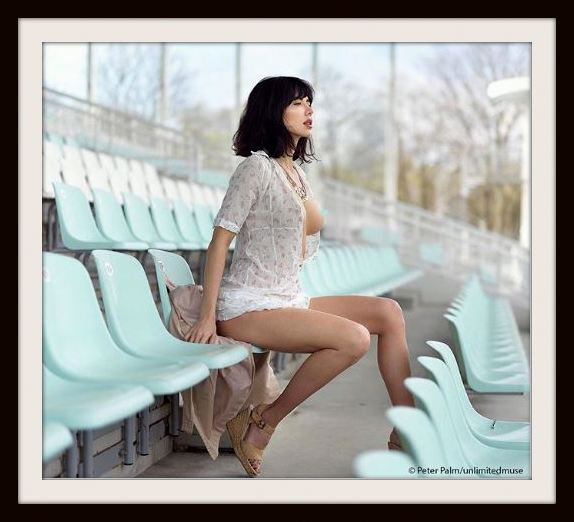













/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)