




Fan d’Isabelle Huppert et des images de Carole Bellaïche ?
Oui : complètement ! C’est pour cela qu’à l’occasion de son exposition à la Galerie XII , nous vous présentons 12 nouvelles photos accompagnées d’extraits du texte par Alain Bergala
par Alain Bergala
La Grande Actrice joue dans un film. Pendant des semaines, elle va être sous le regard de son metteur en scène, mais aussi sous celui du chef-opérateur, qui n’est pas tout à fait un technicien comme les autres. Même s’il travaille à faire l’image que le réalisateur attend de lui, quelque chose se trame souvent entre l’actrice et lui, une connivence très spéciale entre celle qui donne son image et celui qui lui donne forme, lumière et matière. Cette connivence est un peu secrète, presque sans paroles. Le chef-opérateur protège ce qu’il a deviné comme points de fragilité chez elle, réels ou imaginaires, mais dont le cinéaste a parfois besoin pour donner de la force à son film. Le spectateur n’y verra que du feu. Chez la Grande Actrice, les forces et les fragilités ne sont pas contradictoires, elle a besoin des deux pour tenir sa place dans la création du film. Ses rôles se tiennent souvent dans cet écart entre le dur et le fragile.
Quand le tournage s’arrête – et comme disait Bergman « la caméra finit toujours par s’arrêter » – l’intensité de ce qui s’est passé dans ce triangle s’éteint tout à coup. Chacun repart vers un autre film. Pour la Grande Actrice un nouveau film va bientôt commencer, car elle ne s’arrête pratiquement jamais de tourner. Le triangle va se reconstituer ailleurs, avec d’autres partenaires d’image. À chaque film, l’intensité de ce qui se joue dans ce triangle est à recommencer.
Dans les interstices de sa vie de tournages, la grande Actrice se retrouve souvent devant un autre objectif, celui des photographes qui obtiennent d’elle des séances de pose.
Ils ont toujours été très nombreux. Ce n’est pas à son corps défendant car c’est une collectionneuse, voire une croqueuse de regards. Une exposition et un livre – La femme aux portraits – ont rassemblé en 2005 une centaine de photos, parmi les dizaines de milliers où elle a posé pour les meilleurs photographes du monde[1]. Tout ce qui compte comme auteurs dans la photographie, depuis les années 70, a voulu attraper d’elle une image où il l’apprivoiserait à son propre style. Un auteur, en photographie comme en cinéma, est quelqu’un qui intègre son modèle dans des images qui portent le sceau de son style, de son imaginaire esthétique, celui d’une vision qui n’appartient qu’à lui. L’opération n’est pas si facile avec elle. Elle a une capacité de résistance photographique à toute « épreuve ».
Avec l’Amie Photographe, le temps de l’échange n’est plus délimité en tranches étanches, en séquences figées, closes sur elles-mêmes. Ce que la Grande Actrice aime dans cette relation c’est que même après de longs moments de pause, parfois des mois, elle sait qu’elles vont se retrouver un jour ou l’autre, ici ou ailleurs, que la séance va reprendre, que rien ne s’arrête ni ne se fige jamais entre elles. Leurs retrouvailles photographiques sont des moments parmi d’autres, dans leurs propres vies, où l’alibi événementiel (un festival, une séance d’essayage de costumes, un voyage, etc.) compte finalement moins que cette continuité de leurs échanges. Cette longue séance n’est jamais interrompue, seulement suspendue de temps en temps.
Dans cette permanence en pointillés de leur relation photographique, chacune est devenue libre de son rôle. Aucun surmoi ne régit le jeu qu’elle vont improviser ensemble à chaque nouvelle retrouvaille, avec la légèreté de ces moments où personne n’a plus peur de l’autre, où personne ne sent plus le besoin de prouver quoi que ce soit à l’autre, où les deux sont justes visiblement heureuse de retrouver et de conforter un lien d’amitié photographique. Entre elles, les problèmes de style ou de pouvoir ne se posent plus depuis longtemps. L’Amie Photographe n’a plus besoin de marquer de son autorité ces images qui sont réellement partagées, où la frontière entre la pose et l’improvisation est souvent indécelable. La connivence, qui est un mot usé, reprend ici son sens original de « laisser faire » : laisser entre elles les image se faire, sans forçage d’aucune sorte.
Dans la vraie vie, elles n’ont pas pu être amies d’enfance, mais quand elles se retrouvent, elles se rejoignent pourtant dans cette nostalgie que deux femmes peuvent avoir d’une enfance parallèle, sinon commune. La Grande Actrice, un jour, emmène l’Amie Photographe dans la maison qui a été celle de son enfance. C’est une exception, car elle veille soigneusement à séparer de façon étanche la femme privée et la femme publique. Sait-elle à ce moment-là que Carole C. a été une photographe de 14 ans ? Pas une adolescente qui fait des photos mais une vraie photographe, avec un projet précis, rigoureux, où est déjà constitué son rapport photographique aux autres et au monde. Elle a commencé en Seconde à photographier ses amies de lycée – les plus belles précise-t-elle-, dans des coins de la grande maison familiale. Pas dans l’espace commun de la famille mais dans des cachettes à elles, des cabanes imaginaires, des espaces dérobés au collectif de la vie familiale.

Il reste quelque chose de ce jeu d’adolescentes dans leur plaisir à trouver, où qu’elles soient, des petits espaces dérobés dans les grands espaces collectifs des lieux de travail : les loges, les chambres d’hôtel, les couloirs. Elles partagent aussi la nostalgie des maisons perdues de l’enfance, dont la photographe a fait un de ses sujets obsédants.
L’Amie Photographe accompagne parfois la Grande actrice en voyage. Photographier quelqu’un en voyage, c’est souvent en saisir une image exotique, comme si quelque chose de l’identité de la personne avait forcément changé dans cet autre pays, dans ce nouveau décor. L’Amie Photographe continue à la regarder comme elle l’a toujours fait, comme si rien de leur relation n’était différent dans ce nouveau contexte. Au contraire, tout se passe comme si le fait d’être hors de leurs territoires habituels les rendait plus proches. Dans ces photos d’ailleurs, rien de pittoresque : des sites ordinaires où l’atmosphère d’un pays est plus palpable que dans les points touristiques ou symboliques. Elles préfèrent les lieux aux noms communs : la rizière, la rue, etc.
En Chine, au Brésil, le dépaysement affecte peu l’image de la Grande Actrice. Elle habite les rues de la Chine comme elle habite Paris. C’est aussi que la relation entre elle et sa photographe est solidement tissée, et sa continuité plus forte que la rupture que pourrait constituer un déplacement de quelques milliers de kilomètres. Il doit y avoir quelque chose de rassurant, pour la Grande Actrice, d’être sous la permanence de ce regard qui continue à la regarder partout dans le monde avec le même calme, la même disponibilité, la même attention douce. Les seules photos de ce livre avec un contrechamp sur les admirateurs ont été faites en Chine où étrangement les silhouettes des jeunes filles sont très proches de celle de l’actrice, comme des doubles multiples et anonymes. L’une d’elle porte même fortuitement un tee-shirt à rayures et des lunettes.
Dans un des milliers de feuillets qui ont été retrouvés dans les malles de son appartement, Pessoa écrit :
« L’immense série de personnes et de choses qui constitue le monde est pour moi une galerie de tableaux sans fin, dont l’intérieur ne m’intéresse pas. Il ne m’intéresse pas, parce que l’âme est monotone, et toujours la même chez tout le monde; seules en diffèrent les manifestations individuelles, et la meilleure part en est ce qui déborde vers le songe, dans l’allure, les gestes, et pénètre ainsi dans le tableau qui me séduit… »
Il est de grands photographes qui se sont donné le projet, ambitieux, de réussir une image où serait visible « l’âme » du photographié, pour parler comme Pessoa. Certains y sont parfois parvenu, mais l’âme étant monotone ne s’attrape pas deux fois. Il leur faut donc changer sans cesse de modèle. La grande Actrice et l’Amie Photographe ont fait le choix opposé, celui de jouer à deux, le plus souvent possible, sans le moindre surmoi, avec ce qui «déborde » de la fameuse « âme », ce par quoi elle se manifeste sous mille formes labiles et chatoyantes, sans peser, sans jamais s’enkister, sans intimidation de la profondeur : la rêverie, les gestes, les déguisements, les regards, les doubles, la malice, les métamorphoses. Elles ont tissé ainsi, tranquillement, au fil du temps, ce qui est sans doute le portrait le plus juste et le plus vrai de l’Actrice multiple qui a nom Isabelle Huppert. Alain Bergala
Carole Bellaïche : Isabelle Huppert du 15 Novembre au 17 janvier
Galerie XII
14 rue des Jardins Saint Paul
75004 Paris
https://www.galerie-photo12.com/





















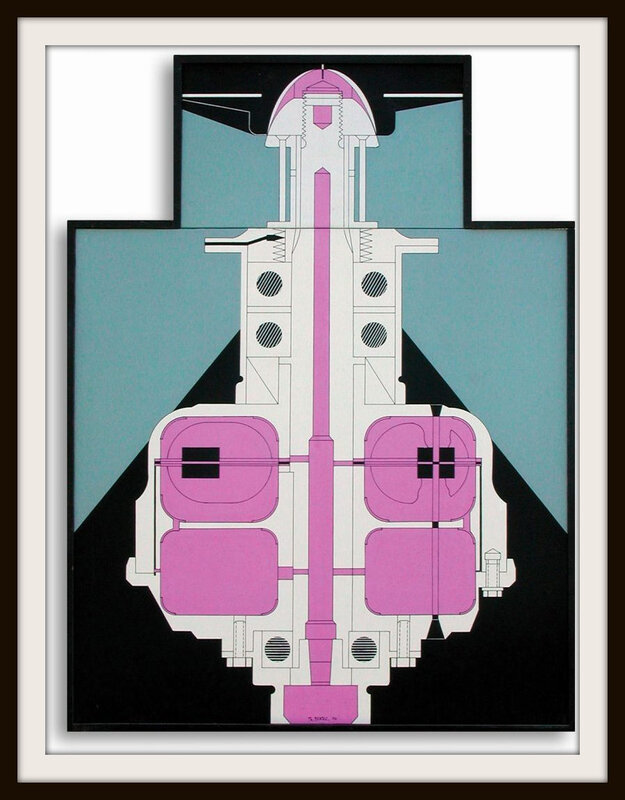




























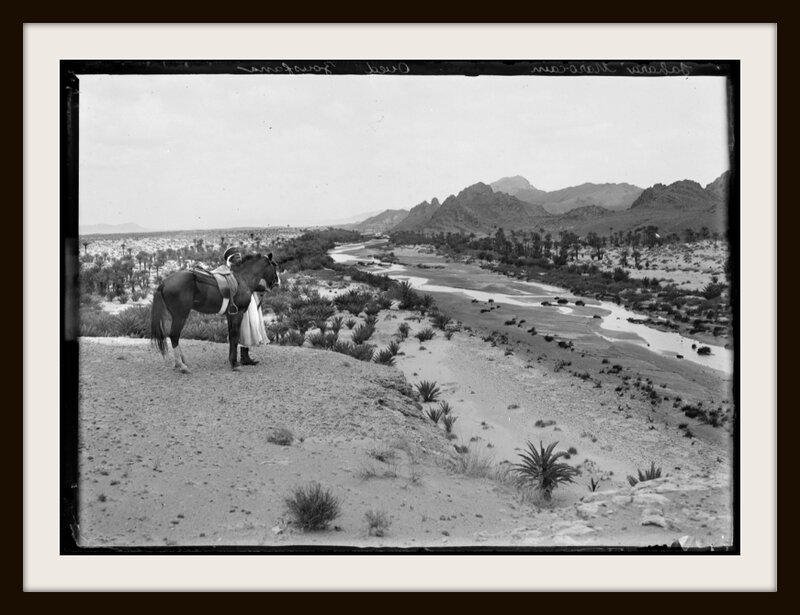




/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)