Les musées face au défi de la surfréquentation
Par Nicole Vulse
Billets préréservés, multiplication des points d’entrée, recours à la mécanique des fluides... certains établissements, comme le Louvre ou La Villette, s’adaptent à des affluences record. Une politique du chiffre qui peut se révéler contre-productive.
La Joconde trône à nouveau dans sa vitrine, réinstallée depuis quelques semaines dans la salle des Etats rénovée, au premier étage du célèbre musée du Louvre. Son sourire énigmatique draine un tel public que Jean-Luc Martinez, le président-directeur du musée, a renoncé à faire figurer la toile dans l’exposition Léonard de Vinci, qui a ouvert ses portes jeudi 24 octobre.
Au total, « 30 000 visiteurs en moyenne viennent voir La Joconde » quotidiennement, explique M. Martinez. Pour l’exposition organisée jusqu’au 24 février 2020, à l’occasion du 500e anniversaire de la mort du maître florentin (1452-1519), il ne s’attend « qu’à » 5 000 personnes par jour.
Au cœur de l’été, quand l’icône du Louvre était provisoirement accrochée salle Médicis, il fallait compter au minimum une heure, parmi un flot ininterrompu de touristes, avant de l’atteindre. Cela reste vrai. En plusieurs langues, des panneaux préviennent : « Chacun a envie de rencontrer La Joconde. Merci de faciliter la visite en restant un bref moment. » Deux gardiens postés devant la plus célèbre toile du musée, peinte sur un panneau de bois de peuplier, font de grands moulinets avec leurs bras pour que les visiteurs ne s’attardent pas trop longtemps devant ce qui constitue bien souvent le clou de leur visite à Paris.
« Go ! Go ! Move on ! [Allez, allez, avancez !] », leur intiment-ils. En moyenne, les spectateurs passent cinquante secondes face à cette œuvre. Le temps de prendre plusieurs selfies. Une minorité conserve son téléphone dans la poche. A la sortie de l’exposition De Vinci, le public a dorénavant la possibilité de scruter plus en détail le portrait de la Joconde, grâce à un casque virtuel.
Si le Louvre, indétrônable numéro un des musées de l’Hexagone en matière de fréquentation, se félicite d’avoir atteint 10,2 millions de visiteurs en 2018 (+ 25 % par rapport à 2017), faut-il vraiment s’en réjouir ? Tout est fait pour attirer un public toujours plus nombreux, quitte à inviter les chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z à créer leur parcours d’œuvres choisies.
« Ce n’est ni du marketing ni une opération financière », tempère Jean-Luc Martinez. Il n’empêche : la politique du chiffre, devenue l’alpha et l’oméga de beaucoup de musées pour doper leurs ressources propres, peut nuire aux visiteurs, et même aux œuvres. « Le tourisme est un phénomène sociétal du XXIe siècle », assure M. Martinez. Un fléau ? « Non, c’est une chance ! » rétorque-t-il. Désormais, il n’est pas de tourisme sans musée, sans selfie devant une œuvre phare. « Pour moi, la question reste celle de la qualité de l’expérience du visiteur », affirme le patron du Louvre.
Course à l’audience
Accueillir de telles foules nécessite certains aménagements. Depuis peu, les musées recourent aux réservations en ligne. Le Louvre a démarré avec l’exposition consacrée au peintre néerlandais Vermeer, en 2017. Pour De Vinci, les billets sont en vente depuis quatre mois. Le Centre Georges-Pompidou propose, pour la première fois, des billets horodatés pour l’exposition sur le peintre britannique Francis Bacon, qui se tient jusqu’au 20 janvier 2020.
« Nous avons assoupli le système, en gardant la possibilité de réserver sur place. Au lieu de trois files d’attente successives, il n’y en a plus qu’une, au sixième étage, et le temps d’attente excède rarement la demi-heure », observe Serge Lasvignes, président du Centre Georges-Pompidou. A la tour Eiffel (6 millions de visiteurs l’an dernier, soit autant qu’au château de Versailles), 50 % des billets sont prévendus à des horaires non modifiables, « ce qui a réduit de trente minutes le temps d’attente en haute saison », souligne-t-on à la Société d’exploitation de la tour Eiffel.
De même pour Toutânkhamon, le trésor du pharaon, à la Grande Halle de La Villette, qui a explosé cette année les records de fréquentation pour une exposition en France (1,4 million de spectateurs en six mois), les tickets étaient valables une demi-heure et les visites s’échelonnaient… jusqu’à minuit. Impossible de venir sans avoir réservé. « La jauge maximale a été cantonnée à 400 personnes », rappelle Didier Fusillier, président du parc et de la Grande Halle de La Villette. Les 155 œuvres n’étaient pas accrochées au mur, « afin d’éviter des files indiennes », mais au milieu des salles, « pour permettre aux spectateurs de tourner autour ».
Comment canaliser le flot du public ? Tel est l’enjeu central. Les musées font appel à des spécialistes de la mécanique des fluides, comme dans les gares ou les aéroports. Multiplier les accès et les portes d’entrée, malgré les mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate, permet de réduire les files d’attente. Pour désengorger l’accès par la Pyramide, M. Martinez envisage deux nouvelles entrées, cour Lefuel et dans le Jardin de l’infante. De même à Beaubourg (où se sont rendues 3,5 millions de personnes en 2018), les travaux sur la Piazza visent à créer cinq entrées dans un an, contre trois aujourd’hui.
L’INJONCTION DES POUVOIRS PUBLICS AUX MUSÉES D’AUGMENTER LEURS RECETTES DE BILLETTERIE SOULÈVE DES QUESTIONS
Certains établissements rivalisent d’inventivité pour juguler l’affluence. Dans la tour de Londres, un tapis roulant évite l’encombrement devant les vitrines des couronnes d’Angleterre. Plus prosaïquement, au Musée des beaux-arts de l’Ontario, à Toronto (Canada), un gardien, chronomètre en main, accorde soixante secondes – pas une de plus – à quatre visiteurs pour voir l’installation de l’artiste japonaise Yayoi Kusama.
Pourquoi une telle course à l’audience ? L’injonction des pouvoirs publics aux musées d’augmenter leurs recettes de billetterie (qui représentaient 35,2 % du budget du Louvre et 13,4 % de celui du Centre Pompidou en 2018) soulève des questions. M. Lasvignes est l’un des rares à lancer à haute voix : « Jusqu’à quand va-t-on se soucier des chiffres de fréquentation ? Nous produisons des expositions qui visent une relecture critique de l’art moderne et contemporain ». Et d’ajouter : « Si nous avions la fréquentation pour seul critère, nous ferions en boucle des monographies de David Hockney, Marc Chagall et René Magritte »…
Appel à des sémiologues
Lui se félicite de l’exposition Préhistoire, une énigme moderne, organisée du 8 mai au 16 septembre, même si elle n’a rassemblé « que » 290 000 visiteurs. Financièrement, les dépenses y ont été mieux maîtrisées et la marge s’est révélée bien supérieure à celle des expositions blockbusters. A titre d’exemple, la monographie de l’Américain Jeff Koons, extrêmement onéreuse, s’est avérée déficitaire.
Les grandes expositions coûtent également des fortunes en assurances (jusqu’à un milliard d’euros pour l’exposition Toutânkhamon à La Villette, par exemple). L’établissement public a dû investir massivement dans la sécurisation des portes et la climatisation. « Les recettes seront partagées avec le ministère des antiquités égyptiennes, la société américaine IMG [spécialisée dans les événements sportifs et artistiques à gros budget] et La Villette », indique M. Fusillier. Fait notable, Toutânkhamon démontre que, même avec un prix d’entrée très cher (le billet sans réduction s’élevait à 24 euros), le public peut être massivement au rendez-vous.
Cela prouve que les icônes feront toujours rêver. Même le président du Centre Pompidou regrette de ne pas avoir d’« œuvres aimants », à l’instar de La Joconde (70 % des visiteurs du Louvre disent souhaiter la voir), de La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh au MoMa de New York, ou encore de Guernica au Musée Reina-Sofia de Madrid. Des œuvres qui, à elles seules, méritent une visite et permettent à ces établissements de réaliser des expositions plus scientifiques, militantes ou complexes.
M. Lasvignes a fait appel à des sémiologues pour définir « la » liste des œuvres les plus emblématiques des collections, destinée à mieux faire connaître Beaubourg auprès des touristes. Les Chinois, par exemple, ne représentent que 1 % des visiteurs. Un parcours d’une quinzaine de « very important pieces » (VIP), fléché dans les collections, comprendra ainsi les Bleu I, II et III de Joan Miró, La Muse endormie de Constantin Brancusi, La Blouse roumaine d’Henri Matisse, Les Loisirs de Fernand Léger, Avec l’arc noir de Vassily Kandinsky ou encore Sculpture éponge bleue d’Yves Klein… Déjà en 1910, le patron du Louvre avait envisagé un miniparcours pour les touristes pressés, en juxtaposant les stars La Vénus de Milo, Les Esclaves de Michel-Ange et La Joconde, avant d’abandonner cette idée politiquement incorrecte.
Faut-il cyniquement jouer les faux pour remplacer les vrais ? Le Musée du Belvédère, à Vienne (Autriche), propose aux visiteurs de faire un selfie devant une reproduction de son tableau le plus emblématique, Le Baiser, de Gustav Klimt. Bon nombre de visiteurs s’en contentent et ne vont pas voir l’authentique. Le Louvre a tenté l’expérience cet été avec La Joconde, mais le public n’a pas mordu à l’hameçon. Beaubourg vient d’installer un Photomaton qui permet de choisir une œuvre du musée en toile de fond.Pour aiguiser l’attention du public, la chaîne culturelle britannique Sky Arts avait proposé en 2016 un jeu, en remplaçant sept chefs-d’œuvre outre-Manche par des copies dans des musées de Londres, Manchester, Edimbourg, Liverpool et Cardiff. Le public non averti n’y a vu que du feu.
Alors, faut-il copier les œuvres pour les diffuser ailleurs ? M. Fusillier a mis en place des « Micro-Folies », des petits espaces modulables installés provisoirement dans des zones rurales ou en banlieues pour y projeter La Joconde en haute définition et sur écran géant. La première a été ouverte à Sevran, en Seine-Saint-Denis. L’idée n’est pas nouvelle. Henri Matisse raconte, dans Bavardages : les entretiens égarés (Skira, 2017), qu’il copiait des œuvres du Louvre lorsqu’il était élève de Gustave Moreau, avant 1897, en espérant être acheté un jour par la commission d’achat qui envoyait ces fac-similés dans les musées de province…



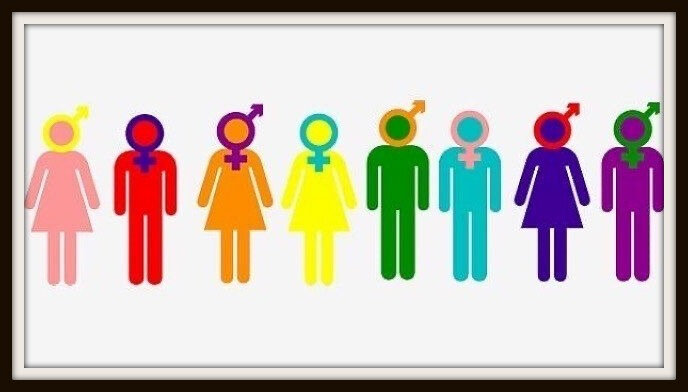
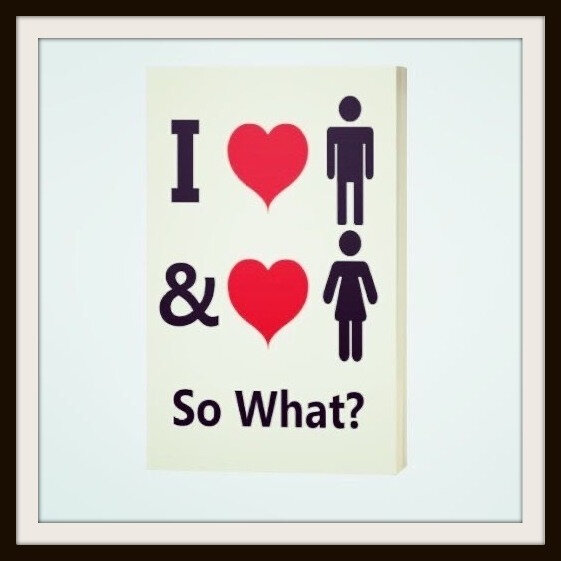

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)