Par Gilles Paris, Washington, correspondant
Correspondants de presse (4/12). A Washington, le journaliste du « Monde » Gilles Paris a vu disparaître les traditionnels briefings de presse et se multiplier les interventions du chef de l’Etat. Avec une difficulté majeure : parvenir à le comprendre.
Récit. Ce matin de juillet, la salle de presse de la Maison Blanche suinte l’ennui. Le soleil qui torréfie la pelouse nord de la bâtisse présidentielle rend la pièce, aveugle sur trois des quatre murs, encore plus terne. Cette star des innombrables films et séries inspirés de la politique américaine affiche une tristesse de délaissée.
Le podium, qui n’a plus accueilli de porte-parole depuis mars, sert de dépôt pour des trépieds de caméras. Le pupitre derrière lequel les visiteurs, naguère, résistaient rarement à se faire prendre en photo, n’est que l’ombre de lui-même. Un technicien d’une chaîne de télévision s’est assoupi sur l’un des strapontins latéraux occupés naguère par les assistants de la porte-parole Sarah Sanders, voire par la conseillère Kellyanne Conway.
Je l’avoue : assister à mes premiers briefings, à l’automne 2014, provoquait en moi de la jubilation. Après avoir visionné en rafale les saisons de la série West Wing (A la Maison Blanche) à la veille de mon départ, même si la reconstitution de la salle de presse y est incroyablement ratée, du moins à ses débuts, j’ai le sentiment de participer à chaque fois au tournage d’un nouvel épisode.
Le sérieux compassé du dernier porte-parole de Barack Obama, Josh Earnest, infiniment courtois face au pilonnage d’Ed Henry, journaliste de la chaîne conservatrice Fox News, y contribue. On s’y ennuie souvent avec politesse. Le porte-parole arrive avec un classeur bourré d’éléments de langage. Il a la parade à toute question, s’entraînant au préalable avec le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Ned Price.
Sous-titres indispensables
Le « Obama no drama » tient ses promesses. Trop. On se sent en territoire familier jusqu’à ce qu’une référence populaire, dont je n’ai aucune idée, fasse réagir la salle en me laissant de marbre. Je tente d’habiller des plus beaux atours de la concentration un sentiment crasse d’incompréhension, comme le jour où est mentionné un « snafu » procédural (acronyme de « Situation Normal : All Fucked Up » : « Tout va bien, c’est le bordel ! ») à l’occasion d’un épisode délicat de la ratification d’un traité de libre-échange auquel les démocrates ne veulent pas de bien.
La familiarité est toujours un peu illusoire lorsqu’on n’a pas vécu durablement aux Etats-Unis avant d’y travailler. Lors d’un reportage après une nuit d’émeutes dans un quartier pauvre de Baltimore (Maryland), consécutive au décès suspect d’un Afro-Américain aux mains de la police municipale, je me retrouve au milieu d’un groupe de jeunes Noirs particulièrement remontés. Je leur demande de répéter une fois, deux fois les raisons de leur colère avant de faire piteusement mine de les comprendre.
Il est vrai que les sous-titres m’ont été indispensables pendant les cinq saisons de la série The Wire, tournée dans la même ville. J’éprouve la même impuissance mordante, plus tard, quand je suis confronté à l’accent texan d’un oilman gestionnaire de « strippers », ces puits au faible débit délaissés par les grandes compagnies.
« LA SALLE DE PRESSE DÉSERTÉE EST DEVENUE, PAR DÉFAUT, L’ESPACE DE COWORKING LE PLUS BAROQUE DE LA CAPITALE FÉDÉRALE »
Cette familiarité, la salle de presse de la Maison Blanche la perdra, dépouillée de sa raison d’être, avec l’arrivée de Donald Trump, et plus précisément avec la décision de Sarah Sanders de rompre avec cet exercice démocratique. Un choix que sa successeure, Stephanie Grisham, arrivée en juillet, ne remet pas en cause pour l’instant.
La pièce est devenue, par défaut, l’espace de coworking le plus baroque de la capitale fédérale. Abandonnés par leurs titulaires faute de briefings, les fauteuils attribués naguère de haute lutte aux titres les plus prestigieux sont littéralement squattés par les journalistes de passage qui ne disposent pas des cagibis misérables et sans fenêtre réservés aux agences et aux chaînes de télévisions, à l’arrière de la salle. C’est là que travaillent les permanenciers, dans un environnement qui provoquerait certainement l’immolation en signe de protestation outrée du comité d’hygiène et de sécurité, s’il en existait un dans ces lieux.
La fin des briefings laisse en outre le journaliste étranger démuni face à un redoutable défi : la traduction du président. Les difficultés commencent très vite avec Donald Trump. Dès la deuxième minute de sa déclaration de candidature à l’investiture présidentielle, le 16 juin 2015. On a alors buté sur une image peu flatteuse qu’il a inventée pour ses rivaux républicains : « They sweated like dogs »… Quatre mots qui méritaient un paragraphe pour faire le tour de la virulence et de l’implicite : la comparaison animale, d’autant plus déconcertante que les chiens ne sont pas réputés pour leur hyperhidrose, bien au contraire ; la dimension olfactive ; le malaise, le sentiment de faute lié à cette sudation ; le souvenir du premier débat télévisé opposant Richard Nixon et son front perlé à John Kennedy, en 1960.
« Great people », « fantastic city »…
On ne s’est jamais vraiment habitué, depuis, aux codes d’une intervention de Donald Trump lorsqu’elle n’est pas encadrée par les écrans translucides des téléprompteurs. Tout d’abord l’absence de construction, voire l’absence de phrases en bonne et due forme. Le magnat de l’immobilier progresse par saccades, en juxtaposant des arguments parfois sans rapport direct les uns aux autres.
Un outil journalistique efficace est en effet l’extrait de discours, le verbatim. Il permet de placer le lecteur peu familier avec l’anglais – et qui aurait échappé par miracle à l’omniprésence des chaînes d’information et surtout de YouTube –, de plain-pied avec un acteur politique, de plonger dans ses mots. Or Donald Trump résiste au verbatim. Tout d’abord parce que l’hyperbole disruptive dont il émaille ses propos est presque intraduisible : ces « great people », « fantastic city », « very special » qui reviennent en boucle ont rarement des équivalents convaincants.
Le président affectionne également les incises qui s’étirent en longueur comme les lacets d’un sentier de montagne, éloignant l’auditeur du sujet de départ, jusqu’à le perdre.
Qu’est-ce qui a bien pu pousser Trump à rendre ex abrupto un long hommage dans le bureau Ovale à un champion automobile de légende, Roger Penske, le 20 juin, à l’occasion d’une visite du premier ministre canadien Justin Trudeau, alors que le monde entier se demandait si les Etats-Unis allaient riposter à la destruction par l’Iran d’un drone d’observation américain ? Pour garder le cœur d’une formule, il faut couper et retrancher l’accessoire, en constellant la phrase de ces indications de coupe : (…) qui donnent furieusement, in fine, l’impression au lecteur d’une parole présidentielle triturée.
Enfin, et surtout, Donald Trump pratique par allusion, en s’appuyant sur les mots-clefs dont le contenu est jugé immédiatement compréhensible par son auditoire, alors qu’il nécessite une rafale de notes de bas de page pour un lecteur étranger. Il raffole des « they » qui peuvent alimenter parfois les interrogations sur leur identité. Il considère enfin que son auditoire connaît de longue date les idées qui structurent sa vision du monde depuis sa première tentative d’entrée en politique, en 1987, et qui ont effectivement peu varié.
LA PRESSE S’EST RÉSIGNÉE À CE PRÉSIDENT OMNIPRÉSENT ET INSAISISSABLE, QUI ASSURE SA COMMUNICATION Y COMPRIS SUR LA PELOUSE DE LA MAISON BLANCHE, AVANT D’EMBARQUER DANS SON HÉLICOPTÈRE
Car c’est un autre trait des interventions du président : elles utilisent le même registre réduit de termes considérés par lui comme interchangeables dont le sens dépend plus que de coutume du contexte dans lequel ils sont prononcés.
En août 2017, Donald Trump évoque sur Twitter la « beautiful Heather Heyer », militante antiraciste tuée à Charlottesville (Virginie) par un sympathisant d’extrême droite. « Beautiful » comme les statues de figures confédérées ainsi qualifiées une semaine plus tard dont la même Heather Heyer combattait la permanence. « Beautiful » comme un projet de loi sur la santé, ou encore un sommet du G20, quelques jours plus tôt.
La formule « smart guy » (un gars intelligent) n’est pas la même lorsqu’elle est prononcée devant la rédaction du New York Times ou lors d’un meeting de campagne devant un public de cols-bleus. Mais comment trancher avec certitude et affecter la complicité bonhomme au second cas et l’éloge des facultés intellectuelles au premier ? Comment être sûr qu’il ne s’agit pas de l’inverse ?
L’intraduisible règne aussi régulièrement en maître lorsque Donald Trump enclenche sur son clavier de téléphone la touche commandant les majuscules. Et lorsqu’il ponctue ses sentences de points d’exclamations.
La presse accréditée s’est résignée à ce président omniprésent et insaisissable, qui assure sa communication y compris sur la pelouse sud de la Maison Blanche, lorsqu’il s’apprête à embarquer à bord de l’hélicoptère présidentiel en direction de la base militaire d’Andrews. Le bruit assourdissant des moteurs de Marine One et l’odeur entêtante de kérosène font alors regretter l’ancienne piscine intérieure reconvertie sous Richard Nixon en salle de presse, désormais inutile.






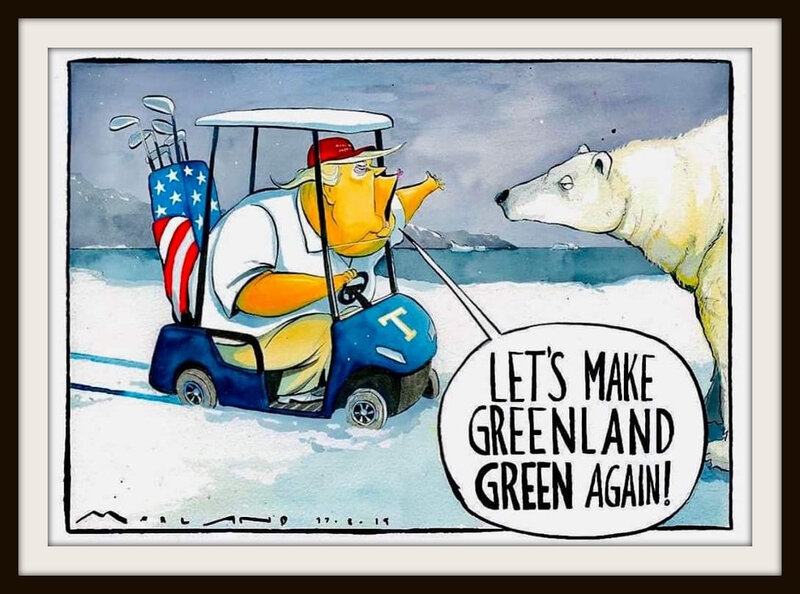


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)