Jean Paul Gaultier haute couture printemps-été 2019, à Paris, janvier 2019.
Jean Paul Gaultier s'est inspiré de la mer et du Japon pour une collection graphique toute en "légèreté et transparence". Sur le podium, la pin-up et effeuilleuse américaine Dita Von Teese et Anna - la fille de Pat Cleveland top-model star des seventies - qui présente la robe de mariée longue blanche et transparente d'inspiration japonaise. Cette mariée "est une tornade, un ouragan et en même temps elle est en elle seule un poème", s'émerveille le couturier. Sans oublier Coco Rocha, professionnelle de la danse irlandaise, en robe cage d'organza turquoise. Bleu, vert, corail - les couleurs et les motifs sont inspirés de la vie aquatique pour cette collection qui porte aussi un message écologique : "les choses sont belles et on ne tue pas les animaux pour autant", souligne le couturier qui s'est engagé à renoncer à la fourrure. Les motifs japonais apparaissent dans des Obi, ceintures de kimono revisitées, et des ceintures "îlots" plissées. "Je voulais que tout soit plissé, même les cheveux", dit le couturier qui a envoyé une invitation plissée pour son défilé. "Je les voulais comme ceux de geisha, avec un effet après amour qui est très beau", souligne-t-il encore.
Médias : une haine qui vient de loin
Par Jean-Baptiste de Montvalon
Depuis sa naissance officielle, en 1631, le journalisme suscite l’envie autant que le mépris. Des gazettes aux réseaux sociaux, retour sur une éternelle défiance.
« Journalistes, collabos ! » Ce slogan, que des « gilets jaunes » ont scandé devant le siège de plusieurs médias lors de récentes manifestations parisiennes, aurait pu tout aussi bien sinon – mieux – résonner dans les rues de la capitale en 1631. On imagine la scène : des rédacteurs de La Gazette pris à partie, agressés, menacés ; leur patron, Théophraste Renaudot, séquestré dans son bureau ; et le titre empêché de paraître.
Rien de tel n’est arrivé au premier périodique français. Créé par privilège du roi, détenteur d’un monopole d’Etat et organe officieux de Richelieu, cet hebdomadaire de quatre pages, au tirage oscillant entre 300 et 800 exemplaires, était pourtant bel et bien un journal de cour. Ce dont il ne se cachait guère : bien plus tard, en 1762, lorsqu’il devint la Gazette de France, il prit pour sous-titre « Organe officiel du Gouvernement royal ».
L’année 1631 marque symboliquement la naissance officielle du journalisme. Et de son « péché originel », selon l’historien Christian Delporte : celui d’être « un contre-pouvoir complètement dépendant des pouvoirs ». Soit l’une des nombreuses critiques, parfois fondées, qui se sont abattues de tout temps sur le métier. « Aucune profession n’est plus décriée que celle de journaliste, aucune n’est plus flagornée », constate Robert de Jouvenel en 1914 dans La République des camarades (Editions des Equateurs, 2014).
Menacés et agressés
Dans L’Invention du journalisme en France (Plon, 1993), l’ancien directeur de la rédaction du Monde Thomas Ferenczi note que, depuis 1631, « la presse française encourt régulièrement les mêmes reproches ». « Les critiques, souligne-t-il, n’ont pas cessé quand la profession, à la fin du XIXe siècle, est devenue plus respectable. » Et « au XXe siècle, la sentence n’a pas été révisée », ajoute-t-il, notant qu’« elle reste marquée par la longue expérience du passé ».
Le début du XXIe siècle est, de ce point de vue, dans le droit fil de ceux qui l’ont précédé. Avec une bien triste et préoccupante « innovation » : les journalistes n’ont plus seulement été critiqués ces dernières semaines, plusieurs de ceux qui couvraient les manifestations ont aussi été menacés et agressés physiquement ; par les forces de l’ordre comme par certains « gilets jaunes ».
Une telle continuité dans la détestation interroge, quand bien même la presse aurait souvent prêté le flanc à la critique. Qui aime bien châtie bien : l’importance vitale de l’information, et donc la lourde responsabilité de ceux qui sont chargés de la transmettre, sont probablement le fil conducteur de cette histoire d’une défiance que l’on ne fera qu’esquisser ici. A tout prendre, elle valut mieux que l’indifférence.
La presse, à ses débuts, ne s’adressait qu’aux élites. Les seules instruites. A elles étaient destinées des considérations sur la littérature, à peu près le seul domaine que la censure de l’Ancien Régime avait laissé à la presse. Ce sont ses lecteurs, ces élites, qui lui ont décoché les premières flèches, et non les moins acérées. Pour les philosophes des Lumières, les journaux ne sont que le pâle reflet d’un vernis de savoir. Ils règlent leur compte à ces plumitifs et autres folliculaires en quelques sentences, évidemment fort bien ciselées. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772) expédie journaux et journalistes en peu de lignes où tout est dit : le mépris qu’ils inspirent aux savants auteurs de cet ouvrage monumental.
« UN BON GAZETIER DOIT ÊTRE PROMPTEMENT INSTRUIT, VÉRIDIQUE, IMPARTIAL, SIMPLE ET CORRECT DANS SON STYLE ; CELA SIGNIFIE QUE LES BONS GAZETIERS SONT TRÈS RARES. » VOLTAIRE
Voltaire se charge des entrées « Gazetier » et « Gazette », où il tire à vue. « Un bon gazetier, écrit-il, doit être promptement instruit, véridique, impartial, simple et correct dans son style ; cela signifie que les bons gazetiers sont très rares. » Quant aux « gazettes littéraires », il note que « la plupart ont été faites uniquement pour gagner de l’argent ; et comme on n’en gagne point à louer des auteurs, la satyre fit d’ordinaire le fonds de ces écrits. On y mêla souvent des personnalités odieuses ; la malignité en procura le débit ; mais la raison et le bon goût qui prévalent toujours à la longue les firent tomber dans le mépris et dans l’oubli. »
« Une efflorescence, un jaillissement »
Ajoutons, pour faire bonne mesure, la « définition » un tantinet lapidaire donnée par Jean-Jacques Rousseau d’un journal, en 1755. Il ne s’agit, écrit-il, que d’assez peu de chose : « Un ouvrage éphémère, sans mérite et sans utilité, dont la lecture, négligée et méprisée par les gens lettrés, ne sert qu’à donner aux femmes et aux sots de la vanité sans instruction, et dont le sort, après avoir brillé sur la toilette, est de mourir le soir dans la garde-robe [le cabinet de toilette]. »
Méprisée par ceux auxquels elle est destinée : on aurait pu espérer pour la presse une meilleure entrée en matière. Au moins l’enjeu n’est-il pas considérable. Car « aux XVIIe et XVIIIe siècles, la presse n’est pas un lieu de débat », rappelle Claire Blandin, professeure de sciences de l’information à Paris-XIII et historienne des médias.
Il en ira tout autrement à compter de la Révolution française, qui marque « la vraie naissance de la presse », comme le souligne Christian Delporte. A partir de la décision du Conseil d’Etat du roi, le 5 juillet 1788, de convoquer les Etats généraux, périodiques et pamphlets prolifèrent. « On assiste à une efflorescence, un jaillissement qu’on n’a jamais connu en France ni auparavant ni jamais depuis lors (même au moment de la Libération) », écrit Jean-Noël Jeanneney dans son Histoire des médias (Seuil, 1996). « Plus de 200 imprimeurs sont bientôt au travail à Paris (contre trente-six seulement à la fin de l’Ancien Régime) », précise-t-il.
« La presse française a toujours été liée au pouvoir »
La presse a conquis sa liberté ; théoriquement tout au moins, puisqu’il lui faudra sans cesse se battre (aux avant-postes en 1830 et 1848) pour la préserver ou la reconquérir.
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la proclame : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Le journalisme, on l’a vu, avait frayé avec le pouvoir et la politique dès sa naissance. Il leur est étroitement imbriqué à partir de la Révolution. « Elle met la presse au service de la politique, après de longues années de prudence obligée, et transforme le journaliste en propagandiste », souligne Thomas Ferenczi.
Le fondateur des Révolutions de France et de Brabant, Camille Desmoulins, décrit sa fonction en ces termes : « Aujourd’hui, les journalistes exercent le ministère public ; ils dénoncent, décrètent, règlent à l’extraordinaire, absolvent ou condamnent. » « Le journaliste se veut alors le censeur, l’égal du politique », note Christian Delporte, qui voit là « l’origine de nos éditorialistes ». « La presse française a toujours été liée au pouvoir », ajoute-t-il.
« UN JOURNAL EST « UN OUVRAGE ÉPHÉMÈRE, SANS MÉRITE ET SANS UTILITÉ, DONT LA LECTURE, NÉGLIGÉE ET MÉPRISÉE PAR LES GENS LETTRÉS, NE SERT QU’À DONNER AUX FEMMES ET AUX SOTS DE LA VANITÉ SANS INSTRUCTION, ET DONT LE SORT, APRÈS AVOIR BRILLÉ SUR LA TOILETTE, EST DE MOURIR LE SOIR DANS LA GARDE-ROBE [LE CABINET DE TOILETTE]. » JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Journalistes, écrivains et politiques ont désormais partie liée, au point qu’il est difficile, parfois, de distinguer ces trois fonctions, ou de savoir laquelle l’emporte sur les autres. Le mélange des genres est la règle. Un exemple parmi tant d’autres : Emile de Girardin, qui conçut le principe du quotidien à bon marché visant un plus grand public (La Presse, fondé en 1836), a marqué l’histoire du journalisme. Mais il fut aussi parlementaire – député, sénateur, puis de nouveau député – sous les différents régimes que connut le XIXe siècle.
A la fin du XIXe siècle, la presse s’industrialise
Les écrivains ont beau être parfois hommes de presse, souvent journalistes occasionnels, cela ne les empêche pas, dans la droite ligne des philosophes des Lumières, de viser les journaux d’un feu nourri de critiques élitistes.
Honoré de Balzac (1799-1850) fut particulièrement affûté dans cet exercice. On lui doit quelques formules acérées : « Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai » ; « Le journalisme est une grande catapulte mise en mouvement par de petites haines » ; et la définitive « Si la presse n’existait pas, il faudrait ne pas l’inventer. »
Notamment parce qu’il n’offre pas toujours ce que l’on en attend, tant ces attentes varient, le journalisme n’a jamais eu bonne presse. De tout temps, des voix se sont élevées – le plus souvent dans les journaux eux-mêmes – pour déplorer ses productions, remettre en cause sa légitimité.
C’est une constante. Et chaque évolution du métier s’est accompagnée d’une volée de bois vert. Certaines critiques sont récurrentes. L’éventuelle collusion avec le pouvoir en est une, et non des moindres. La (trop grande) rapidité de l’information en est une autre : du télégraphe aux réseaux sociaux, la technologie a changé, mais la méfiance est la même. A la fin du XIXe siècle, la presse s’industrialise. Les tirages augmentent considérablement.
Trois ans après la loi de 1881 sur la liberté de la presse, Le Matin voit le jour. S’inspirant du modèle anglo-saxon, ce journal entreprend de donner la priorité à l’information, au reportage, aux faits divers, et à l’interview. Il lui sera immédiatement reproché de chercher à séduire de si mauvaise manière un vaste public.
Dans sa préface à La Morasse, en 1888, Emile Zola écrit : « Le flot déchaîné de l’information à outrance a transformé le journalisme, tué les grands articles de discussion, tué la critique littéraire, donné chaque jour plus de place aux dépêches, aux nouvelles grandes et petites, aux procès-verbaux des reporters et des interviewers. »
« SI LA PRESSE N’EXISTAIT PAS, IL FAUDRAIT NE PAS L’INVENTER. » HONORÉ DE BALZAC
Observons le verre à moitié plein. Un genre se construit tant bien que mal ; une profession également, qui prend son autonomie à partir de la fin du XIXe siècle. Des associations prolifèrent à partir de 1880. Le premier congrès international de la presse se tient à Londres en 1893. Une école supérieure de journalisme est créée à Paris en 1899.
Le journalisme devient peu à peu un métier à part entière, qui se détache tant bien que mal de la politique et de la littérature. Mais des affaires de corruption le minent pendant cet essor, révélant la vénalité de journalistes et leur complicité avec des hommes politiques. Pour un Albert Londres, combien de corrompus ? La presse a été le lieu à la fois des plus grands débats (ainsi l’affaire Dreyfus, ponctuée du célèbre « J’accuse… ! » de Zola à la « une » de L’Aurore) et des manigances les plus sordides.
« Le scandale de Panama et les emprunts russes »
« L’argent des affaires entretenait la presse de manière occulte. Ces pratiques s’étaient développées, surtout à partir du Second Empire, dans l’information économique et financière », raconte l’historien Marc Martin dans un article publié en 2006 dans la revue Le Temps des médias. Mais, poursuit-il, « deux épisodes principaux ont ancré le thème dans notre histoire, le scandale de Panama à la fin du XIXe siècle et la révélation, en 1923 et 1924, des sommes versées aux journaux parisiens par le gouvernement du tsar au moment des emprunts russes. »
Dans le premier cas – révélé en 1892 dans le journal d’Edouard Drumont, La Libre Parole –, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama s’est acheté, par des « compromissions » et des « pots-de-vin », « une bonne image et le silence sur ses difficultés. »
En novembre 1923, L’Humanité promet à ses lecteurs des « documents secrets tirés des archives impériales de Russie, et dont la publication portera un coup impitoyable aux forbans de la presse vénale, aux trafiquants de patriotisme, aux professeurs de morale et de vertu officielles, aux charlatans de banque et de Bourse, aux journalistes à vendre, aux parlementaires à acheter ».
« LE JOURNALISME EST UNE GRANDE CATAPULTE MISE EN MOUVEMENT PAR DE PETITES HAINES. » HONORÉ DE BALZAC
Le « bourrage de crâne », pendant la première guerre mondiale, avait sévèrement remis en cause la fiabilité de l’information. Claire Blandin évoque à ce sujet « un divorce complet entre l’opinion publique et les grands médias », avec l’idée que la guerre a « dévoilé une forme de complicité entre les journaux et le pouvoir ».
L’entre-deux-guerres voit la presse osciller de nouveau entre le prestige de quelques grands reportages et d’autres affaires nettement moins reluisantes. « Très brillante et pourrie jusqu’à l’os, la presse est largement stipendiée jusqu’en 1940 », observe Jean-Noël Jeanneney, qui estime que « les journalistes vivaient plus par les papiers qu’ils ne publiaient pas ». La radio se développe, en dépit des critiques d’intellectuels contre « ce média accusé d’abêtir les foules », note Claire Blandin, qui établit un parallèle avec les reproches adressés de nos jours aux réseaux sociaux.
Remise sur pied à la Libération, où l’on a fait table rase des journaux qui ont continué de paraître pendant l’Occupation, la presse fait peau neuve. Le Monde est créé en décembre 1944. Un système d’autorisation est mis en place. Jusqu’en 1947, explique Christian Delporte, « on peut pour la première fois créer un journal sans mise de fonds. Il n’y a ni concurrence ni publicité ». Cet « âge d’or », « parenthèse pleine d’espoir », profite à des journaux d’opinion, avant que la presse d’information reprenne le dessus. « Le tableau de la presse dans les années 1950 et 1960 est plus favorable », note Jean-Noël Jeanneney.
Mainmise gaulliste
La mainmise gaulliste sur l’audiovisuel vient ensuite nourrir l’accusation fort ancienne d’une presse aux ordres du pouvoir. « L’accusation de connivence a perduré jusqu’à aujourd’hui », souligne François Robinet, maître de conférences en histoire contemporaine, qui invoque « une forme de proximité inhérente à la centralité parisienne et à des cursus similaires ».
Le mouvement social de l’hiver 1995, qui vit les grévistes reprocher aux grands médias de privilégier le point de vue du pouvoir, en fut l’un des points culminants. Une pétition « Pour une action démocratique sur le terrain des médias » aboutit, en 1996, à la création du site Acrimed, « Action-Critique-Médias ». Ce regard (très) critique vis-à-vis de la presse – écrite et audiovisuelle – vient s’appuyer sur les arguments du sociologue Pierre Bourdieu, qui publie la même année son essai Sur la télévision (Liber, « Raisons d’agir »).
Deux axes s’en dégagent : la dénonciation des médias comme agents de propagande des pouvoirs économiques et politiques ; et le refus de laisser aux journalistes le monopole du discours médiatique. Un monopole battu en brèche avec l’essor d’Internet et des réseaux sociaux. La concentration des grands médias, rachetés pour la plupart par de riches hommes d’affaires, a par la suite ressuscité le soupçon sinon de la corruption, tout au moins d’une collusion suspecte avec les milieux économiques et financiers.
« LE FLOT DÉCHAÎNÉ DE L’INFORMATION À OUTRANCE A TRANSFORMÉ LE JOURNALISME, TUÉ LES GRANDS ARTICLES DE DISCUSSION, TUÉ LA CRITIQUE LITTÉRAIRE, DONNÉ CHAQUE JOUR PLUS DE PLACE AUX DÉPÊCHES, AUX NOUVELLES GRANDES ET PETITES, AUX PROCÈS-VERBAUX DES REPORTERS ET DES INTERVIEWERS. » EMILE ZOLA
La presse continue de traîner le lourd héritage de son passé. Et des tombereaux de critiques qui lui ont été adressées. Tout cela pèse sur les médias qui ont le plus grand mal à regagner une confiance qui continue de se détériorer. La dernière édition du baromètre du journal La Croix, publié jeudi 24 janvier, a montré qu’elle était au plus bas depuis le lancement de ce sondage en 1987.
Comment répliquer ? Laissons la conclusion à Séverine, née Caroline Rémy (1855-1929). Proche de Jules Vallès, elle fut la première femme à diriger un grand quotidien, Le Cri du peuple. « Notre profession est belle, nécessaire, déclare-t-elle en 1924, mais seulement dans la mesure où nous la faisons telle. Résistez aux puissances d’argent qui nous oppriment ; résistez aux engouements publics ; résistez aux directeurs de journaux. Résistez à vous-mêmes, aux inévitables déformations qui sont le fait du métier, au succès, à certaines griseries… »
Shutdown
C'est la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis. Donald Trump a annoncé, vendredi 25 janvier, avoir conclu un accord avec le Congrès pour mettre fin temporairement à la paralysie des institutions fédérales, qui dure depuis le 22 décembre. Le président américain s'est engagé à signer une loi garantissant le financement de l'administration jusqu'au 15 février.
Dressing Saint Laurent de Catherine Deneuve : la vente bat des records
Les vestiaires Yves Saint Laurent de Catherine Deneuve, ainsi que de la femme d'affaires libanaise Mouna Ayoub, qui font voyager à travers 40 ans prestigieux de l'histoire de la mode, ont été dispersés jeudi aux enchères, totalisant respectivement 900.000 et 400.000 euros (frais inclus).
Chez Christie's, Catherine Deneuve, amie personnelle d'Yves Saint Laurent, qui vient de fêter ses 75 ans, avait remis aux enchères la quasi intégralité de ses vêtements Saint Laurent à la suite de la vente de sa maison en Normandie où elle conservait cette garde-robe.
Quelque 129 lots étaient proposés dans les élégants salons de l'avenue Matignon. Les enchères ont duré cinq heures et 90 % des lots ont vu leurs prix multipliés par rapport au prix de départ. "Cette semaine d'exposition et les enchères elles-mêmes ont dépassé mes attentes. Christie's a rendu hommage au talent d'Yves Saint Laurent en présentant ses créations de manière exquise", s'est félicitée l'actrice.
Une vente qualifiée de "Triomphe" par Christie's France
François de Ricqlès, président de Christie's France, a qualifié de "triomphe" une vente qui "honore deux artistes iconiques français qui sont la gloire de ce pays."
Un ensemble du soir de la prestigieuse collection russe 1977/78 a atteint 52.500 euros, multipliant par dix l'estimation de départ, et devenant ainsi la meilleure vente de ces enchères chez Christie's. Une robe courte à franges brodée de perles de la collection couture printemps-été 1969 que l'actrice avait porté lorsqu'elle avait rencontré Alfred Hitchcock s'est vendue pour 42.500 euros (contre 3/5.000 euros estimés).
Une session online, qui propose 140 autres objets du vestiaire de Catherine Deneuve, s'achèvera le 30 janvier à minuit.
Renault, les contours de l’après Carlos Ghosn s’ébauchent
Jean-Dominique Senard président de Renault (à gauche) et Thierry Bolloré, directeur général, au siège social du groupe, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le 24 janvier. Christophe Ena / AP
Éric Béziat - Le Monde
L’arrivée du duo Senard-Bolloré a été saluée par les dirigeants de Nissan
Entre sourires et gravité, le nouveau duo désigné pour diriger Renault a fait, jeudi 24 janvier, ses premiers pas devant les caméras, quai Alphonse Le Gallo, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le siège du groupe automobile. Quelques minutes plus tôt, le conseil d’administration de l’entreprise avait entériné la toute récente démission de Carlos Ghosn, son PDG, accusé de malversations financières et incarcéré à Tokyo depuis le 19 novembre 2018, dans l’attente de son procès.
Conformément aux souhaits de l’Etat, premier actionnaire du constructeur automobile (15 % des actions et 22 % des droits de vote), les 18 membres du conseil ont pris la décision « d’instituer une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général ». Ils ont nommé Jean-Dominique Senard, président de Michelin, à la présidence de Renault, et l’actuel patron opérationnel Thierry Bolloré au poste de directeur général.
Place donc à une nouvelle ère dont les contours semblent déjà se dessiner. Les administrateurs l’ont clairement stipulé : M. Senard ne sera pas un président de conseil d’administration lambda mais bien un dirigeant missionné pour remettre de l’ordre dans la gouvernance de l’entreprise et dans l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi fortement secouée en deux mois de crise et de scandale.
Il s’agit de confier au nouveau numéro un du groupe au losange « la pleine responsabilité du pilotage de l’Alliance pour le compte de Renault, en liaison avec le directeur général », précise le conseil d’administration dans un communiqué. « Il est important de retrouver une forme de sérénité après les événements tout à fait extraordinaires que nous venons de vivre », a déclaré, en écho aux demandes du conseil, M. Senard, lors de sa première intervention publique.
La nomination de ce dernier a eu des effets immédiats, au Japon, chez l’allié Nissan. Le constructeur nippon a « salué » jeudi dans un communiqué la constitution du tandem. Lors d’une déclaration à la presse, le président exécutif, Hiroto Saikawa, a dit espérer « une meilleure communication » après plusieurs semaines « difficiles » depuis l’arrestation de M. Ghosn. « M. Senard est un excellent homme d’affaires doté d’une grande expérience, avec qui je pense qu’on peut discuter », a-t-il poursuivi.
Signe que le climat est en train de s’apaiser, Nissan a, aussitôt la nouvelle direction Renault nommée, convoqué une assemblée générale en avril, répondant enfin favorablement à une demande insistante de Renault à laquelle, jusqu’ici, la partie japonaise était restée sourde. En retour, Renault espère bien peser sur la future gouvernance de son partenaire nippon. « L’Etat veut l’application de l’accord Rama dans le respect de la gouvernance de Nissan et du pouvoir du conseil d’administration de Renault », indique Bercy.
« Golden goodbye »
En France, même tonalité favorable chez les salariés si l’on en croit les déclarations syndicales. « Nous sortons enfin de ce feuilleton économico-politico-judiciaire et médiatique qui s’est joué au mépris de vingt années d’effort et de coopération des 450 000 salariés de l’Alliance », déclare Mariette Rih déléguée syndicale centrale de FO. « La dissociation est une excellente chose, se félicite Bruno Azière pour la CFE-CGC, premier syndicat du losange. Il y a, d’une part, l’apport d’un regard neuf avec la nomination de M. Senard mais aussi la continuité avec la confirmation de Thierry Bolloré, ce qui permet de conserver une compétence d’entreprise dans la gouvernance. »
A la CFDT, il y a même une forme d’enthousiasme. « La nomination de Jean-Dominique Senard est une bonne surprise pour nous, au regard de son passé d’industriel, de ce qu’il a écrit et théorisé, explique Franck Daout, délégué central syndical CFDT. Il a influencé une bonne partie du contenu de la loi Pacte qui est en ce moment examinée au Parlement. Nos amis de Michelin nous l’ont confirmé : le côté social mis en avant est réel. C’est important à un moment où l’entreprise va avoir besoin d’innovation sociale. »
Mais tous les a priori ne sont pas positifs. « La forme change mais j’ai bien peur que la stratégie reste la même, souligne Fabien Gache, délégué CGT de Renault. Je rappelle qu’à la nomination de Carlos Ghosn, en 2005, les usines françaises réalisaient 53 % de la production européenne de Renault. En 2017, ce n’était plus que 19 %. Dans l’intervalle Renault-France a perdu 22 500 salariés. »
Un sujet pourrait tendre les représentants syndicaux : celui de l’indemnité de départ de Carlos Ghosn. En cumulant les sommes dues au titre de la rémunération variable différée, de la clause de non-concurrence et de la retraite chapeau, les calculs de la CGT ou du cabinet Proxinvest laissent entendre que l’ex-PDG pourrait bénéficier d’un « golden goodbye » supérieur à 25 millions d’euros. « Nous serons très attentifs au sujet, précise M. Azière. Avant que la moindre somme ne soit versée à Carlos Ghosn, nous devrons être sûrs que l’entreprise n’a pas été victime d’une spoliation. »
En attendant, Jean-Dominique Senard, qui reste président de Michelin jusqu’au 17 mai, date de la prochaine assemblée générale, en raison du statut juridique particulier du géant mondial des pneus (société en commandite par actions), a fait savoir dans un communiqué que sa rémunération chez l’industriel clermontois serait fortement revue à la baisse pendant la période de transition.









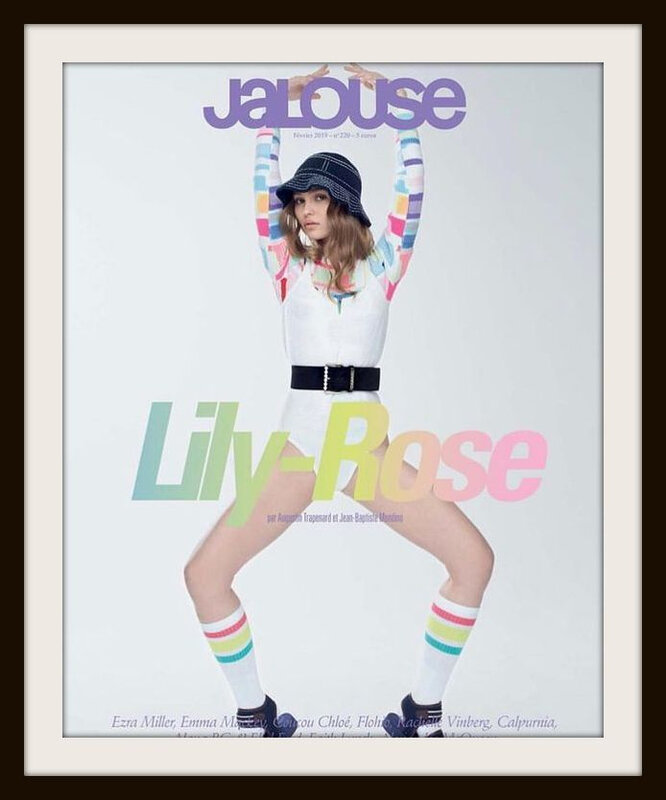

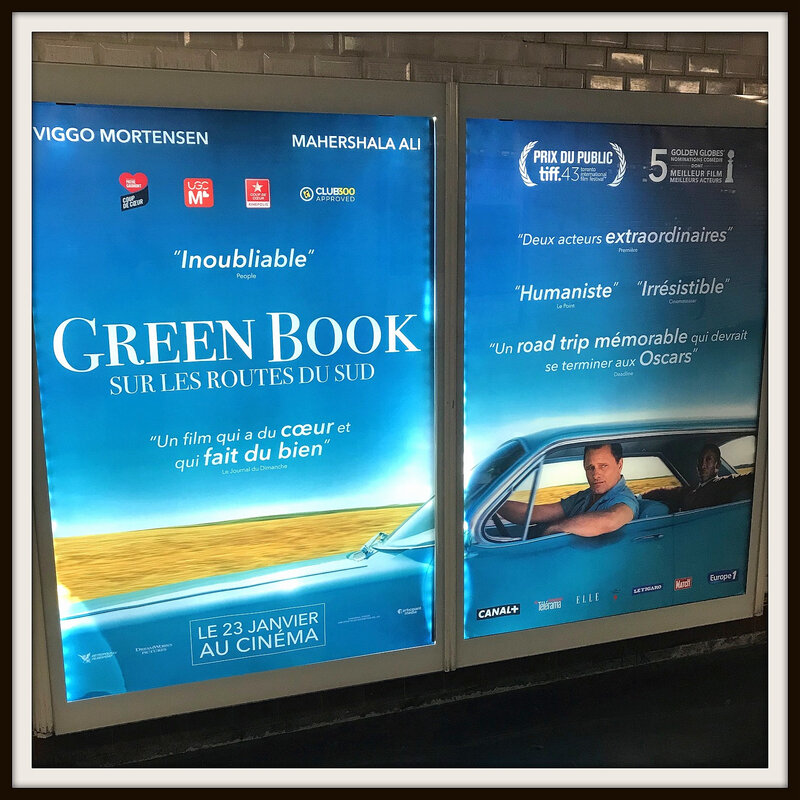




/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)