Mélenchon : «L’idéologie de Macron le paralyse devant les questions de survie collective»
INTERVIEW
Par Rachid Laïreche
Après une certaine retenue dans les premiers jours de l’épidémie, Jean-Luc Mélenchon repart à l’offensive contre le chef de l’Etat, qu’il estime «dépassé» par les événements. Le leader insoumis plaide pour un «déconfinement planifié» et remet en avant son programme présidentiel de 2017.
Jean-Luc Mélenchon tente de se faire entendre. Le chef des insoumis est persuadé qu’il a un «rôle à jouer» dans la période et que le monde d’après la pandémie se trouve entre ses mains, avec son programme «l’Avenir en commun». Alors il s’organise et il innove. Ce vendredi, le député des Bouches-du-Rhône est en meeting «numérique» afin d’esquisser le paysage devant ses troupes. En début de semaine, on s’est connecté sur Skype pour avoir un petit tour d’horizon.
Au début du mois de mars, lorsque la crise sanitaire a pris de l’ampleur, vous n’étiez pas très critique contre le gouvernement. Depuis, votre ton a changé…
J’adapte le ton aux circonstances. Je ne veux pas que les gens confondent notre opposition au gouvernement avec un appel à mépriser les consignes sanitaires. L’incohérence des décisions du président de la République n’aide pas. Exemple, le déconfinement hasardeux du 11 mai prochain. Nous proposons un déconfinement planifié. Pourtant pas question de créer un choc frontal qui aggraverait le chaos. C’est pourquoi nous avons tant insisté pour la continuité des travaux au Parlement. Nous voulons inscrire dans un cadre maîtrisé notre refus des mesures inacceptables du gouvernement, comme celles de la loi d’état d’urgence sanitaire. Pour autant, l’esprit public évolue vite en ce moment. Il faut nourrir cette évolution. On a inventé des espaces pour ça - des manifestations et meetings en ligne - notre commission d’enquête, des propositions de lois. Bref : le confinement sanitaire ne doit pas devenir un confinement politique.
Quel est votre rôle dans cette période ?
Ce qui se joue ce ne sont pas des bulletins de vote mais des vies humaines. Les insoumis font des propositions pratiques. Pour cela, nous sommes passés de la stratégie de conflictualité à celle des «causes communes». Par exemple, la réquisition de l’industrie textile. Pourquoi Emmanuel Macron n’en veut-il pas ? C’est un refus par idéologie.
L’opposition reproche de nombreuses choses au gouvernement, par exemple le maintien du premier tour des élections municipales. Alors que très peu de voix se sont élevées contre avant le scrutin…
Personne n’a demandé notre avis. Quand le Premier ministre annonce la veille du vote qu’il le maintient, j’ai eu le tort de croire qu’il avait évalué le risque. Certains insoumis n’étaient pas de mon avis, ils trouvaient la situation aberrante. Ils avaient raison. Emmanuel Macron tente tout le temps de nous impliquer. C’est manipulateur. Pour lui, l’unité d’action sanitaire, c’est l’union sacrée de type «silence dans les rangs». La majorité crée une mission d’information à l’Assemblée ? Nous n’avons eu le droit qu’à deux minutes de parole après deux heures trente de monologue. Dimanche, le Premier ministre me demande mon avis sur le déconfinement. J’y suis sensible. Mais pour quoi faire ? Rien. Et quand le Président vole nos mots mais refuse toutes nos propositions, je le vois comme un faussaire.
Le rôle du président de la République est-il de trouver un équilibre entre la crise sanitaire et économique ?
Non. La priorité, c’est l’être humain. Quels seront les bénéfices si 200 hospitaliers meurent parce qu’ils n’avaient pas de masques ? Ce n’est pas un projet économique d’ouvrir les entreprises pour que tout le monde y tombe malade ! L’humain est la richesse qui crée toutes les autres. Macron a été obligé d’en tenir compte. Après avoir dit hier que notre peuple était fait de «gaulois réfractaires» et de «riens», il énumère à présent dans ses discours les métiers sans lesquels la vie est impossible : éboueurs, caissières, égoutiers, infirmières… La liste des gens à qui il est contraint de dire merci n’en finit plus. Ceux-là ne doivent plus se laisser oublier.
Peut-être que le Président change de logique…
Vous parlez de celui qui refuse de rétablir l’impôt sur la fortune (ISF), même à titre provisoire ? Je n’y crois pas. C’est un libéral. Son idéologie le paralyse devant les questions de survie collective. Au nom de quoi choisir comme docteur celui qui vous a brisé les jambes ? Rappelez-vous Sarkozy en 2008. Il avait fait un discours gauchiste [référence au discours de Toulon, le 25 septembre 2008, ndlr] : c’était la fin du règne de l’argent roi. On a vu la suite.
A gauche, certains mots, que vous utilisiez, reviennent souvent actuellement, comme «souveraineté»…
Oui, nous sommes récompensés : ça paye de tenir bon sur les concepts essentiels. Du coup, Macron recommande qu’on ne se réfère pas à nos programmes d’hier. Il faudrait «tout réinventer». Comme s’il n’y avait eu aucune alerte depuis vingt ans, comme s’il n’y avait aucune proposition ces dernières années ! Par exemple notre programme «l’Avenir en commun». Combien ironisaient : c’était trop radical de parler de planification écologique ou de règle verte. Savent-ils que ces mots, nous les avions empruntés aux travaux des associations et des intellectuels qui les avaient produits auparavant ? L’ignorance et le mépris de tout ce travail ne valent pas amnistie ! Macron est dépassé. Les libéraux sont impuissants à régler les dégâts qu’ils ont provoqués. A chaque moment d’impasse du capitalisme, la civilisation humaine bifurque. Si le XXe siècle a débuté en 1914, le XXIe débute avec cette crise sanitaire. A plus forte raison avec le collapse du changement climatique. Une nouvelle hégémonie culturelle émerge : l’entraide plutôt que la concurrence libre et non faussée. La relocalisation plutôt que le déménagement permanent du monde. Le retour de l’Etat et des services publics sont impatiemment attendus.
Et sur la bataille des mots ?
Le mot «souveraineté» est enfin compris dans sa vraie dimension. Nos adversaires en ont fait une caricature : qui employait ce mot était un nationaliste, donc un partisan de la guerre. C’était une camisole de force qu’on tentait de nous mettre. A présent, chacun comprend que la souveraineté a un lien avec l’indépendance. Si nous sommes souverains sur le plan alimentaire et sanitaire, ça ne fait pas de nous d’horribles nationalistes mais des gens prudents qui, du coup, peuvent aussi aider les autres si besoin. Je reste lucide : si la vie n’était qu’une bataille de mots, nous l’aurions gagnée depuis longtemps. Mais c’est une lutte d’intérêts. Les puissants ne céderont jamais de bon gré. N’empêche : ils sont incapables de répondre aux besoins simples et concrets des gens. Or les révolutions ne sont pas déclenchées par des attentes idéologiques mais par des demandes concrètes. Ceux qui n’y répondent pas sont balayés.
Entre qui et qui se joue la bataille culturelle ?
Entre les libéraux et les collectivistes. Chacun pour soi ou tous ensemble ? Si tout se bloque, la main ira aux plus radicaux. S’il y a un espace de délibération démocratique, on peut avoir ce que je souhaite : une transition plus douce, plus organisée, plus méthodique. C’est pourquoi dans la situation actuelle, je ne suis pas partisan d’ajouter du chaos au chaos. Mme Le Pen est dans le frontal. C’est irresponsable de sa part. Pour nous, les insoumis, le chaos est le meilleur allié de la tentation autoritaire des gouvernements libéraux. Les mesures liberticides qu’accumule Macron le prouvent. Son monde d’après est déjà dessiné : pire qu’avant.
Pourquoi avez-vous remis votre programme «l’Avenir en commun» en débat ?
Certains prennent la plume pour des tribunes, d’autres veulent organiser des colloques sur le monde d’après. Ce bouillonnement est fertile. Mais la vie des sociétés est faite aussi d’enjeux concrets à gérer. Notre programme propose un chemin gouvernemental. On veut dire quelque chose de fort : on peut commencer à changer le monde demain matin si vous voulez.
La période modifie-t-elle les rapports entre vous et le reste de la gauche, les communistes…
(Il coupe) Non, les communistes, c’est différent, c’est la même famille ! Le ton monte parfois mais à l’Assemblée nationale ou au Sénat, il faut gratter fort pour trouver les différences. Ecologiquement, ils ne sont pas très allants mais ils avancent, ils bougent. Le problème à gauche n’a jamais été de ce côté pour nous.
Il est où le problème, côté Parti socialiste et écolos ?
Je leur ai tendu la main à deux reprises dans vos colonnes. Pour rien. Leur sectarisme est consternant. Vont-ils évoluer ? Ce n’est pas un problème psychologique. On voit leur contradiction : combien parmi eux espèrent encore échapper à la radicalité de l’opposition entre le monde libéral et celui qu’il faut construire ? Quand ont-ils dit un mot de regret à propos de ce qu’ils ont fait à l’hôpital public quand ils étaient au pouvoir ensemble ? Voyez-les signer en commun des tribunes avec des multinationales et des ministres de droite ! On verra leur choix final. Nous, on ne lâchera rien. Car le plus important est dans la société dans laquelle je vois un ample parti sans murs : dégagiste, social-écolo, humaniste. Beaucoup ont cru suffisant de me caricaturer pour disqualifier notre projet. En vain. On le prend par le bout qu’on veut : sept millions de voix pour notre programme [en 2017], ça crée une espérance durable. Certes, chacun doit faire des efforts pour fédérer le peuple et construire une majorité politique. Mais ce sont d’abord des efforts de clarté.
Jeudi, dans une lettre publiée sur le site du JDD, Julien Bayou, secrétaire national de EE-LV, vous accuse, entre autres, de «creuser le tombeau de l’alternative».
«Entre autres», en effet. Je déplore le ton insultant pour répondre à ma question qui ne l’était aucunement sur l’union nationale. Mais je me réjouis qu’il renonce à son «Grenelle du monde d’après» sous la houlette du Premier ministre. Heureux que les Verts français refusent la ligne de leurs homologues allemands et autrichiens, adhèrent à l’idée de VIe République, renoncent à une alliance mondiale avec les firmes transnationales à l’inverse de leurs députés européens… Sur mon blog, j’avais pourtant dit que je voyais «des éléments constructifs dans son propos». Dois-je le regretter ? Quelle arrogance ! Est-ce lèse-majesté que de demander une précision à Julien Bayou quand il nous propose de nous réunir avec Edouard Philippe ? Pour détendre l’atmosphère avec un peu d’humour, je lui recommande d’envoyer sa tribune à Yannick Jadot, à qui elle s’adresse plus souvent qu’à moi.
La semaine passée, vous avez salué l’interview d’Arnaud Montebourg dans les colonnes de Libé…
Il a envoyé une carte postale au bon moment. Il aide à construire un nouveau fond de scène. Pour moi, c’est un renfort très précieux.
Dans la période actuelle, qui trouve grâce à vos yeux ?
Ce n’est pas mon sujet. Je sais que nous allons à la rencontre d’événements exceptionnels. Je me concentre. Je mobilise tout ce que j’ai appris au cours de ma longue vie d’engagement politique : prendre le pouls, sentir le moment, repérer les seuils, relier au savoir historique. Je sais que les insoumis ont un rôle à jouer. Nous ne sommes pas juste des commentateurs, nous voulons ouvrir une issue historique à la crise de la civilisation. C’est notre responsabilité. Les moments terribles où tout est remis en cause n’arrivent pas souvent dans l’histoire. Aujourd’hui, chacun est mis au pied du mur de ce qu’il est, et de ce qu’il est capable de faire. L’histoire est une chance ou une déchiqueteuse.






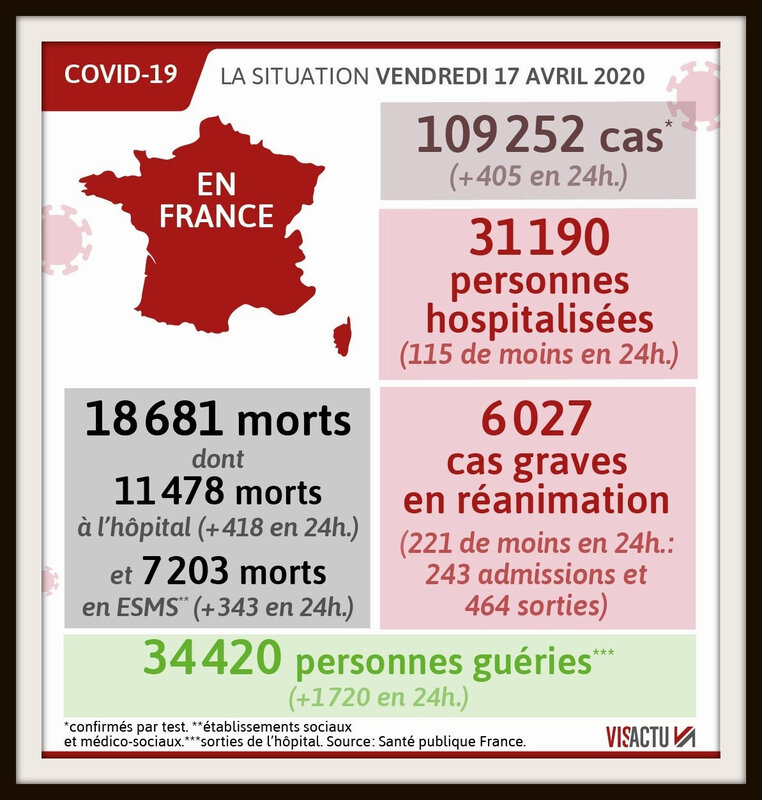




/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)