Vu d'Afrique - Quand les infox se propagent aussi vite que le virus
DER SPIEGEL (HAMBOURG)
La peau noire protège-t-elle du Covid-19 ? La chaleur empêche-t-elle la maladie de prospérer ? Avec la pandémie, une épidémie de fake news se sont répandues en Afrique. Avec, parfois, des conséquences graves.
Cet ami du Ghana était plein de bonnes intentions : sur WhatsApp, il m’a envoyé huit photos, accompagnées d’un petit mot : “Prends bien soin de toi.” Sur chaque image, il y avait un texte blanc sur fond gris. Le premier : “Quand le virus est exposé à une température supérieure à 26 ou 27°, il meurt. Le Covid-19 ne survit pas dans les régions chaudes.” Et qu’importe que cela ne soit pas scientifiquement prouvé. Mon ami ajoute un petit tuyau aussi peu vérifié : “Il y a un autre truc : il faut boire de l’eau très chaude et s’exposer au soleil. Il est conseillé d’éviter les glaces et les plats froids.” Au-dessus, on lit : “Unicef” [l’agence des Nations unies pour les droits des enfants].
Pleines de conseils bidon, les fake news se répandent aussi vite qu’un virus en ce moment. Ces “infodemic”, comme les appelle l’Organisation mondiale de la santé, sont une épidémie qui demande une riposte considérable en parallèle à la lutte contre le coronavirus. Les organisations mondiales ne peuvent pas se concentrer sur l’aide aux seules régions en crise, elles doivent en plus se battre pour leur crédibilité. “La lutte contre ces fausses informations demande beaucoup de temps”, déplore Sandra Bisin, 42 ans, porte-parole de l’Unicef en Afrique occidentale et centrale.
Le monde numérique nous permet souvent de toucher beaucoup de gens. C’est justement ça qui est dangereux, car cela donne à d’autres la possibilité de semer la panique sur les réseaux sociaux.”
Des tweets tueurs de mythes
L’Unicef s’efforce de démonter les rumeurs par des tweets et des vidéos “tueuses de mythes”. L’organisation a installé en Côte d’Ivoire un centre d’information sur le coronavirus grâce auquel on peut obtenir des informations vérifiées sur les symptômes, la prévention et le traitement de la maladie – entre autres par SMS. Il suffit pour cela d’envoyer le code “CORONA”.
Quatre cent mille personnes ont déjà eu recours à ce service. Comme certaines autres organisations, notamment l’OMS, ce centre d’information collabore aussi avec Facebook, Instagram, Twitter et TikTok pour tenter d’endiguer le flux quotidien de fake news. Mais si les réseaux sociaux suppriment en permanence de fausses informations, cela ne veut pas dire pour autant qu’elles disparaissent complètement.
Au Ghana, plusieurs clubs et restaurants ont affiché les pseudo-conseils de l’Unicef sur leurs murs pour rassurer les clients. Quand ces fausses informations sont transmises par une personne de confiance et considérées comme vraies, elles se propagent souvent rapidement par le bouche-à-oreille. “Les informations erronées sont extrêmement dangereuses”, déclare Sandra Bisin. Elles constituent même une menace grave en Afrique.
La chaleur, protection contre le virus?
Jusqu’à présent, le continent comptait relativement peu de cas déclarés par rapport au reste du monde. Même si de nouveaux malades sont détectés tous les jours et qu’un nombre toujours plus important de pays est touché, on se demande si le Covid-19 ne se répandrait pas moins rapidement sous ces latitudes. Ou si, simplement, la détection y est moins bonne qu’ailleurs. Mais alors que les experts parlent d’une lutte contre le temps pour empêcher la propagation du virus, les rumeurs infondées n’aident pas.
L’une des plus dangereuses, c’est celle qui soutient que la chaleur africaine protège de l’infection ou ne permet pas au Covid-19 de survivre. Ce n’est absolument pas prouvé, mais c’est ce qu’affirment plusieurs fake news. Y croire, c’est alors faire fi des mesures de bases : oublier de se laver soigneusement les mains, ne pas éviter les rassemblements.
Autre idée tenace : les Noirs seraient immunisés contre le Covid-19. Alors que les premiers malades du Covid-19 en Afrique étaient des personnes qui venaient d’arriver d’Italie, d’Allemagne, de France, de Norvège, de Turquie, d’Inde et bien entendu de Chine, dans les rues du Ghana on ne lance plus “obruni”, un ancien mot akan qui signifie “blanc”, aux étrangers. On leur dit : “Corona, go home !” Et ce n’est pas censé être drôle. La colère contre les Blancs – alimentée par les réseaux sociaux – grandit : les gens sont convaincus que ce sont eux qui ont apporté le Covid-19 en Afrique.
Il n’y a pourtant aucune preuve scientifique que la “peau noire” ou les “gènes” africains protègent contre le coronavirus, comme l’affirment certains vidéos et messages. Cette idée peut avoir des conséquences fatales. Les personnes présentant des symptômes comme le mal de gorge, la toux, la fièvre ou le rhume sont priées par les ministères de la Santé de nombreux pays africains d’appeler une hot-line et de rester chez elles, où on viendra les tester si besoin. Il est donc important que les intéressés comprennent qu’ils sont à risque. Or comment cela peut-il être le cas s’ils sont persuadés d’être protégés par la couleur de leur peau ou leur origine ?
Poussée xénophobe
“Avec ces histoires, nous aurons bientôt d’autres problèmes”, déclare David Ajikobi. À 37 ans, ce journaliste travaille pour Africa Check, une organisation à but non lucratif dont le siège est en Afrique du Sud et qui compte quatre bureaux, dont un au Nigeria. Son site Internet démonte les fake news en permanence. Ajikobi a commencé à y travailler en 2016, il a été le premier au Nigeria à en faire un emploi à plein temps. “Après la détection d’un cas de Covid-19 au Nigeria le 28 février, le premier de l’Afrique subsaharienne, il y a tout de suite eu une foule de rumeurs en ligne”, ajoute-t-il. La densité de sa population fait que ce pays, le plus peuplé d’Afrique, est particulièrement menacé si l’épidémie de Covid-19 se propage.
“Les Chinois font déjà l’objet de discriminations, explique-t-il. On raconte qu’ils ont délibérément créé le coronavirus pour nuire, qu’ils sont sales et qu’il ne faut pas les approcher. Et les rumeurs ne s’arrêtent pas là. Tout d’un coup, c’est la faute du voisin chrétien, ou musulman, ou d’une autre tribu, ou de celui qui ne parle pas la langue locale.” Même si beaucoup de gens n’ont pas les moyens de s’acheter un smartphone ou des minutes de connexion à Internet, les fake news se répandent extrêmement vite, notamment parce que les stations de radio locales s’en saisissent et les annoncent à l’antenne. “Des millions de personnes entendent sans filtre les bêtises que quelqu’un a partagées avec ses connaissances”, déplore-t-il.
Africa Check a développé une messagerie automatique sur WhatsApp. Ce système de dialogue fondé sur les SMS s’appelle “Kweli” – “vérité” en kiswahili. On peut lui envoyer des informations à vérifier. Ajikobi ne s’efforce pas seulement de démonter le plus de fausses informations possible et de mettre les résultats sur les réseaux sociaux. Il organise également des ateliers pour former des journalistes, des étudiants et des travailleurs sociaux à mettre en question les informations, à ne transmettre que celles qui ont été vérifiées et à demander aux gens de se faire aider. David Ajikobi conclut :
Le gros problème ici, c’est que personne ne veut être celui qui a introduit le Covid-19 dans son village. Sinon, le village est fou de rage et te chasse. C’est pour ça que beaucoup de gens qui présentent les symptômes du Covid-19 ne se signalent pas auprès des cellules d’urgence. Ils préfèrent suivre des traitements obscurs dont ils ont entendu parler Dieu sait où.”
Anne Backhaus










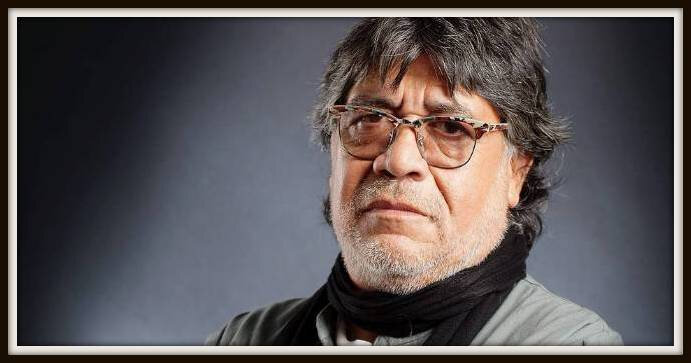

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)