Le patron du « New York Times » dénonce la « rhétorique anti-presse » de Donald Trump
Le président américain a révélé avoir discuté des « fausses informations » avec le directeur du quotidien new-yorkais. M. Sulzberger a fait valoir son inquiétude en retour.
Il ne devait sûrement pas s’y attendre, mais Donald Trump l’a contraint à prendre la parole et à assumer. Le patron du prestigieux quotidien américain New York Times a révélé, dimanche 29 juillet, avoir vigoureusement mis en garde Donald Trump sur ses attaques répétées contre la presse lors d’une rencontre à la Maison Blanche, qualifiant son discours sur les « fake news » de « dangereux et nuisible ».
C’est le président américain lui-même qui avait révélé, un peu plus tôt dans un tweet, avoir discuté de fausses informations avec Arthur Gregg Sulzberger, directeur de la publication du New York Times, que M. Trump prend régulièrement pour cible de ses critiques.
« Nous avons passé beaucoup de temps à parler de la quantité de Fake News qui sont publiées par les médias et comment ces Fake News se sont métamorphosées en une phrase, “Ennemi du peuple”. Triste ! »
Donald Trump qualifie régulièrement de « fake news » (fausses informations) les médias généralistes américains qui, pour la plupart, se montrent très critiques sur sa présidence. Ce tweet a conduit M. Sulzberger à publier un communiqué sur cette rencontre, qui était supposée rester confidentielle, comme toutes les réunions que les dirigeants des grands médias américains ont régulièrement avec les responsables du gouvernement.
Des attaques « dangereuses et nuisibles »
Le patron de 37 ans a précisé avoir rencontré le président septuagénaire le 20 juillet, à la demande de la Maison Blanche, accompagné du responsable des éditoriaux du journal, James Bennet. Il a ajouté avoir décidé de répondre publiquement au tweet de M. Trump, en se basant sur les notes détaillées prises par James Bennet et lui-même, après la façon dont le président américain a évoqué leur conversation.
« Mon objectif principal en acceptant cette rencontre était de soulever mes inquiétudes au sujet de la rhétorique anti-presse extrêmement troublante du président », a expliqué celui qui a succédé début 2018 à son père, Arthur Ochs Sulzberger, comme directeur de la publication du Times. « J’ai dit franchement au président que je pensais que son discours n’était pas seulement facteur de division mais qu’il était de plus en plus dangereux », a-t-il ajouté dans ce communiqué.
« Je lui ai dit que bien que l’expression “fake news” soit fausse et nuisible, j’étais beaucoup plus préoccupé par sa façon de caractériser les journalistes comme des “ennemis du peuple”. »
« Je l’ai prévenu que ce langage incendiaire contribuait à une augmentation des menaces contre les journalistes et allait inciter à la violence », a poursuivi le patron du Times, précisant avoir insisté sur le fait que « c’est particulièrement vrai à l’étranger ». « La rhétorique du président est utilisée par certains régimes pour justifier des répressions d’ampleur contre les journalistes », a-t-il encore dénoncé.
« Je l’ai imploré de revenir sur ses vastes attaques contre le journalisme, que je pense être dangereuses et nuisibles pour notre pays », a ajouté M. Sulzberger, tout en précisant que le président américain avait bien sûr le droit, comme ses prédécesseurs, de critiquer la façon dont la presse relate son action.
Les diatribes habituelles de Trump contre la presse
Le New York Times fait partie des médias les plus souvent attaqués par Donald Trump, avec notamment la chaîne CNN et le Washington Post, propriété du patron d’Amazon, Jeff Bezos. Le président américain l’a qualifié de « défaillant et corrompu », « quasi-lobbyiste » et « partial », ou encore de « vraiment l’un des pires journaux », ayant « la plus imprécise couverture ».
Les diatribes contre la presse font partie du cocktail idéologique de Donald Trump, qui cherche à décrire des élites, dont la presse, éloignées des préoccupations du pays. Une polémique a opposé la semaine dernière CNN à la présidence américaine, qui avait refusé à l’une de ses journalistes l’accès à la Maison Blanche pour une conférence de presse du président américain et du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
Le New York Times occupe cependant une place à part pour Donald Trump. Né à New York, ville où il a construit son succès dans les affaires, c’est probablement le journal qu’il connaît le mieux. C’est à lui aussi qu’il avait accordé l’une de ses premières grandes interviews peu après son élection.





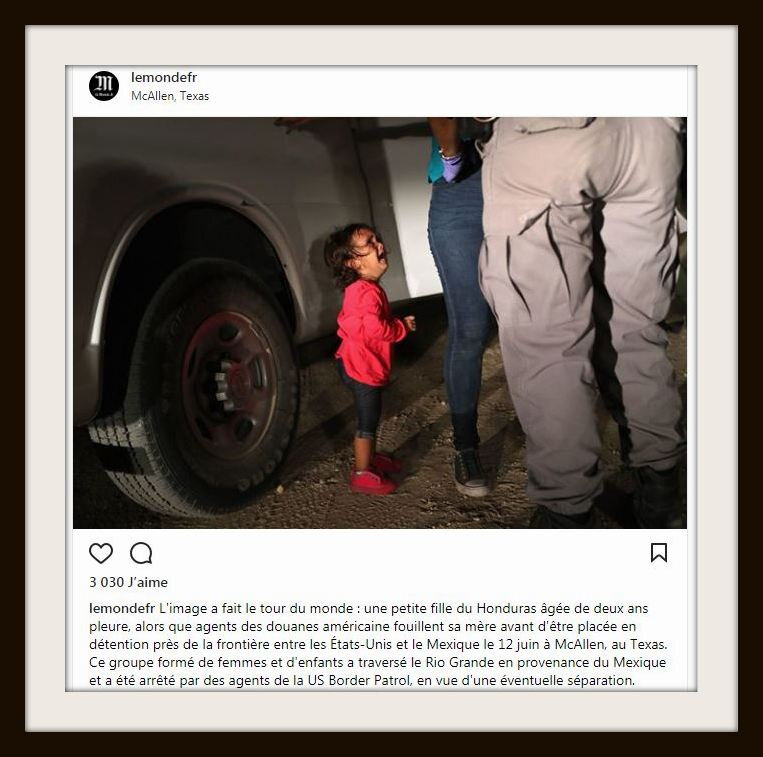





/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)